
Reconnaissance
Le nom de Joseph Czapski, autant que son exceptionnelle destinée, son œuvre de peintre et ses écrits restent aujourd’hui relativement méconnus en Europe et dans le monde, si l’on excepte quelques cercles de fervents amateurs en Suisse et en France, et bien sûr en Pologne où il fait pour ainsi dire figure de héros national mais sans que son œuvre de peintre n’ait vraiment été, jusque-là, évaluée à la hauteur qui est la sienne. Est-il exagéré de parler de méconnaissance à propos de la réception de l’œuvre de Joseph Czapski par les milieux de l’art européen de la deuxième moitié du XXe siècle, et particulièrement en France, s’agissant autant des spécialistes plus ou moins avérés du « milieu » que des relais médiatiques ?
Je ne le crois pas, et ne prendrai qu’un exemple pour l’illustrer en consultant l’ouvrage, visant les amateurs supposés avisés, autant que le grand public, intitulé Dictionnaire amoureux de l’Art moderne et contemporain et signé Pierre Nahon, lequel dirigea la galerie Beaubourg et passe pour un connaisseur avéré. Or l’index des noms cités dans ce « dictionnaire » de plus de 600 pages ne réserve aucune place à Czapski , alors que des pages entières sont consacrées à certains des pires faiseurs dûment consacrés par le Marché et les médias aux ordres, mais pis encore : par ceux-là même qui, dans les institutions les plus officielles, seraient censés défendre l’art vivant dont Joseph Czapski, même tout modestement dans sa soupente, fut un représentant combien plus significatif que le très indigent Jeff Koons concélébré de Versailles à Beaubourg.
Cela étant, il serait faux de conclure à l’injustice absolue qu’aurait subie Czapski, d’abord parce que les signes de reconnaissance réelle se sont bel et bien manifestés de son vivant, et ensuite du fait même de son humilité fondamentale et de son refus instinctif de participer à quelque forme que ce soit d’inflation publicitaire.
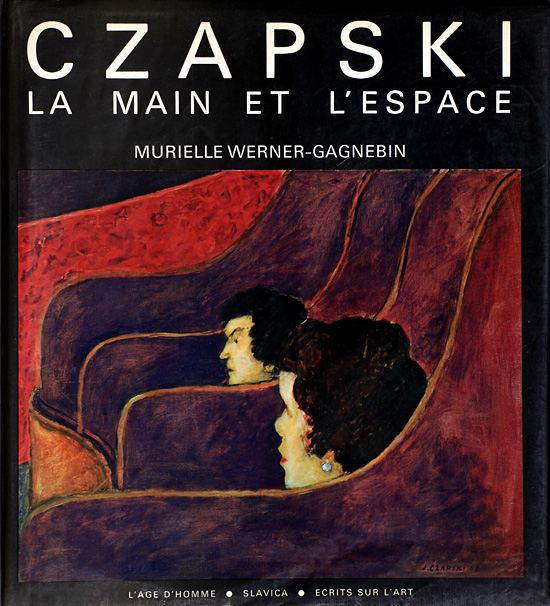
Quelques livres, en outre, et depuis une quarantaine d’années ont amorcé la défense et l’illustration de l’œuvre du Czapski peintre en ses divers aspects, à commencer par l’ouvrage de Murielle Werner-Gagnebin, publié en 1974 à L’Âge d’Homme sous le titre de La main et l’espace. Combinant un premier aperçu substantiel de la vie et des vues du peintre à travers les années, en historienne de l’art mais aussi en amie recueillant les propos de l’artiste en son atelier, l’auteure genevoise s’attacha particulièrement à la question du «cadrage» caractéristique d’une partie des tableaux de Czapski, signalant l’originalité de son regard.
Tout autre devait être l’approche, en 2003, de Wojciech Karpinski, dans un Portrait de Czapski élargissant et approfondissant, sous ses multiples facettes, la découverte d’un univers à la fois intellectuel et artistique, notamment à la lumière du monumental Journal rédigé quotidiennement par l’exilé de Maisons-Lafitte.
Dans la même veine de l’hommage rendu par des proches, amis eux aussi de Czapski, s’inscrivent les témoignages de l’écrivain Jil Silberstein, dans ses Lumières de Joseph Czapski datant de 2003, incarnant ici le jeune poète à l’écoute d’un aîné de constante disponibilité, et de Richard Aeschlimann, avec ses Moments partagés, paru en 2010, s’exprimant en sa double qualité d’artiste éclairé par sa pratique personnelle autant que par d’innombrables conversations, et de galeriste défenseur du peintre avec une fidélité sans partage.

Enfin, et tout récemment, une façon de miracle comme il s’en produit parfois dans les sphères qu’on pourrait dire des passions partagées, a vu paraître la première grande biographie, aussi fouillée que nourrie de réelle admiration affectueuse, conçue par le peintre américain Eric Karpeles , tellement impressionné par la figure et l’art de Joseph Czapski qu’il a multiplié, pendant des année, les recherches sur le terrain ponctuées de rencontres, en Pologne ou en Russie, pour aboutir à deux ouvrages monumentaux, à savoir : Almost nothing, traduit en français en 2010 sous le titre de Presque rien, et le tout récent Apprenticeship of looking marquant, devant la peinture de Czapski très amplement détaillée, dans un ouvrage somptueusement illustré. la reconnaissance d’un artiste contemporain à son pair disparu.
Apparition

La premier tableau de Czapski que j’ai acquis dans ma vingtaine, représentant six poires cernées de noir sur fond rouge carmin, daté de 1973 mais faisant d’emblée, à mes yeux, figure d’icône profane intemporelle, m’a suivi partout, à travers les années, après qu’il me fut apparu, comme une nouvelle réalité m’est apparue par le regard de Czapski dont je ne cesse de me répéter ce qu’il m’a inspiré dès qu’il m’a été donné de découvrir un premier ensemble de ses œuvres, à savoir que ce que je vois me regarde, et c’est cela que j’aimerais à mon tour, sous le signe de la reconnaissance, m’efforcer d’exprimer.
Le monde nous regarde, les gens que nous voyons nous regardent, les objets nous regardent – mais regarder n’est pas seulement voir, c’est garder avec soi, prendre avec.
Tel étant le premier enseignement que j’ai tiré en découvrant la peinture de Joseph Czapski. Mais comment définir celle-ci ?
Czapski néo-impressionniste ? Czapski plutôt expressionniste ? Czapski aux dessins plus proches d’un Daumier que d’un Delacroix ? Czapski peintre du quotidien ? Czapski témoin des gens humbles et des oubliés de la société ? Czapzki paysagiste tendant à l’abstraction lyrique ? Czapski spectateur ou metteur en scène de quel « théâtre du monde » ?
À vrai dire, chacune de ces appréciations pourrait se justifier par rapport à tel ou tel moment, à tel ou tel aspect, à telle ou telle solution apportée par l’artiste à tel ou tel problème rencontré au fil de sa quête, mais séparer celle-ci en « périodes », plus ou moins en résonance avec les mouvements se succédant au XXe siècle, me semble artificiel et par trop académique alors qu’une instance permanente, à caractère ontologique, fonde assurément l’unité de sa démarche d’artiste et d’homme pensant et agissant, qu’on pourrait dire l’attention vive à cela simplement qui est.
La véritable situation de Joseph Czapski, me semble-t-il, est celle d’un veilleur posté au cœur de l’être. L’apparition de six poires sur un guéridon, disposé lui-même devant l’espèce de toile de fond dont le rouge évoque un rideau de théâtre, ne relève évidemment en rien, dans sa finalité essentielle, de l’ornement conventionnel destiné à je ne sais quel salon bourgeois, même si l’objet en question n’exclut aucun usage d’aucun usager, que celui-ci fût un notaire fortuné, une avocate au goût personnel ou un jeune bohème de ma sorte…
L’apparition en question procède d’un noyau, me semble-t-il, qui nous permet, le touchant, de toucher en même temps tous les points de la circonférence et donc tous les aspects de la vie et de la quête artistique de Czapski.
Le motif de l’apparition vaut pour tous les aspects de la représentation du monde que nous propose Czapski, qu’il s’agisse de natures mortes, de paysages de portraits, de scènes de rue ou de cafés, mais on pourrait dire aussi que la vision de l’homme, ou de l’enfant, du soldat, de l’exilé, est à l’origine première, sous le choc émotif de la surprise, de cette apparition ensuite ressaisie et modulée par le jeu des formes et des couleurs. Au début était l’émotion, pourrait-on dire, fondant un regard avant d’être réinvestie en objets qui nous regardent.
Tout noter
Tout noter aura été, durant tant de décennies tragiques (révolutions, guerres, déportations, massacres, tentatives de témoigner, déceptions, tentation de désespérer, exil, confusion du nouveau monde) le souci constant de Czapski malgré l’âge, le fil d’or, le devoir de tous les jours, la mission, et le plaisir s’il vous plaît, le bonheur que c’est d’écrire et de dessiner, de peindre et de zigzaguer sur son bicycle entre les voitures d’aujourd’hui et de demain…
Or que voit-on, sans en déchiffrer le texte en langue polonaise et partant souvent en tous sens, et que nous disent ces croquis hâtifs, souvent incrustés dans le texte, ces esquisses de portraits, ces notations paysagères ou ces début de compositions plus élaborées indiquant peut-être, ici et là, une intention de tableau ?
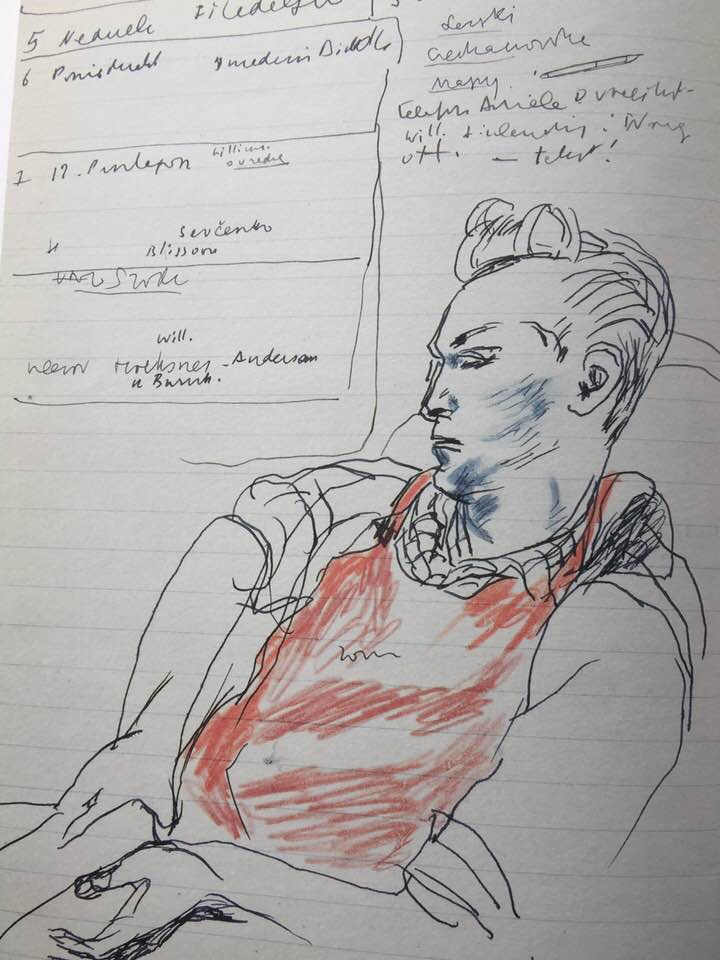
Ce qu’on voit, et qu’on retrouvera maintes fois, est par exemple le portrait d’un homme endormi. Ou c’est ce groupe de personnages, probablement des soldats au repos, à moitié nus, autour d’une table. Ou c’est ce tendre visage d’adolescent, au modelé très délicat. Ou ces croquis d’oiseaux. Ou cette esquisse de paysage devant un sphinx égyptien, sans nulle recherche de pittoresque comme pour dire : j’étais là, telle chose m’apparut. Et ce que nous disent ces dessins ponctue en somme ce que nous disent de leur côté les textes, ceux-là publiés, évoquant la même époque, que ce soit dans les fragments de L’œil, dans les récits « historiques » de Tumulte et spectres ou dans les Souvenirs de Starobielsk dont l’édition française datant de 1987, reproduit des dessins datant de sa captivité en 1941.
Ce que je constate dans ces dessins est que la main de Czapski, comme une voix ou comme un regard personnel, produit un dessin qui n’est qu’à lui, comme la main de Delacroix ou la main de Daumier, la main de Bonnard ou la main de Cézanne. Le dessin est une signature, qu’il soit tout spontané ou « pioché ».

Ce qui apparaît à tout coup, en outre, c’est que le dessin de Czapski n’est jamais académique, même quand il se fait plus élaboré dans les études de mains ou le portrait de tel camarade de captivité dans son journal de prisonnier. Czapski, jamais pittoresque non plus dans ses évocations «orientales» de la période du grand transit de Russie en Irak et en Egypte, ne donne jamais dans le dessin décoratif ou trop joli.
Le dessin de Czapski saisit la vie au vol dans son mouvement, et c’est le trait correspondant au bond dont le peintre parlera souvent, par opposition à l’absorption plus lente et statique du dessin pioché, mais à chaque fois le coup d’œil saisit tel ou tel détail, telle ou telle expression d’un visage, telle ou telle posture d’un personnage, et parfois telle ou telle lumière indiquée.

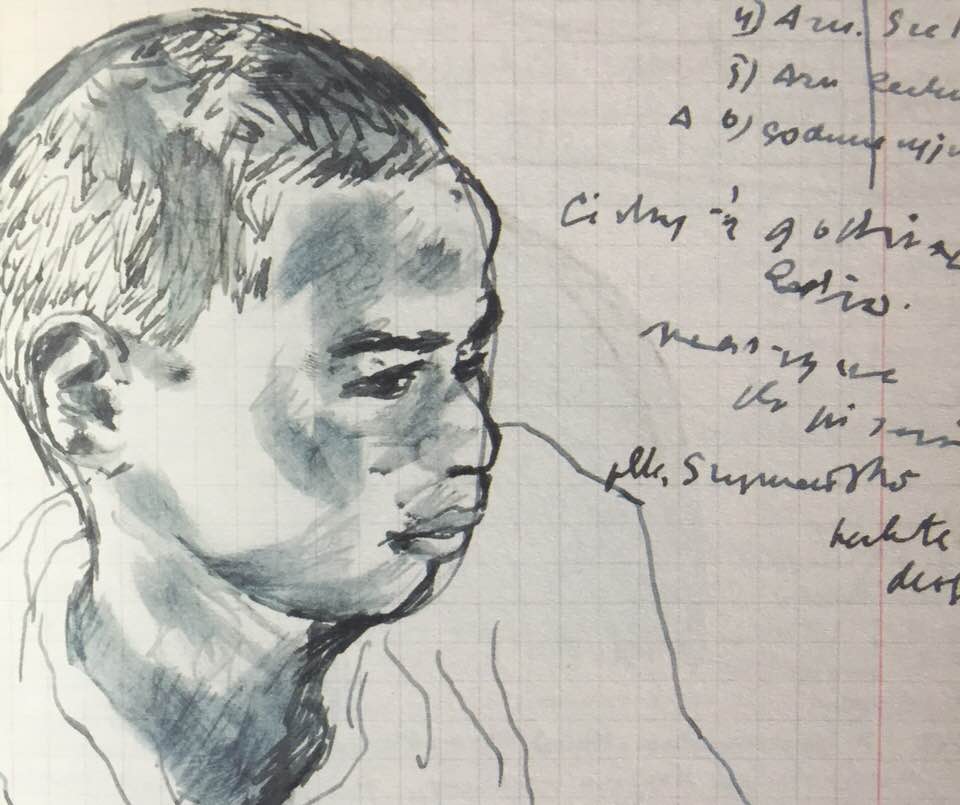

Joseph Czapski lui-même a souvent insisté sur le caractère imparfait de sa technique à telle ou telle période, en invoquant une évolution «dans le temps», quitte à se montrer excessivement, voire injustement sévère envers lui-même, et souligner ce qu’il y aurait de chronologique et sagement linéaire dans ses «progrès ».
Or il me semble que les dessins disent autre chose, dont la note est aussi juste dans ce que nous en connaissons de plus ancien, que vingt ou cinquante ans plus tard, comme s’il, y avait là un donné, une donnée, un don qu’il faut distinguer, sans doute, de la virtuosité «de naissance», de ceux-là qui dessinent à dix ou quinze ans « comme des dieux », relevant alors d’un aisance naturelle talentueuse, voire facile.
Ce que je veux dire, c’est que les premiers dessins de Czapski que nous connaissons, comme les quelques copies miniatures de ses anciennes toiles détruites recomposées de mémoire dans son journal après leur destruction dans les bombardements, loin de nous renvoyer aux tâtons d’un peintre de second ordre, comme certains le considéraient alors, traduisent déjà une vision tout à fait particulière qu’on peut dire propre à Czapski.
Or c’est le même constat, découlant de l’unicité d’un regard et d’une «voix», qui s’impose au fur et à mesure que l’on découvre, dans l’ordre chronologique cette fois, les dessins du Journal. De nombreux « thèmes» sont déjà là, qui seront repris ultérieurement dans l’élaboration de certaines « séries », si tant est que ces termes soient opportuns dans la démarche si peu systématique de l’artiste.
L’abîme et les mimosas
Lors d’une de nos premières rencontres, après que j’eus découvert sa peinture et lu Terre inhumaine, quelque peu mal à l’aise en mon inconsistante peau de garçon de vingt-sept ans, je dis à Czapski, comme beaucoup d’autres l’auront fait sans doute avant moi, que je trouvais stupéfiant que son récit de si terribles péripéties fût dénué de tout pathos, et que s’y trouvent même maints détails parfois cocasses, et surtout que lui-même soit revenu du bout de la nuit sans céder à aucune asthénie, plein de vigueur et même de joie communicative alors qu’il aurait eu tout lieu de désespérer…
Alors lui de me répondre en me prenant par les épaules à deux mains et de me secouer même un peu : « Mais mon cher, figurez-vous que j’ai été beaucoup moins malheureux, dans les camps, que lorsque, à votre âge, je souffrais du mal d’amour ! »
Et d’évoquer la fraternité dans l’infortune, la solidarité rapprochant ces frères de captivité soumis aux mêmes vexations sans considération de leurs statut social ou de leur grade, enfin ce ressaisissement collectif qui fait se rapprocher les humains confrontés à la même épreuve, et ce sursaut de dignité, cet effort commun de ne pas se laisser aller à la désespérance, qui donnerait en somme raison aux tortionnaires, et qui se traduit le mieux par ce lambeau de lumière arraché aux ténèbres que représente Proust contre la déchéance, et l’ensemble des Souvenirs de Starobielsk et de Tumulte et spectres, où la vie des gens, telle foule en prière dans une vaste cour, tel jeune médecin américain s’initiant à la poésie polonaise, tels autres étudiants ou adolescents soldats promis à la fosse commune se trouvent emportés dans une masse de faits dont émerge ici le visage d’un dormeur, deux amoureux éplorés, un enfant tenant la main de sa maman en manteau rouge.
Joseph Czapski a vu et connu ce dont je n’ai idée que par ce qu’il en a écrit ou ce qu’il figure, jamais de manière directe, par ces reflets de l’abîme que sont les regards perdus des personnages de sa peinture dont je dirai, maladroitement, qu’ils ne sont pas peinte mais simplement qu’ils sont. Je perçois ces abîmes, je perçois sa révolte contre le monde, contre Dieu, contre les hommes, contre ses rides et contre la paralysie gagnant le corps de son jeune ami Jean Colin, je passe tous les matins devant la deuxième toile que nous avons acquise, avec Lady L. cette fois, il y a une dizaine d’années, elle-même datant de 1985 et s’intitulant Mimosas, dernière image volée à l’abime de la cécité : après les graves poires de 1973, la joie des mimosas de 1985, huit ans avant 1993 – et tel soir je me serai retrouvé au bord de l’abîme en me projetant le film Katyn d’Andrzej Wajda, ami de Czapski et se faisant ici le témoin du témoin.
J’ai donc vu, ce soir-là, les corps tomber les uns après les autres dans la fosse, après les balles tirées à bout portant dans chaque tête, et j’ai revu le vieil homme dans sa mansarde de Maisons-Laffitte, à la fin des années 70, qui pleurait pendant que je lui lisais des pages de Nuits florentines.
Ensuite le film de Wajda m’a laissé comme abattu, physiquement lessivé, sans voix. Je savais pourtant à peu près tout de Katyn, et d’abord de vive voix par Czapski, avant même la lecture de ses livres; je savais que tout ce qui était raconté là s’était réellement passé. Je le savais par l’esprit, mais le cinéma parle au corps, les images parlent aux sens et aux nerfs, le matraquage est réel, physique, et le fait est qu’il m’a semblé vivre ce soir dans mon corps, tout bien assis dans mon fauteuil que je fusse, l’atroce fin de ces hommes massacrés l’un après l’autre par les sbires de Staline.
Une fois encore, je savais pour l’essentiel ce que signifiait le nom de Katyn et tout ce qui l’entourait, bien au-delà du seul charnier désigné par ce nom. Je savais tout ce que, désormais, tout quidam soucieux d’en savoir plus sur cette « tragédie parmi d’autres » survenues entre 1939 et 1945 peut savoir: je connaissais le détail de la manipulation soviétique et l’opération de propagande longtemps entretenue en France et en Occident, visant à attribuer le massacre aux nazis. Je savais les circonstances de ce crime de masse occulté et comment, par exemple, le major-général du NKVD Vassili Mikhailovitch Blokhine en personne, vêtu d’un tablier de boucher et armé d’un pistolet allemand Walther PPK, avec l’aide de deux exécuteurs fameux, les frères Ivan et Vassili Jigarev, « traita » 7000 hommes en 28 nuits pendant que des millions de pères de famille soviétiques (présumée bons) crevaient sur le front de la même mort que des millions de pères de famille allemands (présumés méchants), et je revoyais Joseph Czapski, dont une partie de la vie avait été consacrée à rétablir la vérité sur l’assassinat des 25.000 officiers et étudiants polonais assassinés par les Soviétiques, qui pleurait ce jour-là sur une page des Nuits florentines de Heinrich Heine que je lui lisais dans sa modeste soupente où voisinaient ses toiles récentes et les centaines de carnets reliés de son légendaire journal constitué de 270 volumes.
Les bras réunis autour de ses immenses jambes pliées, ses immenses mains jointes comme pour une prière, la voix haut perchée d’un vieil enfant, Czapski m’avait donc demandé de lui lire deux ou trois pages des Nuits florentines que notre ami Dimitri aimait tant lui aussi et qu’il rééditerait des années plus tard, mais je ne me rappelle pas ce qui avait tant ému, ce jour-là, l’artiste octogénaire revenu de toutes les horreurs du XXe siècle – des bombardements de Varsovie où l’essentiel de son œuvre avait été détruit, à la bataille de Monte Cassino où les Polonais avaient appris la forfaiture des Alliés les livrant à une nouvelle oppression. Je ne me souviens pas de la source de cette émotion si vive, mais celle-ci me rappelle, à l’instant, les mots que Varlam Chalamov consacre à la rosée du matin dont les perles scintillent au soleil, derrière les barbelés du goulag…
Un homme est trop fragile pour résister à une balle qu’on lui tire à bout portant dans la tête. Mais le même homme fragile est capable de résister à la violence par son art ou par ses larmes.
Et puis il y a le Gros Animal, dont le masque a changé. Je ne parle pas de Mal Absolu, avec ces majuscules de la nouvelle rhétorique qui invoque une partie du réel pour se masquer une fois de plus la réalité : je parle de ce qui me regarde lorsque je suis confronté à l’abîme d’un prisonnier ou de n’importe quel humain endormi, côté Goya pourrais-je dire, avant de revenir à cet autre mystère « lumineux », côté Matisse, d’un bouquet de mimosas.
Je parle du danger mortel, pour l’esprit, de l’euphorie. Je parle du reproche souriant que me faisait Czapski, après avoir lu certains de mes textes baignés par la lumière apollinienne du psalmiste Charles-Albert Cingria, mon mentor au rayon Chant du monde, de me «délecter».
Je pense alors à cette société de la délectation consommatrice, contre laquelle je me suis révolté autant que Czapski chef de rayon dans la section Poids du monde de l’éternel grand magasin, et je parlerai de la diablerie sensuelle qui disperse mais n’éteint pas le désir, et du choix de Czapski de ne jamais représenter ni le Christ ni Dionysos à sa danse.
Une affaire personnelle
Il n’est pas, à ma connaissance d’artiste, qui fût à la fois un écrivain et un personnage historique – un sujet par excellence de biographie et de commentaires de spécialistes à n’en plus finir, qui renvoyât, autant que Czapski, chacune et chacun desdits commentateurs à soi-même.
Ce que je dirai ainsi de Czapski, après celle et ceux qui en ont parlé sur des centaines de pages à ne pas répéter, ne comptera que si ce que j’exprime renvoie chacune et chacun à une approche personnelle que la peinture de l‘artiste ou les lumières de l’écrivain susciteront sans autre intermédiaire. Je parlerai de ce que, par Czapski, sa personne et ses tableaux, ses livres et les écrits qui lui ont été consacrés, j’ai vécu personnellement, dans une intimité «à distance» qui est celle de toute bonne lecture et même de toute amitié vraie, sous l’égide de ce que René Girard appelle la «médiation externe», excluant donc les rivalités mimétiques, dans la liberté préservée des dilections partagées.
Je me rappelle ainsi, pour commencer, remontant à mes vingt-cinq ans, ce dimanche après-midi où celui que nous appelons Dimitri – l’éditeur Vladimir Dimitrijevic dont je suis devenu depuis quelque temps l’un des plus proches amis – m’emmène pour la première fois à l’étage de sa datcha que j’appelle «la maison sous les arbres», après m’avoir dit sur un ton de quasi confidence, qu’il va me donner un livre « écrit pour moi ».
Tout à l’heure, après le repas servi par la douce Geneviève, en compagnie de l’adolescent Marko qui s’est arraché à l’experte observation des poissons de son grand aquarium aux moires d’émeraude bleutée où bougent divers joyaux vivants entre les masses roses de coraux -, Dimitri s’est affalé dans un des fauteuils de velours côtelé marron qu’il y a là, et comme, enroué et fiévreux sous un plaid – l’air presque d’un vieil homme alors qu’il n’a pas encore passé le cap de la quarantaine -, il se dit « peu bien », dans un aveu de faiblesse que je n’aurais jamais imaginé de sa part jusque-là, je lui propose de me retirer afin qu’il se repose, provoquant alors cette espèce de sursaut affectueux qui le fait se lever et m’entraîner dans son pas assourdi par de sages pantoufles.
Alors nous voici devant les milliers de livres bien rangés sur de hautes bibliothèques occupant les quatre parois de la chambre silencieuse donnant sur le jardin dont personne ne s’occupe, et le voilà retirant d’un rayon ce livre couvert de papier pergamin – sainte pratique que j’ai adoptée moi-même avant de le rencontrer -, au titre de La Face sombre du Christ, paru chez Gallimard en 1964 et préfacé par un certain Joseph Czapski, avec cette espèce de dédicace orale de la part de Dimitri : « Ce livre a été écrit pour vous »…
Et que dire alors ? On est évidemment ému, peut-être même a-t-on les larmes aux yeux, au figuré ou au propre, mais on se demande en même temps : et qu’est-ce qu’il en sait, celui-là, et qu’est ce que je vais voir dans cette espèce de miroir qu’il me tend peut-être ? Écrit pour vous ? Et si ce n’étaient que des mots ? Sur quoi, rentré chez lui dans son bout de ferme décati des hauts de ville, à cent mètres du bunker de Georges Simenon, le même soir, le jeune homme aux longs cheveux se plonge dans la lecture de ce livre en commençant par les fragments de Feuilles tombées où tout de suite il sent le souffle chaud d’une intimité jamais ressentie que dans le giron familial, puis il lit les 84 pages de la préface de ce Czapski chez lequel il trouve le même genre d’immédiateté familière au foyer de laquelle il ne cessera de revenir et de revenir jusqu’à ce matin de 2019, un siècle exactement après la date de la mort de Vassily Rozanov, où il lit ces mots soulignés au crayon bleu : «L’amour c’est la douleur. Celui qui n’a pas mal pour quelqu’un ne l’aime pas», ou bien «Dieu verra que je pleure et me tais, mais aussi que mon visage s’éclaire parfois d’un sourire. Mais il n’entendra rien de moi», ou bien encore : «Je pensais que tout était immortel et je chantais. Mais maintenant je sais que tout finira. Et ma chanson s’est tue», ou encore : «Les gens sont grossiers, terriblement grossiers et c’est à cause de cela uniquement ou principalement qu’il y a tant de douleur dans la vie», ou bien «Avec des enfants même ce qui est amer devient doux. Sans enfants on n’a que faire du bonheur. J’ordonne à mon fils et à mes quatre filles d’avoir des enfants», ou encore «Même dans la pensée le cœur vient en premier», ou encore «J’ai un certain fétichisme pour les petites choses. Les petites choses sont mes « divinités ». Toute «grandeur » m’a toujours été étrangère. Je ne l’ai jamais aimée ni estimée», et enfin «Tout le monde s’imagine que l’âme est un être. Pourquoi ne serait-elle pas une musique ? On cherche les «propriétés de l’âme (les propriétés d’un objet). Pourquoi n’aurait-elle pas uniquement une harmonie ?».
Et de fait, plus que des «idées» ou des «pensées», plus que l’expression d’ «opinions» ou de «positions», cette première lecture de ce Rozanov censé avoir «écrit pour moi» est comme une musique jamais entendue, et un peu moins de cinquante ans après avoir lu sa préface je me rappelle le sursaut de surprise joyeuse de Czapski, lors de notre première rencontre, quand je prononce le nom de Rozanov.
Mais à quoi donc tient ce qui nous retient à cet impossible Rozanov, aussi révulsant à bien des égards que si profondément attachant ?
En 2023, je pourrai dire que je n’aurai cessé de revenir et revenir aux écrits de Rozanov, mais serai-je encore de ce monde à cette date, et si je vis encore verrai-je, de mes yeux dont la vue décline, les Poires fond rouge 1973 de Czapski ?
Ces questions éminemment rozanoviennes vont de pair avec mon interrogation portant sur mon attachement à un écrivain aux idées et aux comportements pour le moins déroutants en certaines années, voire scandaleux – et notamment selon les critères actuels ; et dès ma lecture de la préface-fleuve de Czapski à La Face sombre du Christ j’en étais averti : que cet hyper-orthodoxe fut aussi un contempteur enragé du christianisme, et que ce connaisseur pour ainsi dire « charnel » de la religion juive – « chaude » selon lui alors que l’ascèse chrétienne le glaçait – commit des articles d’un antisémitisme si éhonté qu’il fut exclu de la Société religieuse et philosophique qu’il avait contribué à fonder et dont il était le représentant le plus brillant ; que cet ancien soutien des révolutionnaires, au début du XXe siècle, devint un des collaborateurs réguliers du très réactionnaire Novoïé Vremia honni par Lénine, tout en collaborant au journal libéral Rousskoïé Slovo sous le pseudonyme de Varvarine, enfin qu’il fut pris d’une rage nationaliste anti-allemande en 1914 avant que, vers 1917, il propose bonnement de livrer la Russie aux Allemands, et comment le justifier alors ? Comment Joseph Czapski, qui parle lui-même de « divagations » à propos de ces palinodies, en est-il arrivé à se passionner pour ce qu’on dirait aujourd’hui un « infréquentable absolu », à lui consacrer un essai aussi pénétrant sans défendre pour autant les multiples « positions » de l’intempestif « bouc », comme ses élèves d’histoire et de géographie surnommaient l’exécrable prof qu’avait été Rozanov, attentif cependant, et à l’extrême, à ce qui constitue le noyau de cette œuvre à laquelle, sans trouble fascination ni vénération convenue, on revient comme à un vieux pull seyant garant du meilleur confort pour méditer au soleil couchant en se gorgeant de confitures…
Ces dernières images ne sont pas gratuites, qui émanent pour ainsi dire de la pensée «incarnée» de Rozanov, évoquant aussi bien la littérature russe comme un pantalon et ses pantoufles comme un élément constitutif de son être-au-monde.
Or c’est cela, précisément, qui me «reste» de Rozanov, comme une musique à la fois très différente mais aussi pure que celle d’un Charles-Albert Cingria quand il célèbre « cela simplement qui existe », ce sont des bribes de mélodies, des ocelles de lumière, le portrait délicat que Czapski fait de sa sœur Maria, la petite phrase qui revient et revient dans la sonate de Vinteuil que le même Joseph évoque au milieu de ses camarades prisonniers du camp de Griazowietz, ou c’est Vassily (dans le train Louga-Petersbourg, précise-t-il) qui évoque la lumière de celle qu’il appelle «l’amie» ou même «maman» – ce qui me fait sursauter en me rappelant que notre père lui aussi appelait ainsi notre mère : «Depuis vingt ans je vis continuellement dans une atmosphère de poésie. Je suis très observateur, bien que je me taise. Et je ne me rappelle pas un seul jour où je n’eusse pas observé en «elle» quelques traits profondément poétiques ; en la voyant ou en l’entendant (du bout de l’oreille, en travaillant) des larmes d’attendrissement me voilent les yeux. Et voilà pourquoi j’écris si bien (me semble-t-il »…
Vanité de littérateur sentimental ? Nullement : musique de la vie privée, et son enracinement affectif et sexuel : « les liens du sexe avec Dieu sont plus étroits que les liens de l’esptit avec Dieu et même que les liens de conscience avec Dieu, Cela ressort du fait que tous les a-sexuels se révèlent en même temps des athées ».
Et cela encore : «Mon âme est un mélange de boue, de tendresse et de mélancolie. Des petits poissons dorés jouant au soleil dans un aquarium rempli de purin».
Et Charles-Albert : «Ce qui me passionne dans la vie – qui est poème, rien que poème, mais n’allez pas me demander une définition de la poésie que vous ne comprendriez pas – est d’un ordre tellement précis et impérieux que je m’étonne que l’on puisse accorder une seule minute à cette insupportable station dans le piétinement et le gloussement que le bavardage esthéticien vous commande ».
Ou bien en vélocipède, dont Cingria partageait l’usage avec Czapski : « Et puis il y a une descente, jusqu’à un torrent et un pont. Je crois que c’est une frontières de rossignols, cet endroit, car l’on ne peut s’empêcher de prendre pied pour rendre hommage à un concert d’oiseaux impressionnant »
Sur quoi les « esthéticiens » et autres « poéticiens » font la moue.
Mais Rozanov (en pleine nuit, comme il le précise sur la «feuille tombée») coupe court au «piétinement», au «gloussement» et à la jactance des « spécialistes » en murmurant : «Le sifflement du ventilateur dans le corridor est pénible, mais non brutal : je pleure (ou presque) : « c’est pour l’écouter que je veux encore vivre, mais surtout c’est l’amie qui doit vivre. Puis cette pensée : «Est-ce que vraiment elle (l’amie) n ‘entendra pas le ventilateur dans l’autre monde» ; la soif d’immortalité me saisit par les cheveux avec une telle force que je suis sur le point de m’accroupir»…
J’avais vingt-cinq ans cette nuit-là, quand j’ai commencé de lire Rozanov, sans me douter encore que la peinture de ce Czapski à la pensée également si «précise» et si «impérieuse» me parlerait bientôt, elle aussi, de ventilateurs dans la nuit et de personnages esseulés…
En lisant Rozanov j’ai tout suite compris que «ça me regardait», ou plus exactement je l’ai senti, vraiment, comme à l’odeur, comme une sensation de «chaleur» que je recherchais depuis mon enfance pour me défendre du « froid » que j’avais perçu dans certaines «voix», et tout de suite je compris que ce que disait Rozanov du sexe et de Dieu n’avait rien à voir avec ce qui se disait dans le «froid» de la société des années 60-70 et tout à voir avec ce que j’avais vécu entre mes dix et douze ans soudain saisi d’une alacrité volubile où le sexe et Dieu – me reprocha un camarade de mon âge – , tenait de l’obsession, mais strictement verbale et donc mentale, sans rapport avec les pratiques probables de maints adolescents de l’époque couchant déjà ou s’attouchant, comme si le sexe restait une abstraction sans rapport (ou presque) avec ces mystérieux épanchements nocturnes que j’avais constatés avec effarement sans savoir de quelle «nuit» du corps ils venaient, ni la moindre relation non plus, s’agissant de Dieu, avec ce qu’en disait un certain pasteur à la voix métallique du haut de la chaire du temple protestant du quartier, au fil de harangues morales ponctuées de lectures bibliques empruntant tantôt à Matthieu et tantôt à Paul.
Je ne sais ce que représentaient exactement, pour Czapski, le «Dieu» et le «sexe» dont parlait Rozanov, mais je suis sûr que nous étions plus proches, à cet égard, en dépit des cinquante ans qui nous séparaient, que je ne l’étais de la plupart des gens de mon âge, pour lesquels Dieu n’était guère que l’objet d’un débat plus ou moins anachronique et le sexe une réalité objective sujette à «libération».
Or je m’impatientais, à vingt-cinq ans de me libérer surtout d’un langage plaqué, aussi froid et gris qu’une page des écrits de Lénine , tout en vivant dans une certaine confusion des sentiments ou l’affectivité et la sensualité «de mon âge» ne m’agitaient qu’en surface alors qu’une voix intérieure me parlait le même langage qu’en mon enfance, avant le jaillissement du premier sperme, puis en adolescence au fil de mes errances solitaires par les forêts ou le long du lac, où mon imaginaire poétique s’enrichissait de mille voix chaudes et pures comme celles de Verlaine ou de Musset, du Rimbaud des Illuminations ou des Nocturnes de Chopin, des murs montmartrois d’Utrillo ou des coups de gueule de Jacques Brel dans la fumée du Barbare, corps palpitants et voix mêlées de notre jeunesse dont j’évoquerais la mélancolique merveille dans mon premier livre, l’année même où je rencontrai Joseph Czapski de visu avec lequel, aussitôt, il fut question de Rozanov.
De quoi parle Rozanov en associant Dieu et le sexe ?
À vrai dire ce n’est pas clair, et puis cela change selon les années, avant et après sa découverte de l’inéluctable réalité de la mort que concrétise, sous ses yeux, l’évolution de l’inguérissable maladie de l’ «amie».
Ce que montre bien Czapski dans sa préface à La Face sombre du Christ, c’est que la défense du sexe, ou plutôt de la sexualité, n’est en rien liée chez Rozanov à la visée d’une émancipation des mœurs, même s’il affirme que la morale est le dernier de ses soucis. La débauche, autant que le puritanisme ou même l’ascèse chrétienne, lui semblent contraires à la volonté de Dieu, qui recommande à ses tribus d’aller et de procréer. La sexualité est pour Rozanov liée à la procréation, et donc à la vie (Cingria dit quelque part que le sperme est le « sang de la vie »), dont il trouve dans le judaïsme, et plus précisément dans l’Ancien Testament, le culte qu’il appelle de ses vœux, proposant même, à un moment donné, dans ses visions poético-délirantes, d’installer le lit nuptial au milieu de l’église…
À vingt-cinq ans, la mort reste pour moi, comme pour Rozanov, une réalité abstraite même si je l’ai vue «à la maison», avec ma grand-mère paternelle qui aimait en bonne calviniste, répéter que «tout est vanité» ; ou « en ville » , dans la lumière matinale d’une belle journée à venir, à la vue du corps disloqué d’un jeune désespéré venant de se jeter du pont jouxtant la cathédrale de Lausanne, ou encore la nuit au bord de la Seine, tandis qu’on repêchait un autre suicidé.
Dès mes vingt ans, j’ai senti le souffle froid de l’idéologie lors de nos soirées de jeunes progressistes à la Maison du peuple, le même «froid» m’a glacé à dix-neuf ans à la frontière berlinoise de la Pologne, en découvrant la réalité réelle du Rideau de fer, et le lendemain en parcourant les couloirs de l’usine à tuer d’Auschwitz, ainsi puis-je apprécier le «chaud» de la vision rozanovienne par défaut ou par contraste, et d’autant mieux que je dispose déjà d’une certaine «culture» intellectuelle et littéraire où j’ai trouvé de bons points d’appuis «humains», de Camus le révolté à Emmanuel Mounier le personnaliste, lequel m’a conduit à Nicolas Berdiaev et Léon Chestov, autres grands esprits en accord et en désaccord avec Rozanov comme je constate que l’est aussi Joseph Czapski ; enfin je me rappelle que, dans sa correspondance, l’auteur qui incarne déjà, en ces années, une manière d’idéal humain à mes yeux, en la personne d’Anton Tchekhov, a lui aussi manifesté la plus vive réprobation à l’endroit du censeur réactionnaire Rozanov dont les foudres théologico-politiques lui paraissent loufoques.
Mon ami Tchekhov passe souvent pour un agnostique froid ou un « positiviste » de la catégorie que Rozanov abhorrait, mais il suffit de lire L’étudiant, l’un de ses derniers récits qu’il disait aussi son préféré, pour voir qu’il rejoint en somme le «dernier» Rozanov récusant toutes ses positions dogmatiques ou blasphématoires en matière de religion, pour ne s’attacher plus qu’à l’humilité évangélique la plus simple. Si la religion traite de ce-qui-relie, alors Tchekhov est bien plus proche de l’enseignement « familial » du christianisme, tel que je l’ai vécu auprès des miens, hors de toute doctrine mais dans la douce lumière de la bonté, et tel aussi que le ressentait Czapski, que le Rozanov des invectives et des anathèmes -proche de ce Vassili Vassilievitch qui prête plus de tendre attention à sa bonne qu’à Napoléon.
Tchekhov était en contact quotidien avec les hommes de toutes conditions, la maladie était en lui et bien plus que Rozanov en ses pantoufles, plus proche alors de Czapski l’infatigable quêteur de justice, il a «payé », lui qui a fait le voyage de Sakhaline et a témoigné pour les malheureux qui y étaient déportés, comme Czapski l’a fait pour ses camarades disparus. Rozanov lui-même savait très bien la différence entre ceux qui paient de leur personne et ceux qui se paient de mots, et c’est avec autant de sévérité, parfois même complaisante, qu’il se juge lui-même et conspue les intellectuels russes juste bons à échafauder des théories au lieu de travailler.
Or ce qui rapproche ces trois grandes figures si dissemblables est leur attitude devant la souffrance humaine et leur conscience suraiguë de la finitude de notre destinée, par delà les «conversations essentielles». Les frères humains représentés par le peintre Czapski m’évoquent ainsi ceux qui susciteront, au plus profond, la tendresse du penseur Rozanov, et tous les personnages de Tchekhov sans une seule exception.
À l’automne de l’année où j’aurai découvert à la fois Rozanov et Czapski, un accident de la route me fit échouer dans le pavillon de traumatologie de notre hôpital cantonal, au milieu de garçons fracassés dont plusieurs ne se relèveraient jamais, et ce fut pour moi un début de révélation, avant que, dix ans plus tard, la naissance de notre premier enfant me fasse enfin découvrir, dans ma chair, la réalité de la mort, et plus encore celle de la vie réelle, sous une neuve lumière. Mais rien de l’illumination exaltée en cela : juste la vraie réalité telle que Czapski s’efforce, sinon de la «peindre», du moins d’en ressaisir l’aura.
De fait, la souffrance, la maladie, la détresse, la solitude, la mort ne sont pas à proprement parler, pour Czapski, des « sujets de peinture », pas plus que la montagne sainte Victoire de Cézanne n’est un sujet, et l’on n’aura rien dit de plus juste, des écrits de Rozanov, en retenant, par delà toute littérature, leur « musique » ou leurs « soupirs » ; enfin il serait vain de réduire la comédie humaine de Tchekhov à un tableau psychologique ou social, ni d’esthétiser sa profonde poésie, alors que ce qui « nous regarde » là-dedans, défiant toute définition sans pour autant se diluer dans le vague, fait partie de notre être présent et en devenir où tout communique dans ce qu’on pourrait dire une communion des sens, sous l’égide de ce que je ne saurais appeler autrement que la poésie: poésie de Czapski, entre la poésie de Bonnard et de Soutine; poésie de Rozanov en sa solitude tourmentée faisant écho à la poésie de Dostoïevski en son propre tréfonds, et comment ne pas voir en Anton Pavlovitch Tchekhov l’un des plus grands poètes qui soient des sentiments – du moins est-ce ce qu’à l’instant je ressens pour «ce qui me regarde»…
Au fond du puits
(De l’épaisseur de l’Histoire)
Le premier chapitre de la longue préface de Joseph Czapski à La Face sombre du Christ s’intitule «l’homme au fond d’un puits», qui me rappelle évidemment l’homme du souterrain de Dostoïevski ou le «type du tréfonds» qui tarabuste la conscience du protagoniste de L’Inassouvissement de Witkiewicz, et je me rappelle à l’instant le pire de mes cauchemars récurrents où je me trouve coincé dans le boyau resserré d’une grotte obscure sans pouvoir avancer ni reculer (un camarade freudien me souffle qu’il s’agit là de la projection onirique d’une angoisse prénatale, mais qu’en ai-je à fiche ?) alors que je regarde un cliché photographique représentant le jeune Joseph Czapski de 19 ans, donc en 1915, entre deux révolutions, deux guerres et pas mal d’hésitations puisqu’il balance entre un début d’études de droit, la probabilité d’une conscription prochaine et le désir, après s’être imaginé musicien, d’étudier la peinture, ce qu’il commencera de faire à Varsovie en 1918 après un premier service sous l’uniforme polonais qu’il quittera, objecteur de conscience, pour regagner Petrograd où il fondera une communauté pacifiste, et qu’il reprendra à Cracovie en 1921, au lendemain de la guerre russo-polonaise où, cette fois armé, il caracole sur un «bon cheval» et fait fuir un régiment russe avec sa poignée de braves cavaliers, gratifié alors de la médaille « Virtu Militari » pour sa conduite héroïque qu’il évoque non sans se moquer de sa folle hardiesse de pacifiste lancé sur son bolide équestre…
Mais en sais-je plus sur Czapski après avoir entendu, puis lu et relu le récit de ce «haut fait», ou ses visites à Tolstoï, ou tout ce qu’il écrira à propos de ce premier quart de siècle en Russie ou en Pologne, à Petrograd ou à Cracovie dont j’ai découvert le cabaret souterrain du mythique Rynek, à l’enseigne du non moins légendaire Pod Baranami, à dix-neuf ans et déjà au fait du « mal d’amour » depuis l’âge de dix ans – qui est ce type de la photo de 1915 et qui est cet autre garçon a tignasse de beatnik que je dévisage sur mes photos de 1966 ?
Nous nous débattons dans l’enchevêtrement de sensations et de sentiments, de sentiments vrais et de souvenirs plus ou moins «floutés» ou «arrangés» constituant le chaos du journal intime, réel ou imaginaire, de nos années écoulées dont les image se surperposent, parfois, comme sur cet émouvant cliché, pris au smartphone lors de ma première visite au nouveau musée Czapski de Cracovie, en mai 2016, lorsque, me trouvant derrière un ado d’une douzaine d’années posté lui-même devant le portrait du soldat Czapski en uniforme, j’ai capté le reflet de cet enfant apparié à celui du «héros» – rencontre à un siècle de distance !
Le musée Czapski de Cracovie est devenu un «lieu de mémoire», et c’est très bien. Diverses petites troupes d’écoliers et de lycéens polonais en avaient investi les étages au lendemain de son inauguration en présence de notables de la politique et de la culture, et plus encore : d’amis solidaires plus proches, tels Adam Michnik et Andrzej Wajda, Barbara et Richard Aeschlimann, Wojciech Karpinski et Adam Zagajewski ; et le «siècle de Czapski» se trouvait bel et bien honoré avec force documents historiques et autres films d’archives, reconstitution de l’atelier de Maisons-Laffitte et choix (un peu succinct) d’œuvres du peintre – mais encore ? Souscrire au « devoir de mémoire » suffit-il ? Cela ne relève-t-il pas d’un simple rite social qui n’engage aucunement la personne, faute de lui transmettre le sentiment profond que «cela la regarde» ?
De telles questions ne renvoient pas à je ne sais quelle «élite» sensible qui seule serait apte à «comprendre» un Czapksi, hors de toute considération historique, politique ou culturelle, mais à cette «réalité» invoquée autant par Rozanov que par le peintre refusant à la fois la fuite dans l’abstraction et la représentation réaliste conventionnelle réduisant en somme la peinture à une illustration «littéraire» de la réalité.
René Girard parle, à juste titre, de la «conversion de l’art», sans qu’il s’agisse du tout de faire de l’art le support servile d’une conversion idéologique de type religieux, politique ou esthétique, étant entendu que l’idée «progressiste» de l‘art contemporain, nouveau dogmatisme transformant l’anti-académisme de jadis en convention d’autant plus pernicieuse qu’elle a le support de la finance et du commerce, exclut la vraie transmutation dont parle l’éminent critique et penseur français qui coupe court aux discours parasitaires pour nous replacer devant les objets relevant de l’art à l’approche de Proust ou de Wagner, de Nietzsche ou de Hölderlin, en abordant enfin le phénomène religieux, en littérature et en art, ressaisi à la lumière de Simone Weil, qui nous ramène alors à Czapski…
Le fond du puits a de multiples avatars, de la déréliction morale à la fosse commune, mais aussi dans l’espèce d’enfer de l’agréable que représente, dans le monde que nous connaissons en pays nantis supposés évolués et vivant l’Avenir radieux au présent de l’assouvissement, où la fuite dans le bien-être obligatoire est devenu le garant de toute amnésie et l’obstacle à toute considération de l’épaisseur de l’Histoire.
De quoi s’agit-il ? De la réalité. De tout ce qui nous détermine en tel lieu, à telle époque et dans telles circonstances jamais comparables tout à fait aux circonstances apparemment semblables dans un autre lieu et une autre époque.
J’ai l’air d’aligner des truismes, et pourtant à tout moment, dans le monde actuel dont tous les repères temporels et géo-localisés se trouvent nivelés par les effets de l’Information généralisée immédiate, je constate la prolifération d’opinions et de jugements qui éludent ou nient carrément l’épaisseur de l’Histoire.
Lorsque nous arrivons à Cracovie en 1966, deux jeunes gens de l’Ouest dans leur Deux-chevaux bleu ciel quelque peu cabossée que leurs amis polonais ont déjà baptisée Brzydula, – ce qui signifie quelque chose comme « tas de ferraille » ou « poubelle roulante » -, j’ai déjà commencé à percevoir quelque chose qui relève de l’épaisseur de l’Histoire en découvrant, de nuit, la réalité du Rideau de fer (barbelés, miradors, sentinelles, etc.), des routes défoncées de la campagne polonaise, de la grisaille générale, des milliers de visages tapissant les couloirs de l’usine à tuer d’Auschwitz dont l’ancienne odeur évoquée par Imre Kertesz a été remplacée par celle des saucisses grillées de la buvette qu’il y a là, et voici nos hôtes de Wroclaw (la Breslau de jadis), les parents et Slawek l’ami de mon compère Urs dont celui-ci à fait connaissance lors de régates internationales, Slawek étudiant comme nous mais en uniforme de militaire verdâtre pour je ne sais plus quelle raison, le ou les frère et sœur de Slawek – tous confinés dans ce qui me semble un logement bien exigu, et notre première soirée aussi joyeuse et familière que l’environnement m’a paru sinistre, nos récits alternant et ma première cuite à la vodka au miel noir Krupnik, le lendemain mes échanges avec le père de Slawek, ingénieur à la voix douce auquel je dis ma foi en le communisme et la conviction qu’un jour la vie en Pologne sera meilleure qu’à l’Ouest mais que cela va demander du temps, notre visite au théâtre de Jerzy Grotowski où j’achète des affiches dont je tapisserai les murs de ma chambre, bref l’atmosphère de la Pologne de Gomulka, une petite fille en uniforme au milieu d’un stade rempli de jeunes gens qui déclare solennellement «protestujem !» au micro en invoquant la guerre au Vietnam menée par les impérialistes occidentaux, et la chaleur des gens, la chaleur de nos hôtes de Wroclaw et l’inoubliable chaleur des jeunes gens se pressant dans le cabaret Pod Baranami, à Cracovie où Slawek a tenu à nous emmener, les chansons qu’il nous dit satiriques mais auxquelles nous ne comprenons rien tout en riant et applaudissant a tout rompre à l’imitation du public à dominante (il me semble) estudiantine, et la tournure artiste, même bohème de tout ça, et le lendemain la chaleur de ce café de la rue Florianska dont le rouge garance ou cramoisi préfigure celui des loges de théâtre de Czapski – ce mélange d’abîme glacial et d’érotisme bohème frotté de charme artiste…
À dix-neuf ans, membre de la Jeunesse progressiste lausannoise, deux ans avant de me retrouver dans un auditoire de la Sorbonne où nous assisterons, avec mon ami Reynald, aux interminables débats des camarades révolutionnaires français fractionnés en innombrables groupuscules, j’en suis encore à me répéter la phrase douce-amère de Paul Nizan, contempteur des «chiens de garde» de la philosophie académique : « J’avais vingt ans et je ne permettrai à personne de dire que c’est le plus bel âge de la vie», mais je sens confusément que cette phrase n’est qu’une phrase que je n’oserai prononcer en présence de nos amis polonais, et déjà je me reproche le discours pour ainsi dire léniniste que j’ai tenu devant le père de Slawek, dont je voyais bien qu’il se retenait de me dire ce que je méritais d’entendre, la fameuse «voix du tréfonds» m’ayant déjà traité de petit crevé lorsque je me suis vu, en joli costume de velours côtelé et la dégaine d’un archange aux yeux cernés, présenter à la télé romande, en tant que représentant des étudiants progressistes lausannois, la pensée de Marcuse dont je conviens à la fin de l’interview, après une objection de mon interlocuteur, qu’elle ne s’adresse pas vraiment « aux masses ».
Me voir, moi, au petit écran, prononcer gravement le mot de «masses», comme je me suis entendu, moi, en l’aula de l’université, devant une assemblée de plusieurs centaines d’étudiants réunis, m’empêtrer dans un discours tissé de citations de sommités marxistes faisant autorité en ce moment-là dans nos réunions enfumées – disons Georg Lukacs, Louis Althusser encore que, Henri Lefebvre mais avec des réserves, Frantz Fanon, etc.- où je prononce là encore force formules dont l’implication historico-sociale me semble évidente, en insistant sur ce que nous attendons des « groupes de fusion » marquant le rapprochement décisif des étudiants et des ouvriers sans oublier les paysans qu’il s’agit absolument de « conscientiser », je m’entends et je me vois et la langue de bois me colle au palais, la grande salle de l’aula commence à frémir de l’impatience indignée de tant d’étudiants (surtout les «fascistes» des facs de droit et de HEC) encore englués dans leur conception dépassée de la transmission du pouvoir, je vois mes camarades progressistes me faire des signes de conclure, bref je ne suis pas à ma place mais l’ai-je jamais été quand, dans le préau de l’école primaire, je me tenais toujours un peu à l’écart au point d’être qualifié de «rêveur» par ma première institutrice, une demoiselle Chambovey, puis de «songe-creux» par son successeur, un Monsieur Besson «sévère mais juste ».
Zapping
Aux commande de mon ordinateur Big Mac dont vient de s’achever la dernière mise à jour, le regard flottant entre l’écran géant et la fenêtre donnant sur les arbres dont le feuillage d’automne flamboie autour de notre datcha de La Désirade, à 1111 mètres au-dessus de la mer et donc 739 mètres au-dessus des eaux du lac Léman que je dirai ce matin (il est 11h 45, ce 19 octobre 2019) d’un bleu métallisé contrastant avec le bleu plus sombre chiné de verts assourdis et de bruns roux des montagnes de l’ubac de Savoie, tandis que de multiples verts jaunissants scandent notre premier plan de pentes inclinées de part et d’autre du val suspendu que nous dominons, j’essaie de me représenter ce qui distingue foncièrement l’espèce de perception panoptique qui est la mienne, à l’instant, et le regard d’un Vassili Rozanov, tel soir de 1911, franchissant le pont de la Trinité de Saint Pétersbourg (inauguré en 1903 et long de 582 mètres) et notant mentalement puis griffonnant: « Deux anges sont assis sur mes épaules : l’ange du rire et l’ange des larmes. Et leur éternelle dispute constitue ma vie » ?
Est-il fou d‘imaginer l’usage que ferait aujourd’hui Vassili Vassilievitch d’un blog, alors qu’il invente un genre littéraire à cristallisations fragmentaires en prétendant du même coup qu’il marque la fin de la littérature telle qu’elle a été pratiquée jusque-là, narrative et à grosses machines romanesques ventilées dans les journaux de l’époque sous forme de feuilletons ?
J’ai rédigé le chapitre précédent de cet essai sur Czapski en position couchée, au côté de Lady L. très prise ces jours par une bronchite cattarrhale aiguë, pianotant sur mon smartphone avant de transmettre le texte, via le Cloud (mystérieux nuage dont le mécanisme m’échappe à vrai dire), à mon profil Facebook où trois splendides créatures très dénudées, défiant la censure puritaine du réseau social, auront déposé leurs propositions de devenir mes «amies» au cours de la dernière nuit, prétendant outrageusement s’agréger à mes 4011 «amis» dûment homologués, mais illico «poubellisées» comme je le fais chaque jour de kyrielles d’autres propositions non moins affriolantes.
J’imagine la stupéfaction d’un Rozanov revenant dans notre monde et découvrant ces aspects de l’ingéniosité de notre espèce, ou Czapski s’initiant à l’usage d’Instagram. Or de tels rapprochements ne sont pas étrangers, me semble-t-il, au fonctionnement de la pensée de ces deux observateurs aigus des multiples données de la réalité environnante, quel que soit le milieu dans lequel ils évoluent – et pourquoi ne pas développer ce type d’observations dans l’univers éclaté qui est le nôtre, dont les notations quotidiennes que nous en tirerons ne seront jamais foncièrement différentes qu’au temps des Feuilles tombées ou des premiers cahiers du jeune Czapski….
À l’instant, tout en recopiant mes notes du jour, en vue de l’établissement du cinquième recueil de mes carnets (2013-2019) d’ores et déjà intitulé Mémoire vive, j’écoute la bande sonore du film Intervista de Federico Fellini où l’on se rappelle qu’une équipe de télévision japonaise vient s’entretenir avec le Maestro en train de tourner une scène nocturne durant laquelle le rêve éternel de l’homme de voler librement comme un oiseau sera l’occasion d’une première féerie visuelle.
La poésie d’Amarcord, évoquant l’enfance et l’adolescence du même Fellini, tient essentiellement aux associations d’images porteuses d’émotion qu’on retrouve, dans une tout autre tonalité – cela va sans dire – chez le Rozanov le plus pur des dernières années, où le flux d’un murmure continu recompose ce que je dirai le présent du poète, non point coupé du temps et du lieu où se poursuit sa rêverie, mais reconstitué par le jeu de la mémoire et de la mise en forme, dans une sorte de murmure mélodique trouvant en nous de multiples échos.
J’avais dix-neuf ans lorsque j’ai commencé de tenir mes carnets sur les cahiers blancs lignés à la couverture marquée POLSKI que j’avais achetés dans un grand magasin de Wroclaw et que j’ai conservés comme des reliques, j’étais déjà lecteur assidu des Journaliers de Marcel Jouhandeau auquel il m’arriva plus tard d’envoyer quelques lettres toutes gratifiées de réponses où le grand écrivain m’appelait son «enfant», je me rappelle avoir parlé de Jouhandeau à Czapski, des années plus tard, mais je ne me souviens pas de ce qu’il a pu m’en dire alors qu’il m’évoquait plus volontiers le journal de Charles Du Bos, sans doute mieux accordé à sa sensibilité – tout cela une fois encore pour indiquer une façon d’approcher la réalité «à sauts et gambades» sans perdre pour autant le fil zigzaguant d’une investigation qui ne dépend ni du support matériel des notes ni de l’outil utilisé, au point qu’on peut fort bien imaginer les stylos multicolores ou la minuscule machine à écrire de Cingria connectés à quelque computeur répercutant partout le fruit de ses propres grappillages, par exemple lorsqu’il affirme que « l’écriture est un art d’oiseleur, et les mots sont en cage avec des ouvertures sur l ‘infini », ou qu’il constate que «c’est splendide, à vrai dire, d’entendre vibrer comme vibre un bocal dangereusement significatif cet instrument étourdissant qu’est un être »…
Intranquilles et affligés
Mais qu’ont-ils donc à se battre les flancs ? A quoi riment les flagellations qu’ils s’infligent ? Pourquoi les moins cruels, les moins méchants, les moins fautifs de cette drôle d’espèce n’en finissent-ils donc pas de s’accuser, et souvent de trois fois rien à qu’il semble, et cela depuis la nuit des temps à quoi remonte ce qu’ils appellent le péché originel ? Mais qu’est-ce qu’il leur prend de ne pas positiver ?
Voilà ce que pourraient se demander, aujourd’hui, le Nouvel Homme, et, inclusivement, la Femme de Demain, confrontés à ces éternels coupables en leur incompréhensible tourment dont l’apôtre Paul me semble l’un des plus ombrageux initiateurs de la longue lignée avec son fameux texto envoyé aux Romains, chapitre 3, verset 19 : « Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais commets le mal que je ne voudrais pas ».
Et ça continue, ainsi que l’illustreront, de siècle en siècle, les soupirs de leur journaux intimes et autres
murmures, d’Augustin le premier introspecteur général au calviniste Henri-Frédéric Amiel, ou de Maine de Biran le psychologue raffiné au tortueux Vassili Rozanov et au Czapski bientôt sexagénaire en ses lettres infiniment délicates au jeune Colin d’Amiens – douces âmes intranquilles !
L’Artiste n’est jamais content, et c’est sa force. L’Artiste n’aime pas ses manques. L’Artiste se reproche d’être toujours au-dessous de son aspiration, n’était-ce qu’à considérer la Nature, et c’est cela qui le sauve, ou disons que cela le tient debout en rage d’éveil et soutient son effort de ne pas se contenter – ce qui serait mortel.
Ce n’est pas le chemin qui est difficile, disait à peu près Simone Weil, mais le difficile qui est le chemin, et je souscris à deux mains quoique sachant ma propension quotidienne à céder à la facilité : cela seul en effet me pousse à écrire et tout le temps – le difficile.
Difficile est le chemin pierreux des mots autant que le sentier scrupuleux de la poésie faite peinture chez un Corot, difficile est le dessin de la pierre chez Cézanne et difficile l’apprentissage consistant à parler à une pierre ou à la faire parler, ainsi que l’évoque Annie Dillard, comme est difficile l’évocation musicale de la courbe du chemin qu’il s’agit de vivre comme on la respire en écoutant Schubert ou Chopin, ou tâcher de prier en peignant un bol blanc sur fond blanc.
Mais tout cela paraît encore trop «poétique», et l’intraitable Czapski nous le répétera à journée faite autant qu’il se le recommandera en déplorant pêle-mêle, dans ses lettres à Jean Colin, tant ses « défaites » que l’énervement banal et combien légitime que lui inspire tel marchand lui reprochant de ne peindre que d’invendables femmes moches et de tristes quais de métro, ces chaises branlantes dans un recoin de café mal balayé ou ce jeune homme paraissant accablé par le poids de ce qu’il y a hors de lui ou peut-être en lui, allez savoir : lui aussi a l’air de se reprocher Dieu sait quoi, Henri-Frédéric marque chacune des ses « défaites » d’une croix dans les marges de son journal intime, les messieurs sûrs d’eux-mêmes ricanent mais ce ne sont pas eux qui peindront jamais l’Artichaut véridique ou les divines Mandarines, ni n’éprouveront la moindre honte en constatant qu’ils ont rien ajouté à la beauté du monde en ce jour «nuageux à couvert».
Le 4 septembre 1993, un mois avant sa mort, le peintre Thierry Vernet, ami de Czapski et le nôtre aussi, écrit dans ses carnets cette ultime inscription : « Je peins ce que je crois avoir vu. 4/5 de mon élan m’attache à notre vie et à tout ce qu’elle nous donne de merveilleux, mais 1/5 m’attire vers la vie éternelle d’où tant de bras se tendent pour m’accueillir ».
Dans les mêmes carnets inédits, qui sont autant d’un écrivain que d’un artiste, il notait aussi «Ajouter ne serait-ce que sur 10cm2 un peu de beauté au monde, ce qui diminuera d’autant et probablement bien plus de sa laideur», et sur le ton de la remontrance adressée à soi-même qui rejoint celles de Czapski : « Je suis un chiffon sale présentement dans la machine à laver. Lâche, hypocrite, flagorneur, luxurieux, cédant au moindre zéphyr de mes désirs et tentations diverses, comptant sur un sourire et mes acquiescements pour conquérir quelques cœurs utiles (et cela enfant déjà pour «m’en tirer» !). La machine à laver à de quoi faire. Mieux vaut tard que jamais ».
J’évoque une constellation de sensibilités variant dans leurs formules au gré des intermittences du cœur, et c’est ainsi que je retrouve l’écriture de Thierry Vernet dans les marges du tapuscrit de la correspondance à la fois très poignante et très révélatrice témoignant du lien profond entre un jeune homme de 21 ans du nom de Jean Colin et le Czapski dépassant la cinquantaine, entre 1948 et 1958, où la notion de difficulté revient en chaque lettre des deux amis.
La première lettre de Jean Colin à Czapski date de novembre 1948, et tout de suite on ressent la grande reconnaissance affectueuse du jeune homme envers son aîné, et son besoin de lui dire les difficultés, précisément, qu’il rencontre, à la fois à l’usage du fusain, au moyen duquel il travaille à des portraits, et le verbe « piocher » apparaît dans la foulée, mais aussi à s’exprimer par l’écriture : « Cela m’est pénible décrire car je m’épie sans cesse et cela est insupportable, j’ai beaucoup de méfiance envers moi-même quand il s’agit d’écrire ».
Or, dès cette première lettre aussi, Jean Colin, qui revient ce jour-là du musée, entreprend un « rapport » sur ce qu’il a vu comme il en établira sans discontinuer à travers les années, Czapski lui répondant et cela donnant une sorte de conversation d’atelier où les deux artistes partagent et parfois confrontent leurs découvertes, leurs adhésions vives mais aussi leurs rejets – et Colin ne sera pas moins intransigeant que Czapski, qu’ils rapportent à leur propre work in progress, source quotidienne de joies mais aussi de «défaites».
Ce jour-là, plus précisément, Jean Colin se rappelle deux natures mortes de Boudin et un portrait de Frans Hals, avant de s’arrêter plus longuement à l’évocation d’un chaudron de Chardin dont «la couleur sourd, sans qu’on pense à son éclairage», et quel autre œil que celui d’un peintre verrait ce qu’il décrit ensuite, qui pourrait se retrouver d’ailleurs sous la plume de Czapski, à propos de ce qui distingue la lumière qui «sourd» des objets et celle qui procéderait d’un «éclairage» plus ou moins artificiel : «De même qu’il n’y pas de coup de soleil dans les Utrillo où la couleur est si intense, issue des murs, des arbres eux-mêmes».
Dans la lettre suivante, datant de février 1949, Colin dit sa difficulté de vivre après qu’il a quitté Czapksi en compagnie duquel il a visité une exposition de dessins de Brueghel, et l’on sent, même s’il n’en dit rien d’explicite, que la difficulté touche à la fois à sa fragilité physique (il est atteint de la maladie de Charcot) et à ses «défaites» dont il sait, au demeurant, qu’elles le fortifient à proportion de son refus de la facilité : «J’aime autant que le travail ne me soit pas facile, je m’obstine beaucoup plus quand c’est dur. Je dis cela aujourd’hui, mais sur le moment il faudrait savoir se dire cela. Je viens d’avoir l’exemple pour une nature morte que je travaillais ici depuis quelques semaines, et peu à peu j’avais amassé pas mal de choses, et puis j’ai eu un matin où cela a marché comme jamais ; le résultat est que l’après-midi j’ai travaillé avec moins de tension à ce que je faisais, comme si la partie était gagné, et jai fait de cela un barbouillage immonde et tout mon travail de deux semaines est à recommencer parce que j’ai travaillé mollement., lâchement, sans ma conscience tendue à chaque touche que je posais – enfin c’est une expérience sur ma mollesse».
Je retiens aussitôt les deux formules de «conscience tendue » et d’«expérience sur ma mollesse», qui situent bien les occurrences du combat. Je dis bien : combat.
Et ce combat, qui n’a rien à voir avec des états d’âme de mauviettes moites, se retrouve dans une lettre saisissante de Czapski à Colin, dix ans plus tard, un an avant la mort du jeune artiste, où le peintre sexagénaire, revenant d’une séance de pose chez André Malraux, pour un portrait que lui a commandé une revue, détaille ses impressions avec une acuité pure de toute complaisance, où les qualités du brillantissime auteur des Voix du silence, son immense érudition et ses vues pénétrantes, sont reconnues en mêmes temps que le portraitiste saisit ce que Francis Bacon appelait «la flaque» à propos de ses portraits : à savoir l’aura et la « grimace » du sujet, le vrai « visage » de celui-ci sous son masque mouvant, caractériel ou social.
« Il n’a pas pas arrêté de parler avec ses tics incessants », note Czapski après la première séance de pose dont les dessins lui sembleront insuffisants, «il me posait des questions sur des problèmes essentiels , moi je le contredisais sans avoir la centième partie de ses connaissances. J’ai été comme toujours ébloui par l’authenticité de ses connaissances, la sincérité, la justesse de ses réactions à la peinture. La fulgurante vitesse des réactions – mais avec cela un côté « poésie » Chateaubriand-Barrès où tout à coup l’essentiel disparaît pour la phrase, la métaphore à effet. Au dernier moment il s’est mis debout sans bouger pour cinq minutes – pour un croquis – et j’ai tout a coup eu l’impression d’avoir devant moi un arriviste pas tout à fait authentique … cela contredisait mon impression antérieure. Son visage sans une vraie flamme du monologue-dialogue est tout à coup figé dans une expression tendue et sans vie intérieure, un peu bête »…
Ainsi le travail sur ce «portrait» se trouve-t-il mis en situation avec une sorte de fébrilité dans le chaud-froid, relancée dans la séance de pose suivante, après une «énorme lettre» où Czapski revient sur ce qui lui a dit Malraux en insistant «sur le côté équivoque de tout ce qu’il dit dès qu’il touche à l’essentiel», puis il soupire entre les lignes en doutant que son interlocuteur «réagisse profondément» alors que lui a éprouvé le besoin de « piocher » son point de vue – et d’évoquer alors l’incompréhension totale de Malraux quand ils ont évoqué la figure de Simone Weil.
En toute confiance et donc sans la moindre précaution oratoire, Czapski revient sur ce que, lors de sa deuxième séance de pose chez Malraux, celui-ci lui dit de passionnant à propos de Braque, Seurat, Rouault ou Le Titien, et surtout comment deux toile de Cézanne, à propos d’une certaine exposition, «éclipsaient tout», avant de remarquer qu’à l’abord de questions à ses yeux vraiment essentielles, le même Malraux « tombe dans quelque chose de vague », en opposant son génie puissamment rhétorique à celui de Simone Weil dont la luminosité dépasse ledit génie par l’ «absolu incarné en paroles» de son témoignage.
« Personne de nous n’est digne de cette vie, ajoute Czapski à propos de Simone Weil, dont il reproche à Malraux de n’en dire que des platitudes, prétendant « qu’elle n’avait pas de talent » et que c’était «une vie ratée». Et de porter l’estocade au grand écrivain et ministre de la culture en exercice : «Et tout à coup j’ai senti combien il y avait de mauvais goût dans l’atelier extra luxueux de sa villa, cela aussi veut dire quelque chose », avant d’ajouter à l’adresse de Jean Colin, avec une sorte de tendresse filiale : « mon enfant, je te parle de choses qui ne sont pas essentielles » et de lui dire combien sa présence lui est plus chère et vivifiante, en somme, que celle du ponte national à mèche folle.
Cinq ans plus tôt, cependant sur un ton naturellement moins libre, mais avec des objections assez proches de celle que nous trouvons dans la lettre à Colin, s’agissant des rapports complexes entre l’art et le religieux, Czapski présentait, dans la revue Preuves, Les voix du silence avec autant d’acuité attentive et de bienveillance « objective » que de réserve sur « l’essentiel ».
Quasi contemporains, et chacun ayant vécu d’extraordinaires événements, Czapski et Malraux n’en incarnent pas moins deux mondes socialement et spirituellement peu conciliables. N’était-ce que leurs cravates sont de tournures différentes, et l’on imagine mal Malraux s’attarder aux côté de «son cher ami» affalé sur son lit de sa mansarde-atelier de Maisons-Laffitte, où ils parleraient plus «à fond» d’intranquillité religieuse ou de la fonction de l’art dans cette société foncièrement injuste qui fait souffrir Simone Weil, alors que le difficile débat se poursuit tous les jours, en pensée ou en peinture, pour le jeune Jean autant que pour le «vieux» Joseph.
La mémoire devant soi
Compulsant les deux précieux albums extraits du journal de Czapski, dont la suite kaléidoscopique fait alterner, en patchwork aux enluminures de toute sorte, les pages manuscrites plus ou moins enrichies de croquis dessinés ou d’esquisses plus construites de possibles tableaux, les coupures de journaux relatives à l’actualité ou à tel thème lié à la peinture, les documents photographiques nous ramenant au début du XXe siècle ou faisant voisiner les portraits (photo en noir et blanc ou dessins) de sa sœur Maria, les scènes de rue ou de café, les silhouettes croquées au vol dans une infinité de postures saisies avec la même précision et la même justesse, les encarts réservés à des adresses et autres numéros de téléphones, les notes de lecture ou les innombrables développements griffonnés, sans parler des kyrielles de citations glanées au fil des jours et des nuits, je me dis que là se trouve l’«ordinateur» de l’artiste et de l’écrivain travaillant sa double matière littéraire et picturale dans une simultanéité temporelle et une circulation diachronique constante qui fait partie du processus créateur lui-même dont sortiront récits constitués et tableaux aboutis – et voici les plans coloriés si émouvants, datant de la captivité de Czapski à Griazowietz, des fameuses conférences sur Proust miraculeusement sauvées de la débâcle et désormais accessibles en volumes traduits en plusieurs langues, mais dont la genèse remonte à un séjour du jeune Czapski soignant sa fièvre thyphoïde à Londres, en 1926, et découvrant alors Albertine disparue, premier choc préludant à une lecture continue de la Recherche dont la résurgence des scènes et des personnages, une décennie plus tard, dans un environnement infesté de poux, illustrera la puissance subconsciente de ce que Proust lui-même appelle la «mémoire involontaire», question de survie, au gré d’un processus qui met en évidence une espèce de «communion des sens» que les arborescences du journal, au présent de la conférence et au futur de multiples avatars, illustreront comme un fabuleux livre d’images.
Dans une note poétique de mes carnets datée de 1986 et localisée «en forêt» à la manière de Rozanov, j’écrivais que « les poèmes nous viennent comme des visiteurs, aussitôt reconnus », et que «notre porte ne saurait se fermer à ces messagers de nos propres lointains», et c’est à ceux-ci que je pense qui, plus que de simples « souvenirs » rappelés par la mémoire volontaire, ou même involontaire, puisent en notre tréfonds psychique une matière qui est à la fois la même et une autre, mêlée de réalité «logique» et de continuels «délires», nourrie de passé mais aussi de présent au moment de sa formulation, au point que ce qu’on appelle la mémoire me semble comme « en avant » de l’esprit et du « faire » poétique et artistique, inventive à proportion peut-être de notre « laisser faire », éclairante par fusées et autres bonds – réalité de l’envol à laquelle Czapski ne cesse de se référer, mais que seul un travail incessant, une attention sans relâche, ponctués de «défaites», permet d’aboutir à une forme, du graffiti au tableau ou du balbutiement au poème.
«L’art commence quand, après une longue et patiente partie d’échecs, d’un coup de genou sous la table on fait tout valser », écrit Thierry Vernet dans ses propres carnets si proches du journal de Czapski par leur inspiration, et j’ai cru déceler, chez cet autre magnifique artiste, incomparable poète de la couleur, ce même processus d’une «mémoire créatrice» à subits envols découlant d’une longue patience et d’un travail à tâtons et défaites, et puis ces bonheurs de loin en loin cette sourde joie du «computer» humain connecté à son «âme».
Mais qu’est-ce donc que cette «âme» ? Et quel est donc ce «Dieu» auquel le jeune Jean Colin fait si souvent référence, plus strictement catholique, à ce qu’il me semble, que Czapski, en dépit de la distance que celui-ci maintient par rapport aux outrances antichristiques et antisémites de Rozanov, quelle est plus précisément la «religion» de ce Joseph Czapski qui remarque, dans Proust contre la déchéance, qu’on ne trouve pas une fois le mot «Dieu» dans les milliers de pages de la Recherche du temps perdu, où la littérature elle-même devient une manière de religion comme, chez Malraux, l’art rétablit le lien vertical entre l’homme et le sacré – et l’on sent que Czapski n’est tout à fait satisfait ni par l’un ni par l’autre sans se rallier non plus, complètement, à la mystique ascétique d’une Simone Weil ni participer jamais, ni par ses écrits ni par la thématique de sa peinture (pas un Christ comme il y en a chez Rouault ou Soutter, qu’il admire pourtant, ni l’apparition lumineuse d’aucune figure mariale – si l’on excepte Maria sa chère sœur…) à quelque forme d’art qu’on puisse dire explicitement religieux, comme s’il fallait absolument épurer la peinture de toute «littérature» sans exclure pour autant, est c’est me semble-t-il l’essentiel, en quoi il rejoint d’ailleurs le Rozanov «essentiel», moins que le débat : la prière, mais là encore sans plus de recours aux mots qu’à l’esthétique «silencieuse» d’un Morandi auquel on le compare parfois, à tort me semble-t-il.
À jamais intranquille, voire indompté, alors que son précepteur pétersbourgeois espérait en faire un jeune homme « rangé » tout soumis au Dieu réglementaire, selon sa lignée et son rang, Czapski me semble cependant impensable, dans sa perception du monde et son œuvre de peintre, sans référence implicite à ce qu’on appelle l’ «âme», ce qu’on appelle «la religion » et celui qu’on nomme « Dieu »…
Massacres
(La question du sujet)
Certaines phrases ont le pouvoir, étrange et lancinant, de nous confronter à la fois au monde et à nous même, sous un effet comparable à ce qu’on qualifie de précipité en chimie, et c’est, aussi bien, un double saisissement physique et psychique que j’ai éprouvé la première fois que j’ai lu ce fragment des carnets de Thierry Vernet : «D’ailleurs c’est bien simple : ou bien les hommes sont ouverts, autrement dit infinis, ou bien ils sont fermés, finis, et dans ce cas on peut les empiler. Ou en faire n’importe quoi».
Je ne sais à quoi pensait exactement notre ami quand il a noté ces mots, mais ceux-ci me sont souvent revenus à l’esprit, et plus particulièrement lorsque je lisais ou entendais parler des innombrables massacres d’innocents qui ont ponctué le terrible XXe siècle et que se posait à moi la question de ce qu’en peut dire un écrivain ou de la représentation que peuvent en donner un peintre ou un compositeur – et les noms m’apparaissaient ici et là, des figures émergées du chaos d’un Zoran Music ou des thrènes d’un Krzystof Penderecki, pour ne citer que deux exemples particulièrement explicites, et la phrase de Thierry Vernet m’est revenue, aussi, après avoir achevé, accablé, la lecture des Bienveillantes de Jonathan Littell.
Je ne sache pas qu’il y ait, dans les écrits ou les dessins et les peintures de Czapski, une seule évocation explicite des désastres de la guerre.
Czapski a fait la guerre. Il a vu, de près, les séquelles des révolutions russes, il a traversé des champs de ruines, il a partagé le sort de milliers de prisonniers de guerre et de civils en fuite à travers les steppes et les déserts, et il raconte bel et bien tout cela dans des fragments de récits épars ou dans ses témoignages plus développés de Terre inhumaine, Souvenirs de Starobielsk ou Tumulte et spectres, mais on ne pense pas qu’il traite là un « sujet littéraire », pas plus qu’il ne «peint la guerre» ni ne « peint les camps » ou ne fasse « du Goya » ou « du Music », et pas un instant on ne l’imagine au chevet de Colin d’Amiens sur son lit de douleur, en fin de vie, le dessinant comme Ferdinand Hodler dessine et peint son amie mourante « sur le motif ».
Il va de soi que je ne fais aucun grief d’ordre moral à Goya de peindre les désastres de la guerre, à Music d’évoquer l’horreur des camps de la mort, ou à Hodler de scruter les avancées du mal, au front de sa maîtresse, comme Paul Léautaud, dans In memoriam , sans doute son plus beau livre, de se pencher sur son père afin de le voir « décéder un peu plus», mais le fait est que la guerre, la maladie ou la mort ne sont pas pour Czapski des « sujets de peinture » comme les batailles ou les séquelles de la guerre, les « scènes à faire » de la pauvreté ou de l’affliction, de la maladie ou de la mort , ont inspiré les peintres réalistes du XXe siècle, et notamment en Pologne, avec les Matejko et autres maîtres discutés et même combattus par Czapski et ses amis.
Un Jan Matejko, figure majeure de la peinture historique polonaise, dont un chef-d’œuvre monumental reconstitue précisément un haut fait guerrier, sous le titre de La bataille de Grunwald, dans une structure formelle qui peut rappeler de loin la Bataille de San Romano de Paolo Uccello, eût-il pu représenter les tribulations vécues par les Polonais lors des trois dernières guerres auxquelles ils ont participé, entre autres scènes impliquant les masses de civils déportés, parqués, ici en prière et là en fuite ? Pourquoi pas ?
Cependant il y a aussi de l’ «Histoire» dans le fait qu’à un moment donné, en Pologne, de jeunes artistes et de jeunes écrivains, sans participer forcément aux mouvements en rupture d’académisme de France ou d’Autriche, d’Italie et d’Allemagne, aient éprouvé le besoin de s’arracher à cette forme de réalisme, parfois admirable mais plus souvent empêtré dans une «littérature» nationaliste censée délivrer des « messages », mais ce qui me frappe est que ce rejet du «sujet», qui devait assez logiquement conduire à l’abstraction, n’ait cessé chez Czapski de sous-tendre son regard, sa perception du monde et son expression littéraire et picturale, alors même que le « sujet » de la condition humaine restait chez lui tout à fait central.
Les images-chocs de la guerre rendent-ils l’homme plus conscient de l’abomination de la guerre, au point de l’en détourner ? C’est ce que croyait la romancière anglaise Virginia Woolf lorsqu’elle prit connaissance, dans les années 1936-1937, de photos montrant des corps dépecés de civils adultes et enfants victimes des bombardements de l’armée de Franco, en pleine guerre d’Espagne, laquelle fut d’ailleurs le premier conflit largement « couvert » par les photographes de guerre.
Dans le même esprit pacifiste, sous le titre de Guerre à la guerre, l’objecteur de conscience allemand Ernst Friedrich avait publié, en 1924 déjà, un album rassemblant d’effrayantes photos de « gueules cassées », de soldats gazés et de cadavres de toutes nationalités pourrissant en tas.
Or la « guerre de demain » prophétisée en 1938 par Abel Gance dans son film J’accuse, aux images non moins terribles, éclata en dépit de toute « prise de conscience ».
Depuis lors, les représentations de la guerre et de la violence dans le monde se sont multipliées de telle manière que nous baignons littéralement dans les images de la souffrance humaine captées dans le monde entier le jour même. Or pouvons-nous encore compatir, comme y incitaient les gravures célèbres des Désastres de la guerre de Goya, ou sommes-nous immunisés par le flot des images ? Et la manipulation technique et commerciale de celles-ci ne fausse-t-elle pas leur réception, déviant leur fonction de témoignage et assouvissant parfois les pulsions les plus morbides ?
Telles sont, entres autres, les observations et les questions que développa l’essayiste américaine Susan Sontag dans le livre intitulé Devant la douleur des autres, à propos duquel je l’interrogeai en 2003 à Paris, donc dix ans après la mort de Czapski, lequel eût sans doute été intéressé par ce thème lié aujourd’hui à la prolifération cancéreuse de l’image via Instagram
Lorsque j’interrogeai Susan Sontag, intellectuelle libérale bon teint qui avait eu le courage d’aborder le thème alors « tabou », aux USA, du cancer, sur la capacité de la photographie à nous sensibiliser à la souffrance humaine, elle me répondit que le pouvoir spécifique d’une photo est de nous hanter, de créer un choc et de fixer une vision symbolique, tel l’officier vietnamien exécutant un vietcong en gros plan , le soldat républicain de Capa, le gosse levant les mains dans le ghetto de Varsovie ou la petite fille nue fuyant avec sa famille sur une route du Vietnam. Mais Susan Sontag ajoutait que sans les mots, sans légende ou narration, ce que dit la photographie de la guerre est limité. Elle-même l’avait vérifié à propos du siège de Sarajevo, où elle avait séjourné pendant près de trois ans, en parlant, après la guerre, avec des amis qui en avaient vu tous les jours d’innombrables images n’avaient aucune idée de la réalité concrète vécue sur place.
Le hasard des circonstances m’a fait découvrir, ces derniers jours, un documentaire–fleuve sur la guerre du Vietnam, vue des deux côtés par ceux qui y participèrent en première ligne – responsables politiques ou militaires, mais également jeunes combattants et civils dont la vie fut transformée par ce conflit aux séquelles toujours perceptibles – et je me suis rappelé alors les propos de Susan Sontag reconnaissant l’impact des images, inégalé par la passé, mais qui n’auraient jamais suffi sans l’opposition suscitée par la conscription obligatoire et les pertes humaines dans l’opinion publique, également stimulée par des fleuves de mots. Et de souligner le problème nouveau constitué par la réception de ces images, leur exploitation commerciale sur fond d’émotion de masse ou de propagande, rappelant que la première publication dans Life, en juillet 1937, de la photo de Capa montrant le milicien frappé à mort, jouxtait une page de publicité au baume capillaire Vitalis et, plus récemment, l’usage des photos réalisées par Toscani pour Benetton, où la douleur humaine devient une composante publicitaire avec le plus total cynisme.
Lorsque J’évoquai ce qui distingue les gravures de Goya et les plus « belles » photos illustrant la condition humaine en butte au malheur, comme celles de Sebastiao Salgado, Susan Sontag, qui avait précisément défendu Salgado contre ses détracteurs lui reprochant de faire de l’esthétisme avec la misère, me répondit qu’elle se méfiait de la compassion suscitée par des photos que ne prolongeât aucune réflexion, estimant que celle-ci devait se substituer à l’incantation généreuse, qui n’est souvent qu’un simulacre, auquel selon elle échappait un livre ou une représentation photographique ou picturale recomposée, donnant enfin l’exemple, selon elle virulemment « anti-guerre », de la fameuse photo, réalisée en studio par Jeff Wall, représentant des soldats russes et afghans mort dans un vallon ensanglanté – mais probablement Czapski, anti-Matejko, se fût il montré anti-Wall en l’occurrence, rejetant cette vision hyperréaliste, obtenue par des moyens mécaniques, d’une scène de «violence absolue» qui ne pouvait selon lui être un «sujet» de peinture, moins encore l’objet «polémique» d’une showroom.
Et l’on se rappelle alors, au tréfonds de l’abjection, les images de la décapitation du journaliste Danny Pearl diffusées sur Internet et finissant sur les sites pornos, ou j’entends encore le cinéaste indépendant Alain Cavalier me dire pourquoi jamais il ne pourrait reconstituer, comme dans l’immonde film évoquant à l’époque la vie du Christ, la crucifixion de celui-ci imposant à tel moment, à l’accessoiriste, de rajouter un peu de sang aux flancs du supplicié pour «faire vrai».
De la bonté
Joseph Czapski me dit un jour, dans son atelier de Maisons-Laffitte, que le christianisme racontait essentiellement pour lui une histoire de la bonté. Or il était capable de s’ériger aussi vivement contre les chrétiens antisémites que contre les juifs réduisant les Polonais à des antisémites, sans parler des uns et des autres se traitant mutuellement de fascistes ou de sales communistes.
Puis un autre soir, alors qu’il perdait la vue, il me demanda de lui lire la nouvelle de Tchekhov intitulée L’étudiant, dont je lui avais parlé plusieurs fois et que j’avais dans ma poche – la préférée de l’écrivain et qui fit venir, aux yeux du témoin de toutes les horreurs, de vieilles larmes d’enfant…
Vassily Rozanov se demande, à plusieurs reprises, en ses dernières années, s’il a été assez bon dans sa vie, alors que les femmes qui l’entourent l’auront été tellement plus que lui, maudit phraseur ; et je me souviens d’une intervention de notre ami Dimitri à la radio romande, évoquant la littérature russe et caractérisant à son tour la quête essentielle, selon lui, des écrivains russes, avec l’exemple de la bonté du vieil Ikonnikov, dans le roman Vie et destin de Vassili Grossman dont il fut le premier éditeur en langue française.
Dans l’histoire du bien qu’il a griffonnée sur ses feuillets, le vieil Ikonnikov, après avoir remarqué que même Hérode ne versait pas le sang au nom du mal, mais « pour son bien à lui », constate que la doctrine de paix et d’amour du Christ aura coûté, à travers les siècles, «plus de souffrances que les crimes des brigands et des criminels faisant le mal pour le mal ».
Il n’en rejette pas pour autant le message évangélique mais oppose, au « grand bien si terrible » des nations et des églises, des factions et des sectes, la bonté privée, sans témoins, la « petite bonté sans idéologie », la bonté sans pensée que j’ai constatée pour ma part chez mon père et ma mère et que Joseph Czapski «raconte» à sa façon par le truchement de multiples personnages à l’air innocent ou perdu.
Et Vassili Grossman de préciser que la bonté du vieux martyr Ikonnikov est « celle d’une vieille qui, sur le bord de la route, donne un morceau de pain à un bagnard qui passe, c’est la bonté d’un soldat qui tend sa gourde à un ennemi blessé, la bonté de la jeunesse qui a pitié de la vieillesse, la bonté d’un paysan qui cache dans sa grange un vieillard juif. (…) En ces temps terribles où la démence règne au nom de la gloire des Etats et du bien universel, en ce temps où les hommes ne ressemblent plus à des hommes, où ils ne font que s’agiter comme des branches d’arbres, rouler comme des pierres qui, s’entraînant les unes les autres, comblent les ravins et les fossés, en ce temps de terreur et de démence, la pauvre bonté sans idée n’a pas disparu ».
Les «tas» auxquels fait allusion Thierry Vernet se sont accumulés, au XXe siècle, jusqu’au ciel, comptabilisés par des statistiques scientifiquement satisfaisantes pour en faire n’importe quoi. Le «tas» de Katyn n’était pas à peindre, mais Joseph Czapski ne se détourne pas pour autant de la réalité des tas, refusant autant que son ami Thierry de considérer les âmes, les corps, les enfants et les femmes, les hommes et leurs chien comme des entités fermées. Il me semble faux de prétendre que plus rien ne peut être écrit «après Auschwitz», mais comment ne pas voir que peindre le Christ en croix devient impensable dès lors que l’art se réduit à un «tas» ?
Perdus
(Une si présente absence)
Il y a ceux qui dorment, de nuit et de jour, et puis il y a ceux dont le regard semble ailleurs, ou tout ramené à l’intérieur, on ne sait pas trop, en tout cas l’évidence intense d’une absence non moins présente, si l’on peut dire, nous questionne au bord de ce gouffre de silence qui avale tout du bruit des cahots d’un train, d’une rame de métro passant soudain ou des clients du bistrot jacassant alentour.
L’apparition la plus énigmatique à mes yeux serait alors celle de ce personnage noir dans un compartiment de train rouge, vu de profil et difficile à identifier.
S’agit-il d’un jeune pirate à l’œil masqué ou d’une créature de genre indéterminé figurant peut-être la mort ? Rien ne permet de l’affirmer à coup sûr : tout est laissé à l’interprétation de qui le regarde, et je suis celui qui le regarde du compartiment voisin.
Dans les trains et les rames de métro, les gens sont compartimentés, ou disons plus précisément que Czapski est attentif à leur solitude compartimentée, cadrée de diverses façons, mais le titre même de cette toile de 1985 est explicite à cet égard : Le compartiment, 1985, 65x 81cm.
La dominante des couleurs est au rouge sang de taureau frotté de garance et de suie, qu’on pourrait dire aussi, en moins velouté, le rouge sale d’une loge de théâtre décati, sous la lumière d’une seule lampe à l’orange de jaune d’œuf, donc ce doit être la nuit – le peintre est alors âgé de 89 ans mais on dirait là quelque vision de je ne sais quel jeune sauvage berlinois des année 70, et puis non: pas du tout, c’est autre chose, mais quoi ? C’est «du plus pur Czapski»…
L’observation attentive des visages des personnages de Czapski révèle l’extrême sensibilité avec laquelle le peintre rend ce qu’on pourrait dire le poids de la chair et, paradoxalement, la nature la plus délicate de la personne, à savoir son âme affleurant la bidoche.
Cette épaisse femme, par exemple, derrière son bar, qui a l’air d’une pocharde, entre verres et siphon, semble comme perdue dans un rêve dont on ne sait, bien entendu, rien du tout. Elle est là : elle est un peu là, comme on dit. Elle pèse de tout son poids de présence, dans une lumière et au gré d’une inclinaison qui en adoucissent la puissante, voire écrasante affirmation en son tas de viande porcine et mystérieuse.
Mon regard n’est plus ici latéral et réservé, comme dans les compartiments séparés par quelque espace, mais face à face, avec quelque chose de brutal dans ma façon de dévisager cette tête de brute qui ne m’accorde, par ailleurs, aucun regard, tout occupée à peser.
Est-ce la patronne qui pionce après le départ des derniers clients de son troquet, comme pourraient le faire penser les bouteilles et les verres alignés derrière elle et le siphon à portée de pogne, ou bien est-ce une habituée, la pauvre pute du coin ? On n’en sait rien.
Tel marchand s’offusque de ce que Czapski ne peigne point de personnages un peu plus présentables que cette calamité vivante à face ruinée de chair orangée malpropre que marbrent des reflets bleu rose violacé comme des hématomes, mais c’est bien ça que nous regardons et qui nous regarde : c’est là, j’étais là et telle « chose » m’apparut, le regard éperdu ou plus simplement perdu, et le marchand n’en démord pas, ne voyant pas quel salon garnir de ce vilain Au bar, 1956, 46 x 61 cm et ne trouvant à faire valoir à l’artiste que l’objection sonnante et trébuchante : invendable !
Or je vois, pour ma part, tout autre chose qu’une scène misérabiliste à la Zola ou à la Daumier, je vois des couleurs, je vois comme une portée de bois sur laquelle s’alignent les notes de musique d’une dizaine de verres retournés, et d’autre verres au premier plan, ceux-là sur leurs pieds, remplis de doux mélanges de liqueurs de couleur orange, je vois, sous une chevelure d’un brun qu’on dirait de crin chiné, le gros mol et doux visage aux yeux fermés et telle grosse épaule du solide appui fuyant ensuite en défaite fatiguée de l’autre côté de la robe bleue à l’échancrure laissant voir le blanc d’un probable camisole et la chair tendre de ce corps fatigué par la vie salope, je vois, je subodore malgré la certitude verticale du siphon et l’affirmation sourdement décidée du gros poing droit serré de la daronne, je bois la couleur à fortes lampées et laisse à d’autres le soin plus subtil et scientifiquement recevable de déconstruire la chose…
Sur quoi je découvre cette autre coulée de chair de L’Attente, 1981, 65x 81 cm, dont le regard perdu de la femme encore jeune représentée, profil droit, visiblement en espérance, comme on dit, conjugue une nouvelle fois la présence et l’absence.
Rien apparemment de commun, du point de vue de ce qu’on pourrait dire la tonalité plastique, entre ces trois toiles évoquées ici dans le désordre de la chronologie et le souci d’échapper à la fois à la psychologie descriptive, plus encore à l’allusion sociologique, voire à la projection métaphysique, suggérant en revanche l’unicité d’un regard confronté à la double multiplicité du réel et des moyens de le transcrire.
Je regarde le « dessin » très stylisé, voire élémentaire, du personnage du Compartiment me rappelant l’expression célinienne d’ «au bout de la nuit» – et j’y suis revenu à travers les années comme une noctuelle revient vers une lumière affleurant les ténèbres -, pour me trouver ensuite confronté à une rêverie éveillée suggérée dans un tout autre langage « du côté de la vie » pourrait-on dire, avec l’ « événement visuel » que représente la robe-sac de la femme enceinte à bretelles légères, dont le tissu blanc se cloisonne à traits noirs virevoltants et motifs oranges, et les parties visibles du corps de la femme est d’un jaune moutarde à l’unisson de la paroi de la salle d’attente, zigzaguant du visage taché de rose au long bras droit suggérant lui aussi l’attente avec un petit sac prêt à tomber, et ce bas de jambes croisées qui disent elles aussi quelque chose de l’expectative songeuse du personnage perdu dans sa nuit en plein jour.
Les mots peinent à dire «tout ça», il faudrait plutôt dire «à peindre tout ça», ou bien il faudrait que ce qui est ici pure peinture devienne pur poème, et ce serait peut-être mieux dire, de manière « physiquement » plus suggestive et plus libre, côté lecteur, ce qui est exprimé par le jeu des formes et des couleurs, des lignes et des valeurs, qui ne ressortit ni tout à fait au réalisme ni non plus à l’expressionnisme, tant les «propositions» picturales de Czapski, ses « approximations » et ses « trouvailles », défient tout classement.
Logomachies
Les avatars de la langue de bois sont multiples et modulés de façon non moins diverse selon qu’il s’agit de politique, de littérature ou d’esthétique, variant en outre au gré des périodes et des modes.
J’avais dix-neuf ans, l’année du bac et de ma découverte de la Pologne, lorsque, m’étant inscrit à la faculté des lettres de l’Université de Lausanne, j’assistai à la réception de notre volée pour entendre le Doyen, monsieur gris de grave mine de pasteur ou d’employé des pompes funèbres, mettre en garde celles et ceux d’entre nous qui montraient déjà quelque penchant passionné pour la littérature au motif qu’il ne s’agirait plus, désormais, d’aimer celle-ci mais de l’étudier de manière scientifique.
Je le pris très mal et, à vrai dire, ne m’en suis pas encore remis. J’étais alors, déjà, le lecteur passionné que j’ai été dès ma prime adolescence, marqué par Cendrars, ce fou, et son Moravagine, autre figure de dément à la Dostoïevski ; j’avais appris par cœur, quelques années plus tôt, concourant pour le «prix de l’orateur» d’un collège lausannois, le très panthéiste poème en prose intitulé Le vent à Djemila, extrait des Noces d’Albert Camus; j’étais en train de lire les romans-poèmes de Jean Genet qui me semblaient irriguer la langue française d’une nouvelle sensualité à la Rousseau sur fond de canaillerie et de révolte absolue ; je savais encore par cœur de nombreux fragments des Illuminations de cet autre voyou qu’avait été le Rimbaud de mon âge, et voici qu’un sinistre ministre du culte culturel prétendait me couper les ailes, non mais !
Or la «science» de notre cher Doyen n’était encore, en ces années, qu’une docte esquisse de système, prudemment distante de l’analyse marxiste – laquelle m’avait intéressé chez les critiques littéraires Lucien Goldmann et Henri Lefebvre – et sans l’outillage idéologique et méthodologique que lui donneraient bientôt le structuralisme, la sémiologie fine d’un Roland Barthes et les gros sabots sociologisants d’un Pierre Bourdieu.
De mon côté, nul en mathématiques, d’une culture scientifique avoisinant le néant, plutôt solitaire et bohème de nature, immédiatement déçu par le tour pédant et vétilleux des premiers séminaires auxquels j’assistai, et surtout infoutu de siéger sur du bois dur en compagnie de jeunes filles et de jeunes gens me semblant surtout soucieux de se préparer à la régurgitation de ce que nos professeurs leur faisaient avaler en descendants directs des sorbonnicoles épinglés par Rabelais, je passai de plus en plus de temps au bar à café Le Barbare, à lire de la manière la moins scientifique qui fût, avant de sécher les cours, d’oublier les dates d’examens et de ne plus fréquenter que mon université buissonnière où, à côte de centaines d’écrivains selon mon cœur et mon âme – ces entités peu scientifiques évidemment -, de grands professeurs n’ont cessé de me prodiguer conseils et encouragements, d’Albert Thibaudet me parlant de Stendhal à Gaston Bachelard le penseur-poète par lequel j’accédai rétrospectivement à la grande famille des écrivain-philosophes sans systèmes à la Montaigne ou à la Pascal, après Epicure ou Sénèque et avant Léon Chestov et Vassily Rozanov me ramenant à Czapski…
Je serais naturellement de mauvaise foi en réduisant l’université à ce qu’elle n’est que partiellement et le temps d’une cristallisation idéologique, où ma paresse naturelle et mon instinct immunitaire m’ont fait réagir successivement à la «terreur» marxisante et à la « scientificité» structuraliste ; je me dis parfois que j’eusse aimé suivre les cours de Gilles Deleuze ou de Michel Foucault, que j’ai appréciés ici et là par la lecture, mais je m’en remets à certaine «main invisible», laquelle ne doit rien non plus à la «science» des économistes, qui m’a fait opposer de plus en plus radicalement ma sensibilité et mon idiosyncrasie à tout système et toute idéologie. En lisant Albert Camus à quinze ans, je me suis trouvé «chez moi», comme à lire Charles-Albert Cingria à vingt ans, Léon Chestov et Vassily Rozanov à vingt-deux ans, René Girard à cinquante ans ou Peter Sloterdijk à soixante ans, et j’ai été «chez moi» sur la Butte Montmartre de Maurice Utrillo, «chez moi» dans le jardin de Bonnard ou sous l’orage de couleurs de Soutine, et «chez moi», plus que partout ailleurs, dans la peinture de Joseph Czapski et les récits de mon ami Tchekhov.
Passant pour un connaisseur ( ?) de l’œuvre de Charles-Albert Cingria, j’ai été confronté très directement, en 1981, au 45e étage d’un building de la ville de Houston (Texas), au langage d’un spécialiste féru de structuralisme parlant du même auteur à l’enseigne d’un colloque en plein ciel, dont le propos m’échappa autant que s’il se fût exprimé en chinois. Plus précisément, le professeur Michel Beaujour, enseignant la littérature française à New York, m’avait convié à ce rendez-vous le plus inattendu qui fût, pour le chroniqueur free lance et sans le sou que j’étais alors, où l’on parlerait de l’œuvre de Cingria à l’enseigne du meeting annuel de la Modern Language Association réunissant des lettrés des quatre coins des States et du monde, et j’étais là en face du charmant Eugène Nicole, structuraliste comme je l’ai dit, débarqué la veille de Saint-Pierre et Miquelon, très sincèrement féru comme moi de l’œuvre de Charles-Albert mais l’abordant avec son vocabulaire de spécialiste – et pourquoi pas ? Pourquoi le géologue n’aurait-il pas son mot à dire à propos de la montagne Sainte Victoire chère à Paul Cézanne ? Et le vrai «sujet» de Cézanne est-il d’ailleurs ladite montagne ?
Le terme intrinsèquement dépréciatif de «logomachie» dit exactement ce qu’il dit, désignant le pouvoir du langage, et l’on entend aussitôt: pouvoir dominant voire abusif, exactement comme je l’ai ressenti en entendant parler, pour la première fois, d’une approche «scientifique» de la littérature.
Je me souviens d’une soirée passé chez les Aeschlimann, en ces mêmes années, où je racontai à Czapski l’épisode texan qui m’a valu de découvrir les Etats-Unis en trois semaines inoubliables, mais aussi d’assister à la dissection linguistique d’un des écrivains que j’aimais alors le plus, par un jeune universitaire aujourd’hui connu pour sa qualité d’éminent proustien, auteur de plusieurs ouvrages battus par les vents marins (L’œuvre des mers, Alaska et Les eaux territoriales) et tout à fait émancipés des grilles structurales, et je me rappelle combien Joseph fut surpris et amusé par mon évocation !
Il y a langue de bois et logomachie, me semble-t-il, dès lors qu’un objet littéraire ou artistique subit une «réduction» par le truchement de telle ou telle grille d’interprétation. Je veux bien que l’analyse freudienne, par exemple, nous révèle tel ou tel aspect de tel ou tel tableau dont la symbolique ressortirait aux réalités cachées du psychisme humain, mais lorsque je lis, sous la plume de l’historien de l’art Michel Thévoz, entiché de psychanalyse, que tel ou tel dessin de Louis Soutter procède d’une «compulsion masturbatoire», je sursaute comme je sursaute en découvrant, chez le même auteur, la tendance systématique à décrypter les œuvres selon des critères psychanalysants ou sociologisants qui lui font déceler des relents de pédophilie dans la représentation faite par le brave Albert Anker des enfants de son village, ou un fumet d’idéologie «réactionnaire» chez un Ferdinand Hodler également taxé de «militariste» pour avoir peint de fiers hallebardiers à tel moment de sa carrière.
Si la logomachie n’est pas la même en matière de critique littéraire ou musicale, cinématographique ou picturale, un critère me semble constituer un dénominateur commun entre les commentateurs plus ou moins spécialisés en ces divers domaines, et c’est celui de modernité.
Je me rappelle ainsi la perplexité de deux critiques d’art polonais visitant l’exposition consacrée à Czapksi en 1984, à Varsovie, dont la préoccupation principale était de savoir, à l’approche de cette peinture si peu conforme à l’idée qu’ils se faisaient du dernier cri de l’art contemporain occidental, dans quelle mesure ils pouvaient relier Czapski aux «tendances» actuelles, et je me rappelai alors nos réunions de la rubrique culturelle de La Tribune de Lausanne, vingt-cinq ans plus tôt, où le critique d’art attitré, abordant une nouvelle pile d’invitations à des vernissages, en écartait aussitôt, non sans dédain, tout carton relevant de l’art figuratif.
La peinture de Czapski est-elle plus « moderne » quand, au cours de sa dernière période créatrice, il peint des espaces vides, des containers, des objets de moins en moins « piochés», parfois à la limite de ce qu’on appelle l’abstraction, que dans ses natures mortes apparemment «classiques», où tel pain fait si «vrai» qu’on en croquerait, comme l’envie nous prend de mordre dans une pêche de Chardin – signe alors de quel retour en arrière plus ou moins «naturaliste» ?
Pour sauver la mise, comme on invoque la «modernité» de l’art pariétal préhistorique, celle des fresques de Piero della Francesca ou des dessins de Pontormo, l’on pourrait, en attendant de «psychanalyser» Czapski, le raccorder à tel mouvement de néo-figuration ou le rapprocher des atmosphères «à la Hopper», mais revenant à ce que je crois le noyau de son «être créateur», je regarde ailleurs…
Regarder «ailleurs» signifie-t-il se détourner de toute théorie, ou plus précisément de toute réflexion portant sur l’art ou la littérature ? Évidemment pas, et l’auteur de L’œil, réflexions sur la peinture, même se défendant d’être critique ou historien de l’art, en est la meilleure preuve.
À la lecture des lettres que Jean Colin adresse à son cher mentor, l’on voit aussi avec quelle attention et quelle précision Czapski s’entretenait des œuvres contemporaines ou passées, qu’il s’agisse de Francis Bacon – que le jeune artiste critique avec plus de véhémence que son aîné – ou de Corot, de Jérôme Bosch ou de leurs travaux respectifs.
Ce qui saisit aussi, et plus encore dans le Journal de Colin d’Amiens, c’est le mélange constant d’incertitude et de fermeté que manifeste le peintre dans sa vingtaine, dont l’art semble à la fois hors du temps et au cœur même de la présence la plus intense, dont il parle avec cette même simplicité qui caractérise les propos de Czapski sur les peintres et les écrivains. Pas trace du moindre jargon chez aucun des deux épistoliers, moins encore de rivalité mimétique entre eux ni de volonté de puissance, et point non plus d’angélisme ou de fausse modestie qui pourraient faire croire que ces deux êtres sont parfaits.
Le structuralisme, la critique de type marxiste ou l’analyse freudienne seront-ils de la moindre utilité pour apprécier, d’un œil juste, les dessins de Jean Colin, de Joseph Czapski ou de Thierry Vernet, que je tiens à rapprocher, non pour leur «ressemblance» mais pour la probité du regard qu’ils portent sur le monde, et pour la vérité frémissante de leurs traits ? Je n’en crois rien, pas plus que je n’attends quoi que ce soit d’un «poéticien», comme se nomment aujourd’hui les spécialistes universitaires en matière de poétique, pour m’expliquer le processus de germination d’un poème. La nouvelle génétique littéraire, avoisinant le degré zéro de l’engagement critique réel, voudrait nous faire croire que l’usage de tel crayon ou de tel traitement de texte importe décisivement dans le processus de la «création», en insistant sur la textualité du texte, de même que les «trucs d’artistes», y compris la matérialité du matériau utilisé par l’artiste, devraient éventer le processus de celui-ci, mais en quoi ces tautologies nous éclairent-elles vraiment ?
J’ai été responsable, quelques années durant, de la rubrique culturelle d’un quotidien lausannois de grande diffusion, à laquelle collaboraient une dizaine de critiques extérieurs à la rédaction, spécialistes de leur domaine plutôt que journalistes, et je me trouvais donc bien placé pour apprécier la différence notable, au seul niveau du langage, des critiques portant sur la musique classique ou la littérature, le théâtre ou le cinéma, les musiques actuelles et les arts plastiques «traditionnels» ou relevant plutôt de l’«avant-garde».
S’agissant d’un journal de grande audience et non d’une revue spécialisée, j’étais censé trouver un équilibre, du point de vue de la lisibilité, et sans niveler l’expression propre à chaque collaborateur, entre les appréciations et autres jugements formulés par ceux-ci et le public spécifique intéressé par chaque domaine. Pas question, par conséquent, de recourir à des chroniqueurs enferrés dans un jargon inaccessible à nos lecteurs, ce qui ne posait guère de problème dans la plupart des cas même pour la présentation de livres de qualité littéraire supérieure, de grandes expositions, de concerts ou de films parfois « difficiles ». Jouissant de la confiance de la rédaction en chef, je résistais tant que je pouvais aux vagues et aux vogues d’une culture de plus en plus soumise aux modes et aux succès faciles, mais un seul domaine me confrontait régulièrement à une logomachie impliquant, plus que la responsabilité de notre charmante chroniqueuse tâchant de bien faire : le domaine lui-même des arts «plastiques » devenus « visuels » et non moins « conceptuels », où le discours du critique, en adéquation avec le milieu supposé avant-gardiste, devenait répétitif à l’image de la production en vue du moment.
Combien de fois aurai-je alors lu et relu, à propos de telle série de toiles monochromes, succédant à telle autre série du même genre, le discours récurrent de notre critique nous expliquant, faute de pouvoir dire quoi que ce soit d’autre, comment le peintre faisait «monter» la couleur de couche en couche, et comment le gris de telle toile, si subtilement, se distinguait du gris de telle autre, ou le blanc si blanc de celle-ci contrastant avec le noir plus que noir de celle-là.
Les logomachies ont sévi partout, mais il me semble que l’art dit contemporain, et plus encore son commentaire critique, souvent coupé du public non spécialisé, s’est développé en fonction des seuls critères d’une pseudo-nouveauté accordée à l’idéologie hégélienne d’un progrès linéaire, bientôt cautionné, et avec quels dégâts, par un marché de l’art spéculant sur les modes quand il ne les lançait pas.
Sur quoi, ce qui me semblait évident dans ce domaine particulier, marqué par un effondrement progressif de la critique, au profit du commentaire de type publicitaire, s’est étendu dans les autres domaines du «culturel» devenu un peu tout et n’importe quoi.
S’agit-il encore d’une affrontement entre Anciens et Modernes, et s’opposer à la déferlante d’une culture de plus en plus flatteuse relève-t-il d’une idéologie réactionnaire ? La seule façon de répondre à de telles question me semble de revenir aux objets en coupant court, précisément, à toute logomachie, pour achopper aux productions d’hier et d’aujourd’hui et relancer, s’agissant d’une grande œuvre encore méconnue telle que celle de Joseph Czapski, un débat que lui-même a amorcé dans un article de 1960 intitulé L’abstraction – le pour et le contre où il s’interroge sur ce qu’est réellement l’abstraction en peinture, ce qu’il en est de la figuration ou de notre rapport à la réalité, à quoi rime l’art dans un monde tel que le nôtre, comment «faire avec» Picasso, comment ne pas s’égarer entre les « tas » de l’horreur et du bien-être généralisé, comment « changer sa vie » ainsi que se l’ordonnait abruptement un Rainer Maria Rilke, comment se sortir du chaos.
Tous ceux qui ont connu Czapski ont été frappés par son refus véhément de se payer de mots et de beaux discours, mais à la fois sa passion pour les débats et les controverses, écoutant les uns et les autres et prolongeant ses interrogations dans son journal, affirmant parfois une chose et jurant le lendemain qu’il avait voulu dire autre chose, lisant attentivement tel livre de spécialiste avérée qu’aura publié Muriel Gagnebin en 1974 sous le titre de La main et l’espace, et l’annotant dans ses marges, d’accord avec telle appréciation éclairante ou contestant telle autre sur-interprétation, puis se retrouvant seul devant sa toile en proie au doute et s’acharnant à le surmonter – prêt au bond.
Nul en maths comme je l’ai dit, de culture très déficiente en matière scientifique, j’entends cependant le Physicien douter de la scientificité absolue de la science la plus dure, mais je n’en pavoise pas pour autant ni ne me moquerai plus de la science molle du Littéraire : je les observe crayon en main, et je cueillerai les mots de l’un, puis de l’autre, comme le faisait Jules Renard dans son Journal que je ne cesse de lire et de relire, et tout à l’heure je reviendrai aux dessins ou aux tableaux de Joseph Czapski et les regardant, une fois de plus, je m’occuperai de ce qui me regarde.
Paupières de plomb
Les écrans sont partout, dehors et dedans, qui nous empêchent de voir. Dehors ils ont investi la ville et le monde. Dedans ils nous distraient de nous-même et nous masquent à nos propres yeux – ce qu’on dit les yeux de l’âme.
Dehors ce sont des murs couverts d’images, immobiles ou animées, formant un nouveau paysage mondial de l’urbanité publicitaire globalisée. La Joconde apparaît ici associée à une grande marque de parfums multinationaux, souriant énigmatiquement sur les murs de New York ou de Tokyo, et la statue du David de Michel-Ange, relookée par les designers de la firme Jeff & Koons en hologramme d’un vert fluorescent, figure la nouvelle aspiration du client universel à la vie écologiquement durable.
Nous en avons plein la vue, comme on le disait dans l’ancien monde où l’on voyait ce que «ça veut dire», nos paupières sont elles-mêmes des écrans et réversibles puisque les écrans géants du dehors clignotent désormais sans discontinuer dans notre plus intime dedans.
Il me souvient d’avoir évoqué un jour , à propos de Gogol dont nous parlions avec Czapski, le démon russe au nom lancinant de Vii que ses paupières de plomb traînant jusque par terre font ressembler à un monstre plus effrayant même qu’un cyclope, et cette figuration fantastique de l’aveuglement m’aura fait mieux voir à travers les années ce que précisément nous ne voyons plus ou ne voulons pas voir, ou ce que nous croyons voir en présence de la véritable Joconde ou en tournant longuement au pied du David de la place de la Seigneurie de Florence où, à l’instant, des milliers de Japonais et de Chinois, d’Indiens et de Hollandais confirment leur géo-localisation sur leurs minuscules écrans.
Certains spécialistes avérés ont estimé, quelque temps, que les paysages de Czapski étaient moins représentatifs de son art surtout dévolu à ce qu’ils auront appelé le Théâtre du Quotidien, mais ce n’était voir en somme que du déjà vu, comme tout ce qui se réfère à telle ou telle mouvance picturale rapporte ce qui n’a jamais été regardé comme ça à du déjà vu.
Est-ce alors prétendre que tout ce que Czapski voit et traduit en vision tient essentiellement du jamais vu ? Oui et non. Non s’il s’agit de prétendre que personne, jamais, n’a entrevu la myriade des couleurs de la montagne Sainte-Victoire au point de n’en rien reconnaître devant les myriades de représentations qu’en propose Paul Cézanne ; et bien sûr que oui pour attester l’unicité de la vision du même hurluberlu.
L’on pourrait s’étonner de ce que Czapski, à de multiples reprises, invoque le nom de Cézanne et en revendique une part de filiation alors que vraiment, comparant les œuvres respectives de ces deux peintres, l’on se dit à bon droit que cela n’a «rien à voir », et pourtant…
Sur les écrans géants, au fronton de tel musée présentant la énième rétrospective du «maître d’Aix» où sur les sets de table proposés à l’Hyper U de la banlieue de Nîmes, au rayon ménager, la Montagne Sainte-Victoire ou les sympathiques Joueurs de cartes se reconnaissent évidemment au titre du déjà-vu, comme le cinglé à l’oreille coupée ou les corneilles de Van Gogh imprimés sur des t-shirts, et l’on se rappelle alors que certains paysages de Czapski, ou certain pain sur une table, peuvent évoquer quelque chose de la passion picturale du «maître d’Arles», même si ça n’a visiblement «rien à voir» non plus.
Reste donc à voir – ce qui s’appelle voir, en regardant plus attentivement ce qui nous regarde. Cela me semble assez simple, et purificateur pour l’âme, devant les dessins et les tableaux de Jean Colin d’Amiens, qui nous ramènent en douceur au plus intérieur de notre dedans; tandis que voir vraiment ce que fait voir Czapski, qui ne cesse d’aller et de venir entre les dehors du siècle et le dedans de nos âmes et de nos corps, de nos esprits et de nos cœurs compliqués, requiert une attention plus en alerte, de plus vigilantes défenses et tout autant de curiosités, à son instar, que de prudences immunitaires.
S’agit-il de se «brûler les paupières» ? Mais non mon cher, objecterait l’inlassable adversaire de la rhétorique creuse ou par trop romantique : tâchons simplement d’ouvrir nos bons yeux sur les mondes du dehors et du dedans, au dam des écrans.
Avec la douceur requise
(Quelques lettres à Jean Colin)
Jean Colin allait à la mort certaine avant sa trentième année, il n’y avait la quelque chose d’atrocement injuste qui découlait de la vie même et, aux yeux du jeune homme, de quelque chose qui dépendait de la «volonté de Dieu ».
Il ne rejetait pas celui-ci, non seulement il allait à la messe quand il en était encore capable, et s’agenouillait jusqu’à ce que cela ne lui soit plus possible, mais il louait le Seigneur, comme les mystiques hassidim devant l’absolue injustice d’une naissance monstrueuse – enfant sirénomèle ou nain à tête d’oiseau – prononcent l’Hymne approprié saluant la Sagesse du Seigneur ; Jean Colin ne se révoltait pas à ce qu’il semble – ses lettres le prouvent -, il se faisait moult reproches à lui-même et se partageait entre son Art et son Amour – dernier cadeau de la vie qui lui fut donné avec celle qui devint sa femme peu avant sa mort – destinée sainte !
Mais Jean Colin d’Amiens fut il un saint ? Je n’en sais rien, pas plus que je ne saurais dire si Czapksi fut lui-même un saint, mais ce que je constate est que Czapski , dans ses lettres au jeune martyr (le mot n’est pas trop fort), avec une intensité affectueuse qui est plus que d’un père à un fils : d’un disciple à son maître, se confie avec une humilité et une liberté réellement bouleversante, quoique sans trace de pathos, comme on pourrait imaginer qu’un vrai chrétien s’adresse au Crucifié pour lui dire que, nom de Dieu, il lui manque !
Czapski, à la ville, est déçu par la réception de ses œuvres à l’occasion d’une exposition. Il ne se plaint pas en vaniteux, mais tout de même : ce Malraux qui n’est pas venu, ce Mauriac qui s’est fait excuser, ce Julien Green qui lui dit juste que ses toiles sont aussi tristes que ses romans, ce Jean Cassou qui ne semble voir en lui qu’un exilé plutôt réactionnaire le blessent même si de vrais amis l’encouragent et le soutiennent, mais avec le petit Jean qu’il appelle «mon enfant », c’est autre chose, et ce qui me frappe est que «mon enfant», une fois encore, est plus fort sur son lit de douleur que son ami Joseph.
« Je suis celui qui dort d’un sommeil de plomb, alors que tu veilles », écrit Czapski à Colin en 1958, un an avant la mort de celui-ci, et l’on verra plus tard à quel point, dans sa pensée et sa peinture, Czapski «expiera» à sa façon en devenant à son tour veilleur, on pourrai dire à l’imitation du Christ, ou plus humblement et précisément à l’imitation de Jean Colin d’Amiens et de Simone Weil.
Les lettres de Jean Colin à Czapski sont extraordinairement sérieuses et sereines, modestes et sincères, comme à chaque ligne de son journal. Colin est assez tôt reconnu pour son talent, il est affectueusement entouré, il continue le bel art français de Chardin ou de Cézanne et Vuillard, il est très loin de la ville et des agitations, il répète volontiers que son vieil ami Czapski est plus jeune que lui mais l’on sent aussi sa mélancolie de jeune homme qui voit la vie lui échapper « avant l’âge », jusqu’à l’arrivée de celle, Polonaise, qui veillera sur lui.
Elisabeth Plater-Syberg, nièce de Joseph Czapski, a rencontré Jean Colin avant sa maladie et l’a aimé tout de suite. Alors qu’il lui reste un peu plus d’un an vivre, Jean va vivre une passion oscillant entre le refus de mourir et la conscience lancinante de sa fin prochaine.
Le jeune Vincent Guillier, dans la même lumière d’Amiens plusieurs décennies après la mort de Jean Colin, s’est attaché à évoquer cette relation intense, pure et tragique dans un petit livre intitulé Le Jeune homme et la mort, qui situe l’amour du jeune artiste et de celle qui va veiller sur lui jusqu’à la mort dans la filiation du Fidelio de Beethoven : « Jean c’est Florestan dans sa prison », écrit ainsi Vincent Guillier, Elisabeth, Eléonore qui chante l’espoir de la libération».
Dans une atmosphère de poésie confinant à la mystique, les deux jeunes gens, également chéris par Czapski, se marieront dans la pleine conscience de l’inéluctable, peu avant la mort de Jean Colin. Les lettres échangées par les deux amis, à cette époque, ne reflètent en rien, cependant, ce qu’on pourrait croire de la «littérature», même si Czapski se dit touché par l’intérêt et l’attachement que Colin a manifesté pour la la Pologne et la poésie de Norwid.
Là comme ailleurs, l’art et la vie auront été indissociables ; et dans un dernier souffle, à son frère François, Jean l’âme pure dira simplement : «Tu sais, ce n’est pas si difficile de mourir»…
Éros pictor
Lorsque Josef Czapski m’a dit un jour qu’il «bandait» pour la couleur, avec un de ces élans juvéniles, et comme un joyeux défi, qui semblaient soulever tout à coup sa vieille carcasse de géant octogénaire repliée comme celle d’un grand oiseau en cage, dans la mansarde à plafond bas de l’Institut polonais, à Maisons-Laffitte, je l’ai pris comme un saillie, c’est le cas de dire, sachant d’ailleurs d’expérience ce que le rapport physique avec la peinture peut avoir effectivement de sensuel et d’excitant, notamment lorsqu’une forme émerge du chaos des couleurs, avec quelque chose d’indéniablement dionysiaque; et pourtant je sentais que ce que venait de lancer le cher homme n’avait rien d’ «érotique» au sens courant. Du reste, l’ayant interrogé une autre fois sur le fait qu’il n’y eût, dans sa peinture, aucune sorte de personnage, féminin ou masculin, qu’on pût dire simplement une belle femme ou un joli garçon, il m’avait répondu assez vivement, comme si je lui en avais fait le reproche, alors qu’il n’en était rien, que les clichés de la beauté ne l’avaient jamais intéressé, voilà tout !
En l’occurrence, cependant, c’est bien lui qui usait d’un terme relevant de l’érotique, ou plus précisément du langage «technique» en matière sexuelle, qu’on n’imagine pas dans la conversation courante entre personnes bien élevées, et qui disait bien ce que cela disait, comme lorsqu’un Philippe Sollers, de la peinture d’un Francis Bacon, dit qu’elle va «direct au système nerveux».
Au demeurant, on ne se figure guère Joseph Czapski, assis devant son chevalet, pas plus que Monsieur Bonnard debout devant sa toile, tous deux cravatés et sans rien de bohème, «bander» pour la couleur, même si celle-ci est chez eux un élément important, sinon violent comme chez Bacon, du plaisir de peindre
Peindre est, sans doute, un plaisir physique plus intense que celui de l’écriture, mais ce n’est pas tant une affaire d’érection de type sexuel qu’il s’agit, que d’effusion dans le tourbillon des odeurs et des couleurs, de quoi surgit la forme: c’est un plaisir du corps en alerte, à l’évidence, moins «chaste» que la tenue d’un stylo ou le pianotement de deux mains sur un clavier, mais la peinture de Czapski n’en est pas pour autant «érotique», sans qu’il y ait chez lui trace de «sublimation» non plus.
Nietzsche a montré mieux que personne, je crois, l’oscillation entre dionysiaque et apollinien, qui ne se réduit pas au dualisme entre physique et spirituel, loin de là, et moins encore à l’antinomie, ressassée par les esprits binaires, entre sensualité et puritanisme.
Czapski est-il un peintre «sensualiste» au motif qu’il dit «bander» pour la couleur ? Évidemment pas, pas plus qu’il n’est «puritain» par son refus de célébrer la beauté des corps ou des visages.
La façon contemporaine de tout ramener à des critères relevant peu ou prou de l’esthétique publicitaire, dont l’empire est celui de la séduction, pour ne pas dire du sex appeal, ne cesse évidemment de troubler les jugements, notamment en matière de représentation artistique en conflit avec la morale courante de l’époque, où l’extension exponentielle du glamour, et bientôt de la pornographie soft, puis de la pornographie hard devenue ressource commerciale à dimension industrielle, aboutit logiquement au retour des censures et de ce qu’on taxe plus ou moins de «puritanisme».
Si l’Éros, au sens déjà double, mais non point trouble, où l’entendaient les Grecs, qui englobe l’amour créateur et l’ardeur vitale, est bel et bien présent dans les couleurs et les représentations de la nature ou des objets, des visages et des personnages de la comédie humaine investis par la peinture de Czapski, l’érotisme au sens seulement sensuel ou sexuel en est absolument absent, de même que les sous-produits «psychologiques» de la gaîté ou de la tristesse, du pessimisme ou de l’optimisme. Prétendre que telle époque de son œuvre est plus «riante» que telle autre me semble aussi hors de propos que de lui reprocher de ne pas mieux «positiver» dans son approche de ses semblables, et de ne pas célébrer la nature avec plus d’allant décoratif.
Mon ami peintre Olivier Charles, émule réellement lumineux d’un Paul Klee, mais qu’impatientait mon goût très affirmé pour la peinture de Joseph Czapski, reprochait à celui-ci de «peindre sale». Mais que répondre alors ? Que le présumé Amour divin a des taches, comme le relevait Vassily Rozanov. Que Sa Création inclut de terribles bavures, ainsi que le souligne la très chrétienne Annie Dillard en désignant le scandale des enfants malformés de naissance ? Que la vie est un composé de beauté et de mocheté ?
Et si la peinture «propre» n’était qu’un beau mensonge ?
Au couvent pictural
(Premier vitrail)
J’avais écrit ces quelques lignes, que j’avais intitulées Le Royaume, en regardant une fois de plus cette toile de Czapski intitulée Billard électrique, datée de 1981 :
« Il m’arrive d’être las des murs immaculés du monastère, ma contemplation se lasse jusqu’aux rives de l’ennui, je laisse donc ma cellule et descends par les rues où Satan ne va même plus tant il se sent abandonné, mais au pied des murs tagués on fait des rencontres, Dieu m’est témoin, j’y ai retrouvé le bleu des cieux dans les yeux d’un voyou et de sa voyelle, on s’est raconté nos chutes, eux dans le doute et moi dans la certitude, et je les ai fait sourire quand je leur ai dit qu’ils étaient confiés l’un à l’autre et que ça me sauvait de les savoir au monde même à moitié crevés par la dope ».
Je relis aujourd’hui ce texte, sans rapport apparent avec le joueur de flipper de Czapski, et je me dis cependant qu’une relation réelle, profonde, existe bel et bien entre le personnage de mon religieux surgi de nulle part et ce personnage concentré sur son tac-tac mécanique imbécile tout semblable à ceux qui, quand nous étions collégiens ou étudiants, nous ont occupés des heures et des heures, l’air assez mauvais garçon de ce type et le couple de junkies avec lesquels mon fiancé du Seigneur se commet, et je revois alors le vieux Joseph et Jean Colin probablement médicamenté à outrance, et j’entends le poète polonais Adam Zagajewski murmurer son chant à Simone Weil, enfin tout fait écho dans cette espèce de conque en plein ciel que figure le couvent des prières, et je me retrouve devant ce grand escalier montant d’une gare aux cintres d’un théâtre imaginaire, à mi-hauteur duquel se tient cette impérieuse Gitane.
Elle est là. Elle est puissamment là avec ses cabas. J’ai dit : Gitane, mais je n’en sais rien. Elle m’évoque une sorte de reine babylonienne avec des anneaux dans les oreilles et des bagues à tous les doigts, mais ce n’est peut-être qu’une immigrée sortant d’un Prisunic et regagnant sa banlieue ? Elle ne croisera pas ce matin le joueur de flipper de Czapski ni mon religieux taraudé de doute et plein de foi « malgré tout », mais elle n’en est pas moins là.
Je ne sais pas le titre de cette forte peinture, datée de 1952, mais je la place au beau milieu d’un grand vitrail personnel qui me semble réunir comme une clameur de présences. Elle est en effet centrale. Toute la toile, dont j’ignore les dimensions mais qui me paraît immense, est d’une musicalité énorme. Elle en jette ! Le peintre a «bandé» pour la couleur rose d’une espèce de ballerine qui se trouve un peu en retrait de la Diva (ou peut-être est-ce un quidam assis sur une marche de l’escalier et compulsant un journal figuré par une tache blanche), on voit une femme de dos remontant l’escalier de l’autre côté avec un gosse à pull bleu paradis, et là haut bruisse une foule et se voit un ciel en trompe-l’œil bleu purgatoire.
Si le Royaume du Seigneur n’est pas de ce monde, cela se voit très bien ici : c’est un lieu de passage. Dante Alighieri a très bien représenté les degrés, les paliers, les marches d’escalier qui montent d’en bas au ciel espéré, avec les galeries où rampent les repentis et dont cet escalier pourrait être une image, entre enfer et paradis, bassesse et pardon comme ce matin chez mon moine de passage chez les paumés, et le vitrail accueillera aussi cette sorte de vieille naufragée, au milieu de ses fauteuils de théâtre rouges, qu’on trouve sur la toile précisément intitulée Femme seule – fauteuils rouges, 1968, 115×52 cm, qui s’est trouvée longtemps, me semble-t-il, chez notre ami Dimitri, et qu’il m’a semblé retrouver l’autre jour parmi les toiles «sauvées» par les Aeschlimann dans leur propre couvent pictural.
J’ai sous les yeux un dessin de Czapski représentant un jeune homme à longs cheveux en train d’écrire une lettre. Ce dessin, Joseph l’a extrait de son journal et me l’a envoyé après que je lui ai dit que je m’identifiais réellement à ce jeune homme seul et probablement désemparé, et que j’eusse aimé acquérir la toile tellement intense d’émotion, mélange de gris, de blancs et de verts électriques, qu’il en a tirée.
Czapski m’avait demandé de lui renvoyer le dessin, que j’ai gardé par distraction et encadré par dévotion. Mais où est la toile ? La toile est en mon coeur: je l’ai recopiée maintes fois, à l’aquarelle ou à la gouache, même à l’acryl, et le vitrail est en moi, le vitrail est en vous, le vitrail est en nous tous qui sommes supposés dire en quoi cette peinture nous regarde.
Je suis cet autre
(Autoportraits de groupe)
Ce type a la fin m’exaspère, qui me suit partout, me colle comme un sparadrap, me chuchote à l’oreille comme si j’étais son cheval, traîne tantôt la savate et tantôt caracole avant de me lancer comme ça, au moment même où je croyais l’avoir semé, qu’il m’attend Dieu sait où, et moi aussi puisque m’y voici une fois de plus, surpris la main dans le tiroir de ce fichu miroir.
Mais qui donc est cet échassier à lunettes ? En quoi cela me regarde-t-il qu’il me regarde comme ça, me suive comme mon ombre, me précède dans l’escalier quand je peine à remonter dans ma carrée, et surtout me surprenne un peu partout sans crier gare ?
Comme s’il me guettait ! Comme si j’avais des comptes à lui rendre ! Aussi énervant que le Petit bout de femme de la nouvelle de Kafka qui, sans discontinuer, scrute le narrateur comme Dieu le fait de Caïn jusque dans sa tombe, et ma main n’en finit pas d’obéir à je ne sais quelle Autorité, ou peut-être quelle pulsion de fuite et d’exorcisme, attrapant n’importe quel crayon ou stylo à sa portée et tirant vite fait le portrait de cet empêcheur de regarder ailleurs.
Mon journal est plein des croquis de ce «moi» qui voudrait dire «je» sans se regarder, et les croquis ont essayé de dire plus vrai en peinture, les couleurs et les coulures de l’âge sont arrivées, et jamais, jamais , jamais le type ne m’a remercié d’un sourire, non mais !
J’ai lâché le mot: surpris. Je suis surpris, j’ai toujours été surpris et cela dès mon enfance au jardin. Mais peut-être ai-je découvert à la même époque un certain bleu qui n’existait pas dans le jardin ou un certain rouge que j’avais peut-être vu dans un livre ? Je ne sais plus. J’ai été surpris de m’entendre dire un jour un petit mensonge et surpris aussi de voir dans un musée sentant le formol et derrière une vitrine poussiéreuse un veau à deux têtes, Seigneur: un veau à deux têtes!
Je n’en ai parlé à personne à ce moment-là, surtout pas à mon précepteur Iwanowski qui n’attend de moi que de la rectitude et de la platitude et se serait offusqué de me voir relever une telle aberration dans l’Ordre des Choses et douter ainsi à la fois des Plans du Créateur et des Lois de la Nature ; et par la suite je n’eusse pas dû logiquement m’étonner de quoi que ce fût dans un tel monde de vérités à deux faces, mais le fait est que je n’ai cessé toute ma vie d’être surpris et la preuve c’est que je me vois partout comme à l’improviste, et parfois même à moitié ou en morceaux: je me surprends dans le train ou dans le métro, ma tête dépasse d’un banc de compartiment où surgit dans la fenêtre de mon miroir, et même quand je me regarde immobile et debout, tout entier, ici et maintenant, là ou ailleurs, j’ai l’air interloqué comme si je surprenais quelque intrus dans l’encadrement de la porte du miroir.
Et cet air sérieux que j’ai toujours, cet air si terriblement sérieux qui ne doit rien aux apparences de sérieux du grave Iwanowski…
Je revois mes pieds dépassant de la méchante couverture malodorante d’un dortoir encore plus malodorant de tant d’autres pieds malodorants – et là encore je suis surpris de trouver ces pieds et leur odeur plutôt encourageants – je dis bien encourageants, pour la dignité de leur fonction et leur air tellement abandonné au repos; et même aujourd’hui, malgré mes tendons douloureux et comme des nœuds de mauvais acier dans mes cuisses et mes mollets je me trouve encouragé par mes pieds, ou par mes mains quand je les vois, comme des mains de vieille travailleuse posées sagement sur un édredon de sommeil , on le dit d’ailleurs: faire des pieds et des mains, pour suggérer la rage et le courage des humains.
Et les mains de ce snob, aussi, une image en appelant une autre, dont le souvenir m’est revenu au camp où nos pieds puants dépassaient des couvertures trop courtes: ces mains de harpiste ou de pianiste à t’ete de prince abyssin au teint bistre, ces bottines cirées avec autant de soin que ses moustaches et cette voix fluette et grave à la fois, cette voix tellement surprenante elle aussi et ce débit de paroles, ce flux continu, ce flot marin et je dirais même ultramarin avec ses moires vertes et grises, ces roulements veloutés et parfois même ses roucoulements de ramier caché dans le feuillage d’o et de cuivre , et voilà que tout me revient de ce Je tout autre, cet autre moi dédoublé que j’ai entendu pour la première fois là-bas sur mon lit de convalescent flottant dans les brouillards anglais, et les noms remontaient du tréfonds obscur et cela aussi est une sacrée surprise de tous les matins: comme tout nous revient !
Tous les noms de la Recherche du temps perdu, le prisonnier de guerre Joseph Czapski les a notés sur les pages de son journal : les noms d’Odette et de la Berma, de Vinteuil et des Guermantes, tous ces noms qui chantaient encore dans sa mémoire quinze ans après avoir découvert, se relevant à peine des fièvres du typhus en sa trentaine déjà marquée par tant et tant de secousses du temps, le nom d’Albertine et de Swann, de Morel et de Bergotte, et moi je m’étais longtemps endormi sur les pages de ce livre qui me touchaient sans me toucher, me charmaient par leur murmure obsédant et m’assommaient à longueur de tunnels encombrés de marquises et de raseurs, jusqu’au jour où, déclic, et à peu près la même époque ou je lus pour la première fois Proust contre la déchéance, vers les trente-trois ans mythiques du mezzo del cammin di nostra vita, je tombai là-dedans, plouf, comme Czapski y était tombé cinquante ans plus tôt.
Proust écrit quelque part, il me semble que c’est dans Le temps retrouvé, que nous lisons en nous en même temps que nous lisons son livre, et c’est exactement ce que je vis et revis depuis que je le lis et le relis, ça va faire une quarantaine d’années, et songeant maintenant aux autoportraits récurrents et très répétitifs de Czapski, toujours le même regard interrogateur et surpris, toujours le même air sérieux – peu importe alors qu’il se représente en abyme dans une série de miroirs ou la moitié du visage dissimulé par un pan de mur ou un banc de compartiment de train ou de métro – je retrouve même présence que celle du Narrateur de Proust subdivisé en cent et mille personnages réfractant, plus que son pauvre moi, son Je qui endosse toute l’altérité des comtes puants comme des pieds sous leurs brumes parfumées ou des petits Apaches prostitués (et fiancés, mariés, gentils marlous) qui frappent de chaînes les Charlus et les députés, les curés et autres messieurs masqués, et les altesses, les divas d’opéra, Françoise la paysanne et la grand-mère adorable, telle duchesse aux yeux d’un bleu tout à fait introuvable dans la nature sauf a répertorier les pierres précieuses – songeant au reflet de Czapski dans son miroir j’y retrouve tout l’homme en me rappelant soudain cette terrible analogie entre le christianisme et le communisme invoquée par Bernanos : que tous deux réclament Tout l’Homme, et c’est reparti pour la vérité à deux faces que Joseph Czapski aura vécu, à vrai dire, tout autrement, étant établi que la « totalité» communiste se sera effondrée dans les rues de Petrograd au temps de Rozanov et des débandades multiples.
La formule de Rimbaud en sa crâne Lettre du voyant à Paul Demeny, datant de ses dix-sept ans et se présentant comme un programme mystico-lyrique d’une prodigieuse envolée, vaut par sa relance du manifeste baudelairien qui rétablit une ancienne connivence entre les arts au titre des correspondances, dont les profs de lettres se figurent que c’est tout nouveau et s’agenouillent donc comme derrière eux les journalistes, alors qu’il est allé de soi, des siècles durant, que les couleurs sont musicales, que les mots et les clairons ont partie liée et que les sentiments délicats ou les clairières ne sont atteignables que par la traversées des chagrins d’enfance et des ergastules, des champs de ruines ou des charniers.
Les « autoportraits » les plus émouvants de Joseph Czapski sont des dessins de dormeurs. Ce n’est pas lui qui dort, mais c’est lui qui veille les dormeurs, de même que Proust veille les jeunes soldats morts au champ d’honneur ou sa grand-mère, le vieil écrivain Bergotte ou la pauvre Albertine qui a disparu entre les lignes faute d’inspirer au Narrateur plus qu’une jalousie folle pour une femme qu’il n’aimait pas plus que Swann n’aimait vraiment Odette de Crécy, cette conne sublime.
Je pense, sincèrement, que Joseph Czapski, le Juste, voit plus loin que Marcel Proust. Le génie de celui-ci est ce qu’il est: d’un veau à deux têtes. Ce que nous offre Czapski est autre chose, mais je n’en fais pas une affaire de personne : assez d’idolâtrie idiote !
Czapski, lui, n’est pas un monstre, du tout. Edvard Munch se représente en autoportrait dénudé et charnel : c’est exagéré et ne vaut que pour lui.
Tandis que le portrait que Czapski fait de l’homme qu’il regarde et qui le regarde dans le miroir, toujours en cravate, il nous regarde lui aussi – et ça nous regarde.
Le trait, la ligne et le chant
(Approximations sur le dessin de Czapski)
On peut n’être pas spécialiste du tout en matière de dessin, et reconnaître du premier coup d’œil un croquis rapide ou un dessin plus élaboré de Czapski, du moins est-ce mon cas, je le dis sans prétention particulière ni vanité : c’est comme ça.
Je passe en revue cinq ou six siècles de dessins européens, de tels pieds de chevaux de Léonard de Vinci à tel pâtre luttant avec un chèvre de Camille Corot, des esquisses de Raphaël à celles de Picasso, en passant par tel garçon assis du Pontormo ou tels lutteurs de Taddeo Zuccaro, telle tête de Saint Jacques de Tiepolo ou telle femme de Rembrandt avec son enfant en pleurs et son chien, jusqu’à tel vagabond de Seurat qu’aurait pu dessiner Czapski en passant, et le caractère unique du trait de celui-ci m’apparaît mieux par contraste, comme une voix unique qu’on reconnaît au téléphone.
Or à quoi cela tient-il ? Au génie incomparable d’un Maître à la Dürer ? A quelque fabuleux « coup de crayon » dont la virtuosité tiendrait du prodige ? Mais pas du tout, rien de cela !
Lorsque Louis Soutter, que Czapski qualifiait de « Van Gogh suisse », s’aperçut que dessiner de la main droite lui était devenu trop facile par virtuosité, précisément, il résolut de ne plus utiliser que la gauche, ai-je entendu dire. Je ne sais si l’anecdote est vraie, mais elle fait figure d’exemple et c’est ce qui compte pour mieux éclairer la nature particulière du dessin de Czapski, qui n’est pas plus d’un virtuose que d’un tâcheron académique ou d’un dessinateur aussi peu doué «de naissance» que prétendait l’être un Cézanne, et parfois Czapski lui-même, mais d’une main extraordinairement sensible traduisant la vision d’un regard non moins extraordinairement attentif.
Le jeune Joseph dessinait-il aussi «bien» à l’âge ou ses longs doigts couraient plus volontiers sur le clavier d’un piano que sur une page de croquis ? Je n’en sais rien, mais je constate que son trait, sa ligne, sa façon de saisir tel détail au vol, telle posture de tel personnage, telle expression de tel visage, sont pour ainsi dire constitués, «en place», en consonance dès les premières pages du journal qui nous sont restées, où le dessin fait office immédiat de prise de notes avant de s’étoffer en portraits ou en compositions plus « poussés ».
Le « don » de l’artiste est évident dès le début, mais gardons-nous une fois de plus de le considérer comme une gratification des fées qui ferait de Czapski un élu ou un champion du crayonné. Car ce regard immédiatement si personnel et le trait qui en procède sont indissociables, me semble-t-il, de l’expérience vécue par Czapski en ses âges successifs qui se traduit aussi par ses notations verbales et ses récits. À lire ainsi Tumulte et spectres, par exemple, tout se passe comme si je découvrais, sous la plume de l’auteur écrivant, les mêmes détails, dans telle relation d’un voyage aux USA, qu’aura captés Czapski par ses dessins ; et c’était frappant, déjà, dans ses récits de captivité et ses croquis « orientaux », fixant les mêmes détails avec la même justesse de ton et de touche.
Joseph Czapski était, à bien des égards, un être de passion aux élans vifs, à l’intense affectivité et aux enthousiasmes aussi marqués que pouvaient l’être parfois ses indignations et ses rejets. Cependant, et c’est sans doute ce qui le distingue des «exagérations » de l’esthétique expressionniste, sa fidélité à la nature et son respect de la simple réalité le portaient à se tenir à ce que Montaigne appelait le « milieu juste », à distinguer évidemment du «juste milieu» des tièdes.
L’image alors d’une arête parcourue, au bord du ciel, entre deux vertiges, et peut-être deux tentations opposées de se jeter dans les gouffres du désespoir ou de la vanité, me semble évoquer le mieux sa position à la fois éthique et esthétique, physique et sûrement métaphysique aussi.
Est-ce dire que Czapski dansait sur le fil que dessinaient ses doigts bien agiles et non moins bien appliqués à «dire le vrai» ? La métaphore, sans doute, lui eût paru trop facilement «poétique», et là encore il nous enjoint, à notre tour, tâchant de qualifier plus ou moins maladroitement son art, de nous en tenir à cette position modeste du «milieu juste»…
Il nous incombe, alors, en nous efforçant tant bien que mal à la même attention et à la même précision qui caractérisent ses dessins, de détailler ceux-ci du plus vite enlevé à ses portraits ou ses paysages plus travaillés.
Le premier dont j’ai envie de parler est le plus simple et le plus divin. C’est, en quelques traits continus qui semblent jetés mais forment assez exactement un corps humain dénudé aux deux bras écartés de part et d’autre d’une tête penchée en avant que dépassent deux doubles traits verticaux et horizontaux suggérant une croix, on l’a compris : une crucifixion.
Czapski n’a jamais dessiné ou peint de Christ, il l’a dit à son ami Aeschlimann et je l’ai répété, sauf à interpréter à sa façon une figure christique de Rouault, en peinture, ou ici et là quelques dessins, dont une descente de croix, sur une page de son journal des années 40 où l’on déchiffre le mot misère en français, et la copie d’une statue romane intitulée Christ sans bras datée de 1963. Quant au dessin que j’évoque ici, que je ne connaissais pas et que notre ami Richard a reproduit dans ses Moments partagés, je l’affirme «divin», au risque d’user d’un adjectif déprécié par le langage courant («quel coucher de soleil divin !», etc.) en cela qu’il est, malgré son caractère tout à fait élémentaire et sa probable exécution en quelques minutes, chargé d’une réelle spiritualité, presque aussi intense que celle qui se dégage de plusieurs portraits non moins «divins» de Maria Czapska, la sœur admirable.
Quelques traits jetés et c’est un bord de mer; un minuscule paysage réduit à un premier plan que dépassent les toits de deux petites maisons sous un nuage ; ou sur une ligne figurant le plan d’une table, un pot rempli de crayons et le rond d’un fruit ; un oiseau de profil a l’œil « indigné » ; d’une composition plus « dramatique » les têtes groupées de huit hommes aux bouches ouvertes qu’on devine les prisonniers d’un camp ; la tête d’un dormeur chauve endormi au prénom indiqué d’Adam et daté de 1941 à Griazowietz; un autre jeune homme endormi ou peut-être en posture de songerie solitaire évoquée avec quelle tendresse en 1950 – probablement aux Etats-Unis, lors du même voyage relaté dans Tumulte et spectres et qui explique la présence de tel Noir à chapeau lisant dans un compartiment de train ou de métro, de tel autre personnage lavant sa voiture de dimension visiblement « américaine » à rehaut vert au crayon, devant laquelle passent deux autres personnages; et le journal enchaîne ensuite les dessins «au vol» ou plus «construits» de ce joli visage d’enfant, de ces rails de chemin de fer sous les portiques de fer d’une gare, de ce cycliste en petite tenue et de ces gens à tous les coins de rues, dans les cafés et les trains, la vie qui défile enfin sous tous ces aspects et, à tout coup, s’agissant des humains ou des animaux, la ressaisie absolument précise de chaque posture des corps et de chaque expression des visages (alanguis, déhanchés, busqués, butés, absents, concentrés, etc.), et l’on voit cette vie profuse se répéter et, je n’exagère pas : déferler de tous côté sans jamais céder au bavardage ni à aucune mécanique de ressassement au gré léger ou plus appuyé de la main de l’artiste accordée à ses yeux bien ouverts et à son esprit en éveil constant – le dessin devenant aussi bien constant dessein.
Car rien, ici – et c’est en cela que le dessin de Czapski est constamment surprenant, constamment travaillé par la surprise – n’est jamais gratuit ni juste décoratif, sans être soumis pour autant à aucune volonté pesamment laborieuse que dicterait une «visée artistique» et le «devoir» de s’exprimer à tout prix. Là encore, pourrait-on dire, un tri s’opère en accord avec l’humeur du moment et la porosité plus ou moins en alerte, pas toujours mobilisée loin s’en faut, et l’artiste se reprochera souvent de manquer d’attention, mais le carnet n’en reste pas moins à portée de main et voici devant moi, à bord de ce taxi ou de bus, ce chauffeur de taxi noir à casquette bleue dont l’image cadrée m’est bel et bien offerte comme un cadeau – donc je note -, ou voilà ces quatre personnages assis et debout (une femme rouge, une verte et deux hommes bleus), plus le genou dépassant de côté d’un quatrième usager de ce train ou de ce métro – je capte dans la foulée comme j’ai capté juste avant ce profil de femme à turban et lipstick vermillon, et quand j’aurai plus de temps je reprendrai le motif en plus grand : ce groupe de buveurs au zinc deviendra peut-être tableau, car tel est aussi mon dessein, mais le dessin existe en tant que tel et je le signe et le date, non tant par vanité ou révérence à la postérité mais pour que ce cadeau « prenne date» et mes initiales sont là pour le confirmer, après quoi mes amis venez et voyez, voyez à votre tour et prenez si cela vous chante.
C’est cela même en effet : le dessin de Joseph Czapski, qu’il soit «essai de voix» ou qu’il soit tout ouïe et tout œil, dansant sous la main de l’artiste ou grattant, griffant ou glorifiant , chante et signifie.
Coquets et caquets
La scène se passe dans un restaurant de la Rive droite, un soir de vernissage à la galerie parisienne Lambert, en 1974, c’est la première fois que j’ai vu un ensemble conséquent de toiles de Joseph Czapski et que mon regard en a été marqué, j’ose dire: à vie.
Il y a là une dizaine de personne autour d’une table dont il me reste ce portrait de groupe signé Richard Aeschlimann. L’on y reconnaît, notamment, Vladimir Dimitrijevic et son pair éditeur Bernard Laville, Constantin Jelenski, dit Kot, qui me fait penser aussitôt à un noble proustien avec ses grands yeux liquides et sa voix charmeuse ; il me semble que nous étions déjà là à parloter depuis plus d’une heure lorsque l’immense vieillard à béret basque et long manteau noir est apparu – , ce qui s’appelle apparaître, a retiré son interminable écharpe de laine et à pris place à la table où la conversation roulait sur toute sorte de sujets dont je n’ai aucun souvenir sauf qu’en fin de soirée il fut question de Pompidou à propos duquel je me rappelle que Jelenski s’était mis à pérorer vivement au point que Czapski, sur le point de se lever pour regagner sa banlieue en Vélosolex, éleva soudain la voix contre son brillant ami et, nous prenant à témoin, nous enjoignit, à la fois affectueux et virulent à l’encontre du fameux Kot, de ne pas l’écouter tout en le taxant à plusieurs reprises de coquet, oui de coquet – et j’entendais malgré moi, dans le roulement de sa voix très haut perchée feignant l’indignation, le mot de caquet !
Je ne sais quels liens unissaient exactement Constantin Jelenski et Czapski. Je croyais situer, déjà, le compagnon de la très belle et plus ou moins mythique Leonor Fini pour avoir rencontré, deux ans auparavant, tel éphèbe à l’androgyne blondeur qui m’avait dit, jeune peintre, être chargé de préparer les fonds des toiles de la Diva aux yeux de chat ; mais à vrai dire j’ignorais la dimension réelle de ce très éminent représentant de la Pologne exilée, ses faits d’armes et ses nombreuses entreprises au service de la littérature de son pays et de ses écrivains majeurs – j’avais bien lu une de ses traductions de Gombrowicz et connaissais son Anthologie de la poésie polonaise, mais je le jugeais superficiellement, cependant une chose était déjà certaine à mes yeux, qui se vérifierait les années suivantes, d’ailleurs confirmée par Czaspki lui-même, et c’était que l’on ne pouvait imaginer d’univers plus différents et même plus opposés l’un à l’autre que celui de ce couple célèbre hautement raffiné, voire sophistiqué, et celui de Czapski.
Mais comment, me suis-je sûrement demandé ce soir-là, l’auteur de Terre inhumaine pouvait-il donc frayer avec de tels mondains, de tels coquets et de tels caquets ? Et sans doute était-ce, une fois encore, le jugement d’un jeune homme concluant trop vite à la complaisance sociale voire à la «compromission», mais j’ignorais alors qu’on pût être à la fois un artiste voué à la solitude et un homme vivant dans un milieu familial et social quasiment surpeuplé, je ne savais rien de Bernanos sans cesse dérangé par sa turbulente tribu, ni de la vie de mon ami Tchekhov non moins submergé par la présence de ses proches et de ses amis – et le cherchant souvent au demeurant. En petit provincial farouche, voire asocial, je n’étais pas en mesure ne serait-ce que d’imaginer la vie réelle de Czapski dans son logis de l’Institut polonais, avec les résidents de celui-ci et l’incessant va-et-vient des visiteurs de toute espèce, moins encore de me représenter, par delà les tribulations de la guerre et de l’exil, les vicissitudes quotidiennes liées à celui-ci et ces petitesses, voire ces mesquineries qui font aussi partie de l’épaisseur de l’Histoire.
Or, plus de quarante ans après cette mémorable soirée, et plus encore en me rappelant le véritable choc éprouvé ce jour-là à la découverte effective de la peinture de Joseph Czapski – dont aucune reproduction même fidèle ne donne une idée réelle de la présence, ce que représentaient alors, en réalité les «coquets» et les «caquets», fétus de la futilité dans le flot de la vie, ne m’apparaît plus aujourd’hui que sous un jour plutôt anodin, voire comique, alors que la meute sociale a transformé le papotage de naguère, qui fit l’ornement des salons parisiens, en jactance omniprésente et sans la moindre intonation personnelle, répercutée à outrance par les réseaux dits sociaux et qui tendent au contraire à défaire le lien social, à promouvoir l’insignifiance et la vacuité, à détruire toute intimité sous l’égide de l’indiscrétion et de la muflerie, à tout noyer enfin dans l’indétermination, à tout empiler en tas et à conclure au n’importe quoi.
Présences
(Vitrail des personnes ou le poids de la chair)
La particularité du vitrail est de n’apparaître que sous l’effet de la lumière, de ne flamboyer qu’au soleil. L’image est peut-être imparfaite, s’agissant de la peinture de Czapski, mais je parlerai de la présence irradiante de certaines de ses toiles, que j’ose dire « éclairées » par mon regard autant que par leur « être » particulier, comme de celle de «vitraux» tirés de la grisaille des murs par le double effet de leurs couleurs soudain révélées et du regard qui les accueille – présence virtuelle et ferveur partagée.
Rien pour autant de particulièrement «brillant» dans ces représentations de la densité humaine, et surtout dans les sept portraits de femmes que j’aimerais évoquer maintenant.
Comme Alfred Loisy a écrit « Jésus annonçait le Royaume, et c’est l’Eglise qui est venue », Czapski prend les devants en lançant, à ceux qui lui reprochent la «laideur» de ses figures humaines. « on attendait des jeunes filles et ce sont de vieilles femmes qui sont arrivées ».
Sept femmes donc, à trente ans d’intervalle, chacune femme de peine à sa façon, de la diva d’opéra dans son affliction terrible (Patricia Deway en Tosca, 1953) à la funèbre Concierge de 1984 évoquant un spectre humain au premier regard, en passant par La repasseuse (1954) au graphisme élémentaire pour ne pas dire fruste, la croyante majestueusement profilée de Rosaire (1956) la vieille sans visage de Femme forte (1965), la pauvre aveugle à canne blanche et jambes emmaillotées de Misère (1971), ou encore la monumentale négresse sur son banc de Femme seule (1979), autant en effet de solitudes féminines aussi faibles en leur forte apparence que fortes en leur faiblesse non moins évidente, toutes immobiles et peut-être en attente du Royaume ?
Je me trouvais ces derniers jours, dans le métro de Paris, le matin et le soir, à donner la pièce à ce vieux frère humain au curieux bonnet de skieur vert pâle et rose à fine étoiles bleues, debout au sommet de l’escalier mécanique de la station Jourdain, dans le quartier donc de Belleville, qui avait pendu à son cou un petit écriteau indiquant, au feutre noir, l’âge du capitaine en salopette à motifs de camouflage jaunes et verdâtres ici et là tachée de gros rouge : 80 ans. Or l’attention de Czapski eût probablement été électrisée par cette macédoine de couleurs fripées, dont se détachait le jaune tilleul d’une camisole visible dans le décolleté de sa chemise bleu pâle en loque, et les mains du mendiant, aussi finement nervurées que du vieux papier mâché, se retenant d’implorer à la manière théâtrale de la Tosca de Patricia Deway, et ses yeux incolores.
Des clodos de cet acabit, Paris en est plein depuis les époques de Daumier, des misérables de Hugo ou des gueux de tous les temps, et des femmes seules, et de la misère, et me retrouvant donc dans le métro et dans les rues, de multiples apparitions semblables, «à la Czapski», m’auront surpris, comme cet autre SDF dormant contre une guérite en plein midi, au bord de la pièces d’eau des Buttes-Chaumont, ou cet autre gisant d’une sorte plus sordidement à l’abandon en son apparence défoncée, mais est-ce à dire que la peinture de Czapski, qui nous fait certes voir autrement ces figures de solitude ou de détresse de la grande ville, se réduise à ce qu’on a pu dire un «théâtre du quotidien», comme si celui-ci était un spectacle, sinon un show ? Or, serait-il exclu d’imaginer «des Czapski» dans la cour d’une ferme, sur une plage mondaine, dans la foule d’une discothèque ou dans la salle d’attente d’une banque ? Et s’il fallait plutôt regarder, d’abord et avant tout, dans ces représentations humaines, – mais on verra que cela touche aussi aux objets groupés en « natures mortes » ou aux paysages – la chair de tout çà, l’épaisseur et l’espèce de grâce vivante de tout ça, la pesanteur et la fragilité de tout ça, l’apparente laideur de tout ça et l’éventuelle beauté que tout ça peut acquérir en nous par le truchement de l’art, dans la transposition de formes et de couleurs trouvées par l’artiste.
Dans sa série de portraits de femmes au travail, le filmeur Alain Cavalier s’est attaché à l’observation d’une repasseuse parisienne, fort différente évidemment de celle de Czapski, mais dont il émanait une dignité naturelle qui se retrouve dans le geste merveilleusement précis, prévenant et compétent du personnage de vieille au visage presque réduit à de lourdes bajoues, la main gauche presque à une patte plate et la dextre presque à un crochet de bois – autant de presque ignorant le détail bien plus raffiné qu’on ne dirait de tout ça, la bonté et la beauté du geste, l’indicible présence de la vieille femme à la tâche sous sa lampe à fines franges de perles multicolores, dûment ressaisies par Czapski.
La chair selon Czapski n’est pas flattée, pas plus qu’elle n’est humiliée : elle est montrée et l’on se dit à tout coup que «c’est comme ça».
La chair de la pauvre Tosca est dramatisée par Patricia Deway. Je ne sais à quel moment de son visible lamento le peintre a ressaisi ce qui semble une imploration au masque de douleur, mais le réalisme expressif de la scène dépasse tout réalisme convenu autant qu’il intériorise ce que la toile a de bel et bien expressionniste, et la tonalité du tableau, ce qu’il faut bien dire l’âme du tableau sont rendues par des moyens picturaux et non point « littéraires » ou « théâtraux ». Nul besoin de connaître les détails affreux de ce que vit ou va vivre la diva de Puccini face à l’horrible Scarpia. Les bras de Tosca sont d’un rose veiné de bleu qui sanglotent pour ainsi dire, comme sanglotent ses longues mains aux doigts éperdus, et beaucoup de noirs se font écho entre la robe de Tosca et ses yeux et sa coiffure et la dominante sombrement chinée de multiples marrons bleutés du fond de la toile alors que la solennité du lieu et du moment se trouve campée par le grand fauteuil au tissu picturalement très «pioché». Tout cela comme jeté, mais notre œil est puissamment requis et découvre peu à peu le relief et la foison colorée de «tout ça», la puissance poétique de «tout ça» évoquant bel et bien la sombre terreur sadienne de la fin de cet opéra, et c’est d’une femme seule qu’il s’agit, et c’est l’art qui sanglote (« vissi d’arte, vissi d’amore », etc.), le diadème et les bijoux de la Callas seront plus voyants mais l’émotion est dans l’air déchirant et follement intense dont j’imagine ici la citation précise…
La vieille chrétienne de Rosaire, toute de profil et les mains jointes, l’air d’un possible prélat à grand nez impérieux à lippe prononcée autant que d’une vénérable bourgeoise de paroisse, trône elle aussi sur la matière molle et picturalement « piochée » d’un fauteuil ou d’un canapé, avec l’air de dire, sans le dire, ce que répètent en soupirant les vieilles croyantes qui en «ont vu d’autres», comme on dit, et qui sont là à songer ou à prier, on ne sait, à brasser mentalement des années de souvenances ou à ne penser à rien, juste laissant s’échapper la formule évoquant peut-être, ou peut-être pas, le fatalisme de L’Ecclésiaste ou la résignation confiante des Béatitudes : «Ma foi »…
Le seul titre de Rosaire éclaire le «vitrail», si j’ose dire, et si le noir m’évoque ici Goya, la chair «lumineuse» du visage et des mains me semble plutôt nous ramener, justement, du côté des couleurs cernées de plomb ou de noir des vitraux ou des tableaux bibliques de Rouault; cependant la figure, le portrait, le «paysage intérieur» représentés par Czapski, échappant une fois encore à l’anecdote «littéraire» du naturalisme, me semblent réaliser une synthèse appelant de ma part le même constat relevant, plus que de la religiosité conventionnelle, d’un regard sur l’humanité dont on a pu dire qu’elle était «ma foi», capable du ciel…
Le terme de caricature a été utilisé, ici ou là, à propos de certains personnages apparaissant dans les dessins ou les toiles de Czapski, mais cela ne me semble approprié ni dans l’intention du peintre, qui ne donne jamais vraiment dans ce qu’on appelle le «portrait-charge», d’où est issu le terme de caricature, ni non plus dans la nature même de ces portraits dont le caractère semblant exagéré ne dépend pas de celui qui observe mais des données de la vie même, ou, s’il y a déformation stylisée, dans le besoin pictural lui-même,
La meilleure preuve en est l’accablante figure de la Femme forte, qu’on pourrait croire une lourde charge satirique à valeur de critique sociale, avec l’opposition de la vieille à vilain chapeau, prostrée sur son banc de métro, et de la publicité célébrant tout à coté la force féminine en grandes lettres, mais l’on n’est plus ici dans l’anecdote à visée plus ou moins ricanante ou polémique: on est devant une expression picturale réfléchie et construite de l’épaisseur de vivre, contraste du plus existentiel rugueux et du plus artistiquement concerté.
Tout de cette toile pourrait être dit rebutant, à commencer par le lugubre personne représentée sous la lourde cloche de son chapeau, farouchement repliée sur elle-même et dont le peintre a réduit les traits du visage à une sorte de masque d’ombre dont ne ressort qu’un pif orange. Moins avenant tu meurs ! mais le « vitrail » est également là, picturalement donné entre lignes abstraites et couleurs vives, comme saturé de présence humaine dans ce décor pour ainsi dire enluminé par la peinture. Or, quelques années plus tard, deux autres « fortes femmes » imposeront une même présence à la fois écrasante et bonnement magnifiée par la couleur.
La toile intitulée Misère indique précisément, dans l’opposition de l’ombre et de la lumière que la vieille femme à la canne blanche lie et sépare à la fois de sa pesante présence, cette contiguïté contrastée de la déploration et d’une certaine exultation liée à la vie même – suggérée ici par le contraste heurté des couleurs, avec le bleu du vêtement de la vieille dame et le jaune pisseux de la paroi de ce qui semble une salle d’attente, ou le vert de pauvres pantoufles et le blanc de probables pantalons d’intérieur, à quoi s’ajoutent le premier plan dallé figurant l’espèce de relief ondulé et polychrome d’un sol mouvant.
Mais où donc ai-je déjà vu ce jaune hépatique ? Les salles d’attente de Vincent ne sont-elles pas du même jaune un peu maladif en contraste avec les verts pharmaceutiques et le bleu fatigué des vieux lainages ? Et qu’est-ce que cette misère dont parle Czapski en l’occurrence ? S’agit-il de la misère en général, à titre symbolique, ou devons-nous oublier le mot de ce titre pour nous pénétrer, une fois encore, de la présence qu’il traduit ou, plus exactement, que la toile concentre sous nos yeux.
Il y a des années, sans doute, que j’ai vu pour la première fois cette toile de Czapksi dont la vieille au visage marqué par les épreuves se penche vers la terre cruelle; cette malheureuse est en moi dont les pauvres jambes m’en rappellent d’autres au temps de nos enfances quand défilaient, sur la route gelée de l’hiver, les misérables pensionnaires d’un asile voisin semblablement engoncés dans de bleus lainages et processionnant sous la lumière pisseuses des réverbères trouant la semi-obscurité neigeuse de ce long et glacial hiver 1956 – voilà ce qu’aura pu me dire cette Misère de Czapski qui pourraient dire tout autre chose à tous ceux qui la regarderont avec ce même sentiment que j’éprouve que «cela les regarde»…
Quant à la Femme seule, qui a l’air d’un vieux nègre alors que c’est une vieille négresse assise sur un banc dur au bois de chaude couleur jaune orangée, elle trône en sa présence noire (noirs le costume, le bonnet et la chaussure en pointe ) dont le visage seul se moire de rose et de bleus violacés, monumentale en sa façon d’occuper le stable triangle ascendant de la toile dont la diagonale du quai dallé aux belles grandes cases de bleu et de jaune orangé suggère peut-être une autre voie que celle de la solitude prostrée, va savoir, c’est là encore une échappée par le chemin de couleurs, enfin ce qui est sûr une fois de plus est l’évidence lourde massive, humaine, de cette présence.
On en a vu d’autres, pourrait-on se dire en se rappelant cent, mille femmes seules dans le métro, et combien d’homme non moins fragiles et présents, mais ici l’arrêt tient à un seul titre (Femme seule) dédié à cette seule personne.
Enfin le vitrail se trouve, loin du ciel vraiment, comme réduit à une apparition lugubre (La concierge), de pauvre vieille sœur en misère de l’aveugle qui tient elle aussi une canne mais bizarrement son bras gauche la portant plus qu’elle ne s’appuie dessus, la caboche est à peu près d’un masque funéraire, la palette réduite à un camaïeu de noirs et de gris à vague rehauts bruns rappelle le personnage de théâtre rampant sur scène dans le rôle du Revizor de Gogol, ou l’autre apparition, plus sinistre encore, de la vieille pensionnaire d’asile traversant l’enfilade d’un couloir.
Et si c’était votre mère ? Et si cette concierge continuait de vous attendre au pied de ce mur noir devant lequel il vous semble distinguer maintenant le tronc d’un arbre, et si ce qui nous a semblé d’abord une face hideuse et ricanante était moins repoussante en réalité qu’au premier regard de surface, où apparaîtrait, à y regarder mieux, un sourire plutôt qu’une grimace ?
Et si, dans sa nuit à lui, peignant cette grande toile à tâtons, Joseph Czapki, bientôt nonagénaire, avait voulu nous dire une fois encore que nous regardons mal ? Voyez ma concierge aux jambes écartées comme les vieillards de tous pays qui on ont marre mais se tiennent encore bien là, voyez comme elle continue de tenir son rôle de gardienne d’immeuble, voyez donc l’humanité que j’ai regardée depuis tant de temps et un peu partout.
Vous attendiez l’Église et ses beaux atours, et ce sont les humbles qui vous regardent !
Derrière la cravate
Dans une lettre à Jean Colin datant de 1956, Czapski évoque la visite de Julien Green à sa dernière exposition parisienne, au terme de laquelle l’écrivain lui fait observer que sa peinture est «encore plus lugubre» que ses romans, ce qui ne semble pas enchanter vraiment le peintre, mais au moins Green s’est-il déplacé contrairement à Mauriac ou à Malraux, alors même que Czapski se plaint de ce que, probablement, un Jean Cassou ne voit en lui qu’un «exilé réactionnaire».
Or je parle de Julien Green, cité à plusieurs reprises dans les lettres de Jean Colin, non tant parce qu’il y a chez lui un véritable amateur de peinture, que son raffinement «à la française» empêche peut-être de discerner vraiment ce qui apparie, en profondeur, l’art de Czapski et sa propre inspiration, mais du fait de sa cravate. Il y a chez Julien Green un fond de violence sacrée, mais l’auteur de Mont-Cinère et de Moïra, en ville, est très strictement peigné et cravaté, de même que Joseph Czapski, jusque devant son chevalet, porte la cravate plus que la lavallière bohème des clichés, sagement assis au lieu de gesticuler, sans bouteille à sa portée ; et le soir il ne rejoindra pas le babineux Soutine au lupanar.
Que veux-je dire par là ? Je veux dire que la cravate de Joseph Czapski, qui n’est en rien le signe d’un guindage social, autant que la cravate de Julien Green, qu’il portait aussi naturellement par respect de lui-même, plus encore que des convenances, m’indiquent une exigence de tenue que j’entends m’imposer également dans mon approche à col ouvert – chacun son style.
Intrigué par la remarque faite par Julien Green à propos de la peinture de Czapski déclarée «encore plus lugubre que ses romans», j’ai été amené, tout récemment, à revenir à ce grand écrivain dont j’ignorais à vrai dire à peu près tout – en dehors de souvenirs scolaires épars et de lectures sporadiques -, à l’occasion de la publication, tapageusement accueillies par le médias, de son journal en version non expurgée, où le moins qu’on puisse dire est que l’auteur se décravate et se met à nu sans rien perdre, pour autant, de son élégance et de son humour en dépit du caractère scabreux de ses notations quotidiennes jugées impropres à la publication de son vivant.
Joseph Czapski eût-il été choqué par le dévoilement de la vie privée d’un écrivain dont on connaissait évidemment les mœurs mais qui ne s’en était jamais prévalu sur la voie publique à la manière d’un Gide, et qui avait bel et bien autorisé ses héritiers à la publication intégrale de ce journal à titre posthume ? Probablement pas plus qu’il ne l’aurait été par la lecture non expurgée des carnets de son ami Thierry Vernet, lestés eux aussi du «misérable petit tas de secrets» dont parle Malraux.
Quant à moi, immédiatement captivé par la lecture du journal « intégral », après avoir ignoré la version censurée, et nullement déçu par la découverte, sous la cravate de l’écrivain posant pour la postérité, d’un homme souvent en proie à la fringale sexuelle, mais pas intéressé « plus que ça » par le détail cru de ses fredaines, je n’ai pas tardé à me rendre compte que cette détermination à «tout dire» par souci de sincérité et d’honnêteté, ne prendrait de vrai sens que dans le «passage à l’acte» du roman, où la cravate ne serait pas l’insigne d’une pudeur familiale ou sociale mais une question de style et de libre transposition. Aussi bien la lecture des romans de Julien Green, amorcée avec le prodigieux Moïra, poursuivie avec Mont-Cinère et Le visionnaire, Léviathan et Adrienne Mesurat, m’en a-t-elle appris infiniment plus, sans cravate ou sous de multiples vêtements et masques d’emprunt, que le texte brut du journal dont l’intégralité du «tout dire» reste finalement limitée par sa forme même, en deça de tout travail poétique.
En lisant le journal intégral de Julien Green, livrant au public le «misérable tas de petits secrets » évoqué par Malraux, je pense au journal de Czapski , dont j’ignore s’il contient la moindre page à caractère secret que celui-ci aurait écrite par manière d’aveu et d’exorcisme , et n’en éprouve d’ailleurs aucune curiosité. La matière très intime que l’écrivain a choisi d’expurger de la publication de son journal, de son vivant et afin de protéger son entourage, est intéressante pour qui la rapporte au contenu des romans constituant la mise en forme de son magma d’érotomane (Green lui-même se qualifie par ce terme) dans un effort de transposition exemplaire aboutissant à un objet dégagé de toute anecdote.
Les voyeurs et les moralistes à la petite semaine se seront jetés sur cette version intégrale, ménageant à vrai dire un aperçu sur la partie la plus partielle de la vie du grand écrivain, dont le caractère d’intégralité est tout autre dans les romans. Si le fait de rencontrer l’écrivain «derrière» la cravate gênera d’aucuns, et plus encore d’aucunes, je ne saurais dire qu’il en souille l’image dans la mesure où il contribue à dévoiler «toute la vérité» que voulait exprimer Julien Green, fût-ce après sa mort et la dispaarition des personnes concernées. Mais sans les romans, qui constituent le dépassement génial de son chaos, la démarche paraîtrait d’un intérêt bien limité, voire douteuse.
Quant à Joseph Czapski, l’idée seule d’aller fouiller l’éventuel « tas de secrets» de sa vie intime me semblerait tout à fait inconvenante et déplacée dans la mesure où les objets de sa peinture ne sont en rien liés, comme c’est le cas chez Julien Green a une dramaturgie d’ordre moral, affectif, sexuel ou religieux.
Est-ce à dire que l’œuvre de Czapski soit toute sublimation ? La réponse me semble impossible et probablement sans intérêt dans la mesure où ses objets nous parlent d’autre chose que du cœur ou de la confusion des sentiments et des pulsions: de la réalité toute nue qui n’est pas celle de Vénus sortant du puits en ondulante ondine, mais du bord du gouffre ou voisinent la beauté du monde, le poids de la chair et l’ombre de la mort. D’une façon analogue, je doute qu’aucune approche de type psychanalytique nous apprenne quoi que ce soit de déterminant dans la compréhension de sa peinture et même de sa personne.
Retour alors au vrai sujet, devant les objets. Ceux-là seuls nous regardent en somme.
Peinture-peinture
Czapski a dit, écrit et répété maintes fois que lorsque ses amis artistes et lui débarquèrent en 1924 à Paris, où ils restèrent sept ans au lieu des six mois programmés, leur seule visée commune était de rompre avec l’académisme polonais plombé, notamment, par le réalisme historique, au bénéfice de ce qu’il se plaisait à appeler la «peinture-peinture». Mais cette crâne appellation, à la fois explicite et vague, se distinguait autant de la vieille école que des multiples «ismes» proliférant à l’époque, à commencer par le « formisme » polonais, professé par Stanislaw Ignacy Witkiewicz et son compère August Zamoyski qui entendaient rompre eux aussi avec la représentation conventionnelle sans adhérer pour autant à l’abstractionnisme, non plus qu’au tachisme – avatar pourtant possible de la peinture-peinture – ou à l’expressionnisme.
Alors de quoi s’agissait-il ? Je présume que chacun des douze membres du Comité de Paris (ce Komitet Paryski désignant le groupe des kapistes), de Jan Cybis à Zygmunt Waliszewski, pour ne citer que le premier théoricien du groupe et son pair souvent évoqué par Czapski, répondrait différemment, ainsi que l’illustrent d’ailleurs leurs œuvres respectives. On sait leur dette commune au maître de l’école des beaux-arts de Cracovie, Jozef Pankiewicz, précurseur polonais du néo-impressionnisme auquel le critique d’art Joseph Czapski a consacré sa première monographie, et leurs références majeures aux œuvres de Cézanne et de Gauguin, de Van Gogh ou de Bonnard, voire de Soutine ; mais on voit aussitôt le peu de points communs liant ensemble ces œuvres exaltant assurément la «peinture-peinture», ou disons la création picturale dégagée (plus ou moins) du «sujet», de la «littérature» voire de la représentation, quoique là aussi le malentendu, aux franges de l’abstraction, n’en finisse pas de perdurer et de ressurgir tout au long de l’œuvre du seul Czapski.
Celui-ci, d’ailleurs, dans un article lumineux paru en 1960 dans la revue Kultura sous le titre de L’Abstraction – le pour et le contre -, montrera combien cette notion d’abstraction, sous son air tranchant et bien «cadré», prête à confusion en une époque où, socialement, elle apparaît comme l’aboutissement logique et exclusif de l’art contemporain, alors que les «abstraits» eux-mêmes, tel un Bazaine, la relativisent parfois, tandis que des historiens de l’art, comme le philosophe Etienne Gilson, en redéfinissent complètement les tenants et les aboutissants, au point de voir de l’abstraction chez un Uccello, un Véronèse ou un Rembrandt – Jean Bazaine pour sa part trouvant plus d’abstraction chez un Douanier Rousseau que chez un Paul Klee…
Quant à Czapski, nous avons l’occasion d’en redécouvrir aujourd’hui l’œuvre d’un œil neuf , à quoi peut nous aider, paru ces derniers temps, le grand beau livre d’art très richement illustré conçu par Eric Karpeles à la suite de sa monumentale biographie, avec un choix de reproductions admirables qui a le mérite particulier de nous faire entrer littéralement «dans» la peinture de Czapski dont chaque toile est resituée dans le mouvement de l’œuvre avec l’ajout, parfois, de dessins préparatoires implicitement explicatifs.
Regarde le monde qui te regarde, regardez ces objets qui vous regardent, regardons ces êtres qui nous regardent: ici commence l’apprentissage auquel nous convie Éric Karpeles , que chacun mènera à sa guise selon ses moyens.
Pour ma part, je m’efforce d’oublier toutes les théories, les références à telle ou telle école, les supputations et les extrapolations, les beaux discours et les brillantes dissertations pour dire, avec le langage qui est le mien, ce que m’inspirent les œuvres de Czapski en leur langue propre.
Tels objets: un grand vase bleu, un pain, un bouquet de mimosas. Ou tels sujets: un mendiant sans visage, un jeune philosophe au grand front, une vieille dame devant un train.
J’ai vu et revu le Vase bleu au moins une centaines de fois, à travers les années, la plupart du temps en reproduction mais aussi de tout près, la première fois à l’exposition de Chexbres de 1985, et je crois savoir qu’il existe deux version de la même toile datant à peu près de la même époque alors que Czapski, dans une lettre à Colin datant de la dernière année de la vie de celui-ci, à l’occasion de son mariage in extremis avec l’amour de sa vie, propose au jeune couple plusieurs toiles à choix par manière de cadeau, dont un autre vase bleu.
Et que me dit ce bleu ? Il a pour moi valeur d’aura. Je me rappelle ce que me disait un vieux libraire tabagique, selon lequel la couleur bleue était à l’origine celle des auréoles de la peinture religieuse ancienne. Sans le vérifier même je me range à cette vérité devant le bleu irradiant de ce vase sur fond de nuit brune comme la terre quand on la regarde le regard baissé, posé sur le même guéridon qui a servi à mes Poires sur fond rouge, d’un noir semblable à la nuit noire où affleureraient de multiples, minuscules étoiles du même bleu que le vase. Je me rappelle aussi que Czapski lui-même, dans l’une de nos premières conversations, me disait qu’il ne se souciait en rien du symbolisme des couleurs, aussi le silence devant l’objet de contemplation me semble-t-il s’imposer sans que j’aie à m’expliquer sur la raison qui fait que je revienne et revienne boire à la source de ce bleu.
Or la soif de ce bleu n’a de pareille que la faim de brun d’un certain Pain, que je dirai le pain de vie sans allusion symbolique forcée.
Ce que ce pain me dit ou me suggère est notre affaire à tous, ici magnifié et merveilleusement conforme, non pas au cliché du pain mais à une sorte d’icône familiale de partout et de toujours, des cuisines de fermes obscures aux tables princières et pour tous les enfants qui seront des vieillards après une vie à «gagner leur pain», comme on dit.
Ce pain n’est pas tant un symbole ou un archétype q’une réalité poétique première, résultant d’une opération quasi alchimique et millénaire aux retombées actuelles souvent avariées en leur forme de spongieux produits d’usine et qui restent pourtant le pain puisqu’ils assurent la survie de nos frères humains.
Czapski serait-il outragé si vous lui demandiez de peindre ce matin un de ces infâmes pains sortant de fours à micro-ondes qu’on trouve sur les aires d’autoroutes ? Je n’en sais rien. Peut-être cela dépendrait-il de la couleur et de la texture du papier froissé qui jouxterait ce pain-là, ou de la forme de quelque objet qui pût retenir son attention ? À vrai dire, comme tout fait miel au psalmiste , tout peut «faire pain» à Czapski me semble-t-il
Donnez-moi n’importe quel objet, ce cendrier par exemple, n’importe quoi et je vous en tire un récit, lançait Anton Tchekhov à un compère par manière de défi, étant entendu qu’aucun objet regardé par l’écrivain ne serait réduit à n’importe quoi.
Ainsi, comme par réverbération, devenons-nous l’objet du récit de ce pain de Czapski, qui fait écho en nous à des images de nos enfances aux abords de nos villes et de nos villages.
Ce pain est un soleil en croûte vernissé du même brun roux à reflets orangés que les cafés d’Amsterdam, avec quelque chose d’Espagnol plus que de parisien. Il repose sur un guéridon souvent réutilisé par le peintre avec les nuances induites par la lumière et l’esprit du sujet, et voici qu’il lui vient ici un bouton bleu ciel à l’aplomb du bol noir qu’on dirait un cratère de lave traitée en céramique ; enfin chacun ajoute les images qui lui chantent, mais pour l’instant ce pain a valeur à mes yeux de parole d’Évangile, avec un clin d’œil bleu.
Si ce pain devrait recueillir les suffrages de ceux qui attendent d’un tableau du genre nature morte qu’il soit « bien peint », et s’il ne semble en rien assimilable à ce qu’on appelle l’abstraction, le petit vase bleu aux mimosas qui , chaque matin, en notre maison sur la hauteur de La Désirade, nous accueille d’un joyeux crépitement d’étoiles – lesquelles ne sont à vrai dire, et plus précisément, que de hâtives giclures jaunes constellant un fouillis feuillu suggéré à vifs traits verts et noirs -, pourrait être dit au contraire exécuté « à la diable » par ceux-là qui n’en verraient pas plus le caractère de toile abstraite que n’en ressentiraient la poésie d’essence toute pareille, à mon goût, à celle du pain.
De fait, arrachée en 1985 à la pénombre de la cécité à gestes rapides par le quasi nonagénaire fort d’une vie entière de science picturale acquise et poussée ici jusqu’à une synthèse fulgurane, cette toile, qu’on dirait à la fois celle d’un enfant, m’évoque autant la joyeuse pureté d’un Matisse qu’elle marque une pointe de l’art le plus libre, tout spontané d’apparence et ceoendant construit avec quel équilivre et quelle harmonie de formes et de couleurs, poussant la hardiesse jusqu’à doubler le sujet en ombre grise – et d’un gris qui chante, à sa façon légère, voire humoristique, comme chantent toutes les couleurs jetées autour de l’adorable vaes aux trois bleus contrastant avec le rouge vif d’une étoffe disposée là en contrepoint géométrique, après quoi le vase blanc sur fond blanc, daté 1988 et qu’on pourrait dire à la frange du minimalisme, pourrait faire office de paraphe.
Cependant regardons mieux: minimaliste, vraiment, ce vase blanc sur fond blanc avec son bouquet à peine esquissé évoquant quelque lavis négligent ?
Ce qui est sûr, évidemment, c’est que jamais Czapski ne se serait réclamé lui-même d’un tel apparentement d’époque, et que l’usage minimal fait ici de la forme et de la «couleur» n’indique en aucune façon quelque ralliement que ce soit à telle mouvance passagère valorisant à l’excès (c’est mon opinion et je la partage) le presque rien au paradoxal et non moins formidable potentiel publicitaire et boursier.
Non sans un grain de sel, je me rappelle, à propos de cette toile, le propos quasiment extasié de Bernard Blatter, charmant directeur du Musée Jenisch, au vernissage de la rétrospective qu’il sur pied très diligemment en 1980, dans la petite ville vaudoise de Vevey, quand il célébra ce vase blanc sur fond blanc comme une sorte de summum de la modernité de Joseph Czapski.
En fait ce vase blanc sur fond blanc ne danserait pas, comme il le fait, sans la triple indication du cerne noir de son pourtour, les zigzags verticaux de son ornement et le jaillissement vigoureusement marqué des feuilles de son bouquet. Nulle manière voulue minimaliste, sans l’ombre d’un doute, mais une simplicité d’aboutissement dont on comprend qu’elle ait épaté un directeur de musée ouvert à l’art contemporain alors même qu’elle se retrouve, sous d’autres formes et formules, en maintes toiles des dernières années de l’œuvre de Joseph Czapski, toutes vouées à la réduction élémentaire.
Du moins, dans la suite d’objets proposée ici, contrastant vivement avec la composition beaucoup plus élaborée du premier Vase bleu et du Pain, cette toile fait-elle figure, à la fois par le geste qu’on imagine chez le vieux peintre à peu près aveugle et par la vision qu’elle affirme avec une sorte de grâce «taoïste», de symbole d’une présence conjuguant les deux instances, permanentes dans l’œuvre de toutes les époques, de la contemplation et de la fulgurance, du bond et du regard alenti sur les choses et les êtres.