Sésame de la lecture
En mémoire des grands lecteurs que furent Christian Bourgois, Dominique de Roux et Vladimir Dimitrijevic
C’est une belle aventure que de lire, qui nous fait recevoir le monde et le partager.
On peut y voir une fuite et tout l’opposé : la découverte de ce qu’on est ici et maintenant, comme les mots de Vol à voile, de Blaise Cendrars, à l’adolescence, m’ont révélé que le voyage est d’abord l’appel à la partance d’une simple phrase. Je lisais : « le thé des caravanes existe », et le monde existait, et j’existais dans le monde. Ou je lisais : « Il y a dans l’intérieur de la Chine quelques dizaines de gros marchands, des espèces de princes nomades », et déjà j’étais parti sur ce tapis volant qu’est le livre, déjà je me trouvais dans cet état chantant que signale à mes yeux cette espèce d’aura que font les êtres quand ils diffusent, et les livres qui sont des êtres.
Pour moi, la frontière fut toujours imperceptible entre les livres et la vie dès lors qu’une présence se manifestait par le seul déchiffrement des lettres inscrites sur une page, et j’entrais dans une forêt, j’étais sur la route d’Irkoutsk avec Michel Strogoff, soudain la chanson de ce vieux babineux éthylique de Verlaine tirait de mes yeux d’adolescent de treize ans des larmes toutes pures, ou j’avais seize ans sur les arêtes d’Ailefroide et je prenais chez Alexis Zorba des leçons de vie.

Je fuyais, évidemment que je fuyais, je fuyais le cercle trop étroit de mon petit quartier de nains de jardin : un jour, j’avais commencé de lire, trouvé parmi les livres de la maison de l’employé modèle que figurait mon père, ce gros bouquin broché dépenaillé paru chez Marguerat et dont le titre, La Toile et le roc, me semblait ne vouloir rien dire et m’attirait de ce fait même, et pour la première fois, à seize ans et des poussières, je m’étais trouvé comme électrisé par la prose de ce Thomas Wolfe dont j’ignorais tout, le temps de rebondir à la vitesse des mots dans les câbles sous-marins destination New York où grouillaient le vrai monde et la vraie vie, et peu après ce fut dans la foulée de Moravagine que je m’en fus en Russie révolutionnaire.

Je ne sentais autour de moi que prudence et qu’économie alors que les mots crépitaient en noires étincelles sur le mauvais papier du divin Livre de poche : « Vivre, c’est être différent, me révélait le monstre ravissant, je suis le pavillon acoustique de l’univers condensé dans ma ruelle. » Je lisais en marchant : « Au commencement était le rythme et le rythme s’est fait chair. » Mes camarades raillaient le papivore et moi je les narguais de la place Rouge où je venais de débarquer : « Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière ». J’allais par les allées des bibliothèques, mais bientôt m’écœuraient l’odeur de colle blanche et la poussière en suspension, et m’impatientaient les gestes lents des gardiennes du Temple à chignons serrés, aussi me carapatais-je par les chemins de traverse des grands bois de l’arrière-pays ou le long du lac aux eaux transies, à travers les prairies et sur les chemins de crête de ma préférence d’atavique coursier des hauts.
Des années et des siècles d’enfance avant nos parcours d’arêtes j’avais découvert que le mot est un oiseau qui tantôt se morfond dans sa cage et tantôt envoie ses trilles au carreau de ciel bleu. Par les mots reçus en partage j’avais nommé les choses – et de les nommer m’avait investi de pouvoirs secrets dont je n’avais aucune idée mais que chaque nouveau mot étendait –, et leur ombre portée. Je prononçais le mot clairière et c’était évoquer aussitôt son enceinte de ténèbres – sans m’en douter je tenais déjà dans ma balance le poids et le chant du monde.
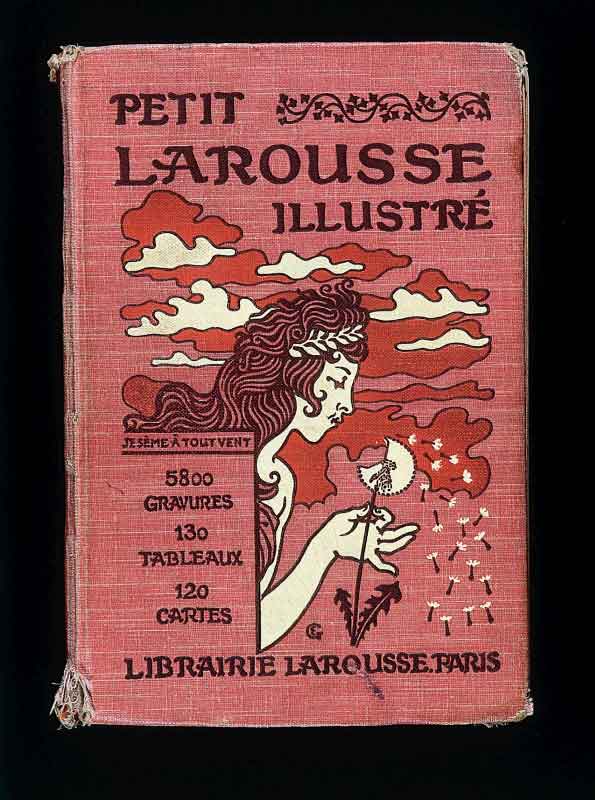
Chaque mot définissait la chose, et la jugeait à la fois. De cela non plus on n’est guère conscient durant les années et les siècles que durent nos enfances, ni de ce que signifie le fait de déchiffrer un mot pour la première fois, puis de l’écrire. Plus tard seulement viendrait la conscience et la griserie plus ou moins vaine de tous les pouvoirs investis par le mot, mais la magie des mots relève de notre nuit des temps comme, tant d’années après, je le découvrirais dans l’insondable Kotik Letaiev d’Andréi Biély.
« Les traces des mots sont pour moi des souvenirs », nous souffle-t-il en scrutant le labyrinthe vertigineux de sa mémoire. Avant de signifier les mots étaient rumeurs de rumeurs et sensations de sensations affleurant cette mémoire d’avant la mémoire, mais comment ne pas constater l’insuffisance aussi des mots à la lecture du monde ?
Lire serait alors vivre cent fois et de mille façons diverses, comme le conteur de partout vit cent et mille fois à psalmodier sous l’Arbre, et cent et mille fois Rembrandt à se relire au miroir et se répéter autrement, cent et mille l’aveugle murmurant ce qu’il voit à l’écoute du vent et cent autres et mille fois un chacun qui admire, s’étonne, adhère ou s’indigne, s’illusionne ou découvre qu’on l’abuse, s’immerge tout un été dans un roman-fleuve ou s’éloigne de tout écrit pour ne plus lire que dans les arbres et les étoiles, ou les plans de génie civil ou les dessins d’enfants, étant entendu que ne plus lire du tout ne se conçoit pas plus que ne plus respirer, et qu’il en va de toute page comme de toute chair.
Bien avant Cendrars déjà je savais que l’esprit du conte est une magie et plus encore : une façon d’accommoder le monde. Seul sur l’île déserte d’un carré de peau de mouton jeté sur l’océan du gazon familial, j’ai fait vers dix ans cette même expérience du jeune Samuel Belet de Ramuz, amené aux livres par un Monsieur Loup et qui raconte non sans candeur à propos du Robinson suisse : « Je me passionnai surtout pour quand le boa mange l’âne. »

Lorsque le Livre affirme, par la voix de Jean l’évangéliste poète, que le verbe s’est fait chair, je l’entends bien ainsi : que le mot se caresse et se mange, et que toute phrase vivante se dévore, et que du mot cannibale au mot hostie on a parcouru tout le chemin d’humanité comme en substituant à la pyramide des crânes de Tamerlan celle de gros blocs taillée au ciseau fin des tombeaux égyptiens.
Ce chemin d’humanité serpente entre ces pages aussi, du pas tantôt hésitant et tantôt plus décidé d’un incorrigible irrégulier jamais à l’aise sous aucune discipline d’aucune école, n’ayant à produire que le Doctorat de l’Université buissonnière des littératures. Le seul fait d’entendre, par manière d’accueil à la Faculté des lettres de Lausanne, et de la voix grise du Mandarin de l’époque à longue figure blafarde de calviniste, qu’en ces lieux ne se pratiquerait jamais l’amour de la chose littéraire mais la seule Analyse Scientifique des Structures, suffit à me renvoyer aux sous-bois et aux rivages de mon industrieuse paresse, momentanément flattée aussi par l’esprit frondeur de Mai 1968. Les aphorismes obscurs et sensuels de René Char, autant que les proses transgressives de Jean Genet, les essais libertaires de Marcuse et la haute éthique érudite non alignée de Walter Benjamin me tinrent alors lieu d’enseignement vif, tandis que je m’adonnais à outrance à l’exercice plus stérile de la lecture dite par l’aisselle. Porter sous son bras tel ou tel volume vert sale des Œuvres complètes de Vladimir Ilitch Oulianov, dit Lénine, serrer de la même façon Das Kapital de Marx en v.o. ou les dernières livraisons de la revue L’Homme et la société, transbahuter ainsi, de librairies en bars, sans les ouvrir mais en absorbant leur substance comme par osmose, ces sommes théoriques fut quelque temps ma façon révolutionnaire de lire, jusqu’au jour où, las de feindre et retrouvant, en d’autres lieux, le plaisir partagé d’explorer les travées de bibliothèques, je flambai tout à coup à la découverte du psalmiste libérateur que devait figurer à mes yeux Charles-Albert Cingria, dont les mots et les phrases me semblaient peints à la feuille d’or sur fond de parchemin ceint d’azur : « L’écriture est un art d’oiseleur et les mots sont en cage, avec des ouvertures sur l’infini. » En ma vieille vingtaine qui me pesait tant aux épaules, les yeux cernés par le chagrin du monde et la délectation morose, lire Cingria m’a rendu la fraîcheur.
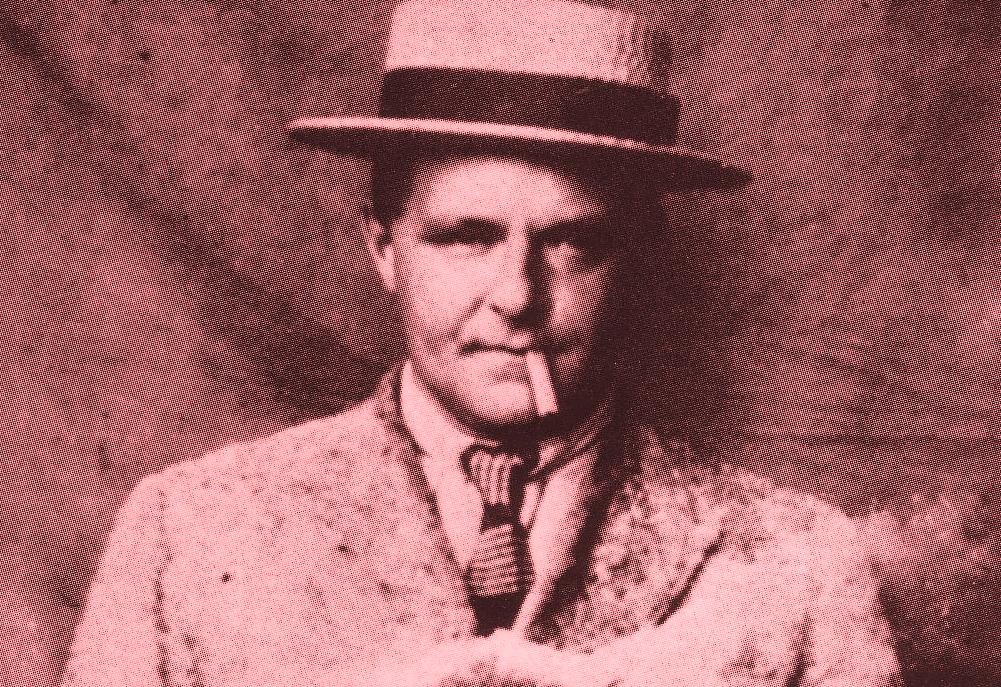
« Il nous faut relire plus que lire », affirmait ce druide des bibliothèques que fut John Cowper Powys, et c’est dans le faisceau de regards croisés de tous mes âges et de tous les âges du lecteur que je voudrais situer Les Passions partagées, dans ce même mouvement de ressaisie qui fait noter à Samuel Belet, le personnage de Ramuz, au moment de se raconter, que « ce qui n’a pas assez été vécu est revécu », et le passé ressuscite dans un nouveau présent « car tout est confondu, la distance en allée et le temps supprimé. Il n’y a plus ni mort ni vie. Il n’y a plus que cette grande image du monde dans quoi tout est contenu ».

« Un homme peut réussir dans la vie sans avoir jamais feuilleté un livre, écrit encore John Cowper Powys, il peut s’enrichir, il peut tyranniser ses semblables, mais il ne pourra jamais “ voir Dieu ”, il ne pourra jamais vivre dans un présent qui est le fils du passé et le père de l’avenir sans une certaine connaissance du journal de bord que tient la race humaine depuis l’origine des temps et qui s’appelle la Littérature. »
John Cowper Powys, lecteur universel
C’est un formidable ouvroir de lecture potentielle que Les plaisirs de la littérature de John Cowper Powys, dont il faut aussitôt dégager le titre de ce qu’il peut avoir aujourd’hui de faussé par la résonance du mot plaisir, accommodé à la sauce du fun débile de nos jours. Les plaisirs de Cowper Powys n’ont rien d’un petit délassement d’amateur au sens esthète ou d’un agité hyperfestif mais relèvent de la plus haute extatique jouissance, à la fois charnelle, intellectuelle et et spirituelle.
On connaît déjà John Cowper Powys pour sa révélatrice Autobiographie, les romans tout empreints de sensualité tellurique et de magie visionnaire que représentent Les sables de la mer, Wolf Solent et la tétralogie des Enchantements de Glastonbury, ou encore ses essais diversement inspirés sur Le sens de la culture et L’Art du bonheur.
Or le Powys lecteur n’est pas moins créateur que le romancier, qui nous entraîne dans une sorte de palpitante chasse au trésor en ne cessant de faire appel à notre imagination et à notre tonus critique.
«Toute bonne littérature est une critique de la vie», affirme John Cowper Powys en citant Matthew Arnold, et cette position, à la fois radicale et généreuse, donne son élan à chacun de ses jugements, et sa nécessité vitale. Pour John Cowper Powys, la littérature se distingue illico des Belles Lettres au sens académique de l’expression. La littérature concentre, dans quelques livres qu’il nous faut lire et relire, la somme des rêves et des pensées que l’énigme du monde a inspiré à nos frères humains, et toutes les «illusions vitales», aussi, qui les ont aidés à souffrir un peu moins ou à endurer un peu mieux l’horrible réalité – quand celle-ci n’a pas le tour radieux de ce matin.

Rien de lettreux dans cette approche qui nous fait revivre, avec quelle gaîté communicative, les premiers émerveillements de nos lectures adolescentes, tout en ressaisissant la «substantifique moelle» de celles-ci au gré de fulgurantes synthèses. Rien non plus d’exhaustif dans ces aperçus, mais autant de propositions originales et stimulantes, autant de «germes» qu’il nous incombe de vivifier, conformément à l’idée que «toute création artistique a besoin d’être complétée par les générations futures avant de pouvoir atteindre sa véritable maturité».
Cette idée pascalienne d’une «société des êtres» qui travaillerait au même accomplissement secret du «seul véritable progrès» digne d’être considéré dans l’histoire des hommes, «c’est-à-dire l’accroissement de la bonté et de la miséricorde dans les cœurs» à quoi contribuent pêle-mêle les Ecritures et Rabelais, saint Paul et Dickens ou Walt Whitman, entre cent autres, ne ramène jamais à la valorisation d’une littérature édifiante au sens conventionnel de la morale. D’entrée de jeu, c’est bien plutôt le caractère subversif de la littérature que l’auteur met en exergue. «Une boutique de livres d’occasion est le sanctuaire où trouvent refuge les pensées les plus explosives, les plus hérétiques de l’humanité», relève-t-il avant de préciser que ladite boutique «fournit des armes au prophète dans sa lutte contre le prêtre, au prisonnier dans sa lutte contre la société, au pauvre dans sa lutte contre le riche, à l’individu dans sa lutte contre l’univers». Et de même trouve-t-il, dans l’Ancien Testament, «le grand arsenal révolutionnaire où l’individu peut se ravitailler en armes dans son combat contre toutes les autorités constituées», où le Christ a puisé avant de devenir celui que William Blake appelait le Suprême Anarchiste «qui envoya ses septante disciples prêcher contre la Religion et le Gouvernement».
Mais peu d’anarchistes sont aussi soucieux que Cowper Powys d’harmonie et d’équanimité. Si nous nous référons à la distinction faite par Léon Daudet entre écrivains incendiaires et sauveteurs, sans doute est-ce à la seconde catégorie qu’appartient notre druide bienveillant. «Ce Celte tout de feu, de féerie et de magie est un bienfaiteur», écrit fort justement Gérard Joulié dont la traduction, soit dit en passant, respire la santé vigoureuse et l’élégance.
Rebouteux des âmes, John Cowper Powys nous communique des secrets bien plus qu’il ne nous assène des messages. Les ombres, voire l’obscénité de la littérature ne sollicitent pas moins son intérêt que ses lumières et ses grâces, et s’il répète après Goethe que «seul le sérieux confère à la vie un cachet d’éternité», nul ne pénètre mieux que lui les profondeurs de l’humour de Shakespeare ou de Rabelais.
A croire Powys, le pouvoir détonant de la Bible ne tient pas à sa doctrine spirituelle ou morale, mais «réside dans ses suprêmes contradictions émotionnelles, chacune poussée à l’extrême, et chacune représentant de manière définitive et pour tous les temps quelque aspect immuable de la vie humaine sur terre». La Bible est à ses yeux par excellence «le livre pour tous», dont la poésie éclipse toutes les gloses et dont trois motifs dominants assurent la pérennité: «la grandeur et la misère de l’homme, la terrifiante beauté de la nature, et le mystère tantôt effrayant et tantôt consolant de la Cause Première». Mais là encore, rien de trop étroitement littéraire dans les propos de ce présumé païen, dont le chapitre consacré à saint Paul nous paraît plus fondamentalement inspiré par «l’esprit du Christ» que mille exégèses autorisées.
Cet esprit du Christ qui est «le meilleur espoir de salut de notre f… civilisation», et qui se réduit en somme à l’effort séculaire d’humanisation des individus, constitue bonnement le fil rouge liant entre eux les vingt chapitres des Plaisirs de la littérature, courant d’un Rabelais dégagé des clichés graveleux aux visions christiques de Dickens et Dostoïevski, d’Homère fondant un «esprit divin de discernement» à Dante nous aidant à «sublimer notre sauvagerie humaine naturelle pour en faire le véhicule de notre vision esthétique», ou de Shakespeare, à qui l’humour ondoyant et sceptique tient lieu de philosophie, à Whitman qui suscite «une extension émotionnelle de notre moi personnel à tous les autres «moi» et à tous les objets qui l’entourent».
De la même façon, notre «moi» de lecteur, dans cette grande traversée de plein vent ou s’entrecroisent encore les sillages de Montaigne et de Melville, de Cervantès et de Proust, de Milton et de Nietzsche, se dilate sans se diluer, l’énergie absorbée par cette lecture se transformant finalement en impatience vive de remonter à chaque source et de sonder chaque secret.

Notre ami Tchékhov
Il y a 112 ans, le 2 juillet 1904, Anton Pavlovitch Tchékhov s’éteignait dans une station thermale de Forêt-Noire, à l’âge de 44 ans, vingt ans après le premier crachement de sang que la tuberculose lui arracha.
Durant la nuit du 1er juillet, Tchékhov se réveilla et pria son épouse Olga Knipper, grande comédienne de l’époque, d’appeler un médecin. Lorsque celui-ci arriva à deux heures du matin, le malade lui dit simplement «Ich sterbe», but une flûte de champagne, s’étendit sur le flanc et expira. La suite des événements, Tchékhov aurait pu la décrire avec la causticité de ses premiers écrits. De fait, c’est dans un convoi destiné au transport d’huîtres que sa dépouille fut rapatriée à Moscou, où l’accueillit une fanfare militaire qui jouait une marche funèbre. Or celle-ci n’était pas destinée à Tchekhov mais à un certain général Keller, mort en Mandchourie. Une foule immense n’en attendait pas moins, au cimetière, le cercueil de l’écrivain porté par deux étudiants…
En janvier de la même année, la dernière pièce de Tchékhov, La cerisaie, avait connu un succès phénoménal. L’interprétation de la pièce, à laquelle le metteur en scène Stanislavski avait donné des accents tragiques, déplut cependant à Tchékhov qui s’exclama: « Mais ce n’est pas un drame que j’ai écrit, c’est une comédie et même, par endroits, une véritable farce ! ». Or, le malentendu allait perdurer. L’image d’un poète des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe, survit ainsi à travers le cliché d’un « doux rêveur», alors que la véritable figure de ce fils de petits commerçants né en 1860 est celle d’un observateur implacable de la réalité.
Marqué en son enfance par un père aussi religieux que violent, dont la faillite a fait de lui un soutien de famille précoce, Anton Pavlovicth fut, en tant que médecin (dès 1884) aux premières loges de la misère russe, trop lucide cependant pour croire à la révolution. Jamais dupe des idéologies, il n’en a pas moins une conscience sociale aiguë. Dès son établissement de médecin, il arrondit ses fins de mois avec des récits souvent mordants qui lui valent un vif succès. En 1890, en dépit de sa maladie, il entreprend un séjour d’un an au bagne de Sakhaline afin de porter témoignage sur le sort des déportés. Toute sa vie, d’ailleurs, Tchékhov multipliera les actions de bienfaisance, de constructions d’écoles en soins gratuits. Ses nouvelles d’abord, son théâtre ensuite, le feront reconnaitre de son vivant comme une des gloires nationales russes, à l’égal d’un Dostoïevski ou d’un Tolstoï.
Or ce qui frappe, aujourd’hui, c’est que ce peintre souvent noir de la société russe et des comportements individuels reste actuel et pertinent, notamment dans son théâtre (lire encadré). Contre toute emphase et tout héroïsme factice, Tchékhov présente la réalité comme elle, est, sans jamais l’enjoliver. « Il n’y a que le sérieux qui soit beau », écrivait-il, mais en souriant. Et le rire était sa défense contre le désespoir.
Un autre Tchékhov
Au demeurant il n’y a pas que le rire et le désespoir, chez Anton Pavlovitch, mais aussi cette joie profonde qui traverse les siècles, retrouvée dans celui de ses récits qu’il disait préférer entre tous: L’étudiant, mystique plongée en 5 pages dans la profondeur du Temps.
Au soir du Vendredi saint, revenant de chasse où il vient de tuer une bécasse, le jeune Ivan Vélikopolski s’arrête auprès de deux veuves dans leur jardin, auxquelles il raconte soudain la nuit durant laquelle Pierre trahit le Christ à trois reprises, comme annoncé. Et voici que les veuves sont bouleversées par son récit, comme si elles s’y trouvaient personnellement impliquées, et voilà que le jeune fils de diacre, étudiant à l’académie religieuse, se trouve rempli d’une joie mystérieuse alors même qu’il constate l’actualité de la nuit terrible:
« Alors la joie se mit à bouillonner dans son esprit, si fort qu’il dut s’arrêter un instant pour reprendre son souffle. Le passé, pensait-il, était lié au présent par une chaîne ininterrompue d’événements qui découlaient les uns des autres. Il lui semblait qu’il voyait les deux extrémités de cette chaîne: il en touche une et voici que l’autre frissonne
« Comme il prenait le bac pour passer la rivière, et plus tard comme il montait sur la colline en regardant son village natal et le couchant où brillait le ruban étroit d’un crépuscule froid et pourpre, il pensait que la vérité et la beauté qui dirigeaient la vie de l’homme là-bas, dans le jardin et dans la cour du grand-prêtre, s’étaient perpétuées sans s’arrêter jusqu’à ce jour, et qu’elles avaient sans doute toujours été le plus profond, le plus important dans la vie de l’homme, et sur toute la terre en général; et un sentiment de jeunesse, de santé et de force – il n’avait que vingt-deux ans – et une attente indiciblement douce du bonheur, d’un bonheur inconnu, mystérieux, s’emparaient peu à peu de lui, et la vie lui paraissait éblouissante, miraculeuse et toute emplie du sens le plus haut ».
Le regard d’Ivan Bounine
L’image d’un Tchékhov poète de l’évanescence et des illusions perdues, se complaisant dans une peinture douce-amère de la province russe de la fin du siècle passé, continue de se perpétuer à travers le cliché du “doux rêveur”, qui vole au contraire en éclats dès qu’on prend la peine de l’approcher vraiment. Or une nouvelle occasion nous en est donnée, pour commémorer son centenaire, avec la parution d’un ouvrage à la fois passionnant et inachevé, constituant un témoignage de première main et dans lequel une véritable révélation biographique se fait jour. De dix ans le cadet de Tchékhov, Ivan Bounine, merveilleux écrivain lui-même (Prix Nobel de littérature en 1933), fut un ami particulièrement cher à Tchékhov, qu’il fréquenta de 1895 à sa mort. Le présent recueil de souvenirs, et jusque dans sa forme relevant parfois du croquis ou de la note préparatoire, fut entrepris par Bounine en 1952, un an avant sa mort, et la préfacière et traductrice, Claire Hauchard, précise qu’on ne sait trop quelle forme définitive il devait avoir. Or l’inachèvement de l’ouvrage n’enlève rien à son intérêt et moins encore à son charme, tant Ivan Bounine excelle, près d’un demi-siècle après sa mort, à rendre vivante et presque palpable la présence de Tchékhov.
Pour fixer, en moins de cent pages, ce que fut assez exactement le parcours de Tchekhov, et se faire une idée précise de la rude vie qui fut la sienne entre un père despotique, bigot et fondu en ivrognerie, des frères non moins irresponsables et le reste de sa famille dépendant de lui alors qu’il n’avait pas vingt ans, le lecteur non onformé se reportera à la Vie de Tchékhov insérée en seconde partie dans le recueil des Conseils à un écrivain, sous la plume de Natalia Ginzburg.
Quant à Bounine, c’est par petite touches qu’il complète son portrait “en mouvement” d’un Tchékhov à la fois fraternel et distant, qui ne perd pas une occasion de rire et n’a décidément rien du “geignard” que stigmatisent certains critiques. Ne se plaignant jamais de son sort, alors que la maladie lui est souvent cruelle, l’écrivain apparaît, sous le regard de Bounine, comme un homme chaleureux et d’un naturel tout simple, raillant volontiers la jobardise des gendelettres sans poser pour autant au “pur”. Le récit de ses visites au vieux Tolstoï est tordant, et Bounine, accueilli à un moment donné par la mère et la soeur de Tchékhov, éclaire également sa grande sollicitude de fils et de frère. De surcroît, c’est un véritable récit tchékhovien que Bounine à propos de ce qui fut, selon lui, le grand amour “empêché” d’Anton Pavlovitch, avec une femme mariée du nom de Lidia Alexeievna Avilova (1865-1943), nouvelliste et romancière prête à refaire sa vie avec lui et qu’il aima aussi sans se résoudre à l’arracher à sa famille – la repoussant ainsi en douceur…
L’hommage de l’édition française à Tchékhov est un peu, reconnaissons-le, de bric et de broc. Le meilleur exemple en est donné par l’édition bâclée d’un recueil de récits donnés pour “inédits”, intitulé Le malheur des autres, alors même que la nouvelle éponyme a déjà été traduite par André Markowicz dans l’ensemble du Violon de Rotschild.
Bref, et malgré sa traduction parfois bien lourde, l’on saura gré à Lily Denis d’enrichir tout de même, ici, l’éventail des récits de Tchékhov (il y en a 649 en tout) dont la Pléiade nous a fait connaître 250 titres, entre autres éditions. Nulle “révélation” dans ces 38 récits, si l’on songe à tant de merveilles connues, mais le génie de Tchékhov y est néanmoins omniprésent, fût-ce parfois dans un certain “tout-venant” journalistique.
Anton Tchekhov écrivit d’abord pour arrondir les fins de semaine de la famille dont il avait la charge, et seuls les cuistres lui reprocheront de ne pas toujours fignoler son style, alors qu’un souffle de vie constant traverse ses moindres récits. Ses Conseil à un écrivain, tirés de sa correspondance et présentée par Pierre Brunello, constituent un formidable recueil de malicieuse sagesse, qu’on pourrait intituler aussi “conseils à tout le monde”. Ecrire et vivre, pour Tchekhov, allait de pair, et ses propos sur “la petite vie de tous les jours” ou sur l’authenticité, sur l’intelligentsia ou l’abus de l’adjectif, trahissent autant de positions éthiques d’une exigence que Bounine eût qualifiée de “féroce”. C’est qu’à l’opposé du littérateur se payant de mots, de l’homme de lettres trônant sur son propre monument, ou de l’instituteur du peuple, Tchekhov se contentait de chercher, pour chaque sentiment ou chaque fait, le mot juste.

Dame de coeur
Alice Munro est sans doute la plus grande nouvelliste de la littérature mondiale actuelle, très justement récompensée par le Prix Nobel de littérature 2013. Le triple mérite de celui-ci fut de consacrer une femme, Canadienne anglaise donc un peu décentrée, et cantonnée dans le genre de la nouvelle assez peu prisé, surtout en langue française.
Parfois comparée à celles de Tchékhov ou de Raymond Carver, l’oeuvre d’Alice Munro est à vrai dire d’une totale originalité, tant par sa perception du monde que par sa poésie hyperréaliste.
Divorce, avortement, émancipation des moeurs, destinées personnelles sur fond de tragédies collectives, femmes en fuite, familles éclatées et recomposées: il y a de tout ça dans ces nouvelles dont le plus surprenant est leur façon de nous situer dans le temps.
Que sommes-nous devenus avec les années ? Telle est la question qui revient à tout moment chez Alice Munro, dont le réalisme hypersensible, extrêmement attentif à l’intimité de chacun, va de pair avec le sentiment que nos vies, à tout moment, peuvent bifurquer et se refaire, sans aucune règle.
Alice Munro avait passé le cap de ses 78 ans lorsqu’elle publia Trop de bonheur, rassemblant dix nouvelles plus étonnantes les unes que les autres.
Le recueil s’ouvre sur le récit insoutenable de Dimensions, nous confrontant à une folie meurtrière. La figure du psychopathe est très présente dans la littérature contemporaine. Or les gens on beau parler de « fou criminel » à propos de Lloyd, le père de ses trois enfants: la narratrice voit surtout en lui un « accident de la nature » et continue de lui rendre visite dans l’institution où il est incarcéré. De ce triple infanticide évoqué en cinq lignes quant aux faits précis, la nouvelliste tire un récit d’une trentaine de pages modulant le point de vue de Doree, laquelle continue de rester attachée à celui qui est taxé de « monstre » par son entourage, sans lui céder en rien pour autant.
Dans Trous-profonds, Alice Munro revient sur un thème qu’elle a souvent traité: la fuite et la disparition d’un proche, retrouvé des années plus tard. Or cette histoire d’un ado surdoué, accidenté en ses jeunes années, jamais vraiment reconnu par son père à l’ego envahissant, et qui s’éclipse pendant des années après avoir plaqué ses étude sans crier gare, reflète quelque chose de profond de notre époque, qu’on pourrait dire le désarroi des immatures de tous âges.
Sans préjugé doloriste, Alice Munro est extrêmement sensible aux êtres fragilisés d’une façon ou de l’autre, comme il en va du narrateur de Visage, rejeté par son conosaure de père du fait de la tache de vin qui marque son visage. Or le vrai thème de cette nouvelle, également récurrent, touche à une passion enfantine jamais avouée. Sans complaisance, la nouvelliste lève ainsi le voile sur les secrets de tous les âges (comme dans Jeu d’enfant) et de tous les milieux, sans jamais faire du « social » ou du « psy », juste à fleur de sentiments.
Munro13.pngAlice Munro va partout, pourrait-on dire, dans tous les milieux, à tous les étages de la société, sans aucun préjugé. Peu d’écrivains parlent si librement et si naturellement de la sexualité, sans une once de provocation. Comme un Tchékhov, la nouvelliste ne démontre rien: elle montre. Au lecteur ensuite de conclure…
Dans la merveilleuse nouvelle intitulée Bois, nous voici dans foulée d’un menuisier-ébéniste qui va choisir ses arbres dans la forêt, évoquée avec un souffle et une connaissance technique et poétique rappelant Jack London. Ou nous voilà, avec Trop de bonheur, remonter le courant de l’Histoire à la rencontre d’un extraordinaire personnage féminin. En concentré romanesque de cinquante pages, inspiré par le personnage réel de Sofia Kovalevskaïa, mathématicienne et romancière, Alice Munro retrace une destinée de femme libre et sa fin bouleversante. Une fois de plus, comme dans la dizaine de recueils traduits à ce jour, s’exerce son prodigieux don d’observation reliant sans cesse le moindre détail à l’ensemble, sensible en même temps au tragique de la condition humaine et au comique de la vie, et trouvant à tout coup une nouvelle manière de raconter.
Pour lire dans la foulée…
John Cowper Powys. Les plaisirs de la littérature. Traduit de l’anglais par Gérard Joulié. L’Age d’Homme, 444p. Un dossier de la revue Granit a été consacré à Powys en 1973, constituant une bonne introduction à son œuvre
Ivan Bounine. Tchékhov. Traduit du russe, préfacé et annoté par Claire Hauchard. Editions du Rocher, 210p.
Anton Tchékhov. Conseils à un écrivain. Choix de textes présenté par Pierre Brunello. Traduit du russe par Marianne Gourg. Suivi de Vie d’Anton Tchékohv, par Natalia Ginzburg. Traduit de l’italien par Béatrice Vierne. Editions du Rocher, coll. Anatolia, 240p.
Anton Tchékhov. Le malheur des autres. Nouvelles choisies et traduites du russe par Lily Denis. Gallimard,
Anton Tchékhov, L’étudiant, traduit du russe par André Markowicz dans le recueil indispensable réunissant dix-neuf nouvelles et intitulé Le Violon de Rotschild, paru chez Alinea en 1986 avec une préface lumineuse de Gérard Conio).
Alice Munro. Trop de bonheur. Traduit de l’anglais (Canada) par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso. L’Olivier, 2013, 215.
