
(Carnets volants)
« Que faire d’un jardin s’il n’a pas la surface entière de votre pays ? Que faire d’une maison si vous ne pouvez pas vous sentir libre ni heureux dès que vous en franchissez la porte ? » (Kamel Daoud, Mes indépendances)
Rester partir

Je m’étais dit cette nuit-là, en subite lucidité d’insomnie, entre trois et quatre heures du matin, que jamais je n’aurai aimé le voyage. Voyager est assommant. La vogue actuelle des récits de voyage m’insupporte presque autant que l’irruption d’un paquebot américain dans la lagune vénitienne, et je me suis rappelé cette nuit que jamais je n’aurai su voyager faute d’oser aborder les gens et de me décarcasser sans argent. Il y a plus de cinquante ans que je me joue la comédie d’aimer ça mais à présent ça suffit: je vais donc essayer vraiment de noter ce que je ressens sans exagérer ni dans le sens de l’exaltation ni moins encore dans celui de la déploration morose, juste dire ce qui est et comment c’est, juste se rappeler ce qui a été et comment cela n’en finira qu’à la fin du tour du jardin.
Une certaine année, notre père a constaté qu’il ne pourrait plus désormais faire le tour de son jardin, et ce fut ensuite comme s’il s’éloignait de nous et de lui-même, sans un mot pour l’exprimer, mais je revois son regard et son silence me parle toujours.
Je me rappelle aussi leurs voyages de retraités en divers pays lointains, malgré sa maladie à lui, ses multiples opérations et ses angoisses à elle, curieux d’Italie ou de lointains mexicains, remuant leurs vieilles nageoires dans les lagons ensoleillés des Antilles ou les baignoires de boue israéliennes, ne dédaignant ni les groupes ni les troupes et revenant fatigués mais heureux, selon leur expression, comme des milliers et des millions de voyageurs organisés que pour ma part j’ai toujours fuis.
Ce qu’il y a de pire dans le voyage c’est de voyager seul, mais voyager à deux n’est souvent qu’un enfer augmenté. Voyager seul quand on ne sait pas bien s’y prendre relève au départ du cauchemar angoissant, car il faut partir et l’on se fait mine à soi-même de s’en réjouir, après quoi ce ne sont que tracas jusqu’au moment où l’on a posé ses affaires et qu’enfin l’on se retrouve là, peu importe où, que ce soit en Andalousie ou au Japon, dans ce pub de Sheffield où sur les crêtes de haute Toscane, et là c’est comme partout : je suis chez moi comme partout et je ne suis plus que reconnaissance devant cela simplement qui m’attendait en silence. Or, en cet état chantant voyager à deux, ou plus si affinités, redevient une grâce…
Je décrie le tourisme en cela qu’il est le contraire du voyage quand il se fait à la masse. Le Grand Tour de jadis était une découverte de chaque jour, et lente, et fervente, tandis que l’évasion de la meute est invasion distraite et pillage d’images, ou simulation festive ou festivalière à vomir de plaisir.
Bref, le TOUT DIRE du voyage sera poétique ou n’a jamais été. Voyager autour de sa chambre, autour du jardin, ou faire la tournée des planètes revient alors du pareil au même, etc.
Vélocipédies toscanes

J’avais dormi pendant tout le trajet italien dans la couchette puant la sueur du gros mec d’à côté, j’avais encore l’impression d’être dans un rêve lorsque j’ai récupéré ma bécane à la consigne après avoir enjambé les corps allongés d’une foule de hippies sur les quais, j’ai ficelé tant bien que mal mes trois sacs sur l’engin puis je me suis lancé sur le pavé en titubant, ne me réveillant vraiment qu’avec le sentiment d’entrer dans un autre songe à la Chirico lorsque, par les venelles désertes et absolument silencieuses, j’ai débouché sur la Place de la Seigneurie; et là je ne me suis pas arrêté: j’ai juste tourniqué trois fois en faisant la nique au David bodybuildé de Michelangelo auquel je préfère cent fois le petit Persée à joli cul de Benvenuto Cellini, puis j’ai filé le long de l’Arno, je me suis senti des ailes en trouvant beau tout ce que je voyais, les fleurs et les petites fabriques décaties du long de la route, les matinaux qui commençaient d’apparaître et les bagnoles me dépassant en klaxonnant, puis la pente a commencé de se redresser, à un moment donné Florence m’est apparue tout entière dont je voyais maintenant le dôme et les clochers dans la brume de beau temps, ensuite de quoi j’ai commencé de remonter les rudes pentes du Chianti, tantôt pédalant et tantôt poussant mon espèce de mule roulante sans cesse en déséquilibre, tantôt exultant à la découverte d’une nouvelle enfilade de colline à cyprès et tantôt me traitant d’olibrius anachronique, comme devaient le penser les jeunes gens motorisés me doublant avec des clameurs, jusqu’au sommet d’un petit col où semblaient m’attendre deux gosses trapus aux airs farouches dont le petit commerce m’a fait retoucher terre.
Ce devait être passé midi, j’étais plus qu’en nage, je n’avais bu jusque-là qu’au lavabo d’un salon de coiffure où je m’étais fait rafraîchir la nuque en écoutant un discours du Figaro lippu à la gloire de Sa Sainteté Jean XXIII dont l’effigie jouxtait une réclame pour l’Acqua di Selva, j’avais maintenant envie de litres de limonade mais les deux mioches voulurent savoir si j’aurais de quoi payer, puis survint leur soeur aînée, peut-être douze ans d’âge et visiblement la responsable de l’organisation, qui me dit avec solennité le prix d’un litre d’orangeade, et je montrai mes lires et réclamai deux bouteille à boire ici même, ce qui sembla visiblement une énormité au grave trio, mais bientôt j’eus mes deux litres avec l’injonction de restituer le verre sous peine d’une surtaxe, et je m’acquittai de mon dû et n’osai protester lorsque le chef de gang me rendit la monnaie sous forme de bonbons – d’ailleurs j’étais bien trop heureux pour cela, car telle est l’Italie que j’aime, en tout cas je les remerciai in petto sans quitter moi non plus mon air de sombre négociateur, je bus devant eux et je rotai, leur rendis les bouteilles et m’en fus sans les dérider une seconde.
Après cette seule étape je n’ai cessé de pédaler dans la touffeur, parfois abruti par l’effort et faisant corps avec ma monture grinçante, puis me saoulant de plats et de descentes avant de mouliner en danseuse ou de remettre pied à terre, jusqu’au dernier plan incliné d’Arezzo, où je suis arrivé en début de soirée tout ruisselant et titubant d’épuisement, pionçant trois heures d’affilée dans une étroite chambre d’hôtel avant de ressortir de songes confus pleins de bielles et de bouteilles pour entrer dans le rêve éveillé de la vieille ville où m’attendait un dernier ébranlement onirique: la Piazza Grande, nom de Dieu, cette place où je n’avais jamais mis les pieds et que j’ai reconnue tout à coup, cette place inclinée comme le Campo de Sienne et que j’étais sûr d’avoir déjà vue quelque part, je ne sais où, peut-être dans mes rêves de maisons ou dans un film (peut-être le Roméo et Juliette de Zeffirelli ?), peut-être encore dans une autre vie – et maintenant j’écris à une terrasse en continuant de m’hydrater (tout à l’heure je buvais l’eau de ma douche) puis en me réjouissant de voir demain les couleurs plus que réelles des fresques de Piero della Francesca.
A présent cependant, vidé et vanné comme je le suis, mais en ce lieu comme protégé par les arches séculaires et les lumières trouant la nuit des ruelles, j’aspire à me délester plus encore de toute référence culturelle en sorte de recevoir les choses non répertoriées ni commentées.
Et que vois-je ? Je vois une vieille Allemande penchée sur son guide Baedeker rose fané qui demain fera procession, c’est certain, l’air grave, au milieu des étudiant bataves ou norvégiens dont les essaims m’entourent aussi à l’instant, sémillants et séduisants, et je les vois me regarder à les regarder et sourire – je leur souris en effet car même crevé je me sens de leur espèce d’espèces d’anges ailés, et le Frau Professor tiendra la chandelle quand bien nus et réchauffés nous nous enlacerons à ressusciter sur les fresques de Signorelli – mais voici que le culte de la culture culturelle me reprend décidément, allons garçon encore un peu de Chianti !
Et qu’entends-je après qu’ils sont partis, tous tant qu’il, sont, seul cheminant par les venelles, qu’entends-je sinon les voix juvéniles ou sans âge de tous les temps, seul titubant un peu de fatigue et de vin grenat, bientôt escorté de tous ceux qui auront foulé le doux pavé de la cité au labyrinthe enchanté, et les voix des vivants aussi, les voix de ce matin et tout au long du chemin, les voix des miens et, de loin en loin, les voix remontées des champs de bataille ou de la mer, ou descendues des collines là-haut où le Très-Bas parlait aux oiseaux… (Arezzo, 1975).
Au bord du ciel

Depuis Arezzo, cité de l’Arétin (poète érotique mineur) et de Pétrarque (poète érotique majeur), où l’on voyage à travers le temps devant les fresques de Piero della Francesca quand elles ne se trouvent plus assiégées par la meute étourdie, j’ai repris mon vélocipède et treize kilomètres plus loin, en contrehaut, s’étagent les murs ocres et les toits roses de Cortone ; une dernière féroce montée et voici, passée l’arche d’entrée, se découvrait la petite place pavée en pente du bourg qu’encerclent le palais municipal et les hautes maisons des notables et trois cafés (il y a là trois partis influents) et le coiffeur (on dit il barbiere) et l’église devant laquelle siège depuis sept siècles le bossu (il gobbo) de père en fils.
L’Italie se défait à divers égards mais ses bossus demeurent, et teigneux comme il sied. Les vieux sont aussi là pour accueillir l’étranger, lequel se dirige bientôt non vers l’hôtel voyant dont le prospectus vante le mobilier suédois, mais, à l’opposite, vers l’albergo décati dont les chambres dénuées de tout ne coûtent rien et donnent sur la plaine et les brumes du lac de Trasimène et le lointain mouvant des collines les plus douces de la Terre.
Et tout est d’ailleurs comme ça à Cortone : tout est à la fois populaire et civilisé, fragrance de jardin de monastère et vin de pays, tout est nature et culture, boxe et monnaie de chewing-gum, tout est ciel au bord du sud noir.
Par exemple on monte le long des ruelles aussi raides que la raide pente de la montagne maintes fois gravie à genoux par les ascètes des déserts d’en dessus et les pécheresses majeures ou mineures, et des maisons de pierre, de part et d’autre de la rampe ardue, s’échappe la même sublime idiote rengaine de Gigliola Cinquetti que reprennent en chœur les jeunes filles alanguies dans la torpeur pénombre. Un peu plus haut, dans les buissons d’épines, commence le chemin de croix modernisant de Gino Severini au bout duquel gît la béate Santa Margherita dans une sorte de châsse de dame pharaon.
L’église manque de grâce dans son genre néo-renaissance un peu mastoc, mais de là-haut se découvre le paysage jusqu’à Pérouse et Jérusalem. La dernière fois que j’y fus, en été torride, j’y avais lu, dans un volume salée d’eau de la mer Egée et tanné par tous les soleils, les lettres de Maxime Gorki à Tchékhov. L’une d’elles évoquait La dame au petit chien et Gorki notait avec une reconnaissance que je fis mienne aussitôt : « Après le plus insignifiant de vos récits tout semble grossier, écrit non pas avec une plume mais avec une bûche. Avec vos petits récits vous faites une très grande chose, vous éveillez chez les gens le dégoût de la vie somnolente, à demi morte, vos récits sont comme des flacons élégamment ciselés qui contiennent tous les parfums de la vie ».
Or ceux-ci s’éventent, le soir à Cortone, sous le toit de l’humble albergo où s’ouvre une vaste loggia. Le ciel est cisaillé par le vol et les cris de martinets fulgurants. Les cloches répondent à celles d’Arezzo qui répondent à celle de Sienne qui répondent à celles de Volterra qui répondent à celles de Radio-Vatican. Et dans le ciel bruissent les ailes à la feuille d’or des anges de l’Angelico. La vierge de l’Annonciation, tout à côté, porte une robe tissée de candeur. De même la chasteté règne-t-elle sur le Museo Diocesano fermé à cette heure : divers objets étrusques y reposent dans les limbes poudrés de farine de temps…
Lumières du monde

Je me trouvais ce soir-là dans la lumière accordée de Cortone, et de ce balcon je voyais le monde, et je me disais que tout était bien. Je ne connaissais personne et nul ne savait où je me trouvais à l’instant précis dans ce lieu de beauté. Je me sentais pure liberté et pure bonté dans cette lumière intemporelle. Je n’étais que réceptacle, ou qu’alambic, ou que vase communicant. Je ne voyais alors que la face claire du monde, j’absorbais et j’étais absorbé.
Un jour je m’étais éveillé à cette conscience et à cette effusion de l’être qui se reconnaît, et cette seconde naissance m’avait vu commencer de balbutier et de griffonner sur des carnets volants avec la gravité de l’aspirant druide retrouvant les antiques formules au bois sacré.
À Cortone, ce soir-là, je ne voyais de l’Univers que les couleurs du tableau qui s’estompaient dans la lumière d’éternité : tous les verts assourdis des petits prés suspendus, de l’autre côté de la plaine du fond de laquelle montaient quelques fumées pensives, les touches d’ocre tendre ou de gris rouillé des murets, le gris bleuté des oliviers, les flammèches noir océan des cyprès solitaires ou groupé en rangs de croches sur la partition, et la couleur orange de l’heure diluant les tuiles tièdes et les murs terre de Sienne, et la paille dans le bleu du vert, et le blanc dans l’argile rougeoyante, et tantôt comme un voile de gaze, tantôt comme une feuille de papier huilé brouillaient la vision, puis se distinguaient de nouveaux détails et de nouveaux rapports dont la totalité plénière m’apparaissait comme une figure de l’harmonie pure.
C’était à Cortone, ce pouvait être partout mais ce soir-là c’était à Cortone que je m’étais retrouvé dans cet état chantant. J’avais sous les yeux l’image même du jardin humain : non la mythique prairie originelle mais le bocage et le pacage, le champ labouré, la haie, l’amenée d’eau, le plant de vigne arraché aux jachères, et subsistant aussi là-dedans le pavot et l’ortie, la ronce et l’odeur sauvage, la vipère là-bas sous les rocs et, là-haut, le martinet fusant comme une serpe sur le champ d’azur coupé d’or. (Cortone, 1975)
Voyage dans le temps

Nous avions vingt ans et des poussières et nous étions heureux à nager nus dans les criques des îles bienheureuses, entre Cyclades et Sporades, mais autant que nos élancements de chair ou de chère (le soir au-dessus des moulins dans les fumées de poissons grillés que nous arrosions de vin de Samos), me restent mes errances au-dessous d’un certain volcan mexicain, sur les pas chancelants d’un consul enivré se perdant en sa Selva oscura…
Lire en Grèce, à vingt ans, Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou Le Gai savoir de Nietzsche, vivre bonnement à l’unisson de Zorba dans le sillage des dauphins, se retrouver à Delphes au temps des fulminants oracles et courir ensuite à l’autobus bondé de gens du coin et de tendres étudiants de tous les sexes – lire et vivre aura toujours été, pour nous autres de l’université buissonnière, ce voyage à travers le temps et les lieux – et l’étude joyeuse n’en finira jamais…
Longtemps je n’ai pas su voyager: vraiment pas bien, ou parfois pire, trop seul ou trop mal dans ma peau ou fermé aux ailleurs. Ou disons que je croyais voyager en ne faisant qu’imiter et sans partage: ainsi filais-je écrire absolument un livre à Sienne dans la foulée du Condottiere, dont je revenais les mains vides; ou à Grenade retrouver Lorca qui m’échappait non moins dans les enfilades et les illusions; à Vienne au Prater ou au Café Diglas, à Cracovie ou à Sorrente dont, à tout coup, je ne voyais à peu près rien non sans poétiser à l’avenant.
Mais la vie ? Or, à Séville elle déborda cette nuit-là, je ne sais comment ni pourquoi mais je m’étais retrouvé là, dans cet obscur caveau débordant d’exubérance piaffante et lancinante, dans ce tourbillon de danseuses et de chanteurs et de chanteuses et de danseurs – mais où était-ce encore, cette Totcha ? Très à l’écart je me le rappelle au moins, loin des estrades fréquentées mais où ? je ne saurais le dire.
Me reviennent seulement, montés du tréfonds humain, ces litanies gutturales et ces appels virulents du cante jondo et ces répons, ces croupes ondulées et ces oeillades, cette comédie des regards et ces parodies des trop vieilles ou des trop jeunes – tous ces rites de la séduction dressée dans cet affrontement constant de l’effronté et de la fatale ou de l’enjoué relançant la soumise. Or la transe n’est rien sans être partagée, aurai-je appris cette nuit-là d’un voyage esseulé où, tôt l’aube revenue, comme un nouveau désir de rencontre me fut inspiré.
Sevillanas

À Séville, premier confort inouï: l’hostal dont le patron est à la fois concierge, chasseur et sommelier. L’on y pénètre par un long escalier de céramique au sommet duquel se trouve une porte vitrée toujours close. Lorsqu’on a sonné, c’est d’abord un remuement lointain de chaises ou de bouteilles, puis se distingue le flapflap d’une paire de savates et l’écran de verre à lunules se remplit d’une silhouette impressionnante, s’entrouvre et laisse apparaître un faciès qui en a vu d’autres, comme on dit.
Dans cet hostal des quartiers populaires, ma chambre se trouve sur la terrasse du toit, juste sous les étoiles. C’est une cellule de trappiste dont le lit, le volet intérieur de la fenêtre et la porte sont du même fer peint vert céladon.
Enfin il y a, sur une tablette branlante, une carafe d’eau claire et un verre modeste. Par la porte ouverte on voit la Giralda et des publicités lyrique.
L’oeil qui s’entrouvre à l’aube, qu’on appelle ici la madrugada, est un oeil blanc dont on ne sait si ce sont les rêves de la nuit passée ou les bruits de la ville inconnue qui lui donnent ce blanc d’amnésie. Pas une pensée, pas un mot lui venant à l’esprit pour le détourner de cette espèce de tableau intimiste qu’est la chambre par la fenêtre de laquelle la vue se porte d’une corde à lessive au muret d’une terrasse ne laissant apparaître, de la femme qui étend son linge, que deux bras nus et un immense chignon qu’un mouvement plus vif, de temps à autre, fait osciller comme un chapeau ou comme un nid d’oiseau.
L’oeil ne comprend rien mais il épouse, déjà, et le vert écaillé du petit mur lui rappelle alors quelque chose. Il lui remémore un monde clair où les formes parlent, où les couleurs font comme des taches de musique, où voir et contempler n’ont plus de frontière qui les séparent, où le dehors et le dedans s’appellent et se répondent.
Ce qui est le plus étonnant, quand on ne sait rien d’eux, c’est le sérieux des Espagnols. Il y a des clubs de notables, des réunions de poètes et des palais du jouet. Il y a, sur le zinc des bars, des serviettes en papier à foison qui sont utilisées gravement dans l’exercice de manger des douceurs.
Non loin de la place d’Espagne, dans un jardin, la nuit, devant une grande vasque. Au ciel, une lune verte. Dans un arbre, des pommes, vertes aussi, mais d’un vert qui se devine à peine. Sur un banc ces deux-là se murmurant des tendresses. Et sur les moires de la pièce d’eau, ce petit canard d’émail qui suit un moment la courbe de l’anneau puis, fantaisie soudaine, vire en silence dans le rayon de lune.
L’obscurité retentit d’appels, des quais du Guadalquivir aux frondaisons des jardins de Murillo. Là-bas, autour d’un petit kiosque illuminé où se vendent des amandes grillées et des glaces à plusieurs parfums, ondulent des jeunes filles probablement vierges qu’on dirait vêtues d’abat-jour que l’air du soir fait bomber.
Qui appellent-elles, les cigales égarées sur la place déserte ? Le trille impatient des sifflets des agents occupés à évacuer les jardins leur donnera-t-il l’espoir de rencontrer enfin l’âme soeur ?
Séville est la ville de tous les reflets, mais chaque reflet semble garder le souvenir infrangible de son image, laquelle naît au foyer d’une infinité d’autres images; et par l’oeil d’une espèce de kaléidoscope apparaît finalement une vision seule, comme le blanc étincelant des venelles du Barrio de Santa Cruz fait la somme de toutes les couleurs de la faïence des corridors, des patios et des fleurs aux murs.
Mais Séville n’est pas qu’un décor. C’est aussi un personnage. Et de nouveau, mille personnages en un, avec ce nom de femme qui les résume, et celui du Guadalquivir lui faisant écho, dont les lentes boues dorées se traînent encore vers la mer.
Il y a là comme une folie en suspension, qui se perçoit à la fin des tièdes après-midi printanières, ou plus tard dans la soirée – cela dépend des concentrations d’énergies – quand l’on entend soudain des cris lointains, derrière les arènes ou dans quelque rue avoisinante, on ne sait pas très bien; et c’est comme l’exultation de choeurs invisibles, comme la fusée soudaine d’appels incompréhensibles – comme la clameur que le génie des lieux déclenche tout au fond de nous, résonnant longtemps encore par la suite dans notre âme troublée.
Par la porte entrouverte de la chapelle on l’entend tonner, dans l’ombre où tremblotent les quinquets des cierges et moutonnent les mantilles de vieilles esseulées, Savonarole de quartier dont la cellule austère est sûrement ornée du portrait de Franco, qui vitupère la “contestacion”, la “pornografia” et “las relaciones sexuales prematrimoniales” tandis que passent, dans la rue ensoleillée, des garçons et des filles fleurant le printemps et n’ayant visiblement de cesse que de se connaître selon la Bible. (Séville, mai 1975).
Rue de la Félicité

Moi j’aime Paris, je veux dire : les rues de Paris, les maisons de Paris, le blanc des murs des maisons de cinq étages de Paris, et les femmes de Paris : je veux dire les jambes des femmes de Paris qui sont plus fermes de se faire tous les jours les escaliers des cinq étages des chambres de bonnes de Paris, voilà ce que je veux dire quand je te dis que j’aime Paris, et le gens de Paris : la vie des gens de Paris qui n’est pas que de Parisiens imbus ou déçus d’un Paris prétendu disparu…
Plus que toutes les autres de Paris, pour commencer, je te dirai que j’aime la rue de la Félicité, cette année-là, juste au mois de mai, les jambes en coton de la première fois que je me suis fait mon Paris tout seul, le cœur en coton comme les blancs nuages du ciel tout neufs au-dessus du quartier gris chaulé à toits bleutés, l’asphalte un peu mol annonçant l’été et le café maure d’à côté et la porte vert Véronèse délavé à la fine main de bronze et l’escalier penché de bois craquant jusqu’au comble des combles là haut au ciel retrouvé par les tabatières, et Paris tout autour, des Batignolles à Monceau et vers Montmartre où le lendemain j’avais, entre le Lapin agile et Ménilmontant, à vérifier qu’Utrillo et Carné n’en auront pas rajouté, et le surlendemain par la rue des Cascades et le long des quais je file le train du chien Macaire jusqu’à ceux de Léautaud, de l’autre côté de la Seine, et plus loin les jours d’après en tourniquant de la Butte aux-Cailles à l’impasse de l’Homme armé; et chaque soir, tu peux m’croire, des rues par les ponts et retour par les jardins sous la lune des Tuileries je me retrouve dans ma soupente de la rue de la Félicité, et ce sera pas deux fois, je te dis que ça : pas deux fois que ce sera la première fois.
Au Luco

Les gros nuages saturés d’encre du lever du jour s’étant dissipés, voici le premier soleil dardant entre les feuilles des feuillus…
Or, saluant au passage le sombre Beethoven de Bourdelle dans la pénombre mordorée de l’antichambre végétal, puis le Verlaine non moins grave se dressant un peu plus loin dans un cercle de fleurs florales, je me détends en regardant longuement, un peu plus loin, la souple, lente, ondulante et muette gesticulation de quatre adeptes du Taï-chi et de leur jeune maître chinois tout de noir vêtu…
Le Luxembourg le matin est une oasis de vitalité radieuse. Tout le monde y court sans considération d’âge. Une très vieille Chinoise vêtue de vert s’y exerce, en compagnie d’un tout frais Occidental glabre, au jeu du sabre de fer-blanc à fulgurant foulard. Un peu plus loin, devant la statue de Blanche de Castille, décédée en 1252 (sa date de naissance est effacée), une autre alerte vieillarde à profil d’Indienne, en tenue de soie vieux rose, se livre elle aussi à toute une gestuelle énigmatique…
Ensuite, le long des allées ponctuées de statues de reines et de figures mythologiques, je constate pour la première fois que leurs têtes se hérissent de fines pointes évoquant d’abord des bâtons d’encens et qui sont à l’évidence de métal tenace. Mais de quoi s’agit-il au juste ? Sont-ce des paratonnerres ? Ou peut-être des antennes permettant à ces êtres d’un autre temps de communiquer avec le nôtre ? Je m’interroge et puis, à considérer l’immaculée blancheur de la reine Mathilde, décédée en 1082 (date de naissance également effacée), me vient l’idée prosaïque que ces aiguilles sont probablement destinées à éloigner les pigeons. Oui, ce doit être cela : le Luxembourg reste très prisé des pigeons dont le roucoulement hante le feuillage des feuillus, mais nul d’entre eux ne se voit à l’instant sur aucun occiput d’aucune reine statufiée…
On est là comme hors du monde, au milieu de ces figures de pierre et de cette nature fraîche, et pourtant un peu plus loin, aux grilles du Jardin donnant sur le Boul’Mich, ont été accrochées de grande photographies, à l’occasion de 30 ans de Reporters sans frontières, qui nous ramènent aux tribulations du XXe siècle.
La première à me frapper est cette image de Marc Riboud datant de mai 68 et représentant un front de manifestants, drôlement allurés pour certains et brandissant des couvercles de poubelles en guise de boucliers, face à un seul flic casqué. Cela me rappelle notre équipée de camarades Helvètes, débarqués à la Sorbonne aux petites aubes en caravane de 2CV, avec notre stock de plasma sanguin destiné aux présumées victimes des CRS…

Et voilà d’autres images du siècle, devant lesquelles je passe en visant le faune de bronze à la pantomime comme en suspens, dont je note au passage que c’est une copie italienne d’une statue de Pompéi : telle étant la danse de l’humanité sur le volcan de la planète, soudain résumée par ces instantanés de la guerre au Congo ou du Front populaire, des foules en guerre ou des foules en fête, du fameux poulbot à baguette parisienne de Willy Ronis ou de ce gosse au cerf-volant sur un terrain vague de la bande de Gaza – enfin de tant de drames qui perdurent aux quatre vents tandis que nous baguenaudons au Luco dans le soleil candide…
Paris la nuit

Après l’heure du dernier métro, quand il n’y a plus dans les cafés que des traînées de sciure et de vagues ombres vertes au fond des miroirs, Paris devient comme un théâtre de songes, et je m’en vais suivant mon pas qui ne sait, pas plus que moi, où il va…
Ce soir, la lune à peu près pleine roule au-dessus des toits en créneaux de Montmartre. De rares passants vont leur chemin tandis que je dévale la rue Fontaine avec des idées de marche à n’en plus finir.
Le long d’une venelle déserte, mon pas résonne jusqu’au dernier étage où s’aperçoit encore, tamisé par un rayon malingre, le quinquet de l’étudiant, des amants insatiables ou du vieil insomniaque. Et ainsi, de loin en loin, mon pas solitaire fait se lever les chers vieux clichés de la vie de bohème.
Un soir qu’il neigeait, je fus ainsi Rodolphe à la Barrière d’Enfer, et déjà je savais que Mimi la douce ne passerait pas l’hiver avec sa toux de misère.

C’était triste à languir, mais que serait l’amour sans la mélancolie, et les airs de Puccini me revenaient, dont je sais toutes les voix par cœur…
Une autre fois, m’étant attardé dans un square de Ménilmontant avec un volume des Hommes de bonne volonté, je me transformai en chacun de ses personnages, et je fus donc l’apprenti Wazemmes qui rejoint, à la brune, l’espèce de grue dont la vocation spéciale semble de le déniaiser; ou c’était un des quatre jeudis sans heures et je fus le poulbot Bastide qui traverse tout son quartier à la poursuite de son cerceau – puis je fus le député Gurau à l’instant où il rejoint sa théâtreuse, je fus le marquis de Saint-Papoul ou Jerphanion le socialo, je fus le chien Macaire et je fus Quinette, le Landru de la bande qui s’en va dans les brumes du canal Saint-Martin cher à Maigret – et maintenant je m’imagine dans la peau d’ours de celui-ci passant de maison en maison et de secret en secret…
Rome à la paresseuse

C’est toujours un stress d’enfer que le dernier travail d’avant le départ, surtout le départ de nuit qui fait penser aux partances sans retour, mais le seul drame ce soir serait de ne pas retrouver son passeport jusqu’à moins une avant de s’arracher à son toit et au névé de narcisses embaumant la vanille – or la route appelle et le quai là-bas et le train de nuit et les tunnels en enfilade vers le Sud qui trouent le Temps pour nous rendre les lieux…
Se relevant d’une nuit de tagadam tantôt trépidant et tantôt en sourdine nos paupières tôt l’aube nous révèlent ce matin ces verts tendres des collines de Toscane aux crêtes à fines flammes de cyprès et de clochers, et le long des voies se voient ces îlots de coquelicots et jusque dans l’entrelacs des voies de Roma Termini, et jusque sur les murs de notre chambre jouxtant le Campo de Fiori en candide aquarelle…
Il n’y a qu’à Rome qu’une fontaine n’est faite que pour les chiens, et c’est à Rome aussi que s’élèvera la fontaine de mémoire de Pier Paolo Pasolini, faite juste pour se laver les mains en passant ou se rafraîchir, juste pour boire en passant de l’eau fraîche ou se refaire une beauté – il n’y a qu’à Rome que le soir, au Campo de Fiori, les gars et les filles dégagent la même sensualité qui est celle, en mai, de notre bonne et belle vie…
C’est la seule ville au monde où le tout afflué de partout participe en fusion à la totalité du tintamarre et du tournis de saveurs et d’images kaléidoscopiques, tout s’y fond du présent et de tous les passés, tout se compénètre et rejaillit et se tisse et se métisse dans un flux de pareil au même – et ce matin même au Trastevere désert tout retentissait encore dans le silence retombé de la nuit
traversée…

Tout est mélange extrême dans la catholicité païenne que figure l’éléphant de la Minerva portant l’obélisque et la croix sur quoi ne manque que le logo de McDo, et c’est le génie des lieux et des gens qui déteint sur tous qui fait que chacun se la joue Fellini Roma, ce matin au Panthéon où l’on voyait deux sans-emplois déguisés en légionnaires romains s’appeler d’un bout à l’autre de la place au moyen de leurs cellulaires SONY, et défilaient les écoliers et les retraités de partout, se croisaient les lycéens et les pèlerins de partout sous le dome cyclopéen, et le vieux mendiant au petit chien et l’abbé sapé de noir à baskettes violettes, et sept soudaines scootéristes surgies sur le parvis du temple des marchands – tout ce trop se mêlait, ce trop de tout, ce trop de vie de notre chère Italie…
Promis-juré nous ne ferons rien aujourd’hui, ni ruines, ni monuments, ni sanctuaires, ni monastères – nous ne nous laisserons entraîner dans aucun courant et moins encore dans aucun contre-courant, nous nous laisserons vivre, depuis une vie partagée nos paresses s’accordent à merveille et c’est cela, peut-être, que je préfère chez toi et que chez moi tu apprécies de concert, c’est cette façon de se laisser surprendre, ainsi ne ferons-nous rien aujourd’hui que nous laisser surprendre à voir tout Rome et boire tout Rome et nous en imprégner du matin au soir…
A Rome certains jours la chaleur devient touffeur et même bouffeur, car la touffeur bouffe comme une robe se mouvant un peu sous la molle brise de plus en plus chaude, et quand l’air succombe lui-même à la touffeur la robe bouffante et suante se met à couler jusque dans nos dessous ou tout désir s’étouffe…
Au Capitolino les éphèbes d’Hadrien ont toujours le téton dur et le sourire doux, et quelques déesses à la douceur égale de marbre pur sous la caresse attendent avec eux la nuit – et comme la clim fonctionne et que tout est beau, comme à l’antique nous resterions là des heures à regarder le Temps qui passe…

Avec L. on se balade sans cesser de relancer nos curiosités, en a-t-on marre qu’on en redemande de jardins en terrasses (hier soir c’était de limoncelli qu’on redemandait tant et plus au coin de la place Saint-Eustache où se boit le meilleur café de Rome tandis qu’un émule de Paolo Conte sussurait en sourdine) et d’allées en promontoires dont la vue prend toute la ville, comme au débouché de la ruelle Socrate, à l’instant, sur le Monte Mario ou ce vieux chat se gratte…
Combien de temps le train s’est-il arrêté dans la nuit, et quels rêves dans le rêve l’ont-ils hanté tout ce temps comme suspendu, le train de nuit a-t-il quelque chose à nous dire, qu’il nous réveille parfois sur sa voie d’attente, ou n’est-ce qu’un rêve dans le rêve ?
Le veilleur sourit à l’idée que les dormeurs du train de nuit puissent se rencontrer sans se lever et se parler et fraterniser dans une autre dimension où la vie et le voyage se transformeraient en voyage vers la vie…
Une autre angoisse les reprendra tout à l’heure quand le train repartira, et c’est que le tunnel n’ait plus cette fois de fin, ou que le train plonge soudain, tombe soudain, ne traverse plus leur sommeil mais en devienne la tombe… (Rome et retour, mai 2009)
Lisbonne à la mer de paille

On arrive à Lisbonne par le ciel et c’est ensuite à bonnes foulées dans le vent vif qu’on descend l’Avenida da Libertade vers le fleuve là-bas qu’on devine entre les toits et la mer qui s’ouvre au-delà comme s’ouvre la ville à la double évidence claire et plus obscure qu’il n’y paraît, car aussitôt son mystères et ses ruses se ressentent à l’avenant et le premier soir on se tait, comme intimidé par tant de présences et de secrets latents, devant la mer de paille…
Son nom se chuinte du matin au soir et dans tous les quartiers, des palais aux bouges et à tous les étages on parle d’elle, on l’évoque , on l’exalte, on soupire, elle obsède, elle est partout et nulle part et de partout on vient la voir mais à tout coup elle se dérobe, elle est princière ou courtisane ou bourgeoise vertueuse ou lycéenne nattée à jolis bas ou fiancée abandonnée à poignard, elle attend son pirate, elles attendent tous leurs pescadores, elle sont transparentes et tout à fait imprévisibles comme le temps au ciel, d’ailleurs des poètes en débattent sur des photo surannées, et de partout montent en murmures les voix du passé tissant le présent, on raconte, on a dit, le discours est une musique il s’agit de choisir entre cracher fin et faire venir, à savoir ménager l’importun et le provoquer, on sait d’elle tant de choses mais patience, écoutez, mille voix la disent et la traduisent et la trahissent sans cesser de lui sourire – et ce matin de Pâques elle est toute vierge et pure sous le grand ciel lavé de tout le péché d’hier soir et d’avant-hier encore plus noir, elle est encore en cheveux, elle se prépare pour la messe et les bénédictions, hier soir encore elle vociférait qu’elle était si heureuse d’être si triste, c’était à n’y rien comprendre, elle fait mille manières, elle se tord les mains dans cette boîte de fado garantie tipica de l’Alfama, elle jette les mains en avant comme les jette la gitane et un sort avec, puis elle joue la sérénité et se met à parler français et te raconte alors l’histoire d’un saint venu par l’eau et de ses corbeaux invisibles et de ses scribes attitrés ou vagabonds, tel ce Camilo en ses mauvais lieux statufié dans le square voisin ou ce José Cardoso à sa fenêtre de solitude, telles ces voix gravées dans la cire du fado des errants – et ce matin de Pâques elle est en gloire au retour des caravelles, l’enfant prodigue fera le beau, elle a vu revenir ses pirates dont les capitaines sont juchés sur des colonnes trouant le ciel et là-haut d’autres histoires de comptoirs et de soleils mouillés se racontent au bord des parapets, enfin ce soir tout ça sera du passé et reprendra l’incantation à Lisboa, cependant qu’au bar de la religieuse portugaise, ou là-haut vers le miradouro da Nossa Senhora do Monte au tendre sanctuaire de la religieuse portugaise, ou là-haut sur le jardin suspendu de Santa Catarina où se convulse le monstre Adamastor, enfin partout, là-haut ou là-bas, où elle se trouve et se retrouve et se perd sans repères, les aiguilles du Temps continuent de tourner à l’envers…
Le sentiment ne m’est apparu qu’avec le temps que le point de départ se situe partout et que c’est tous les jours, comme à l’instant au promontoire de ce jardin dominant le Tage, qui me rappelle mes premiers départs d’un balcon en forêt à l’adolescence, dans l’état chantant des appels de Cendrars, vers une vie plus libre et pour écrire là-bas mieux que dans mon quartier de nains de jardin, par exemple à Sienne ou à Cortone, à Venise ou à Rome, et je partais mais n’en ramenais rien que les lumières infuses de Sienne, au déclin du jour orangé sur le Campo, des immatérielles collines de Cortone ou des crépuscules de Rome aux jardins de la villa Borghese.
Or, c’est cela justement qui nous est donné par le ciel de Lisbonne, c’est ce bleu, tout ce grand bleu que parcourt le vent à grandes enjambées, nous échevelant dans ce geste déjà familier de ses grande mains salées par la mer ou les monts, c’est ce bleu dans lequel on se dit qu’en effet on nage un peu, comme étourdi, secoué, mais c’est parti, cette fois c’est vraiment parti, le bleu s’est mis à parler, les azulejos à danser là-bas sur les murs et dans les patios, et me revoici sur ce balcon en forêt, quelques vies auparavant, au milieu de cette clairière où s’est formé le sentiment que c’était là que ça se passait et que partir n’aurait de sens que pour vérifier que tout se passe ici, à l’instant même et nulle part ailleurs…

Le geste du Léon de Manet de former sa bulle et d’en suspendre l’éclat résume à mes yeux ce chef-d’œuvre réalisé du moment pur de l’art, plus fragile et plus inutile on ne saurait imaginer, c’est l’instant absolu qui retient son souffle et pour l’éternité figurée que représentent les objets, car ce n’est qu’un objet mais qui nous fait signe, et voici que nous nous en arrachons avec son secret, Léon nous a dit son bonheur enfantin de former cette bulle, toute la grâce d’une enfance bientôt passée, toute la gravité de se sentir sans âge.
On « fait des heures », à Lisbonne, quand on n’a rien d’autre à faire, disent les Lisboètes, et l’Américain John Dos Passos dit sa « nostalgie endormie », et Saint-Exupéry lui trouve un air de « paradis clair et triste », José Cardoso Pires lui revient en confidence et lui fait d’emblée ce premier aveu qui en contient tant d’autres : « Pour commencer, tu m’apparais posée sur le Tage comme une ville qui navigue. Ce ne m’étonne pas : chaque fois que je me sens sur le point d’étreindre le monde, que ce soit à la pointe d’un belvédère ou assis sur un nuage, je te vois ville-nef, vaisseau fait de rues et de jardins, et la brise elle-même a pour moi un goût de sel. Il y a les vagues du grand large dessinées sur tes chaussées ; il y des ancres, des sirènes.Le bordage du pont, quand il s’évase et devient place avec une roses des vents brodée sur le pavage, est commandé par deux colonnes surgies des eaux qui montent une garde d’honneur aux partants pour les océans ». Et les yeux levés vers le bleu du ciel de ce matin de Pâques Pedro Tamen ajoute enfin :
« Du haut d’où je vous parle
J’ajoute du bleu de plusieurs couleurs
à cet autre bleu que vos yeux perçoivent… »
On peut ne savoir à peu près rien du Portugal, et guère plus de Lisbonne en dehors de ce qu’on en a lu dans quelques livres, et percevoir cependant, en peu de temps, un pays et une ville de connaissance, liés à un monde qu’on dira l’Europe des cultures, selon l’expression chère à Denis de Rougemont, qui l’opposait à l’Europe des nations et des bureaucrates.
Ainsi quelques jours seulement à flâner dans Lisbonne et tant d’odeurs aussitôt, suaves ou fortes, tant de couleurs douces ou vives, tant de lumières changeantes, le bleu des azulejos et le noir des gueules ou des yeux nous relient à Séville mais dans un autre ton, le linge aux fenêtres est celui de Naples mais différemment, l’ondulant pavé doux me remémore mes errances à Cracovie et je pense aux ports et aux figures de pêcheurs de Bretagne ou au bois sculpté des visages de nos vieux paysans de montagne, et lisant Miguel Torga je retrouve les gens de notre terre ou ceux de Verga le Sicilien, parce que derrière Lisbonne, nous rappelle justement Torga, plus en haut, plus près de la terre et du ciel, avant Lisbonne existe le Portugal comme un père ou comme la mère éternelle de ce père, et voici Torga parler de son merveilleux Royaume de Tràs-os-Montes, « tout en haut du Portugal, comme les nids sont tout en haut des arbres pour que la distance les rende plus impossibles et désirables », et c’est une espèce de Tibet dans l’océan de pierres, une espèce de Valais que rappellent ces mots qui pourraient être de Maurice Chappaz : « On ne voit pas comment ce sol pourrait donner du pain et du vin. Mais il en donne. Pain de maïs, de seigle, d’orge et de froment. Pain complet. Parce que c’est du vrai pain, et pétri à la sueur du front. Il a goût de labeur. C’est bien pourquoi les gens le baisent lorsqu’il tombe à terre ».
Or notre pain et notre vin d’Alentejo, ce soir, nous le partagerons dans le tonitruement obsédant du pont autoroutier et ferroviaire du 25 avril, au bord de la marina d’Alcantara, non loin de la promenade de Santos où commence la déambulation fantomatique du Requiem d’Antonio Tabucchi, et je voudrais oublier toute cette littérature, je m’étais promis de ne pas la laisser nous suivre partout, et la revoilà pourtant, la nuit scintillant sur le Tage et le boucan du pont se fondant au loin : elle est partout et voilà que Miguel Torga, loin de l’arrière-pays, ne peut que revenir et céder à son tour au charme : « Le sort a voulu qu’il en soit ainsi et que le Tage ouvrît dans le calcaire de l’Estremadura un estuaire large et majestueux, profond et abrité ; qu’après avoir meurtri les hauteurs côtières il les transformât en promontoire de rêve. Et de chaque colline où l’on vient se pencher c’est un ravissement sans limites qui embrasse le ciel et la terre en une même émotion reconnaissante. » Mais ensuite, avec le retour des caravelles, c’est une autre ville qui surgit de la nuit aux mille visages de toutes les ethnies et les couleurs et cette Europe sera de partout.

Il est émouvant de voir le jeune Pessoa, plein de componction lettrée, se faire le guide prévenant et candidement enthousiaste du visiteur débarquant à Lisbonne, dans un texte daté des années 1920-1930 et qui ne porte en rien la marque du génie polymorphe de son auteur. On y sent une autre urgence, qui est de partager un trésor dont la méconnaissance l’impatiente.
Voici ma ville merveilleuse, dit-il en détaillant ses monuments avec application zélée, et voici mon Portugal. Or, venant de Suisse, dont la gloire passée n’est en rien comparable à celle des Lusitaniens, mais qui fait bel et bien partie de l’Europe des cultures depuis sept siècles et plus, ce refrain lancinant des pays plus ou moins injustement dédaignés des prétendues grandes nations trouve un écho immédiat, avec le malin plaisir aujourd’hui de savoir que le guide un peu empesé de trente-cinq ans, dans son imper couleur muraille, est considéré désormais comme l’un des plus grands écrivains européens, à l’égal d’un Musil ou d’un Kafka, autres poètes apparemment «sans qualités» de leur vivant…
Au jasmin rebelle

Sur le départ on hésite, à tout coup, une dernière fois. On a la boule au ventre. On serait tenté de tout laisser tomber. On pense à l’emmerdement de tout voyage dans les pays à cabinets différents des nôtres. On pense à la chaleur, on pense aux voleurs (il n’y a que ça dans les autres pays), on pense à l’eau douteuse des pays de là-bas – et puis tout à coup ça y est, c’est reparti, le vieil homme est dépouillé, Aladin nous voici et Ferdine remet ça : « ça a commencé comme ça…
Et tandis que nous bouclons nos valises me revient le souvenir enchanté de Kairouan cette nuit-là, la première fois, cette nuit que j’étais tombé du ciel en reporter tout débutant, l’avion à hélices nous avait pas mal secoués, le nom de MONASTIR m’était apparu au-dessus des palmiers et maintenant c’était la route à cahots qui nous trimballait, enfin voici qu’au bout de la nuit noire tout était devenu blanc : c’était Kairouan aux mosquées, j’étais transporté, jamais je n’avais vu ça, c’était une magie éveillée, tous ces types en robes blanches et cette mélopée de je ne sais quelle Fairouz, ou quelle Oum Kaltsoum, tous ces appels tombés de je ne sais quels minarets et ces envolées, et sur les milliers de petits écrans de télé : ce même vieux birbe en blanc sorti la veille de l’hosto et qu’on me disait le père de tous – ce Bourguiba qui parlait à ses enfants ce soir-là…
Il paraît que ça s’est gâté en quarante ans, là-bas à Djerba, je ne sais pas, on verra, d’ailleurs ce n’est pas sûr qu’on s’y pointera, mais rien ne me rappellera plus, jamais, le parfum du printemps, la douce fraîcheur du printemps, la moelleuse suavité du printemps que celui de la fleur de jasmin dans les allées de Djerba…

Six mois après la Révolution du jasmin flotte toujours, en Tunisie, un parfum de liberté retrouvée dont tout un chacun parle et débat dans une sorte de joyeuse confusion qui me rappelle un certain mois de mai frondeur ; et comme au Quartier latin d’alors on y croit ou on veut y croire, on ne peut pas croire que ce soit un leurre, et d’ailleurs on va voter pour ça, cependant ils sont beaucoup à hésiter encore – pourquoi voter alors que tout se manigance une fois de plus en coulisses ? Et ceux qui y croient ou veulent y croire vont le répétant tant et plus : que l’Avenir sera l’affaire de tous ou ne sera pas…
Et là, tout de suite, sur les murs de l’aéroport et par les avenues ensuite, aux panneaux des places et sur la haute façade de l’ancien siège du Parti, voici ce qui sidère et réjouit Rafik le Scribe de retour au pays : que le Portrait omniprésent du Président n’y est plus, que cela fait comme un vide – qu’on n’attendait que ça mais que c’est décidément à n’y pas croire tandis que les gens répètent à n’en plus finir, genre Méthode Coué, que jamais, en tout cas, jamais on ne reverra ça…
Et dès le premier soir à La Goulette c’est la bonne vie retrouvée, la cohue de la rue et la bousculade populeuse, le jovial chaos des gens et des conversations aux terrasses où l’on continue de ne parler que de ça : de ce qui nous arrive et en adviendra, et c’est un régal de mets et de mots malgré l’anxiété qu’on sent mêlée aux libations – à la tablée du Scribe son frère le Conseiller Hafedh se livre à la plus fine analyse d’où il ressort que tout reste à faire et que rien n’est acquis, confiance et méfiance iront de pair et la soirée s’éternise entre frères humains.
On sait que c’est au Baron d’Erlanger, peintre délicat, que Sidi Bou Saïd doit le dominion établi de son bleu, sans pareil au monde si l’on excepte quelque ruelle ou quelque place de Séville ou des Cyclades, mais un tel ensemble, ici, du blanc chaulé et de cet extrême azur que surexaltent le violet ou le rouge et le blanc des bougainvillées et du jasmin, me paraît unique absolument, qui dépasse le pittoresque et le pictural pour devenir peinture sculptée ou architecture rêvée par un géomètre poète de la vraie races des bâtisseurs anonymes pour lesquels la beauté relève d’une seconde nature. On en reste sans voix.
Or, à ce bonheur avéré s’ajoute ces jours celui de voir les terrasses, au soir venant et à la nuit se faisant lentement sur la baie, occupées par des Tunisiens de tous âges et semblant goûter la jouissance du lieu plus tranquillement, au lieu de la meute ordinaire des roumis en pantelants troupeaux – et la nuit vient, on savoure son thé de menthe les yeux perdus jusqu’au Mont de Plomb, de l’autre côté des eaux scintillantes; et les amis s’attarderont longtemps encore à poursuivre sans discontinuer leur débat sur la vie qui va dans ce pays tout occupé de soi…
Avant cela nous nous étions perdus à travers la médina, dans la houle canalisée de la foule entre les hauts murs à loggias et moucharabiehs, étourdis par la touffeur des odeurs sucrées et des beignets, des parfums, des narguilés, et dans cette boutique où je m’étais arrêté pour faire l’achat d’une sacoche de cuir utile à l’attirail du plumassier, le prénommé Brahim, tout avenant avec sa dent manquante lui donnant quelque chose de médiéval, avait sorti son briquet pour me prouver que ce cuir-là n’était pas du vulgaire skaï et valait donc son pesant de dinars, et j’avais réduit sa mise de moitié, sur quoi Brahim m’ayant demandé quel avenir je voyais à son pays, je lui répondis comme au jeune douanier me le demandant pareillement à notre débarquement : mais mon gars c’est ton affaire et je te la souhaite toute bonne …
De la progression des salafistes et du ramadan prochain dont le parti religieux pourrait tirer profit politique, du sort de la Banque islamique ou de la déconvenue liée au nouveau Pacte républicain, le tigre du zoo du Belvédère ne semble point se préoccuper le moins du monde, mais qui oserait lui parler de liberté à celui-là !
Nous avons subi cet après-midi la morgue de la lionne et le dédain du cerf de l’Atlas, le regard plus doux et plus triste à la fois du Mouflon à manchettes et, sur leur rocher, les crânes mimiques de défi des babouins, nous avons vu le rhinocéros se tourner très lentement à notre arrivée pour ne plus nous montrer que son formidable derrière blindé – nous avons perçu l’humeur plombée par la chaleur des encagés, et je me suis rappelé alors ce paragraphe de Rien que la terre de Paul Morand où tout est dit de cette confrontation: « Je rêve d’un pacte de sécurité entre l’homme et les animaux, où chacun cessant d’obéir à la loi de la jungle, s’engagerait à se respecter en s’aimant ; où les tigres, comme des frères, viendraient à Singapore se faire soigner les dents par le dentiste japonais ou épiler les moustaches par le coiffeur chinois, iraient au besoin se faire admirer dans ces jardins zoologiques qui seraient comme d’accueillants hôtels, puis rentreraient librement chez eux dans la forêt équatoriale. Mais comment leur cacher que les hommes mangent de la viande ? »

À en croire la vieil Algérien Kateb méditant au bord de la fosse des singes Hamadryas, au zoo du Belvédère, le Tunisien se signale par une étrangeté de langage qu’on peut trouver choquante, en cela qu’il mange la femme et baise la chèvre.
De fait, lorsqu’un Tunisien se vante d’avoir connu une femme au sens biblique, il dit l’avoir mangée, ce qui ne semble pas une expression dictée par le Coran. En revanche, après un bon repas, il dira chastement qu’il a baisé la poule ou l’agneau, ce que le loup entendrait autrement puisqu’il se contente de manger ceux-là…
Le match de football de la finale de la Coupe de Tunisie, qui a été gagnée lundi soir par L’Espérance, contre l’Etoile, nous a valu un tonitruant concert de klaxons sur les pentes de Sidi Bou Saïd, mais c’est surtout devant les écrans de télé que la fête a eu lieu puisque la rencontre s’est jouée « à huis-clos » devant un stade à peu près vide, réservé à environ 2000 spectateurs, pour cause d’injonction répressive et de sécurité générale à relents post-révolutionnaire. Or on sait que la Révolution a également vidé les grands hôtels de Tunisie, au dam de l’économie du pays et des gens qui en vivent.
C’est cependant avec une espèce de satisfaction maligne que j’aurai traversé les halls froids et les allées et les pelouses désertées du Mövenpick de Gammarth dont l’étalage de luxe se déploie jusqu’au rivage doré, quasiment sans âme qui vive – et c’est l’expression qui convient à cette planque pharaonique pour Lybiens friqués: sans âme qui vive.
À la buvette du musée du Bardo toujours en chantier, dont nous avons parcouru ensemble le fabuleux dédale de mosaïques, le prof poète Jalel El Gharbinous avoue, quand nous lui demandons s’il avait prévu cette révolution, qu’il s’est juste trompé de trente ans. Mais la Mafia régnante, selon lui, était condamnée à terme : il était pour ainsi dire écrit qu’un tel état de corruption signât sa propre fin.
Et voici qu’avec trente ans d’avance, les Tunisiens déjà s’impatientent !
Comme nous filons plein sud sur l’autoroute à trois larges pistes constituant l’ancienne Voie Royale menant le Président Ben Ali d’un de ses palais à l’autre, nous remarquons, sur l’accotement, un jeune homme brandissant un bâton le long duquel se tortillent de drôles de lézards vivants. Alors notre ami Semi l’enseignant, frère de Rafik le scribe que nous accompagnons dans son pèlerinage à Moknine où il a passé son enfance, de nous apprendre qu’il s’agit de caméléons à vendre en vue de pratiques magiques, telles que s’y employait la femme du Président elle-même. La chose paraît hallucinante mais elle a été rapportée récemment par l’ancien majordome de la sinistre « coiffeuse », qui égorgeait chaque matin un caméléon sur la cuisse du potentat, lequel jetait aussitôt un sort à tel ou tel ennemi…
Après Hammamet, où se trouve l’ancien palais présidentiel, l’autoroute n’a plus que deux pistes, puis le voyage se poursuit par des routes de moins en moins larges, dans ce paysage du Sahel tunisien évoquant d’abord la Provence des vignobles et ensuite la Toscane des oliveraies, jusqu’à une bourgade où, par une entrelacs de ruelles de plus en plus étroites, nous arrivons dans celle qui fut le décor de l’enfance de Rafik le scribe et de ses neuf autres frères et sœurs.
Or une suite d’émotions fortes l’attendent en ces lieux. D’abord en tombant sur un grand diable émacié, la soixantaine comme lui, qu’il n’a plus revu depuis cinquante ans et avec lequel s’échangent aussitôt moult souvenirs qui font s’exclamer les deux frères se rappelant l’interdiction paternelle qui leur était faite de jouer avec ce « voyou » ! Ensuite en pénétrant dans la maison familiale occupée aujourd’hui par deux sémillants octogénaires : elle d’une rare beauté vaguement gitane, et lui figurant un vrai personnage de comédie orientale, qui nous ouvrent une chambre après l’autre afin de bien nous montrer qu’ils ne manquent de rien, leurs beaux lits d’acajou, leurs grandes jarres d’huile et de mil, le confort le plus sommaire et parfaitement suffisant à l’évidence.

Et puis dans la foulée : Rafik le scribe, conteur inépuisable retrouvant les lieux de son Amarcord des années 50, Rafik retrouvant la petite gare désaffectée de Moknine, Rafik pénétrant ensuite dans la salle de classe où l’instituteur le rouait de coups avec son bâton d’âne, Rafik retrouvant la boutique du photographe pédéraste qui lui valut d’être battu une fois de plus par son père inquiet de le voir revenir de là-bas avec un photo dont il était si fier, Rafik ému, tour à tout exalté, pensif, abattu, révolté une fois de plus…
En moins d’une heure et sur moins de cinquante kilomètres, entre Moknine et Sousse, dix kilomètres de côte délabrée et l’urbanisation touristique à l’américaine la plus délirante, on passe de la quasi misère au plus extravagant tapage de luxe, modulé par autant de palaces monumentaux, actuellement sous-occupés.
Voilà bien la Tunisie actuelle, qu’on sent entre deux temps et deux mondes, deux régimes et le choix le plus incertain – la Tunisie de toutes les incertitudes et qui aura de quoi faire avec tant de contradictions et de contrastes confondants, la Tunisie de demain dont on espère qu’elle s’aime assez pour s’aider; la Tunisie qu’on aurait envie d’aimer, aussi, sans la flatter, cette Tunisie où l’on est si bien reçu tout en restant tellement étranger…
« C’était tellement mieux avant ! », soupire la très vieille dame vieille France à sa compagne et complice qui lui demande de préciser : «Vous voulez dire du temps de Ben Ali ? », et la première : « Mais non voyons, je ne parle pas de ce malfrat ! », alors la seconde d’insister : «Vous voulez donc dire du temps de Bourguiba ? », et la très vieille momie : « Eh surtout pas ce manant de Bourguiba qui a tout chambardé ! Vous ne vous souvenez donc pas des parasols de l’Hôtel Majestic, combien leur couleur s’accordait aux uniformes de nos légionnaires… »
Rafik le scribe ne décolère pas, qui revient du quartier de la rue de Marseille, ce vendredi de prière, où il a buté sur des centaines de croyants musulmans obstruant la chaussée, comme on l’a vu à Paris et comme il me disait, récemment encore, que jamais on ne le verrait dans son pays !
« C’est le choc de ma vie ! » s’exclame-t-il en tempêtant, lui qui se vantait hier d’avoir botté le cul, adolescent, d’un agenouillé priant dans le nouveau sanctuaire de Feu Bourguiba, et son frère Hafedh le conseiller, plus tolérant, plus débonnaire, de chercher à le calmer en arguant qu’il ne s’agit là que d’une minorité, mais plus grande que la colère du Prophète est celle de Rafik le mécréant !
Il n’y aura de Révolution, me dit Rafik le scribe, Rafik le voltairien, Rafik l’intraitable laïc, que le jour où l’on cessera de me dire que je suis musulman parce que je suis Tunisien ! Mes frères m’enjoignent de me calmer en me disant que c’est comme ça parce que cela l’a toujours été, mais jamais je ne l’accepterai, pas plus que je n’ai accepté de célébrer le ramadan dès l’âge de Raison de mes douze ans ! Qu’est-ce donc que cet état de fait qui nous ferait musulman sans l’avoir voté ?
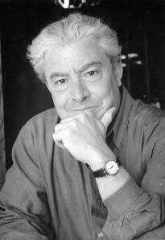
Dans le jardin sous les étoiles, dans la nuit traversée par les appels du muezzin et les youyous d’une proche fête de probable mariage, ce samedi soir, nous refaisons le monde entre amis et jusqu’à point d’heures, avec le rire pour pallier les éclats de Rafik le scribe, lesquels n’ébranlent en rien la patiente bienveillance de son frère Hafedh le conseiller, avocat et prof de droit qui connaît mieux que moi les rouages des institutions suisses sans parler des moindres aspects de la société tunisienne en plein changement. A propos, ainsi, des croyants musulmans priant sur le pavé jouxtant les mosquées, il nous explique que ceux-là, sincères et non politisés, ne constituent aucun réel danger et qu’il serait vain de leur interdire de prier ainsi, que le pays restera musulman et que la majorité des Tunisiens désapprouve les extrémistes violents, salafistes et compagnie, dont on a fait des martyrs en les enfermant et les torturant ; pourtant l’incertitude demeure et les excès de ceux-ci et des anciens du Parti dominant restent aussi imprévisibles.
De ces apaisements de l’homme sage et pondéré, Rafik le scribe n’a rien à faire. À ses yeux l’agenouillé et le couché sont indignes, mais c’est à mon tour de lui faire observer que prier est pour l’homme une façon aussi de se grandir et non seulement de s’aplaventrir, de se recueillir et de s’ouvrir à un autre ciel tout spirituel, et Nozha la gracieuse et la joyeuse invoque alors les transits d’énergie qui nous font communiquer avec les sphères et l’infini, et ma bonne amie sourit doucement et j’en reviens à d’autres cultes actuels du barbecue et du jacuzzi peut-être moins dignes que le fait de participer à la Parole – puis notre rire relativise toutes ces graves méditations dans la nuit des dieux divers…
C’est ce couple pétillant des vieux fiancés de Moknine, c’est Azza la femme médecin et écrivain évoquant le mimétisme des immolés par le feu, c’est cet autre médecin romancier imaginant dans son livre le rapprochement soudain des rivages opposés de la Méditerranée et racontant ensuite ses derniers mois d’opposant sur Facebook, c’est Samia sa conjointe professeure de littérature modulant ses propres observations sur ce qui se prépare, c’est Jalel nous consacrant une matinée pour nous montrer le Bardo, c’est Rafik et ses frères et sa nièce de trente ans lancée dans la modélisation en 3D d’une série d’animation évoquant la Tunisie de 2050, les amis c’est l’amitié sans idéologie, les amis c’est l’accueil et l’écoute et les possibles engueulées, les amis c’est l’art relancé de la conversation ou l’art du silence accordé – c’est un peu tout ça les amis…
Rafik l’étudiant, déjà vibrant de révolte et d’insolence, avait affronté son oncle Ahmed alors ministre de l’économie, en lui reprochant de promouvoir le tourisme dans les années 60. « Vous allez faire de nous des larbins, sinon des putains ! », avait lancé l’impudent à la face du grand homme de la famille qui l’écarta d’un revers de main : « Va donc, fils, tu ne sais rien de tout ça ! »
Or, un demi-siècle plus tard, l’on se dit qu’il y avait du vrai dans l’objection du jeune rebelle et que la question mérite d’être repensée…
Azza la romancière nous raconte l’histoire, à valeur de fable, de cette jeune touriste, d’origine tunisienne, revenue au pays avec des amis français en janvier dernier pour un séjour balnéaire assorti de tous les agréments distrayants, sportifs et festifs, quinze jours de rêve et retour vers le 20 janvier pour découvrir à Paris que, pendant ce temps, la Révolution était survenue en Tunisie.
L’embêtant avec ce tourisme-là, c’est que tu ne rencontres personne en vérité ; je me l’étais dit en 1970, envoyé en Tunisie pour mon premier reportage consacré au tout début du tourisme de masse, et je me le répète aujourd’hui en constatant à quel point le malentendu se trouve entretenu entre prétendus maîtres et semblants de serviteurs – ces rôles que tu peux inverser à l’envi…
À cette terrasse de La Marsa où nous nous trouvons avec quelques amis, Samia la prof de littérature nous fait observer les deux peuples qu’il y a là : celui de la terrasse qui a les moyens de consommer et l’autre là-bas de la plage où les gens se baignent gratuitement ; et c’est là-bas que je vais ensuite, à la mer qui appartient à tous mais où l’on ne voit pas un seul Européen pour l’instant, pas un Américain ni un Japonais, et les femmes mûres se baignent tout habillées ou ne se baignent pas, et voici cette vieille qui admoneste cette adolescente en maillot au motif qu’elle s’est trop approchée des hommes, là-bas, qui font les fous de leur côté…
Dans le dernier livre de Colette Fellous, un amour de frère à paraître prochainement, une scène des plus troublantes en dit long sur la très grande intimité et la très grande distance unissant-séparant la jeune sœur de vingt ans et son frère de sept ans son aîné lorsque de celui-ci, reposant nu après sa mort, nu mais sous un drap, sa sœur s’approche, seule, et soulève le drap pour voir de lui cette chose qu’elle n’a jamais vue alors qu’un tel amour les unissait qu’elle draguait parfois les garçons pour lui – ce confondant secret de l’autre ignoré, trop dangereusement aimé et interdit, séparé par sa mortelle maladie de diabétique et par celle de vivre aussi…
Le bord de mer de Moknine n’est pas loin aujourd’hui du cloaque, où Rafik et les siens venaient se baigner en leur âge tendre, et c’est devant ce rivage infect, paradis de jadis, qu’il m’apprend que les femmes, ici, n’étaient autorisées à se baigner que la nuit ; et je me rappelle alors les affolements pudibonds de notre grand-mère paternelle tout imprégnée de sentences bibliques et surtout de l’Ancien Testament et de l’apôtre Paul le sourcilleux, jérémiades et malédictions, chair maudite et interdits variés, qui nous enjoignait, garçons, de cacher notre oiseau, et pas question pour les filles de porter ces minijupes ou ces bikinis inventés par Satan…
Depuis notre premier soir à La Goulette, où nos premiers échanges amicaux ont duré des heures autour d’une table en terrasse, les mots-clefs qui m’ont semblé caractériser le ton de toutes nos conversations auront été: soulagement, libération, espérance, sur fond d’inquiétude latente, mais comme un nouveau souffle se manifestant à tout coup, avec quelle reconnaissance de tous pour « les jeunes »…
Et cette fébrilité partout perceptible, notamment dans les journaux qu’on sent traversés par le souffle d’un débat de fond, véritable raz-de-marée d’expression relevant visiblement de l’exorcisme et de la compulsion, où le sentiment d’urgence revient à tout moment, et les mises en garde, les avertissements, les appels à la responsabilité, la dénonciation des fauteurs de troubles, la méfiance envers ceux qui pourraient trahir ou capter la révolution.
Certains médias occidentaux semblent déjà se réjouir, avec quelle mauvaiseSchadenfreude, de ce qu’ils décrivent, en termes plus ou moins méprisants, comme une retombée, voire une faillite, de ce qu’on a appelé le « printemps arabe ». Mais que peut-on en dire au juste ? La Bourse de Tunis, m’apprend un journal financier africain, accuse un recul « historique » de 19% pour les six premiers mois de l‘année. Et qu’en conclure ? Partout on entend ici que « rien ne sera plus jamais comme avant ».
Très exactement ce que disait la rue de Mai 68, dans le Quartier latin où nous avions débarqué, jeunes camarades, en petite caravane de Deux-Chevaux helvètes, et de fait bien des choses ont changé de puis lors, mais bien autrement que nous nous le figurions, et qui pourrait imaginer ce que sera l’avenir du monde mondialisé – quelle sorte d’espérance qui ne soit pas à trop bon marché ?

À l’instant je me rappelle cependant cette autre formule de la Révolution du jasmin : « Plus jamais peur ». Et me revient alors l’observation de Jalel El Gharbi se faisant reprendre par ses enfants avant la chute de Ben Ali : « Chut, papa, on pourrait t’entendre… ».
Où l’espoir du « plus jamais peur ! » rend un son propre à ce qui s’est passé en Tunisie, en attendant le meilleur ou le pire…
Sur la même page d’ Un amour de frère, son dernier récit évoquant à la fois un retour à ses sources tunisiennes et son arrachement à un monde par trop contraignant, toutes choses liées et fondues par la ressaisie de ce qu’elle appelle la mémoire aimantée, Colette Fellous évoque la chevauchée de Bourguiba à travers Tunis préludant à l’indépendance, et sa propre cavalcade de jeune fille en quête d’émancipation, qui se retrouve à Paris avec ses frères et découvre le monde dans les salles obscures des cinémas. Exactement comme ce fut le lot de Michel Boujut, jeune déserteur de la guerre d’Algérie se planquant avant son exfiltration vers le pays des porteurs de valises qu’était alors la Suisse…
On sent chez certains la nostalgie des années Bourguiba, et tel de ceux-là rappelle les qualités de la première constitution de 1959 élaborée sous l’égide de celui-ci, qui pourrait encore faire l’affaire à ce qu’il écrit dans La Presse. Mais sur les murs de Tunis que voit-on ces jours ? On voit partout l’effigie de Salah Ben Youssef, camarade puis rival du « combattant suprême », bientôt recalé, contraint à l’exil et assassiné par un sbire de celui-là. Et Bourguiba de s’en vanter publiquement lors d’une manifestation à grand fracas.
Cela pour se rappeler, me souffle Rafik le révolté, qu’une dictature en a remplacé une autre, avant de préciser que l’avenir sous Ben Youssef n’eût pas été, probablement, garant de plus liberté tant il était proche des islamistes, lesquels se servent aujourd’hui de lui, par voie d’affiches, pour appeler au rassemblement des leurs…
On a beaucoup parlé, dans les médias occidentaux, du pacifisme caractérisé de la révolution du jasmin ; or il faut s’en rappeler aussi les violences, et la chronique, jour par jour, des événements survenus depuis l’immolation par le feu de Mohammed Bouazizi, en décembre 2010, rappelle comment le formidable mouvement de protestation et de destitution de la Mafia despotique fort bien vue des Américains et des Français, a cristallisé après nombre de soulèvements populaires aux quatre coins du pays, et notamment dans les foyers de révolte de Kasserine ou de Ghafsa, violemment réprimés.
J’ai retrouvé cette chronique, très abondamment illustrée et documentée, dans un grand album récemment paru intitulé Dégage ! à côté duquel un Indignez-vous !, ou un Engagez-vous ! paraissent bien convenus…
Au fil de ces jours que nous avons passés en Tunisie qu’il avait encore connue sous la dictature en octobre dernier, notre ami Rafik n’a cessé de râler contre tout ce qui ne va pas dans ce pays: les machistes et les salafistes, les détritus non ramassés dans les rues et les musulmans agenouillés en travers de la chaussée, ou, pour faire culminer sa rage, le veilleur de nuit de l’hôtel infoutu de le réveiller à l’heure !
Et s’il n’y avait que ça ! Alors que son dernier livre, Les Caves du Minustaire, est perçu par beaucoup de ses lecteurs comme l’oeuvre d’un monstre de cruauté (les lecteurs reportent souvent la férocité du réel décrit sur l’auteur…) en cela qu’il détaille la monstruosité d’un régime de maffieux recourant à la torture, lequel régime s’effondra peu avant la publication de l’ouvrage !
Et voici, ce dimanche matin à la Télévision nationale, le même intempestif se montrer tout bien élevé et réservé, poli, stylé mais sans flatterie, se gardant de faire au potentat l’honneur de citer nom, comme si l’on était déjà dans l’Histoire entérinée, et va ! comme dit la conteuse de son roman…
Certains jours je me suis demandé ce que nous fichions dans ce pays, tant j’y éprouvais de contraintes latentes, surtout dans la relation entre femmes et hommes. Mais grâce à nos amis j’ai finalement envie d’y revenir encore et déjà j’y pense, déjà nous y pensons avec ma bonne amie – nous reviendrons et pas que pour les rivages dorés de la Tunisie balnéaire.
Une jeune fille de notre connaissance raconte que sa famille, après qu’elle eut brisé ses fiançailles, l’a bonnement harcelée afin de trouver un nouveau prétendant, et l’a même sommée de se livrer à ce qu’elle appelle des «entretiens d’embauche». Or loin de nous éloigner de ce pays, de telles situations nous donnent envie d’en savoir plus ; et c’est pourquoi je me suis lancé, après notre rencontre, dans la lecture des Propos changeants sur l’amour d’Azza Filali, dont la dernière phrase est de mise ce dernier dimanche matin : « À de tels moments, il m’arrivera, sans doute, de repenser à vous »…
Or la dernière vision que nous retiendrons de cette trop brève semaine en Tunisie sera celle des Mangeclous, je veux dire des Ben Salah, de la tribu des Ben Salah comptant, pour la seule génération de Rafik, cinq sœurs et cinq frères, ces Ben Salah venus saluer leur frère et oncle ou cousin, surprise des surprises, dans le hall de départ de l’aéroport ! Aussitôt j’ai pensé : voici les Mangeclous, par allusion aux Valeureux du Juif Albert Cohen de Céphalonie – et même les couffins y étaient, débordant de figues et de dattes et d’Allah sait sûrement quoi.
Oui mon cher Rafik, et que tu le veuilles ou non, le temps de ce vol de retour Allah sera ton copilote et les roumis que nous sommes lui adressent un ultime salamalec… (En Tunisie, juillet 2011)
Le joaillier, les grappilleurs et l’alouette

Il n’est pas, me semble-t-il, de véritable premier voyage qui ne s’ancre dans la première enfance, je veux dire : dans l’odieux emmaillotement de la première enfance et dans son immobilité forcée, dans la première impatience de l’enfance et son premier trépignement après son premier cri, dans les premiers regards effarés de la prime enfance sur tous ces murs et tous ces yeux et toutes ces serrures, dans le premier effroi de l’enfance qui vous a fourré dans ce corps et dans ces couches et dans ces entrelacs de bras et de barreaux de prison, dont il faut absolument s’arracher.
La première enfance, il faut bien le dire, est tellement contraignante qu’elle appelle immédiatement au voyage. On ne peut rester là. On droit partir, on doit se casser, on n’en peut plus : de l’air ! Cependant pour l’instant – la vie est dure, mais c’est comme ça -, on ne peut aller nulle part ailleurs, sinon par l’imagination, et même cela sera pour plus tard.
Pascal Quignard raconte, dans La barque silencieuse, le retour des nourrissons parisiens confiés aux femmes de Corbeil, connues pour leur bon lait campagnard et forestier, sur de longs coches d’eau appelés aussi corbeillats (dont le mot corbillard découlera), glissant le long de la Seine, et les terribles hurlements des nourrissons emmaillotés.
Pascal Quignard n’est pas vraiment ce qu’on peut dire un écrivain du voyage, mais on voyage beaucoup, à travers ses livres, dans les mots qu’il ne cesse de sonder pour en dire mieux le transit. Ainsi écrit-il à propos de la prime enfance : « Quel qu’il soit, quel que soit le siècle, quelle que soit la nation, tout enfant est d’abord un inconnu. Tout destin humain est : l’inconnu de la mise au monde confié à l’inconnu de la mort. »
Ensuite l’enfant se fait au monde, comme on dit. L’enfant s’acclimate et s’habitue. L’enfant s’avachit, en tout cas en apparence. L’enfant déchoit-il ? Minute ! Car l’enfant entend aussi des contes et commence bientôt à lire, et c’est alors un nouvel appel d’air et le possible sursaut du voyage, d’abord imaginaire, avec les livres et par les oncles.
Une enfance sans oncles voyageurs, comme les sept oncles de Blaise Cendrars, une enfance sans tantes un peu aventurières, à l’image de l’institutrice bernoise Lina Bögli, est une pauvre enfance, convenons-en. Pourtant les premières nouvelles du monde rapportées de vives voix par les oncles et les tantes à l’enfant lui arriveront, tout aussi bien et parfois mieux, par les livres.
Par les oncles l’enfant apprend qu’il y a des pirates en Malaisie et des mines à Sonora, les noms des oncles et des tantes diffusent une première magie que les livres prolongent les jours de pluie ou sous la lampe. L’enfant lit ainsi : « Le thé des caravanes existe », et le monde existe autour de lui. Puis l’enfant se cabre et se busque en adolescent farouche et lit alors : « Il y a dans l’intérieur de la Chine quelques dizaines de gros marchands, des espèce de princes nomades », et l’enfant se reconnaît évidemment et le voyage n’en finira plus désormais, il reçoit d’un de ses oncles Vol à voile de Cendrars et bientôt Bourlinguer et plus tard Moravagine et voici ce qu’il lit à douze ou quinze ans : «Moscou est belle comme une sainte napolitaine. Un ciel céruléen reflète, mire, biseaute les mille et mille tours, clochers, campaniles qui se dressent, s’étirent, se cabrent ou, retombant lourdement, s’évasent, se bulbent comme des stalactites polychromes dans un bouillonnement, un vermicellement de lumière. » Ces mots précis, ces mots comme des musiques et des sculptures, ces mots comme du cinéma ont marqué la pâte tendre de l’enfance et de l’adolescence, dont tous les voyages découleront ensuite plus ou moins.
De fait les mots précis des poètes, et je pense maintenant à Nicolas Bouvier, en disent plus que les récits plus ou moins ressassés, voire éventés, des oncles voyageurs, comme on verra que les écrivains qui voyagent en disent plus, dans le précis et le durable, des voyageurs qui écrivent, avec de notables exceptions.

Lina Bögli en est une. Avant Nicolas Bouvier, mais sans l’intention poétique de celui-ci, Lina Bögli incarne une curiosité voyageuse assez typiquement helvétique, avec une façon de capter et de restituer ses observations, frottées de bon naturel, qui rappelle immédiatement Ma vie de Thomas Platter, le candide chevrier des hauts gazons devenu grand humaniste de la Renaissance européenne, Le pauvre homme du Toggenburg d’Uli Bräker, l’érudit paysan traducteur de Shakespeare, ou encore les merveilleuses lettres de voyage de Thierry Vernet, constituant un pendant foisonnant et primesautier de L’Usage du monde.
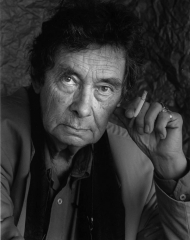
Or, le rapprochement des écrits de Nicolas Bouvier et des lettres de son compagnon de voyage, représentant désormais près de mille pages, devrait permettre au lecteur de mieux faire la distinction entre ceux qu’on dit des écrivains voyageurs et ceux qui, voyageurs eux aussi, n’ont pas pour autant de prétention littéraire. La distinction n’est ni polémique ni académique non plus : elle vise au rapport de celui qui écrit avec la langue, elle marque la nuance entre l’écrivain accomplissant sur la langue un travail de joaillier, et celui, plus modeste, et délié, qu’on pourrait dire écrivant ou grappilleur.
D’aucuns tendent à penser, peut-être par rejet de toute une mode actuelle des « étonnants voyageurs » devenue fonds de commerce, que, de la littérature du voyage, il n’y a de bon précisément que LA littérature, à savoir : les œuvre surfines d’écrivains surfins, stylistes parfaits, dont Nicolas Bouvier serait l’un des maîtres. Mais cette distinction ne tiendrait pas longtemps. Elle ne tiendrait même pas longtemps à comparer la prose étincelante de L’Usage du monde ou du Poisson-scorpion et certains récits de voyage de Bouvier, d’un éclat et d’une densité moindres. Il y a, de toute évidence, un incomparable joaillier chez Nicolas Bouvier, mais le grappilleur compte aussi, et la lecture de sa correspondance avec Thierry Vernet, loin de ternir son image, ne laissera au contraire de l’enrichir et de mieux montrer aussi l’entier du voyage, en deça et au-delà de la seule joaillerie. De la même façon, l’on pourrait distinguer chez un Cendrars ou un Charles-Albert Cingria, autre poète itinérant, les composantes du joaillier taillant, polissant et sertissant les mots comme des bijoux, et celles du grappilleur plus débonnaire. Mais revenons, un instant, à notre charmant tendron.
À trente ans, en 1892, craignant de s’encroûter dans la famille polonaise qui l’emploie à Cracovie, l’institutrice Lina Bögli décide d’accomplir un tour du monde dont elle fixe la durée à une dizaine d’années : « Je ne suis nécessaire à personne, je n’ai point de parents qui pourraient se tourmenter pour moi, donc je pars ! »
Embaquée à Brindisi à bord du bateau Vorwärts (En avant !, dont elle se rappelle que ce fut la devise de l’explorateur Nansen), la jeune femme, petite provinciale encore farouche, va gagner Colombo par Aden (« trop de degrés de chaleur, trop de serpents et trop de mendiants »…), avant de pousser jusqu’en Australie où elle s’installera plusieurs années à Sydney, toute dévouée aux variantes diverses de la jeune fille mondiale. Or, tout au long de son périple, Lina Bögli écrit à son amie Lisa des lettres épatantes d’ingénuité malicieuse et de franchise, mais aussi de précision réaliste dans ses observations, dont le ton et la sagacité pourraient être d’un Candide curieux de notre temps ou d’un Huron en jupon. Il y a chez elle en effet du petit reporter, qui soumettra tel vieux Maori cannibale à l’interview et se rendra chez les Mormons polygames de l’Utah en s’inquiétant d’abord de leur mœurs, avant de reconnaître les agréments inattendus de leurs arrangements. Et quant à la vraie douceur de vivre, notre probable vierge la découvrira aux îles Samoa où tel bel indigène la tentera bel et bien de s’installer en ce paradis avant de la faire se récrier : « Hélas, j’ai besoin de toutes les choses qui font mon tourment ! ».
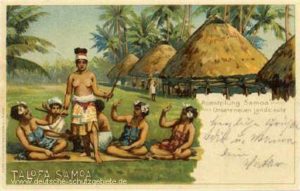
Le récit épistolaire de Lina Bögli n’est à vrai dire ni d’un joaillier ni d’un grappilleur, mais il n’en participe pas moins d’une lecture de monde à la fois limpide et cousue de préjugés bientôt remis en question, typique en somme de l’approche du touriste contemporain le mieux intentionné, le moins prédateur, le plus sincèrement intéressé par le monde et les gens. Il est émouvant, ainsi, de la voir compatir, en Helvète démocrate, avec les Hawaïens humiliés par l’annexion américaine, et plus touchant encore de la voir bouleversée par l’arrivée des émigrants européens à New York, comme si cet exode exprimait toute la misère du Vieux Monde.
Maints écrivains voyageurs sont plus brillants qu’elle, maints voyageurs-écrivants ont plus de choses à raconter, mais Lina Bögli nous ramène à une sorte d’enfance du voyage qui nous rappelle Tintin, Robinson ou les jeunes gens entreprenants de mark Twain ou de Jacl London, avec une fraîcheur, une capacité d’émerveillement, mais aussi d’indignation, que nous retrouvons également dans les lettres de Nicolas Bouvier et de Thierry Vernet en leur jeunesse impatiente de s’arracher à l’emmaillottement calviniste et bourgeois de leurs familles.
À la fin de son tour du monde, fatiguée mais contente, retrouvant la vieille Europe et Cracovie dix ans après son départ, ponctuelle comme un coucou suisse, Lina Bögli formule cette humble conclusion pleine de reconnaissance : «En regardant en arrière, je vois qu’en somme j’ai eu bien peu de souffrance et de difficultés. Jamais le moindre accident grave ne m’est arrivé ; je n’ai jamais manqué ni train ni bateau ; je n’ai jamais rien perdu, n’ai jamais été volée ou insultée ; mais j’ai rencontré partout la plus grande politesse de la part de tous, à quelque nation que j’eusse affaire. »
Et tel pourrait être, aussi, le bilan d’un bon usage du monde, aussi légitime en somme que celui des joailliers ou des grappilleurs de la littérature voyageuse.
Nicolas Bouvier, maître joaillier s’il en fut, n’est pas pour autant, non plus, l’artisan suprême de la poésie du voyage, évidemment incarnée par Dante Alighieri dont la Commedia représente le périple initiatique par excellence, ressaisissant le parcours symbolique de l’homme en ce bas monde dans une langue à la fois fondatrice et de radieuse portée, bonnement universelle.
Or, au vingtième chant du Paradis, Dante trouve une image adaptée au démaillottement du mondial poupon cousu dans sa camisole de force, exprimant le plaisir divin d’être au monde dans la pureté du soir : « Comme l’alouette qui s’élance dans l’air / chantant d’abord, et puis se tait, contente de la dernière douceur qui la comble, elle me sembla l’image de l’empreinte/ du plaisir éternel, au désir de qui /toute chose devient ce qu’elle est… »
Sud des Alpes

Il n’est pas de vert plus vert que celui du Lac Majeur, de ce vert émeraude de l’eau qui tourne au noir sur les monts à la péruvienne que le subit et grondant orage d’été dramatise encore, et nulle pluie n’est si drue et si liquide et si fraîche et si limpide et si vivement mouillée que celle qui tombe en trombes de ce ciel tessinois du partage des eaux du Nord et du Sud évoquant à la fois les fjords et le Brésil – le plus sévère et sensuel mélange de l’alpin et du latino…
Les mots chantent ici comme nulle part en Suisse, les mots et les noms aussi, pergola et Solari, zoccoli et Solduno, les mots chantent ici autrement qu’en Italie, en Italie on ne dit pas grotto comme ici, en Italie on hésiterait tout de même à baptiser une montagne Monte Generoso, ou une autre Monte Verità, il y a là quelque chose de terrien et de lyrique à la fois, de pierreux et de fluide, d’âpre et de soleilleux comme le vin d’un rouge un peu noir et d’un goût un peu dur qui se retrouve dans les visages des vieux aux yeux candides…
En remontant la Maggia l’on passe de la Polynésie languide aux marmites d’eaux glacées où les corps mortels et les âmes suressentielles se purifient, et c’est dans un bleu d’agate qu’on se plonge et se frotte et se lustre, il y a là de quoi revigorer les peaux jeunes et vieilles, nulle part au monde sauf peut-être au Japon l’eau n’est si belle et bonne que dans cette rivière tombée du ciel et polie par la pierre…

Le banc à la fontaine du bout du village a été repeint, mais une couche de rouge ne suffit pas à effacer notre souvenir des baisers volés aux soirs de l’adolescence, à présent il fait encore jour, un garçon fou de rap y gravera peut-être demain, au couteau à cran d’arrêt, Ti amo Luisa, mais dès la nuit revenue reprendront les chers murmures de l’adolescence, au paradis des premières sensualités, dans le vol effaré des noctuelles et des chauves-souris…
Il nous était permis, enfants, de tapoter les trois ventres du Marseillais se vantant de tout à nos veillées de la fontaine, mais de ses trois boules il se gardait de nous parler, enfants, alors que notre grand frère en partageait le secret tout en nous enjoignant de tapoter le bedon, faute de bossu sous la main pour nous porter chance – et sur les trois boules notre père concluait : bidon de Marseillais..
Les filles de l’été se repaissaient de feuilletons à l’eau de rose et les garçons de fumetti, aux filles de l’été nos mères et nos tantes refilaient les derniers numéros de Nous Deux, et toutes, cet été-là, craquèrent pour les yeux bleus de Jean Sorel en beau meccano qui en pinçait pour la fille d’un richeto, et l’histoire intitulée L’été fatal finissait par le crash en auto des deux amants après une première et dernière nuit qui faisait rêver les fanciulle de tous les âges – se non è vero è ben trovato…

Riviera dei Fiori
La descente vers le Sud, des Alpes à la Riviera dei Fiori, ne m’avait jamais semblé une telle plongée, et de fait il n’est aucune voie, me semble-t-il, en Italie et peut-être même dans toute l’Europe et le monde quadrillé d’autoroutes, qui donne, autant que l’A6, reliant Torino à Savona, le sentiment-sensation qu’avec son véhicule on est plus que lancé : précipité sur un toboggan, entrecoupé des innombrables tubes fermés que sont les tunnels, dans une dévalée vertigineuse qui tend bientôt à annuler tout autre paysage que celui des monts boisés affleurant les viaducs, au-dessus des toits roses des villages, avec le souci constant d’échapper aux poids lourds de plus en plus pressés à ce qu’il semble de rejoindre les ports et autres hangars du bord de mer.

Dino Buzzati a tout observé et pressenti, dans son Voyage aux enfers du XXe siècle, de ce que deviendraient les villes tentaculaires et les terres partout urbanisées du monde à venir, et encore l’A6 en octobre échappe-t-elle aux migrations massives des vacanciers, mais l’ultime plongée sur la ville aux grandes cheminées et aux voies suspendues tournoyant au-dessus des zones industrielles a bel et bien de quoi donner le vertige, comme au débouché des tunnels sur Gênes, sur quoi l’on aperçoit là-bas la mer étale dans son indifférence bleutée, et le nom de Via Aurelia nous fait passer d’un temps à l’autre avant que le nom de Riviera s’accorde enfin aux couleurs encore vives des bougainvillées…

Notre goût partagé, avec Lady L., nous a toujours fait fuir les étalements balnéaires et les foules estivales, et c’est donc en ambiance connue que nous retrouvons cet hors-saison de la côte s’incurvant entre Alassio et San Remo, foison d’anciens petits ports saturés par l’industrie vacancière et cependant, merci la chance, voici que la Pensione Maruzzella où nous nous retrouvons ce soir, bourdonnante de gens peu portés à se pavaner, nous évoque la fin des vacances de Monsieur Hulot ou quelque chronique populaire du meilleur aloi.
Après le repas du soir (Strozzapreti alla Sorrentina arrosés de Nero d’Avola par trop dur et froid je trouve), en compagnie nombreuse et fourmillant de petits enfants qu’ont emmenés leurs parents profs en vacances, nous marchons dans la nuit déserte jusqu’aux quais déserts bordés d’hôtels déserts et de discos non moins admirablement désertes, muettes, toutes paupières baissées, stores verrouillés – la fête est finie sauf dans nos cœurs…
Ce matin m’est venue l’idée, dans la pénombre de l’hôtel anonyme, et après une nuit interrompue par une longue insomnie (séquelle du Nero d’Avola trop acide d’hier soir), que ce n’est pas la pensée-sensation de la mort qui plombe ma première conscience de l’éveil, à chaque aube, depuis quelques années, mais au contraire la pensée de la vie, l’angoisse et presque l’épouvante à la conscience exacerbée de ce qu’est la vie et de ce qu’elle sera de plus en plus, avec la pensée-sentiment que je n’en fais pas assez pour la mériter vraiment, que je la galvaude et la vilipende au lieu de travailler sans relâche à la transmutation du plomb en or, pensée-sentiment qui recoupe très exactement celle que Tolstoï module dans La mort d’Ivan Illitch et qu’on retrouve dans le génial Vivre d’Akira Kurosawa, dont les protagonistes, pris à la gorge par l’annonce de leur mort prochaine.

Or j’y repensais ce soir en nous attardant, après la longue montée dans les ruelles médiévales aux belles couleurs passées ou rafraîchies du vieux Menton, par les allées du petit cimetière en plein vent enclos, au sommet de la colline, et donnant donc sur la mer, dans les ruines de l’ancien château ; je pensais à tant de vies peut-être brillantissimes, de princes russes et de duchesses austro-hongroises, entre autres Lords et Ladies anglais, venus se réfugier en ce semblant de paradis terrestre, précédés ou suivis de leur progéniture plus ou moins perdue de tuberculose, et dont ne témoignent plus que quelques monuments usés ou cassés, quelques inscriptions souvent effacées, et cette kyrielle de noms prestigieux (Troubetzkoi, Volkonski, Souvarov, Henkel von Donnersmarck) qui ne disent quasiment plus rien aujourd’hui à personne de moins de trente-trois ans – et loin de me sentir accablé je me rappelai l’herbe qui repousse sur la tombe du bon Illia Illitch Oblomov, sous le ciel brodé des mêmes étoiles qui ornaient sa très vaste et très douce robe de chambre d’éternel paresseux…
On monte le long de venelles à marches d’âne, le grand bleu revenu fait aux murs vanille ou safran, mauves ou verts, une toile de fond qui se fond presque là-bas au bleu cependant scintillant de la mer , c’est le plein silence de l’après-midi d’après la haute saison, en ce bourg d’anciens pêcheurs de corail, les murs renvoient un peu de chaleur encore, et plus haut se découvre la blanche façade ornée de la grande église baroque en gloire de San Giorgio de Cervo, dans la pénombre de laquelle m’attend cette toute petite effigie d’un Christ aux douleurs, la vraie présence de ces lieux, en un autre lieu pourtant…

Mais un vilain verrou, bouclant une haute grille, interdit l’accès de la petite église hors-les-murs de San Nicola, qui nous tient ainsi à distance du Cruciflé, là-bas, tout émacié mais de bois dur ivoirin, taché de sang et la peau déchirée par le fouet et les bâtons, quelque chose du supplicié de Grünewald ou de quelque autre maître ancien arrachant la scène à toute sensualité pour exacerber l’expression de la Douleur mais sans pathos de théâtre pour autant – même de loin on perçoit cette figure de vérité que le cadenas protège probablement des immondes pillages de sbires d’antiquaires…
Et sous le même ciel se tortillent les deux pimbêches et les chauves tout cuir à créoles de macs qui les cornaquent, tout enveloppées de peignoirs et prêtes là-dessous à tous les déguisements, au théâtre frelaté de Portofino, toutes les poses, les lascives et les langoureuses, laquées et lustrées, les lèvres et les ongles peints des mêmes roses violacés – c’est la Dolce Vita de Gabbano pour pubs de demi-luxe, les chauves se font pitbulls aux chevilles de qui materait de trop près ; c’est l’Italie putanisée du Cavaliere que nous regardons avec cet œil amusé que nous a enseigné le Maestro Fellini…
On descendait en Italie, dans les années 50 et 60, par les premières autoroutes européennes, avec les allemandes, qu’on appelait alors des autostrades, et ce matin nous nous retrouvons sur cette Via Aurelia dont le nom fleure l’antique et qui, de San Remo, file vers Savona et ensuite, changeant de nom, vers Genova et La Spezia, Livorno et Roma ou plus bas vers l’Italie africaine…
Cependant, autant l’autostrade contrevient à la lecture des paysages, autant elle est propice à celle des livres que nous avalons avec les kilomètres, Lady L. conduisant et moi lui lisant la belle et bonne conférence du Nobel donnée l’an dernier à Stockholm par Mario Vargas Llosa, intitulée Eloge de la lecture et de la fictionet célébrant par conséquent ce qu’on pourrait dire la révélation du monde et l’invention de cette fausse réalité, plus vraie que la vraie, que nous appelons littérature.
Il n’y a presque plus de paysage lisible aux fenêtres de la Honda Jazz Hybrid,que les monts pelés de la côte ligure, puis les amoncellements urbains des approches de Gênes – on est de nouveau précipité entre tunnels et viaducs, mais dans le volée on lit ceci qui vaut bien des horizons : « Tout comme écrire, lire c’est protester contre les insuffisances de la vie », ou cela encore : « Nous serions pires que ce que nous sommes sans les bons livres que nous avons lus ; nous serions plus conformistes, moins inquiets, moins insoumis, et l’esprit critique, moteur du progrès, n’existerait même pas »…
En plongeant de Turin à Savona j’avais repris la lecture des nouvelles du compère Bertrand Redonnet en son succulent recueil du Théâtre des choses, où le voyage se poursuit entre Bretagne et Garabagne polonaise, jetant d’autres passerelles entre nos humanités.
Bertrand Redonnet est un drôle de loup français des steppes. Il vient de Maupassant et va vers les conteurs russes à la Leskov, via la poésie anar bien rythmée et mélodieuse de son cher Brassens, et ses humanités se peaufinent entre isbas et gargotes, comme en ce troquet de l’île de Ré où le voici tomber sur le type le plus farouche qui soit, « seul au monde » dit le titre, parangon peut-être de ce qu’on pourrait dire un frère humain voire un « copain d’abord », à cela près que les circonstances de la vie, les gènes et la gêne de ce qu’on appelle la « nature humaine » ont fait de cet individu visiblement sorti de taule ce qu’on dit précisément dans les journaux : un Individu, cet Individu – l’Individu a encore sévi, l’Individu court toujours…
Devrais-je m’inquiéter d’éprouver en somme, et quoique n’ayant aucun goût pour le crime de sang ou de sexe, de meilleurs sentiments pour un tueur en série, violeur de surcroît, vraiment la lie des ergastules, que pour deux mannequins italiens flanqués de leur clique et nous imposant, sur le môle de Portofino, le théâtre débilitant de leur shooting d’enfants de pub ? Je ne sais pas, ou plutôt je sais trop bien…
C’est que l’homme de Seul au monde existe, par la grâce d’un écrivain vrai, tandis que la pauvre comédie des top models et de leur escorte de malabars asexués se réduit à du tout simili, singerie d’imitation et tutti quanti, autant que celle des Ricains friqués et fardés des terrasses, là-bas, de l’autre côté du port, débarqués en troupe molle de la « ville flottante » qui mouille au large, blanche comme un mirage…
Le toc et le kitsch sont la matière première du dernier Fellini d’Intervista, satiriste inégalé quoique toujours tendre de la télé berlusconienne avant l’heure, et sans doute le Maestro se régalerait-il, autant que nous, à la vision de la pacotille artistique prétendue avant-gardiste ornant les jardins de Portofino de ses sculptures prétendues dérangeantes, genre Documenta de naguère et jadis ou Biennale de Partout, entre autres Galeries Pilotes de Nulle part.

Saluons donc le rhinocéros suspendu et combien symbolique probablement, les éphèbes de résine revisitant l’Antiquité d’un Winckelmann de backroom, ou les monstres divers renvoyant à la monstruosité diverse du monde mondialisé, enfin saluons les lemmings roses, dressés sur leur pattes de derrière avant le grand saut collégial – saluons la jolie fumisterie avant de gagner la terrasse ombragée, là-bas, où nous attend le toujours authentique risotto ou les raviolis fleurant l’Italie véridique…
Les amis retrouvés
Ils ne s’étaient plus vus depuis trop de jours et de semaines et de mois, presque des années, mais ils se sont retrouvés comme s’ils s’étaient quittés la veille, juste un peu plus décatis que la veille, elle maintenant, la Professorella, à la retraite de l’Université et donc libérée du souci des intrigues sentimentales de la jeunesse toscane, et lui, le Gentiluomo, ne cessant de jouer les prolongations de son job d’avocat et ce soir encore à Florence pour inaugurer un atelier de cinéma à l’Auberge de Jeunesse dont il préside la confrérie nationale depuis des lustres par idéal d’après-guerre…
Or c’est à l’état de leur chienne Thea et de leurs sept chats que nous mesurons le mieux les effets du temps écoulé depuis nos dernières fois, mais l’amitié vraie est une braise vite ravivée dans la cendre du temps.
°°°
Et voici donc Bella qui va vers sa vingtième année, autant dire qu’elle vire centenaire, ainsi nommée naguère par exorcisme conjuratoire tant elle incarnait la Miss Mocheté quand notre amie l’a recueillie toute cassée et cabossée, d’abord rejetée par la smalah de ses congénère mais se cramponnant et se remplumant aux bons soins de nos infirmiers bénévoles – Bella qui honora quelque temps son nom et que voici réduite à l’état mouillé dépenaillé de chouette tricolore claudiquant sur place, roucoulant du moins et s’attardant longtemps sur mes carnets ouverts, comme pour se persuader d’exister encore…
°°°
Ce qui fait qu’on appelle ces gens-là nos amis tient à des riens : disons qu’on se trouve bien en leur compagnie, sans rien à se prouver moins que jamais, parce que c’était nous et que c’était eux, disons qu’on se comprend à demi-mot, mettons que nous partageons pas mal de goûts et pas mal d’idées aussi mais pas toutes, avec des rites amicaux établis entre café du matin à renfort de dolci et marchés populaires de l’après-midi, flâneries et causeries; et le soir le Gentiluomo ne manquera pas de s’exclamer « povero paese ! » aux dernières nouvelles de la télé abhorrée, à quoi nous rétorquerons non moins rituellement « caro paese » en savourant les produits de pays de la Fattoria Marinella, « maraviglioso paese » en voyant tourbillonner les gangs d’étourneaux sur les feuillées – poveri uccellini dans le ciel à la Tiepolo de l’automne marin, cari uccellacci !
°°°
On le trouve en montant de Carrare à Colonnata, qu’on sait un foyer de l’anarchisme de tradition ouvrière, on s’élève par des lacets sur l’ancienne route des carriers et bientôt, à main gauche, un petit val s’évase, immédiatement signalé par une kyrielle de sculptures de marbre de toutes dimensions, disposées sur le fond ou les flanc du ravin, toutes de la même inspiration « primitive », selon le propre dire du maître des lieux, géant chapeauté de 86 ans du nom de Mario del Sarto, qu’on retrouve dans le pavillon de bois sis un peu plus haut, en face du Mur de la Vérité et dont la porte est surmontée de l’inscription : Lavorando mi riposo, je me repose en travaillant…
°°°
La dernière fois que nous lui avions rendu visite, Mario m’avait offert une pièce de marbre taillée sous mes yeux, évoquant une figure vaguement parente avec celles des îles de Pâques, et qui me sert depuis lors de cale à livres.
Mais cette fois je lui explique que j’aimerais en savoir un peu plus de sa vie et de ses œuvres, de leurs tenants et de leur évolution, enfin comment il en est venu, la cinquantaine passée à ce que je sais déjà, à tirer du marbre son fabuleux bestiaire…
°°°
L’homme a l’aplomb des humbles, la sûreté de soi de l’artisan se mesurant aux solides matières, mais aussi la naïveté de l’artiste et la douce folie du terrien sage et sauvage.
Son père et les siens faisaient paître jadis leurs moutons dans les hauteurs avoisinantes, avec ses frères et sœurs il faisait en enfance la longue marche jusqu’à Carrare, mais à quinze ans déjà il a quitté l’école et des années durant il a travaillé dans les carrières où il devint machiniste à bord des chemins de fer vertigineux de là-haut. « Tout vient de la terre, me dit-il, pour aller vers le ciel et revenir à la terre ».
°°°
Non sans candeur ensuite Mario m’explique que, tout admirables qu’ils aient été dans leur art, les Grecs anciens et Michel Ange, imbattables dans la finition fine de tel corps d’éphèbe ou de tel visage de vierge, ne délivraient pas pour autant de messages, alors que lui s’y emploie ; et de m’entraîner vers la grande figure du devin Aronte, qui se réfugia dans une grotte des hauts de Carrare et que Dante évoque dans le chapitre XX de L’Enfer de la Commedia, que le sculpteur se met alors à réciter par cœur avant de conclure. « Le devant d’Aronte, Dante l’a placé derrière, et c’est pourquoi je l’ai sculpté comme ça : tel est le message ».
Et pour les mains immenses qu’il a taillées au bout des bras de sa Mère Teresa, Mario del Sarto conclut : « Ce sont les mains du Don, les mains de la Compassion… »
°°°
En route je n’ai cessé de lire les journaux, aussi, de cette vaine double page de L’Obs sur les minables fiestas profanatoires du Cavaliere, vil débris gluant de gomina, à cette chronique de Claude Monnier évoquant ce sentiment d’un peu tous que nous sommes tous plus ou moins largués dans ce monde en train de se faire, de se défaire ou de se refaire, on n’en sait trop rien, largués les gens et non moins largués les gouvernants – et j’y repensai tout à l’heure dans les allées du parc tenant lieu de refuge à tous les animaux blessés, maltraités ou rejetés, rescapés de la route ou des prédateurs de toutes espèces, largués eux aussi et que le Fonds Mondial pour la Vie Sauvage (WWF) a recueillis dans ce labyrinthe végétal en zone urbaine de Marina di Massa où serpentent vieux sentiers entre taillis et pièces d’eau, enclos en plein air et cages décaties, tout cela frémissant de plumes et de poils hérissés, cela piaillant et criaillant entre vieux panneaux explicatifs et poèmes animaliers sous le regard éteint d’un vague vieux gardien à main postiche jetant en passant sa pitance au paon posant au prince – à croire que ce jardin de tous les accueils est aussi celui de tous les abandons…
Et pourtant la vie continue, me suis-je dit ensuite sous les falaises de marbre tandis que crépitaient sous mes yeux les étincelles verbales d’une sorte de feu de mots, comme une cascade d’eau glacée aux arêtes brûlantes, comme un souffle de nord tropical issu de ce poème que m’avait balancé quelques jours plus tôt, par mail, tel jeune barde de nos amis – et voici que se lâchait sur vingt pages ce jazz rockeux rythmé à la Cendrars mâtiné de Ginsberg whitmanien, et je lisais « Mais la résolution est prise / tu te prends à rêver /scintillements d’orages sourds / au petit tour des Pôles », il me semblait retrouver quelque chose de l’ingénuité sauvage du jeune Chappaz avec ce « vieux remède minéral /comme une fourmi / mangée et froide dans le gosier / du merle blanc », je retrouvais là-dedans des micassures rimbaldiennes, je lisais « Et toi aussi / depuis ta petite table / tu te croyais au monde centré sourd tout-puissant / mais c’est le monde qui feule en toi / quand tu prends de ta main brûlante la braise blanche pour souffler la poussière / C’est dans tes artères que passe le sang nouveau /coagulé partout / des grandes possibilités », ou ceci enfin pour la route : « J’ai envie de rester sur mon arbre / derrière des rochers paresser / j’ai envie de couvrir le détroit / redescendre vers le Sud, où les morcellements d’îles /font de nous des princes doux et /fermentés pluvieux / dans les bouches / et les registres saints »…
°°°
Ensuite on s’est retrouvés aux rivages en train de se retirer, on revenait de Pistoia, ce dimanche de parade médiévale, juvénile cinéma local où s’entretient la tradition et le flirt, le folklore et la révérence sociale, lancer du drapeau et du chapeau, danses et tambours véhéments pour aiguiser les sexes jeunes – enfin le soir a roulé sur les collines roulant elles-mêmes vers la mer, enfin il n’y avait plus que la mer en allée et revenant pour mieux fluer et refluer, enfin il n’y avait plus que deux silhouettes là-bas à la frange de la nuit sur la mer…
Katanga Express
J’avais rêvé que la nuit d’Afrique à gueule de crocodile m’avalait, comme Milou en est menacé dans Tintin au Congo, puis le sourire de ma bonne amie a éclairé mon réveil, j’ai bouclé mes valises, nous nous sommes quittés devant la gare le coeur un peu serré, elle m’a dit de penser à elle et j’ai souri en me disant que nos anges gardiens puisent en nous leur propre force et déjà j’avais les tripes et le coeur en Afrique avant d’y mettre le premier pied, me replongeant, en train, dans la lecture des Mathématiques congolaises d’In Koli Jean Bofane entreprise la veille, le tendre paysage de La Côte défilait aux fenêtres et je me trouvais entraîné dans la gabegie savoureuse et violente à la fois de Kinshasa, je voyais passer les villas de nababs du bord du lac et je lisais la scène atroce du gosse massacré par le sergent-chef Personne chargé de driller les enfants-soldats, enfin je débarquai à Geneva Airport et retrouvai mon compère Max le Bantou avec lequel je me trouvais investi de la « haute mission », c’était marqué sur un papier, de représenter la Confédération helvétique au Congrès des écrivains francophones à Lubumbashi, en République Démocratique du Congo – et Max me disait que son ange gardien à lui, sa mère à Douala, lui avait recommandé tout à l’heure au téléphone de ne pas oublier d’emporter là-bas « La Parole »…
°°°
À l’annonce du retard conséquent de l’avion de Rome nous n’avons pas bronché, avec Max le Bantou, notre commune passion du jeu gratuit, qui s’ajoute à notre goût partagé pour les histoires à n’en plus finir, nous ayant portés vers l’improvisation ludique combinant le damier de carton et les capsules de bière et de limonade, et c’est ainsi que le temps a passé jusqu’à la prochaine attente dans les couloirs marbrés de Fiumicino aux boutiques de luxe et aux bars outrageusement fermés après dix heures du soir, autant dire que nous nous impatientions de toucher bientôt à des rivages moins clinquants, et bientôt nous nous étions retrouvés suspendus dans le silence chuintant de l’avion éthiopien destination Addis-Abeba et, par delà la longue nuit, fantômes enveloppés de couvertures aux bons soins de veilleuses stylées, nos paupières s’étaient relevées sur le jour se levant dans le ciel congolais, et là-bas la terre montait peu à peu vers nous bien rouge, aux essaims de maisons oranges – pour la première fois l’Afrique noire m’apparaissait du ciel en ses couleurs chinées…
°°°
Et tout de suite, touchant terre dans la touffeur de Lubumbashi, anciennement Elisabethville en son avatar colonial, m’a ravi le chaos organisé de cette Afrique-là, ah mais nos bagages étaient-ils arrivés, se trouvaient-ils dans l’entassement pyramidal jouxtant le tapis roulant ne roulant plus depuis longtemps, n’y avait-il pas de quoi s’inquiéter ? mais non car dix, vingt, trente lascars aux gilets marqués de l’enseigne KATANGA EXPRES s’agglutinaient de toute part et nous pressaient de leur confier la recherche de nos précieux bagages moyennant quelques poignées de dollars, et voilà que surgissait, rayonnant du plus alerte sourire d’accueil, le bien nommé Chef du Protocole mandaté par le Congrès et se réjouissant de nous identifier non sans s’inquiéter de l’absence du troisième éminent scribe annoncé en la personne d’un certain Fiston…
°°°
Mais n’avais-je pas rêvé ? Ce Congrès congolais se tiendrait-il jamais ? Ce M. Fabrice Sprimont qui était censé nous recevoir, auquel j’avais écrit à Kinshasa et qui ne répondait pas, existait-il seulement ? Et s’il était vrai que la malaria l’avait terrassé au point de remettre déjà d’un mois le colloque, celui-ci ne restait-il pas aussi aléatoire que le Sommet de la francophonie qu’on disait battre de l’aile ?
Je m’étais posé ces questions au moment de me faire inoculer cinq vaccins. Je me les répétai dans l’antichambre du Ministre chargé de me délivrer mon visa. Mais voici que nous nous retrouvions, ce premier soir de notre séjour au Katanga, à la table du Safari Grill du mythique Park Hotel de l’ancienne cité coloniale, en face de ce Monsieur Sprimont, Conseiller à la Communauté française de Belgique, dont l’accueil immédiatement avenant m’a d’autant plus rassuré que le personnage, de toute évidence, manifeste autant de compétence aux affaires que d’entregent convivial.
°°°
Les Belges sont étonnants. Il reste évidement de l’Afrique dans leur complexion physique et spirituelle, et je ne sais ce qui m’a fait penser aussitôt aux romans africains du Liégeois Simenon en observant le Conseiller, dont le bouc et l’espèce de détachement très attentif m’ont rappelé aussi mon cher Anton Pavlovitch Tchekhov, figure tutélaire de ma Russie personnelle.
Or cette double ressemblance était liée aussi, sans doute, à cette impression que le Conseiller, à mes yeux, émargeait probablement à l’espèce de ceux qui, d’une manière ou de l’autre, ont pris la tangente, passant ce que le Simenon de La Fuite de Monsieur Hire appelle la ligne rouge.
Ensuite notre conversation m’a confirmé dans le préjugé favorable que m’inspirent les irréguliers, je veux dire: les aventuriers organisés que sont le plus souvent les gens d’entreprise ou de culture expatriés, artistes et parfois espions, nostalgiques d’une vie meilleure ou fuyant un passé dévasté. À cela s’ajoutant la culture réelle, non plaquée, humainement éprouvée, et l’humour de Fabrice qui, tout de suite, nous a épatés le Bantou et moi.
°°°
Quoique détestant les palaces, et ceux des pays pauvres plus que les autres évidemment, je me suis trouvé presque à l’aise dans le Park Hôtel aux chambres immenses et aux vérandas suggérant autant de veillées coloniales. Et du coup je me suis rappelé tant d’ambiances de romans ou de films dont il ne restait ici que le décor surplombant, dans la nuit avancée, la rue aux ombres plus ou moins menaçantes des prédateurs urbains.
Le Park Hôtel date de 1929, quelques années après le voyage au Congo de Gide et du jeune Marc Allégret, qui y tourna un film tandis que l’écrivain y établissait ses réquisitoires. Cependant nous voici bien loin du grand humaniste aux indignations de bourgeois en rupture de conformité: près d’un siècle après son Voyage au Congo,la parole est bel est bien aujourd’hui aux Africains et je suis là pour les écouter.
Après le Dinner très cool avec le Conseiller, plus que vannés par le voyage et la longue journée, il nous restait, avec Max le Bantou, à réviser notre speech commun du lendemain dont nous venions de découvrir le motif établi à notre insu et proposant « Le défi de la langue et du langage aujourd’hui; rapport avec la langue française et les langues partenaires »…
Mais qui donc nous avait collé cette expression babélienne de « langues partenaires », et qu’aurions-nous diable à disserter à ce propos, s’inquiétait mon jeune Camerounais au bon sens éprouvé ? Que dalle! lui répondis-je tout de go. Langue de coton de papas universitaires ! Ils proposent et nous disposerons: nous parlerons de nos parlures et de nos façons à nous de lire et d’écrire en nos périphéries dans la langue de Rabelais et de Voltaire qui est celle aussi d’Aimé Césaire et d’Amadou Hampâté Bâ, où tous nous sommes propriétaires et partenaires à la fois, à grappiller de concert à l’arbre aux mots pour en faire notre miel millénaire…
°°°
Nous avions droit au prime time matinal des tables rondes arrangées en carré, c’était bien de l’honneur pour deux émissaires black’n’white de la Suisse qui lave-plus-blanc comme on sait, nous nous étions promis, avec Max le Bantou, de rester simples et vrais autant que faire se pouvait, je parlerais des transits féconds entre nos régions aux parlures variées, Max dirait à sa façon comment il vit la multilangue française entre Douala et le quartier des Pâquis de la Geneva International, déjà les micros grésillaient et tourniquaient les caméras aux épaules, déjà j’avais repéré les soeurs Courage appelées par l’omniprésent organisateur André Yoka au commandement des débats suivants, bref la journée était lancée et je ne sais pourquoi, à ce moment-là, le souvenir des Katangais de mai 68 dans les couloirs de la Sorbonne m’est revenu – je voyais en face de moi le jeune Fiston Mwanda Mujila qui n’avait pas dit mot aux débats de la veille – le trentenaire n’était pas né alors que je lisais Les damnés de la terre à mes vingt ans -, je voyais à côté de lui Jean Bofane dont j’avais lu quelque pages de plus la nuit passée – il avait douze ans en cette année où nous errions dans le Temple de la culture française avec nos mines farouches d’apprentis révolutionnaires -, je revoyais ces parias de la banlieue parisienne débarqués aux barricades et qu’on appelait alors, je ne sais pourquoi, les Katangais, il y avait de ça plus de quarante ans, autant d’années que celle qui me séparaient sans me séparer des vingt-cinq ans de mon compère le Bantou…
°°°
Elles n’en finissent pas de nous ramener sur terre, nos mères et nos frangines, nos amantes et nos amies, nous avons le miel des mots aux lèvres et malgré leur romantisme invétéré elles n’en finissent pas de nous rappeler le sel et le sol de la vie, et là je les voyais une fois de plus couper court au choeur des « y a qu’à » et des « il faut », nous écoutions donc Bestine et Ana, qui oeuvrent toutes deux sur le terrain d’Afrique, et Dominique venue de Liège, et je me disais que sans elles rien ne se ferait qui doit se faire à partir de rien, avant même que rien d’institué se fasse, car c’était de cela qu’il s’agissait bel et bien: combien de librairies en ces lieux, quelle politique du livre et de la culture au Katanga et dans l’entier Congo, quel appui aux écrivains et à la chaîne des passeurs, or elles arrivaient avec leur expérience concrète de telle ou telle réalisation, l’heure n’était pas au lamento que nous connaissons aussi aux pays de la profusion, le moment n’étais pas non plus à se donner bonne conscience, le temps de cet improbable congrès était aux débats fondés en réalité lançant les premiers ponts de possibles actions de demain.
°°°
Or on aura tout entendu ce jour-là, de professeurs ou d’auteurs arrivés des quatre vents de l’Afrique francophone ou des lointains européens. Florent le Béninois reconnu, Sami le Togolais consacré, Jean le Congolais non moins auréolé de succès ont parlé la langage de ceux qui ont la double expérience du dénuement et de la saturation, proposant autant de bons exemples de développement, et tous ensuite auront témoigné pêle-mêle avec force arguments et bonne volonté à n’en plus pouvoir, m’évoquant une pièce de théâtre se donnant sur une scène cernée par les étudiants tenus à l’écart derrière lesquels j’imaginais la multitude des gens sans livres mais pleins de mots – un notable universitaire a daubé sur le fait que ses étudiants affirmaient lire en français sans comprendre rien, un écrivain invoquait le droit à ne pas être surveillé dans ce pays et tel notable soucieux de bienséance l’a mouché vite fait , tel autre prônait l’encouragement de la langue vernaculaire, tel invoquait la pratique des langue jumelées, l’oubli des auteurs locaux fut pointé et mouché lui aussi de dédaigneuse façon, bref c’était la joyeuse confusion des généralités et des mâles péroraisons échappant à nos soeurs Courage, mais enfin quoi n’était-on pas dans un colloque littéraire, enfin le même soir nous nous sommes tous retrouvés au lieu vibratile de la Halle de l’étoile, aux bons soins de cet autre échappé des conformités qu’incarne le directeur de l’Institut français au joli nom de Dominique Maillochon, et ce furent alors des transes belles ou ce slam de haute volée nous rappelant que le langage exprimant la réalité, et la langue-geste, ne passent pas que par les filtres de l’élite pensante et parlante en sa trop fameuse « instance de consécration »…
°°°
Un malingre philosophe allemand à moustache de paille de fer disait ne pouvoir croire qu’en un dieu qui danse, et je serai le dernier à le railler car là gît bel et bien le secret de l’homme aux semelles de style qui est tout mouvement et toute grâce vivante, je me le disais tout au long de cette soirée à la Halle de l’étoile à les voir danser et raper et chanter et slamer, les garçons sauvages et les filles souveraines, à nous retremper dans nos forêts ancestrales, à nous relancer dans la ville-monde aux semelles de rail, selon l’image de Fiston Mwanza Mujila qui me racontait la galère sans espoir des jeunes en sa ville-pays: à peine y était-il revenu depuis quatre années qu’il en repartirait, mais ce soir-là c’était à danser qu’il pensait entre deux apartés et c’était à danser que tous nous aspirions après avoir tant parlé et parlé…
°°°
À l’aéroport d’Addis-Abeba j’étais resté longtemps à observer, moi le mécréant paléochrétien frère en Christ des fils de Niambe et de Loba, les fidèles musulmans se recueillant dans cet Espace Prière où ils s’agenouillaient après de brèves ablutions à jolies théières d’eau du robinet des lieux d’aisance d’à côté, femmes gracieuses et jeunes gens décents, époux séparé de l’épouse, et je n’éprouvai pour eux que respect quand les flagellants et autres talibans ou foudres de Klan m’insupportent et me hérissent de quelque culte qu’ils se réclament – je ne voyais de ceux-là que l’aura d’humilité avant de tomber, dans l’avion de Lushi, sur ces deux élus du seul Seigneur évangélique de la Pentecôte arborant leurs uniformes d’hommes-sandwiches du Dieu triomphant au rictus de tiroir-caisse…
Et dansant avec ceux de l’étoile je me suis retrouvé lisant Dans la peau d’un noir, adolescent révolté de seize ans, Bestine l’avocate ondulait comme une prêtresse de la forêt, Jean Bofane démantibulait son ndombolo en roulant ses yeux de bille noire, Fabrice le décolonisé s’africanisait en déhanchements élégants, enfin tout se stylisait à l’avenant sous le regard de sphinx noir de Sami Tchak, tout était mouvement et fusion devant les effigies affichées de toutes les Femmes d’Afrique en mémorial éclatant – de Reine Pokou en Sarrouina ou de Mariama Bâ en Zena M’dere du Commando des chatouilleuses -, et je me figurais l’échappée rêvée dans le noir que ce serait, plus tard, de cette ville-pays et en toutes les villes-mondes à greffer et revivifier nos pensers et nos langues – notre corps nombreux dans le multimonde…
°°°
L’aube poignait au troisième jour du Congrès subtropical, j’entendais la rumeur montante de la rue populaire de derrières les voilages protecteurs de la chambre immense de l’ancien hôtel colonial et je me demandais ce que diable je foutais là, à quoi rimait notre présence en ces lieux, le sens de tout ça sous le froid éclairage de la lucidité décapée d’avant le retour à la vie ordinaire et à ses comédies ; je pensais au Congo des effrois, je me rappelais le Kivu, les affreux reportages, les messages de mon ami Bona, je me rappelais mes doutes vertigineux de certain autre congrès du PEN-Club international en 1993, sous les falaises croates de la guerre où les écrivains avaient dansé comme des ours de propagande, je pensais aux virulentes oppositions au prochain Sommet de la francophonie à Kinshasa et je me disais que tout de même, que peut-être, qu’être là valait peut-être mieux que de n’y être pas, je me rappelais nos propres combats séculaires pour un peu plus de liberté et de libre pensée, tout ce qu’à travers les siècles nous avions appris, tout me revenait pêle-mêle de notre histoire et de nos alternances d’ombre et de lumière, comment nos livres pouvaient exister aujourd’hui et circuler, et quand même, par conséquent, comment nous pouvions modestement en témoigner en ces lieux où tout restait à faire…
°°°
Or au cours de ce jour on avait parlé d’abord de tourisme, on allait voir peut-être le lion vivant ou l’okapi, le girafon ou le gnou du fameux zoo de Lubumbashi, on irait peut-être dans les collines surplombant les anciens terrils, aux terres de la Ferme Espoir du Président ou aux domaines pilotes du Gouverneur, et puis non, les projet s’était réduit au fil des heures, remplacé par la visite solennelle, et donc sapée et cravatée, à la seule Excellence locale, aussi tous les écrivains s’étaient-ils faits jolis, j’avais hésité à y couper mais mon compère le Bantou m’avait objurgué que je ne pouvais louper un tel spectacle, ainsi m’étais-je procuré vite fait chemise d’apparat et cravate associée, avais-je lustré mes boots à la lotion capillaire et m’étais-je brumisé au parfum social, ainsi tous s’étaient-ils pimpé l’apparence afin de faire honneur aux Lettres francophones à la réception de l’avenant Moïse Katumbi Chapwe, aussi connu comme homme d’affaires éclairé qu’en sa qualité de Président du club-vedette de foot Mazembé (Impossible n’est pas Mazembé !) et nous recevant sans grande protection, souriant, à l’aise, charmeur, jurant que la Littérature lui est chère après avoir colmaté, dit-on, pas mal de carences des institutions scolaires et de nids de poules sur les voix d’accès aux collèges et facultés…
°°°
On aura donc bien disserté tous ces jours, on aura crânement entonné l’Hymne du prochain Sommet de la Francophonie, on aura psalmodié « Chantons en choeur notre riche diversité / Oui chantons Francophonie et Fraternité », on aura repris comme ça: « Ah! Il est si merveilleux notre monde / Tambourinons ses rythmes à la ronde », on aura vécu cette comédie et voilà que, dans les coulisses de ce théâtre-là, nous nous serons rencontrés, quelques-uns et même plus, nous aurons réellement échangée des idées et des vues, des livres, des documents, des projets, quelques amitiés peut-être durables seront peut-être nées par delà les solennelles déclarations d’intention et autant d’« il faut » que d’« y a qu’à », oui peut-être, quand même – peut-être tout ça n’aura-t-il pas été que words, words, words…
L’automne au Yorkshire
Je ne savais trop ce qui m’attendait là-bas, à Sheffield où j’allais me retrouver cet après-midi après avoir débarqué à Manchester. Nous nous connaissions, avec Bona, depuis sept ans, sans nous être jamais rencontrés que sur la Toile. J’avais lu ses livres et je les avais chroniqués. Il m’en avait remercié par une flamboyante Fleur de volcan. J’aimais son humour et nous partagions pas mal de passions en littérature et en peinture, en musique et sur les choses de la vie; nous avions failli nous rencontrer à Béziers quand il s’y trouvait en résidence d’artiste, mais cela ne s’était pas fait, les années avaient passé, il s’était ensuite installé à Sheffield avec les siens où il était devenu Master of Arts.
Or je me demandais encore, ce matin, qui était vraiment ce Bona-là en me rappelant d’autres échanges sporadiques de toutes ces années, mais à son premier sourire immense et à son premier rire, à l’aéroport de Manchester où il était venu me chercher, j’ai tout de suite perçu , chez ce Bona en 3D à la fois plus jeune et plus vif que je ne l’imaginais, le bon compère que je m’étais figuré de plus en plus en plus précisément dans nos échanges devenus quasi quotidiens sur Facebook.
L’autre énigme, évidemment, tenait à la personne qui partage la vie de cet ami plutôt discret sur ces choses-là, dont je savais juste qu’elle portait un double prénom de lumière et qu’elle lui avait donné deux enfants également prénommés à l’africaine, la fille aînée portant le nom d’une pierre précieuse et le grand ado de quinze ans, fan d’Avendgers, celui du parangon virtuel de la perfection. Or, dès notre arrivée à Woodstock Road (rien que ce nom me faisait jubiler d’avance !), dans cette rue montante à l’enfilade de maisons de brique à bow-windows – dès entrouverte la porte de mes hôtes ce serait cet autre sourire et cette même malice, et quelle grâce ajoutée !
°°°
Entretemps j’avais déjà repéré, dans le train de Manchester à Sheffield, des banlieues de la grande ville aux campagnes déroulées, la nature anglaise dont je ne connaissais guère jusque-là que les évocations littéraires, de Thomas Hardy à Ian McEwan, puis ce fut cette ville de Sheffield que j’imaginais toute grise ou noire de son passé industriel, et que je découvrais aussitôt pleine de charme et tout entourée de collines, toute dorée aussi et mordorée par les couleurs de l’automne.
Les alignées de maisons de brique à bow-windows pourraient faire craindre la monotonie, mais pas du tout. En ce qui me concerne en tout cas m’est apparu d’emblée un ton me convenant mieux dans sa variante middle class qu’en Allemagne ou qu’en Autriche ou qu’en Suisse où le mitoyen m’a toujours effrayé par son uniformité plus ou moins exsangue, à laquelle échappe évidemment Amsterdam entre autres villes qui ondulent. Il est des maisons dont on peut rêver, et d’autres non.
Or la maison des Bona, faite de quatre pièces sur trois étages reliées entre elles par un vertigineux escalier à la manière amstellodamoise (nécessité de place fait loi) est du genre à favoriser les rêves topologiques dont parlait Walter Benjamin dans ses ruminations urbaines – c’est à quoi je songe ce matin en savourant la confiture de gingembre du breakfast de de mes amis tandis que la conversation roule déjà à plein régime. Cependant, avant de filer en ville, Bona me fera voir encore le jardin qu’il y a derrière la maison, et tous les jardins alignés où l’on imagine, l’été parmi les fleurs, les voisins de diverses nationalités voisiner sans se gêner…
°°°
L’amitié se mesure à mes yeux à la qualité de la conversation, où le gossip et la chiacchierata ont évidemment leur bonne place, mais sans passions partagées ni substance ni fantaisie ni folie même: point d’amitié vivante à mes yeux. Or je ne serais pas venu jusqu’à Sheffield sans être à peu près sûr d’y trouver un écho vif, et quoi de plus vital en effet ? On nous bassine de nos jours sur le manque de reconnaissance, et certes elle est souhaitable et légitime en cela qu’elle vivifie le lien social, mais on ne meurt pas du manque de reconnaissance tandis que sans écho l’on crève. Or nous avions parlé toute la soirée et jusque tard dans la nuit de l’Afrique et de nos mères et pères et de Lausanne la nuit et de livres et de mille autres choses, et maintenant nous étions en ville et mon ami l’artiste m’expliquait le procédé de sérigraphie devant les autoportraits de Warhol en exposition dans le même petit musée où voisinaient les objets de collection de Ruskin et les oiseaux d’Audubon, et de pubs en jardins (Sheffield compte autant de ceux-ci que de ceux-là) nous n’en finissions pas de ne pas voir le temps passer en ne discontinuant de parler – et c’est cela aussi l’amitié: que le temps y passe sans qu’on s’en lasse…
°°°
On peut parler peinture, ou parler musique, on peut se la jouer spécialiste, on peut parler littérature et briller sans se rencontrer vraiment. Sonder la couleur, traverser le mur des sons, se retrouver au bout de la nuit des mots est autre chose. Or c’est cela même que, depuis des années, même à distance, même sans se rencontrer jusque-là, je partageais avec mon occulte compère Bona: cette fusion sensible et cette effusion. Déjà j’avais fait écho aux mots de ses livres, et lui aux miens. Déjà les noms de Goya, de Soutine ou de Delacroix, déjà son soliloque du Caravage en sa dernière nuit, et mes propres échappées poétiques, ou picturales, nous avaient fait nous rencontrer hors de tout propos convenu, et voici que ce seul tableau de Bonnard, au Musée de Sheffield, aura scellé pour ainsi dire cette espèce d’alliance échappant à tout discours de pions cultivés…
Il n’y a qu’un Bonnard au Musée de Sheffield, mais ce tableau nous a réunis, en ce moment précis et comme jamais avant, avec mon compère Bona, en cela qu’il fait bonnement événement, concentrant toute la grâce secrète d’une intimité féminine à la fois voilée et dévoilée, toute de présence incarnée et toute de pure peinture. Il y a là, comme dans l’Olympia de Manet, l’expression même de la nudité féminine, mais ici surprise plus encore qu’exposée, fondue au noir mystérieux et tirée de là par les ors bleutés de la chair à la fois légère et lourde aux hanches, mélange de pudeur et d’offrande, le visage juste masqué par le désordre confus de la chemise retirée et le bras commandant au mouvement; et tant d’autres choses suggérées par le grand et le petit triangle et la douce polyphonie des couleurs mordorées…
On entend encore le ricanement de dortoir des garçons qui se sont rincé l’oeil, selon leur expression, mais c’est si peu de cela qu’il s’agit ici, quand le voyeurisme prédateur devient contemplation par la magie de l’art le plus délicat faisant ce corps non pas éthéré mais comme épuré, comme rendu à sa pure matérialité mais celle-ci transfigurée par les touches et les tons et les couches de couleurs ocellées de lumière – comme pétri de sensualité sensible spiritualisée; et rincé bel et bien, pour le coup, rincé le regard et nettoyé, lustré le regard des amis se retrouvant dans le dédale étoilé des rues et des reflets des vitrines, dans les cafés, les marchés, les pâtisseries et les parfumeries, les brasseries et les boucheries-féeries aux mille fragrances en bouquets…
°°°
Mon compère Bona et moi nous aimons fouiner et chiner. Ainsi avons-nous passé la moitié de cette deuxième journée à écumer les Charities – ce puces à l’anglaise où l’on trouve à peu près de tout pour pas cher – et les bookshops d’occases où l’on trouve autant de disques que de livres. Avec cet autre compère rencontré il y a quelques années sur la Toile puis en 3D à Montpellier, l’écrivain Jean-Daniel Dupuy passé cet été à La Désirade avec les siens, nous avons lanterné des heures dans les bouquineries lausannoises à farfouiller et nous enthousiasmer de concert (« Ah mais tu dois lire absolument Au présent d’Annie Dillard ! » – « Et toi, j’te dis que ça: que Silvina Ocampo a écrit ses nouvelles pour toi !), et voici que le miracle se prolonge en ces lieux fleurant la bonne bohême (Sheffield compte plus de 50.000 étudiants et ça se sent) où la conversation se poursuit entre échelles et rayons…
°°°
C’est le propre de certains passionnés de peinture, dont je suis, que de se faire clouer par certaines oeuvres, avec quelque chose là-dedans qui relève de la sensualité pure, voire de la pulsion sexuelle, du côté de ce que Nietzsche (dans La Naissance de la tragédie, j’crois bien) appelait l’élément dionysiaque de la création artistique, par opposition à l’élément apollinien. Grosso modo: la chair endiablée et l’esprit filtrant, ou la bête et l’ange, sauf qu’il y a de l’ange dans la bête artiste et inversement.
Or j’avais été frappé, déjà, par une quinzaine de grandes toiles saisissantes de Neil Rands, dans cette nouvelle galerie de Sheffield où mon compère Bona m’avait emmené, lorsque CE tableau me cloua debout de tous ses verts et ses rouges intempestifs (couleurs même de la passion comme chacun sait) alors que cette représentation du site mythique de Stonehenge, devant lequel planait littéralement un homme rouge en fin de chute, m’apparaissait comme l’illustration par excellence du vol plané de l’homme à travers le Temps.
°°°
Surtout on aura bien ri avec mon compère Bona, par les cafés et les quartiers et les musées et les jardins de Sheffield, autant qu’avec sa douce moitié. Et pour stimuler pneumatiquement ce rire, nous aurons trouvé l’irremplaçable objet transitionnel d’un recueil de poësie poëtique trouvé par Bona pour 2 livres chez un bouquiniste, intitulé De dedans la nature et signé Philippe Beck, identifié sous le surnom de « l’impersonnage » par la critique de poësie poëtique en France française. Or les premiers vers que nous aurons lu de ce parangon de jobardise en sa 69e séquence, nous auront immédiatement mis en joie avant de devenir le leitmotiv de notre hilare complicité. Et ces vers les voici:
« À la question du coquillage, / je dois répliquer Non ».
Et pour ne point les laisser flotter comme ça, même s’ils restent emblématiques dans l’absolu, les vers suivants doivent être cités aussi « pour la route »:
« Les bergers musiqueurs / qui peuplent la future Bucolie / (Bucolie dans les branches du haut qu’assemble la tête) sont des ballons dans la Pièce / Colorée Pure, pas plus. /Le « Jardin Suspendu Sprituel »./ Car Pièce fleurit / le bouquet des essais /piquants et décriveurs / pour évoquer Muse (Effort / =Muse) / au milieu des animateurs ».
Or donc, ces « animateurs » nous auront mis en joie, mon compère Bona et moi. Dès la révélation de ces premiers vers de la 69e séquence de Dans de la nature (Flammarion, 2003) nous n’aurons eu de cesse de découvrir ceux de la 68e ainsi lancés: « Dignes paquets d’expression/ et universalité plaintive /ont de la peine à faire Lac. / Des groupistes se creusent, / comme les « Viens » inarrêtables, / Bruit entre feuilles, oiseaux, / pailles générales, poutres /exigent force d’être là / encyclopédiquement ».
Déjà notre rire était propre à soulever, cela va sans dire, l’ire des amateurs agenouillés de la poësie poëtique de Philipe Beck, « impersonnage » fort en vue dans les allées académiques et médiatiques, jusques aux cimes de l’officialité de la culture culturelle (il préside la sous- section poétique du CNL, précise le wikipédant), autant dire :un ponte, voire un pontife, et comment en rire ? Cependant, aussi philistins l’un que l’autre, mon compère Bona et moi n’en finissions pas de revenir au seul Texte, comme Rabelais jadis et comme Léautaud naguère, en déchiffrant pareil galimatias, tel celui de la 7e séquence de De dedans la nature: « Sa bouche est dans le paysage. / Il est rupture idyllique. / Intolérée, et si aimable si l’oeil se lève, /redresseur. C’est Monsieur Transitif ».
J’entends encore le rire de crécelle de Paul Léautaud quand, dans ses entretiens mythiques avec Robert Mallet, il taille des croupières à Valéry ou à Mallarmé à propos de certaines tournures ampoulées ou obscures de leurs vers, dont la musicalité et le jeu des images n’ont évidemment rien à voir avec les vers aphones de notre « impersonnage ». La poésie, surtout contemporaine, depuis les Symbolistes et Lautréamont, Rimbaud et les Surréalistes, regorge d’obscurités, et Baudelaire n’échappe pas aux images que le bon sens peut trouver absconses, comme l’a bien montré Marcel Aymé dans cet essai joyeusement impertinent qu’est Le confort intellectuel. Mais le vieux bon sens populaire ou terrien, relancé par le bon naturel africain, a cela de précieux et de tonifiant qu’il parie en somme pour la poésie la plus simple et la plus limpide, lisible par tous, dont l’eau claire nous désaltère depuis La Fontaine, etc.
°°°
Ce qu’il y a de beau dans l’amitié, dont je ne suis guère un chantre inconditionnel, c’est quand l’ami vous laisse libre. Jamais je n’ai supporté qu’un ami (les amies c’est autre chose, qui ont d’autres façons de vous lier ou vous ligoter) me fasse le chantage à l’amitié pour souscrire à des positions humaines ou plus précisément sociales (je ne parle pas de postures ni même d’idées, lesquelles peuvent cohabiter et même se chamailler dans une relation amicale), qui limiteraient ma liberté jusqu’à l’atrophie et nous font nous trahir pour ne pas trahir l’amitié… Tout cela bien entendu reste assez relatif, car nous avons tous nos accommodements, à égale distance d’Alceste et de Philinte, mais pour ma part je sacrifierai sans hésiter une amitié aliénant ma liberté (surtout intérieure) au nom d’une relation de convenance…
Je ne sais pourquoi mais tout de suite j’ai vu, dans cet homme rouge tombant paradoxalement à l’horizontale, le frère fantastique de l’ange en pantalon-nuage de Vladimir Maïakovski, dans un poème que je savais par coeur à dix-huit ans mais dont il ne me reste pas un mot.
Neil Rands n’a probablement aucun rapport avec le modernisme poétique ou pictural du début du XXe siècle en Russie soviétique de la fin des grandes espérances (Maïakovski tomberait bientôt du ciel dans le sang de son suicide), et pourtant j’ai bel et bien ressenti la décharge d’un arc électrique liant deux bornes sensibles, comme je la ressens quand je relie, à travers le Temps, les fulgurances de Goya et de Soutine ou de Soutine et de Louis Soutter…
°°°
L’horizon limpide, par delà les mégalithes de Stonehenge, dans le tableau de Neil Rands (le plus solidement senti et construit, à mes yeux, de toute la série déclinée sur le même thème, qu’on retrouve sur son site), est d’une pureté candide dont le bleu le plus délicat me rappelle ceux des fonds de décors des angéliques maîtres italiens, ou ceux de Corot.
Peut-être Neil me prendra-t-il pour un allumé ou un pédant grave à faire ces mises en rapport ? Mais cela ne m’importe aucunement, vu que le peintre a brossé cette toile rien que pour moi (comme chacune et chacun pense que Schubert n’a écrit sa Sonate posthume rien que pour elle ou lui… ), et voyant de plus près ce bleu tendre je pense à l’innocence et à ce que disait l’affreux Thomas Bernhard sur la pureté du ciel, dans son entretien d’Ibiza où l’on voit son pied battre la mesure de sa pensée sous la table à l’instant où il évoque cet azur qui est aussi celui de Bach quand sa musique nous rappelle que l’homme, cette immonde créature, est parfois « capable du ciel »…
De l’autre côté
L’idée de revenir ce matin de Genève à La Désirade par l’autre rive m’est venue comme, ça, sans raison claire. Ou peut-être était-ce l’envie de me retrouver un moment en France, après le théâtre de la veille ? Ou plus inconsciemment, quelque chose de vivant m’attirait de l’autre côté, comme notre chère K. le disait quand elle prenait le bateau. Ou peut-être aussi, dans la suite de l’enregistrement que je m’étais passé en voiture à l’aller, d’Albertine disparue lu par le comédien Denis Podalydès, qui module si subtilement, avec quelle douceur et quelle force, les moindres inflexions de cette incroyable symphonie mentale qu’on redécouvre plus ample encore à l’écoute; ou peut-être redoutais-je simplement les encombrements matinaux de l’autoroute ?
La veille j’avais assisté au Poche, en fin d’après-midi, à la générale de la nouvelle pièce de Dominique Ziegler consacrée à Jean Jaurès, dont la force expressive crescendo m’avais aiguisé l’esprit et réchauffé le coeur; et c’est donc l’esprit et le coeur accordés que j’avais rejoint mon compère Max le Bantou à La Trappe des Pâquis pour une nouvelle soirée à n’en plus finir de nous raconter nos choses de la vie. Je lui ai aussi raconté le formidable Jaurès, il m’a parlé de ses lectures récentes et de ses projets d’écriture – et jouant une fois de plus son ange gardien il m’a dissuadé de reprendre le volant après nos agapes, j’ai vrillé un clin d’oeil aux dames en vitrines après l’avoir quitté à l’angle de la rue de Berne, enfin je suis allé lire un bout du Journal de Lars Norèn dans une mansarde de l’Hôtel Capitole; et ce matin je me suis réveillé comme à l’étranger.
Or je me disais tout à l’heure, sur la route de l’ubac lémanique, que l’esprit de mon nouveau livre en chantier tendait, précisément, à ce passage de l’autre côté, tandis que, m’accompagnant en voiture, le Narrateur, éperdu à l’idée qu’Albertine pût ne pas revenir, et recevant soudain le fameux message où elle lui dit tranquillement qu’elle le pourrait bien, lui fait cette réponse travestissant son plus vif désir en feinte indifférence et en froideur exprimant exactement le contraire de ce qu’il ressent crainte de perdre la face et la main, si l’on peut dire – et tout à coup le nom d’Excenevex m’a frappé…
°°°
Le seul nom d’Excenevex en lettres blanches sur fond bleu, ou en lettre noires sur fond blanc, m’avait immédiatement paru étrange et bizarrement attirant lorsqu’il nous était apparu pour la première fois, à l’été 1961, à mon ami allemand T. et à moi, tous deux âgés de quatorze ans et accomplissant alors le tour du lac à vélo, sur la bord de la route que nous parcourions en direction de Thonon ou peut-être avant cela: sur la carte ou nous avions tracé notre itinéraire de je ne sais plus combien de jours.
Or ce nom d’Excenevex, moins encore que ceux de Locum ou de Novel, que nous découvririons plus tard, ne ressemblait à rien, et moins que tout aux noms de la rive romande. Mais ce nom se chargea ces jours-là d’une magie nouvelle, liée au site lacustre, encadré d’une pinède et déployant de vraies dunes – chose unique à ma connaissance sur le pourtour du lac Léman, où nous décidâmes d’établir notre campement et où nous vécûmes ce que je crois les plus belles heures de ce périple adolescent. Cependant est-ce bien sûr ? N’ai-je pas magnifié ce souvenir si lointain ? Est-ce possible que ce lieu de notre bonheur estival se soit pareillement dégradé ? C’est ce que je me suis demandé ce matin en découvrant ces lieux devenus affreux, les dunes réduites à la grève la plus mesquine et souillée de déchets, une méchante pelouse reliant désormais le lac et la pinède, et l’ancien camping plus ou moins sauvage remplacé par un camp de concentration balnéaire à baraques identiques et tout entouré de clôtures – pourquoi pas des miradors tant qu’on y était ? Or à peine m’étais-je parqué sur une aire de stationnement absolument déserte qu’un policier m’abordait pour me faire observer que je me trouvais en zone privée et que j’étais prié de garer mon véhicule sur cette autre aire de stationnement déserte, là-bas. J’ai obtempéré tout en racontant mon souvenir au flic, et mon pèlerinage, et j’eus droit alors, au moins, à une espèce de sourire…
°°°
Dans la foulée j’avais un autre pèlerinage à accomplir, à la basilique de Thonon-les-Bains où notre chère K., mère de ma bonne amie et bonne dame elle-même s’il en fut, ne manquait jamais d’allumer un cierge en dépit de sa mécréance. Thonon respire la bonne province française même en morte saison (j’ai fredonné la chanson de Georges Chelon en gagnant le petit port de Rives en funiculaire), et je me suis rappelé ce que la vieille dame disait à propos de l’autre rive qu’elle, Hollandaise éprise des vastes ciels, aimait à gagner presque chaque semaine au motif supplémentaire que la vie sociale à la française, les rues, les boutiques, le marché et les gens, ondulent d’une manière moins ordonnée et prévisible qu’en Suisse trop propre et trop en ordre. Je suis donc entré dans la basilique dédiée à Saint-François de Sales, j’ai allumé mon cierge, je suis resté quelques temps à m’adoucir le regard aux couleurs de l’émouvant chemin de croix de Maurice Denis, puis j’ai regagné la rue qui ondule, je suis entré dans un bar populaire bien ondulant et j’ai regardé les gens onduler…
Faire la trace
La neige étant revenue en abondance, je suis reparti sur mes raquettes de trappiste destination l’alpage supérieur, avec le chien Snoopy ondulant comme une otarie à papattes dans la profonde; et tout aussitôt me sont revenus plein de souvenirs de traces sur la Haute Route.
Ainsi je nous revois remonter les altitudes de Zermatt au col du Mont-Brûlé, cette année-là. La neige portant bien il nous semblait avoir des ailes en dépit de nos sacs de sherpas, et nous y fûmes en cinq ou six heures; mais l’année suivante, brassant une couche fraîche nous arrivant aux genoux, chacun des lascars ne faisant que cinquante ou cent pas avant de se faire relayer, c’est à la nuit, après douze heures de marche que nous étions parvenus là-haut dans la clarté lunaire, laquelle avait donné à notre folle descente sur les tuiles de vent, droit sur le glacier d’Arolla, des allures de surf halluciné d’une folle griserie. Nous avions vingt ans et voici que, neuf lustres plus tard, Snoopy me dépasse crânement pour faire la trace devant moi comme, à mes quatorze ans, sur d’autres cimes, j’avais été prié par mon père de passer devant…
°°°
Nous avons laissé l’isba en contrebas et nous trouvions à présent tout seuls au-dessus des Vénérables, comme nous appelons les sapins immenses à dégaine ces jours de formidables moines à capuches immaculées, et du coup je me suis retrouvé dans la magie de cet autre monde des esprits sans âge et des âmes murmurantes dont la nature est le berceau, l’écrin ou le cercueil, on ne sait trop – le temple, enfin quoi l’église surnaturelle des premiers et des derniers jours où l’on s’agenouille debout…
°°°
Depuis que j’ai découvert où l’Armailli planque la grande clef de l’alpage supérieur, j’aime bien y faire escale en douce hors saison, ni vu ni connu, parfois à lancer un feu dans la petite cuisine au lit de fer et à la table de vieux bois lustré, mais cette fois juste en passant non sans prendre connaissance des derniers rapports écrits de l’Armailli, sur les feuillets qu’il annote et constituent en somme son journal d’estivage réduit aux plus simples expressions: Monté le 6 juin, pas beau. Réparé la clôture d’en haut. Fauché derrière. Remonté le 15 avec le troupeau. Fauché les orties. Remis la fontaine en ordre – ce genre de choses.
Surtout j’aime regarder les objets de l’Armailli, pas bien beaux à part quelques cuillers de bois sculpté. Je l’imagine fumant son tabac gris en maugréant, comme la seule fois où nous nous sommes rencontrés devant l’isba, le farouche devant se demander quel hurluberlu j’étais pour transformer ainsi une étable en bibliothèque et la peindre en rouge de surcroît. Je regarde ses vieux bouquins du Fleuve noir, ou ce recueil des Anecdotes alpines de Charles Gos dont la poussière me dit qu’il n’a plus été lu depuis des années. Je m’amuse à déchiffrer, sur la porte intérieure de l’armoire à vaisselle, cette coupure jaune d’un article signé Tip Top et prodiguant moult Bons Conseils sur la cuisson des macaronis ou la façon de nettoyer les taches de graisse. Je me demande qui a cloué, sur une poutre jouxtant la porte du chalet, cette frise de prières tibétaines imprimées sur des banderoles d’indienne déchirées par le vent et le temps ? Enfin je me dis que ce que je fais-là de bien indiscret, tous les écrivains devraient le faire: soulever le toit de chaque maison, regarder ce qu’il y a dedans, observer la vie des gens, partager tout ça…
Ceux-là sont des imbéciles: cet écrivain, ce cinéaste, ce critique sans entrailles, qui prétendent que la Suisse n’offre aucune prise à l’invention romanesque. J’imagine un Simenon découvrant ici les objets de l’Armailli, ou Tchékhov qui disait pouvoir écrire un récit à partir d’un cendrier. Ramon Gomez de La Serna rêvait d’écrire un roman dont les personnages seraient des objets. Ce que François Bon a fait à sa façon, racontant à la fois les siens, le monde d’un garage ou d’un atelier, son propre apprentissage et se passions de jeunesse, la Russie ou le rock à travers des ustensile ou des outils, dans son Autobiographie des objets. Tout un monde à raconter, qu’il suffit de tirer de la pénombre de cette prétendue banalité. Toute une vie à ressusciter…
Chiens de la Seine
Je me trouvais tout à l’heure à la cafète du Louisiane quand, ouvrant à peine ce livre intitulé Séismes, son incipit me cloue: « Quand mère s’est jetée sous le train, il a bien fallu trouver une femme de ménage ».
Cloué, je te dis. À deux tables de là, dans l’espèce de couloir malcommode de la caféte du lieu mythique (mais oui, tu te rappelles: Henry Miller y a baisé tant et plus et Cossery y a défunté après des années à se momifier au sixième), le couple classique des intellos américains mal dans leurs vieilles peaux maugréait je ne sais quoi sous l’effigie en bas-relief plâtreux de je ne sais quel fondateur évoquant à la fois le profil de JFK et ceux de Scott Fitzgerald ou d’Hemingway jeune, et j’en reviens à l’humour noir si juste de ce constat fleurant le réalisme terrien de nos cantons: « Quand mère s’est jetée sous le train, il a bien fallu trouver une femme de ménage ».
Déjà les exergues du nouveau livre de Jérôme Meizoz m’avaient épaté. De Zouc: « Mon village, je peux le dessiner maison par maison. Je le connais comme mon sac à main ». Et de Maurice Chappaz: « L’encre est la partie imaginaire du sang ». Mais là, page 7 de Séismes, la chose, dont je n’attendais pas vraiment le foudroiement (j’aime bien Meizoz quand il échappe à son carcan d’universitaire bourdieusard bon teint, sans attendre de lui le feu du ciel, en tout cas jusque-là), j’ai pris ma fine pointe Ball Pentel et j’ai recopié dans mon carnet Paperblanks Black Maroccan format bréviaire: « Quand mère s’est jetée sous le train, il a bien fallu trouver une femme de ménage. Père était sur les routes dès l’aube pour le travail, je l’entendais tousser longuement le tabac de la veille, mettre rageusement ses habits, avaler en vitesse le pain et le fromage. Puis il criait un nom d’enfant, le mien, par la cage d’escalier, pour que l’école ne soit pas manquée. L’appel était si brusque, incontestable, malgré le diminutif affectueux, qu’il signait d’un coup le retour à la vie diurne. Père claquait la porte et le silence régnait dans l’appartement jusqu’au soir ».
Ah mais ça: je ne pensais pas vraiment lire du Meizoz à Paris, ou alors dans le TGV du retour, demain serait bien assez tôt ! Et puis non: c’est avec Jérôme que je me suis résolu à prendre le métro tout à l’heure direction pas de direction, peut-être Saint-Denis ou Montrouge, peut-être les Buttes-Chaumont ou peut-être place Paul Verlaine où, une après-midi d’il y a bien des années, je lisais Les Palmiers sauvages de Faulkner quand il s’est mis à pleuvoir d’énormes gouttes dont le livre, j’te jure, garde la trace de la sainte onction…
Le métro parisien est l’idéal salon de lecture roulant de
tournure populaire, qui réduit à néant le préjugé selon lequel plus personne ne lit. Tout le monde lit au contraire dans le métro, j’veux dire: le métro parisien , et la preuve ce matin c’est que je dérange deux voyageuses en train de lire Joël Dicker pour continuer de lire Meizoz. Et tout de suite, d’Odéon à Châtelet, je me retrouve, à lire Séismes, dans la situation précise où, une autre année, je m’étais trouvé, dans une carrée de la rue de Lille que m’avait prêtée mon ami Tonio, alias Antonin Moeri, à lire Le Laitier de Peter Bichsel qui, subitement, m’avait ramené la voix de mon grand-père paternel dont les litanies allaient devenir un livre.
De la même façon, les séquences de la remémoration des années d’enfance de Meizoz, dans un monde à peine moins archaïque que celui de mon Grossvater, ont commencé de se déployer comme une espèce d’Amarcord valaisan dont se détachait précisément un avatar de la Gradisca sous les traits d’une belle plante se pointant à la messe avec ses fourrures de crâneuse – mais voici qu’à Châtelet il fallait changer de rame…
Jérôme Meizoz a encore vu, dans le Valais de son enfance, comment on traitait les Ritals et autres « saisonniers », mais son récit évoquant les débuts de la télé fait aussi apparaître un certain politicien (j’ai cru reconnaître le compère Jean Ziegler) qui martèle à la lucarne que la Suisse est une espèce de coffre-fort enterré aux multiples ramifications souterraines, et j’aime la façon dont son village cerné d’industrie (il y a un immense mur de barrage au béton bouchant le ciel d’un côté) prend peu à peu sociale consistance sans peser.
Une frise de personnages relance tout autrement le Portrait des Valaisans de Chappaz, les détails intimes foisonnent et résonnent comme chez Fellini (avec la chair qui s’éveille et les filles qui rôdent au bord du Rhône), et comme pour accompagner ma lecture je vois Paris se transformer sur la ligne de Saint-Denis, et tout soudain l’idée me vient d’un pèlerinage au Cimetière des chiens, donc je sors à La Fourche, je switche sur la ligne de Gennevilliers, je descends à Mairie de Clichy, je m’engage sur le boulevard Jean Jaurès présenté come « apôtre de la paix », je poursuis à pied sur le pont enjambant la Seine et là que vois-je à mi-fleuve: cette inscription de mémoire qui me scie le coeur, rappelant qu’ici des manifestants pacifiques furent jetés au fleuve le 17 octobre 1961.
°°°
Quant au Cimetière des chiens c’est un poème, et d’abord le poème des noms, à commencer par celui de Barry dont le considérable monument de granit se dresse à l’entrée de l’inénarrable nécropole et me ramène aux chanoines valaisans qui se sont efforcés de dresser, aussi Jérôme Meizoz. On n’oubliera pas que des hommes furent traités, non loin de là, plus mal que Bijou, Ramsès ou Rintintin la star. Pour ma part, je me rappelle cette anecdote rapportée par Léautaud, du type décidé à foutre son chien à la Seine, qui s’y reprend à deux fois car l’animal revient, et qui la troisième fois le rejette si violemment qu’il tombe à l’eau avec le chien, qui le repêche…
°°°
Je ne me lasse pas, dans le métro parisien, de regarder les gens. Pour échapper à l’effet de masse et de presse découlant évidemment du surnombre en mouvement brownien, je concentre mon regard sur les visages et les mains. Hier ainsi, sur le trajet de la banlieue nord, les mains se faisaient de plus en calleuses ou gercées, et les visages de plus en plus arabes ou africains; et comme il y avait plus de jeunots que de jeunotes, et de moins en moins mélangés, je me suis rappelé la psalmodie de Grand Corps Malade sur le thème de Roméo kiffe Juliette, après quoi j’ai remarqué de plus en plus de visages de mères en soucis.
°°°
Autant que les longs vols, que j’exècre, les trajets solo en TGV m’ont toujours semblé coupés du temps, voire de la vie. L’homme du TGV, à portable et calculette, est à mes yeux l’incarnation par excellence du zombie de fourmilière humaine; cependant un livre, un voisinage moins nul, ou l’alcool aident plus ou moins à passer d’une rive à l’autre de ce fleuve de vide.
Or l’alcool m’étant interdit ces jours pour excès de médics, je me suis replongé, le temps de mon retour de Paris, dans les récits de Tchékhov et, plus précisément, dans la terrible nouvelle intitulé Volodia, tandis que ma très jeune et jolie et blonde et fine voisine soupirait, à la lecture de Closer, sur un reportage consacré à la mort de Gérald au premier jour de tournage de l’imbécile série de Koh-Lanta.
C’est entendu: nous pleurons tous Gérald Babin, mais son pauvre sort sera bientôt liquidé par pertes et profits sur l’autel vénal des simulacres d’évasion, alors que le coup de feu qui met fin volontaire à la vie de Volodia, jeunot de dix-sept ans succombant au désespoir, retentira à jamais dans la nuit de nos mémoires.
°°°
De Montreux, jadis station lacustre pour Anglais, à l’Oberland bernois idyllique où tant de Russes de renom ont passé, de Tolstoï ou Tourgueniev à Nabokov brandissant son filet à papillons, le train préalpin qui me ramène à notre nid d’aigle figure au soir une volière de perruches hispaniques ou latino-américaines regagnant leurs pensionnats de haut renom. Toutes terroriseraient mon pauvre Volodia.
Nul mieux que Tchékhov n’a dit, comme dans cette nouvelle, le désarroi d’un garçon sensible se sachant laid, maladroit, humilié par sa mère volage et servile, ensuite pour ainsi dire violé par la coquette à laquelle il a osé avouer son impudent amour – nul n’a mieux suggéré le désespoir d’un garçon taxé de « vilain canard » par la dinde qui vient de s’offrir à lui, nul n’a décrit en si peu de pages le dégoût éprouvé par un coeur tendre pour le monde immonde des futiles – mais voici que j’aperçois quelqu’un que j’aime là-bas sur le quai, et c’est, ma parole, une dame au petit chien…
Cité du soleil
À la fin le bleu commençait à nous manquer: nous devenions maussades autant que des Hyperboréens, et ça ne s’arrangeait pas ces derniers jours: donc nous sommes partis ce matin à dix heures de nos monts transis où les premiers narcisses perçaient timidement dans le brouillard glacé, et nous sommes arrivés au Cap d’Agde à six heures du soir, par grand beau.
Un épisode à la Tati m’a vu trépigner devant la porte de notre studio 59 du Bloc D de l’Héliopole où nous revenons chaque année depuis 25 ans, m’acharnant avec les deux clefs sur la serrure alors que la porte était restée ouverte, juste rétive à l’accueil. Mais voilà, nous y étions: un double éclat de rire a donc marqué notre arrivée et notre belle humeur retrouvée…
°°°
Quant à la descente, elle s’est faite en glissade par les autoroutes, le soleil nous rejoignant à la hauteur d’Orange, comme son nom l’indique; et du coup nous avons été requinqués alors que je lisais à haute voix, à ma bonne amie conduisant la Jazzselon la tradition, le dernier roman de Pascale Kramer (Gloria) qui nous a tout de suite scotchés. J’ai passé à côté de ses deux romans précédents, dont L’implacable brutalité du réveil est paraît-il un très beau livre; elle croit peut-être que je lui fais la gueule alors qu’il n’en est rien, enfin bref: la vie est comme ça et c’est d’ailleurs pourquoi j’aime les livres de Pascale qui disent cela à leur façon unique: les gens dans la vie sont comme ça…
Si nous revenons depuis tant d’années en ces lieux plus ou moins futuristes (style Metropolis méditerranéenne middle class française des années 60) et décatis sur les bords, c’est essentiellement pour la mer immédiate et les vingt bornes de dunes qu’on peut suivre à pied jusqu’à la plage sétoise chère à Brassens, les alvéoles locatives bon marché dans l’immense amphithéâtre ouvert sur la Grande Bleue, l’interdiction faite à toute circulation automobile sous nos terrasses et les commerces à trois pas.
Guère intégristes en matière de naturisme, nous n’avons pas pour autant détesté la liberté de vivre à poil aux âge où nos chairs s’épanouissaient encore, nos petites filles n’ont pas été effarouchées de voir « toutes ces saucisses », selon l’expression de la benjamine, puis les années ont passé, la pudeur des jeunotes s’est développée, les « libertins » ont débarqué avec leur fric et leur ostentation sexuelle fauteuse parfois de conflits ouverts sur les plages, le climat des lieux s’est un peu gâté quelque temps mais le bon naturel des gens, la mer, les dunes et la Librairie sétoise, les moules du Grau d’Agde et la France profonde du Cantal et du Midi libre ont concouru à entretenir notre fidélité et notre plaisir débonnaire à la revenance. Bref, nous allons passer vingt jours de plus à l’héliopole, ma bonne amie a pris ses livres et j’ai pris les miens à lire plus celui que j’ai en route, notre matos de dessinage et d’aquarelle, nos vieilles osses et nos coeurs indéfectiblement accordés…
°°°
Les ciels de mer sont à peindre en ces jours changeants. Les grands nuages blancs comme amoncelés, présages d’été, du côté de l’arrière-pays des Corbières, semblent attendre on ne sait quoi, pas menaçants mais non moins présents, immobiles, faits pour être peints à la gouache plus qu’à l’aquarelle; ou alors celle-ci bien plastique, bien à-plat dans les blancs arrondis du cumulus affirmé, ensuite avec des nuances de gris qui feraient pressentir le possible mouvement prochain. On connaît les ciels bretons de Boudin, mais je ne sais aucun peintre de ciels languedociens chargés de grands nuages barrant ainsi le ciel de terre vers les Pyrénées, tout autrement évidemment qu’en Beauce, à Combrai ou dans l’arrière-pays vaudois – et moins encore de metteur en scène pictural de ce qui se prépare à l’instant de l’autre côté, tandis que la tramontane se lève sur les dunes dans le ciel, là-bas, vers le mont Saint-Clair, au-dessus de Sète.
°°°
Ensuite on a donc découvert, comme un fait accompli, ce ciel noir du soir à traînées oranges virant au rouge sombre par imperceptibles pression de doigts invisibles. Le photographe allait pour sauter sur son appareil, non sans pressentir que rien ne serait retenu à temps de cette apparition de lourdes panses d’ânesses groupées et vues de dessous, et leurs veines de sang – tout ce magma d’un instant presque dramatique au-dessus d’un deuxième arrière-ciel encore très bleu presque doucereux, pour ainsi dire pervenche, que le peintre éventuel tâchera de se rappeler alors que le tableau se fait bientôt noir…
°°°
Enfin ce même soir m’est arrivée, par courriel côtier des hauts de Toulon, cette bonne missive d’un des rares scribes bluesy de mes âges, auteur d’ailleurs du roman Blues et de cantilènes aux mémoires de Miles ou de Billie Holiday, tout récemment de la formidable Saison sabbatique et qui, en notre jeune temps, fut l’un des seuls storytellers de moins de trente ans à m’enchanter durablement avec Le Buffet de la Gare et La couleur orange, plus tard avec ses incomparables récits des Jours de vin et de roses – ce sacré bougre de compère au nom d’Alain Gerber qui me dit ce soir que, peut-être, le blues serait une espèce de grâce donnée en partage à qui veut bien la recevoir et la faire rayonner…
Nyctalopes
Je m’étais représenté JDD sombre et plus ou moins dément à la lecture d’ Invention des autres jours, son premier opus paru chez Attila, nos échanges initiaux avaient confirmé cette impression d’avoir affaire à un type bizarre, accentuée par la découverte de ses photos de farouche lycanthrope, et pourtant c’est un compère très doux, très tendre paternel de deux très beaux enfants et très bon compagnon de sa gracieuse moitié comédienne et danseuse, que nous avons rencontré l’an dernier à Montpellier avec les siens devenus, depuis lors, nos amis sûrs.
Autant dire que ce fut une fête, hier, de retrouver le charmant quatuor, de se balader ensemble par les ruelles (rues des Soeurs noires, rue des Rêves et autres venelles bien nommées) du vieux Montpellier avant d’assister de loin, en les murs d’Aigues-Mortes, aux mouvements de la Bataille des Nations rassemblant la fine fleur mondiale des jeunes croisés médiévalisants pour des combats de « full contact en armures », enfin de nous retrouver sur le pont de l’Adelante du frère de JDD, à l’estacade de Port Camargue, à parler voiles latines et cinéma américain tandis que la nuit se faisait et que JDD nous dédicaçait son dernier livre paru la veille…
Le hasard me fait lire, ce matin de tramontane glaciale, deux livres qui évoquent, avec le même souci d’objectivité pour ainsi dire hyperrréaliste, la ville-monde en ses derniers avatars. Sous le pseudo d’Emile Dajan, notre ami Jean-Daniel Dupuy, alias JDD, investit, dans Zoneapolis, l’univers des grandes surfaces commerciales en lesquelles il voit la résurgence des forteresses de jadis, qui seraient à la fois des temples et des mausolées du présent où Tout se trouve à la fois à portée de main et comme dérobé. « Car dans ce Marché Supérieur, tous les échantillons peuvent être emportés. Mais Tout est illusion. Car Tout est à vendre. Aqueuse est la pisse et le désir se nourrit de son manque ».
Or ce « manque » se retrouve illico dans La Nuit de Frédéric Jaccaud, vaste contre-utopie nocturne située dans la ville-monde la plus au nord d’une Europe à bout de souffle et de sève, dont les moroses autochtones survivent à côté de hordes de viveurs débarqués des pays voisins pour s’éclater dans les boîtes de cette espèce de Babylone jouxtant la banquise.
Il me plaît alors de lire, au sud des parapets européens où, le soir, de prétendus libertins se massent dans la mousse de maussades parties, ces deux livres lucides et purs dont la manière noire tranche d’avec la grisaille ambiante à nuances convenues.
°°°
Dans La Nuit de Frédéric Jaccaud, un certain Aleksy Linden, progammeur-compileur aussi virtuose que misantrope, qui a rêvé de changer le monde, les lois de la physique, les règles sociétales et la combinatoire des nébuleuses, se coupe bientôt de ses semblables pour se claquemurer dans le virtuel, survivant matériellement du commerce de ses bricolages informatiques et se complaisant finalement à « traquer sa propre trace, en alimentant lui-même des rumeurs à son sujet sur les forums ».
On ne fait pas mieux dans le noir constat impliquant, à la fois l’aliénation contemporaine à son point d’auto-anéantissement, et l’exorcisme de sa représentation. Telle est d’ailleurs la vertu de la manière noire, en littérature, qui force le regard à raviver son désir de couleur, n’était-ce qu’en découvrant les nuances du noir – comme dans la peinture de Soulages, très présent ces jours à Montpellier en attendant l’ouverture de son musée. Retour par conséquent au spectre tonifiant des couleurs de la vie à quoi nous renvoient, subrepticement, les révélations du noir…
Sète, rue du Génie
La pluie sur la mer nous ramène à tout coup en librairie, et l’escapade s’imposait d’autant plus, ce matin, que la fiction et les faits se conjuguaient pour accentuer le poids du ciel: j’avais entrepris la lecture du Chinois de Henning Manckell, dont les premières pages ruissellent du sang de dix-neuf innocents massacrés dans le même petit bled enneigé du nord de la Suède plombé par le froid, et ma bonne amie suivait, sur son Mac, la diffusion de la conférence de presse donnée par la police et les autorités lausannoises après l’odieux assassinat de la jeune Marie par un tueur imprudemment relâché dans la nature malgré une première condamnation pour meurtre.
Bref, la perspective d’une virée à Sète, même par temps moche, nous souriait d’autant plus que nous aimons la cité de Brassens et de Valéry depuis tant d’années que nous y revenons, attirés aussi par la Nouvelle Librairie Sétoise et ses tenanciers de haute compétence, où nous avons déjà claqué des fortunes.
°°°
Sur la route longeant les eaux du bassin de Thau, aussi puantes que la conscience d’un Méchant, nous avons souri de concert, ma bonne amie et moi, tandis que je lui faisais la lecture de Daisy Miller, la nouvelle de Henry James qui se situe – je ne me le rappelais pas – dans notre bonne petite ville lémanique de Vevey, et commence plus précisément dans les jardins de l’hôtel des Trois Couronnes où, il y a dix ans déjà, nous aurons fêté nos vingt ans de vie commune. Après les trente première pages affreuses du Chinois, celles de l’immense romancier faisaient irradier le charme piquant de la jeune Américaine, non sans nous amuser quand elle désigne « là-haut » les tours du château de Chillon famous in the World, évidemment invisible des jardins en question. Mais la fiction a de ses droits, n’est-ce pas…
°°°
Lorsqu’on établira enfin une Carte du Tendre des meilleures librairies littéraires francophones, entre La Liseuse de Françoise Berclaz à Sion, La Librairie de Sylviane Friederich à Morges et leurs homologues de Besançon à Bordeaux ou Manosque, entre trente-trois autres, on aura garde d’oublier la Nouvelle Librairie Sétoise qui nous émerveille, à chaque fois, par l’excellence de son fonds, de son choix de parutions récentes et des conseils de ses passeurs.
Nous n’étions pas là depuis cinq minutes, cette fois, que la patronne du lieu me racontait le nouveau roman de Martin Suter, Le temps, le temps, paru ces jours chez Bourgois, après que je lui eus raconté La Nuit de Frédéric Jaccaud; et moins d’une heure plus tard nous repartions avec les entretiens de Françoise Jaunin (ma chère ex-collègue de 24Heures) avec Pierre Soulages, le commentaire du Balcon de Genet par Alain Badiou (Pornographie du temps présent), les deux derniers romans d’Amin Maalouf (Les désorientés) et d’Andrea Camilleri (L’âge du doute), une enquête historique de Tidian N’diaye sur le néo-colonialisme chinois en Afrique (Le jaune et le noir) propre à compléter la fiction de Manckell sur le même thème, plus Superman est arabe et C’est ça la mort de Donald Westlake pour ma bonne amie, et pour moi le dernier album de Fred (Le train où vont les choses) afin de renouer avec l’inoubliable Philémon, le texte testamentaire de Stig Dagerman (Notre besoin de consolation est impossible à rassasier), plus encore Le parti pris des animaux de Jean-Christophe Bailly qui sonde, comme le souligne l’auteur, l’ « énigmatique du vivant » et dont le titre d’un des essais fait écho méditatif à la lecture de La nuit de Frédéric Jaccaud, tragiquement pétri de ce thème: « les animaux conjuguent les verbes en silence »…
L’appel du bleu
Il y avait hier, tout en bas du ciel de tôle faisant rideau de fer sur les vagues noires remontant jusqu’aux dunes de Marseillan, comme une lande de bleu très bleu là-bas vers l’horizon montueux de la lointaine Côte vermeille, et tout de suite le nom de Collioure m’est revenu avec les mots du coloriste irradiant que fut Matisse ce fauve été-là de juillet-août 1905, nous enjoignant d’y aller dans la foulée: « Il n’y a pas en France de ciel plus bleu que celui de Collioure. Je n’ai qu’à fermer les volets de ma chambre et j’ai toutes les couleurs de la Méditerranée chez moi ».
Le temps d’y rouler je nous ai lu, à haute voix, les cinquante premières pages du nouveau roman de Martin Suter, intitulé Le temps, le temps et ressaisissant, dans un climat d’inquiétante étrangeté parano, la confrontation de deux voisins vis-à-vis s’épiant l’un l’autre avec méfiance après avoir vécu le même choc de la perte prématurée de leur compagne; le plus âgé développant toute une théorie sur le fait que le temps ne passe pas en réalité, et toute une conduite d’exorcisme pour en conjurer les trop évidentes conséquences.
°°°
Ensuite parcourant le dédale de la forteresse séculaire du Château royal dominant le port de Collioure, je me suis rappelé les derniers jours d’Antonio Machado et de sa mère, dans un petit hôtel où leur exode aboutit en février 1939, dans les conditions les plus précaires (le poète et son frère José se prêtant leur seul pantalon encore présentable pour apparaître en public…) et le climat de désespoir que Pablo Neruda évoque dans un hommage: « La guerre civile – et incivile – d’Espagne agonisait de cette manière: des gens à demi prisonniers étaient entassés dans des forteresses quand ils ne s’amoncelaient pas pour dormir à même le sable. L’exode avait brisé le coeur du plus grand des poètes, don Antonio Machado. Ce coeur avait cessé de battre à peine franchies les Pyrénées. Des soldats de la République, dans leurs uniformes en lambeaux, avaient porté son cercueil au cimetière de Collioure. C’est là que cet Andalou qui avait chanté comme aucun autre les campagnes de Castille repose encore ».
°°°
Et dans le même petit livre racontant Les derniers jours d’Antonio Machado, publié par Jacques Issorel aux éditions Mare Nostrum en 2002, avec toute une série de témoignages sur les circonstances de cette triste et noble fin dégagée de ses fables posthumes, le poète Gumersind Gomila ajoute ces mots défiant le temps qui passe, devant la première humble tombe que remplacerait plus tard un monument plus solennel : « Sur la pierre tombale bien déserte, / sans aucune date ni aucun nom, / toute blanche, en marbre, / la lune se plaît car elle luit. / Et elle vit pour toi la lune claire / et chaque étoile vit pour toi, / et tout respire la poésie /comme si ta parole se répandait ».
L’incomparable bleu et toutes les couleurs de Collioure ont inspiré les peintres, ainsi que le rappellent les murs du bar des Templiers, couverts de tableaux, et l’on pense évidement à Signac qui en fut le premier découvreur, à Derain, à Gauguin et plus encore à Matisse pressentant lui-même le génie de Cézanne, mais c’est encore le poète Gomila qui dit cela si bien de ses mots simples et clairs: « La barque repose sur la plage, / les viles sèchent et les filets; /là-haut, là-haut, une mouette chante la vie et la clarté » (…) « Que dit le rossignol qui passe /et reprend haleine, posé sur la croix ? / Il dit que la vie est belle, belle, /comme un profil de Liberté. / Il dit à ceux qui ne peuvent plus le voir / que le ciel est bleu et bleue la mer … »
Les anges blessés
Il ne m’a fallu que le retour à quelques pages du Great Gatsby pour me rappeler cette évidence: que ce qui nous touche vraiment en littérature, et donc dans la vie, ou inversement, est une affaire d’anges. Je me le disais déjà hier en relisant un récit de Tchékhov intitulé Ceux qui sont de trop, et cela m’est encore plus clair à la lecture de Scott Fitzgerald: que nous crèverions sans les anges.
Cela n’a rien à voir avec ce qu’on décrie justement comme angélisme, au sens d’une idéaliste suavité ou d’une innocence fantasmée de bambins béats: cette bimbeloterie odieuse propre aux mères américaines et à leurs clones n’a rien de commun avec les anges de tous âges et conditions que je dis, qui en bavent le plus souvent plus que les autres et sont parfois teigneux voire affreux.
L’affreux et teigneux Charles Bukowski, par exemple, est de ces anges au même titre que ce snob gigolo de Rainer Maria Rilke ou que cette punaise de Simone Weil ou que cette harpie de Patty Higsmith ou que le calamiteux Arthur Rimbaud – tous ayant en commun le même don d’illumination et la même grâce diffusée par Scott Fitzgerald quand il capte la douleur sous le lipstick.
Le prétendu romantisme glamour des années 20 aux States est évidemment une foutaise, et particulièrement au cinéma, et plus précisément encore dans le film Gatsy le magnifique de Baz Luhrmann, mais sous l’or cosmétique dont on a pommadé le visage plébéien de Leonardo di Caprio se perçoit néanmoins un rien de frémissement angélique qui se retrouve ici et là dans les regards de Daisy ou dans le rien de folie ou de délicatesse échappant à l’écrasement de la machine hollywoodienne dont on se rappelle en passant qu’elle a laissé le poète crever comme un chien.
L’obstacle majeur à la diffusion lumineuse de l’ange – ce qui revient à parler de l’art ou de la poésie -, est l’agitation imbécile, laquelle procède de la vanité et de l’envie, qui participent elles-mêmes des composants de la basse passion de posséder ou de soumettre ou de s’en mettre pleine la panse ou de s’éclater comme on dit.
Les Anges de la télé figurent cette agitation au pinacle de la stupidité médiatique. Cependant le rejet vertueux ou la moquerie me semblent insuffisants. Je me disais même, hier soir, que les meufs et les mecs élus sur le plateau de cette émission d’une débilité extrême, sont peut-être, quand même, quelque part, des anges – je me disais que chacun de ces pantins laqués ne ferait pas de vieilles osses dans cette arène du Rien et dans l’immédiat je saluais avec espoir un rien de panique enfantine dans l’expression de la pauvre Nabilla changeant de culotte à vue; je guettais chez les boys un rien de gouaille ou de bonne vulgarité sous la dégaine à la coule de celui qui assure avec la conviction (voix off) de vivre quelque chose de géant, pour ne pas dire d’Historique comme le martèlent les hystériques du TJ – bref je cherchais à ces zombies programmés une issue en les imaginant revenus dans leur banlieue ou leurs nouveaux meubles ou leurs sanglots subits de lucidité: je souhaitais secrètement a Nabilla & Co de se retrouver un de ces soirs largués et perdus, jetés éperdus loin des spots et des cadres putes de la télé, se frottant enfin les paupières au lever du jour et se sentant des ailes…
La grâce n’est pas toujours où les spécialistes en la matière la situent, même si les saintes et les saints homologués dans les cultes divers ne sont pas sans mérites avérés, mais la percevoir suppose d’abord qu’on se calme, qu’on se taise, qu’on écoute, qu’on se montre plus attentif même en pleine disco ou dans la tonitruance du stade en folie après un but de rêve: les messagers sont parmi nous mais nous ne savons point les voir ni les accueillir. Or il importe de discerner plus clairement ce qui nous en empêche, et ensuite cela pourrait aller mieux.
L’obsession en tout genre est un obstacle sérieux. L’obsession apoplectique du Pouvoir me semble pour ainsi dire rédhibitoire, j’entends: politique, financier et symbolique. Devant ces obstacles, l’ange se sent flagada. Mais il faut se méfier du pire qui use parfois de la parure du Bien. L’obsession de la vertu ou de la pureté peut aussi contrevenir au passage du messager, qu’une certaine tradition spirituelle a raison de voir préférer les mauvais lieux aux tea-rooms proprets. Une certaine obsession de la bonne santé ou de la belle humeur peuvent s’opposer aussi à la libre circulation des personnes angéliques. Imagine-t-on Notre Seigneur dans un fitness ou les poètes Novalis, Baudelaire, Dylan Thomas, Emily Dickinson dans un jacuzzi ? alors que leur vocation les porte à s’incarner en douleur et en douceur…
Suisse profonde
Du sentier sinuant au bord du ciel on voit, trois cent mètres plus bas, la petite prairie au tendre vert inclinée vers le lac qu’on appelle Rütli (plutôt Grütli en Suisse romande) et qui symbolise géographiquement et sentimentalement le mythe fondateur helvétique. L’eau de cette partie la plus méridionale du lac des Quatre-Cantons paraît de là-haut d’un vert sombre tendant au noir, sur lequel les bateaux tracent des sillons argentés. Or j’ai beau me sentir peu porté à l’extase patriotique convenue : la magie du lieu ne me saisit pas moins par sa pureté sauvage échappant aux chromos touristiques. Le lieu n’a rien à vrai dire de pittoresque: il est mythique.
La seule fois que j’étais monté au Rütli, il y a quelques années, depuis le débarcadère, c’était pour y assister à une représentation du Guillaume Tell de Schiller, dans une mise en scène au goût du temps. Des voix conservatrices avaient crié au scandale avant même le spectacle réalisé, qui plus était, par des « étrangers », mais la pièce en sortait au contraire épurée et touchant mieux à l’universalité de la légende. Et la nuit d’été, comme suspendue hors du temps, avait magnifié le souffle du verbe accordé à la magie du lieu.
Je ne pouvais mieux tomber que sur l’hôtel Tell de Seelisberg pour y passer la nuit, ayant à lire la dernière pièce de mon cher compère René Zahnd, précisément consacrée à Guillaume Tell. La coïncidence était épatante, et d’autant plus que René, dont la dernière pièce jouée, Bab et Sane – dialogue savoureux de deux gardiens de la villa lausannoise de Mobutu, qui a beaucoup tourné en nos contrées et en Afrique -, a toujours cultivé le goût libertaire des personnages hors normes (d’Annemarie Schwarzenbach à Thomas Sankara) dont Tell est une sorte de parangon.
Lisant donc cette nouvelle pièce, j’ai été heureux d’y retrouver un coureur des cimes sans bretelles suissaudes « typiques », chasseur sans terres bondissant sur les crêtes au dam de ses dames épouse et mère, m’évoquant la figure du contrebandier Farinet de Ramuz ou l’homme des bois de Dürrenmatt. D’ailleurs René me l’a confirmé par SMS après que je lui ai balancé mes premières impressions: « G voulu en faire une espèce de chaman »…
En outre la story de notre héros national d’improbable origine est bien là avec sa galerie de fameux personnages, du bailli Gessler flanqué d’un ange de noir conseil, soumettant la piétaille locale à sa férule tyrannique, aux Confédérés ligués sagement ou sauvagement selon leur âge, en passant par les femmes dont les choeurs modulent les peines et la révolte.
Le lieudit Seelisberg désigne la montagne au petit lac dont on découvre en effet, dans un sorte d’écrin de verdure bleutée, les eaux absolument limpides qui accueillent, comme dans l’orbe parfait d’un miroir, le reflet dédoublé des monts alentour et du ciel. D’une parfaite sérénité, l’endroit porte naturellement au recueillement.
Mais c’est l’invite à une autre forme d’élévation spirituelle qui se matérialise, à quelque distance de là, au lieudit Sonnenberg (montagne du soleil), sous la forme d’un bâtiment tenant à la fois de l’ancien palace alpestre (ce qu’il fut en effet) et du temple New Age à dorures, à l’enseigne de la Méditation Transcendantale de l’illustrissime Maharishi Maesh Yogi.
Hélas, comme je restais encore sous le charme du petit lac magique, je n’aurai fait que passer dans le hall d’entrée de cet établissement m’évoquant une sorte de clinique de luxe (une affiche voyante y annonce 24 Heures de bien-être par jour à grand renfort d’Ayurveda) ou de centre de congrès occultes. Du moins me suis-je incliné, respectueusement, devant l’effigie du feu gourou, non sans emporter l’utile documentation consacrée à la commercialisation mondiale de son miel védique, garant de longue vie et de paix entre les peuples. À ma connaissance, ledit miel védique, Maharishi Honey, n’est pas encore coté en Bourse…
°°°
L’idée d’aller au hasard, sans but précis, après avoir quitté ce coeur présumé de la Suisse mythique, avec l’envie tout de même de retrouver certains lieux d’élection personnelle, du côté de l’Engadine où la lumière est si limpide, là-bas où le Nord le cède au Sud, entre Sils-Maria et Soglio dans le val Bregaglia – cette idée, ou plus exactement ce sentiment ne pouvait pas ne pas céder à l’appel des noms, et le premier fut celui de Maderanertal, signalé à l’échappée de la funeste autoroute du Gothard où je m’étais engagé très imprudemment.
J’écris bien: la funeste autoroute du Gothard pour ce que cette voie de l’actuel grégarisme impose: pare-chocs contre pare-chocs, camions de brutes et tunnels asphyxiants, et cette évidence odieuse que le consentement est obligatoire à l’exclusion de toute alternative. De quoi se flinguer s’il n’y avait pas sur l’autoradio les voix en alternance de Rossini et de Michael Lonsdale lisant La Recherche, ou de Billie Holiday ou de Lightning Hopkins – et tout soudain la tangente ouverte par le nom de WASSEN et cette autre promesse éventuelle du MADERANERTAL…
°°°
Il y avait de quoi s’étonner, sans doute, de ce que, parallèlement à la funeste autoroute du Gothard dont l’encombrement vaudrait des heures d’attente à ceux qui s’y agglutinaient, sinuait la plus aimable route nationale, fluide comme une onde, où je me lançai donc avec allégresse jusqu’au pied des roides premières pentes où zigzaguait, presque à la verticale, la route latérale du fameux Maderanertal annoncé. J’écris fameux non sans ironie, sachant le val farouche absolument ignoré de la horde autoroutière, accessible en circulation alternée tant sa route vertigineuse est étroite, défiant tout croisement et entrecoupée de minces galeries donnant sur le vide, mais accédant finalement à la merveille d’un val suspendu largement ouvert à l’azur.
Or progressant le long de cette corniche taillée en pleine roche, je me rappelai les mots du bailli Gessler, au début du Guillaume Tell de mon compère René Zahd, maudissant « cette nature sauvage faite pour les ours ». Et je me dis alors que l’étranger, pas plus que le bailli autrichien, ne comprendrait jamais vraiment la Suisse profonde sans être monté, loin des banques et des kiosques à chocolat, jusqu’au cirque solaire de Derborence par la sombre faille qui y conduit, ou sans entrevoir au moins une fois, comme l’a déploré le vilain Gessler, « ces montagnes qui tombent à pic dans des lacs sournois, ces brumes qui cachent les dangers », mais aussi ces hauts gazons où l’on se sent mieux « capable du ciel »…
°°°
Le jour déclinant, quelques heures plus tard, deux autres noms m’ont détourné de la route des Grisons que j’avais rejointe par le col de l’Oberalp, du LUKMANIER et d’OLIVONE. Et là, c’était le souvenir des deux autres amis, le peintre Thierry Vernet et sa conjointe Floristella, qui m’a fait aller plutôt vers ce col accédant au Tessin, et cette fois encore, comme à chaque fois que mon regard se tourne vers leurs tableaux, il me sembla communier avec ces si chers disparus. D’abord avec les verts, prodigieusement intenses, pour ainsi dire irlandais, des pentes septentrionales du Lukmanier – et la je m’arrêtai à Baselgia, dont le nom chantait aussi dans mon souvenir, lié au titre de quelque toile de l’un de nos deux amis artistes, pour y visiter une chapelle à lumière d’éternité. Ensuite, par delà le col, les pins succédant aux sapins, avec la lente et sublime descente vers Olivone où je savais retrouver le décor, à la fois épuré et flamboyant en ses couleurs, de celui des tableaux de Thierry que j’ai toujours préféré dans son mélange de contemplation et de fulgurance, évoquant le crépuscule en incendie de couleurs…
°°°
De Lugano, dont la façade monégasque de place d’affaires me rebute de plus en plus, je m’impatientais de m’éloigner, et le nom de GANDRIA s’est alors imposé à mon attention, me rappelant la proche côte italienne qu’on longe en arrivant des Grisons, sa route calamiteuse et ses hôtels décatis campés tout au bord du lac, mais c’est avec un nouvel étonnement, tout de même, que j’ai passé, ce soir, du front de lac outrageusement luxueux de Castagnola et ses palaces aux obscurs petits bourgs italiens d’après la frontière, semblant réellement d’un autre monde, vingt ou quarante ans en arrière, mais immédiatement plus à mon goût, plus vivants et vibrants.
Hélas j’arrivais trop tard pour y trouver encore une chambre libre, mais j’avisai alors le nom quasiment effacé, sur un placard de bois vermoulu, de CAMPEGGIO SAN ROCCO, aussi me lançai-je dans la remontée improbable d’une pente à n’en plus finir serpentant entre murs de vignes et jardins suspendus, riant sous cape de pouvoir étrenner ainsi ma tente à arceaux et sardines d’opérette acquise pour l’occase, grimpant et grimpant encore à bientôt cinq cents mètres à l’aplomb du lac, n’y croyant plus au moment de déboucher sur un système de terrasses comme en trouve en Valais ou à Bali, toute dévolues au camping; et déjà le plus souriant jeune barbu m’accueillait et me proposait, plutôt qu’un carré d’herbe pour ma tente à arceaux, vu le mauvais temps qui s’annonçait: une caravane à 12 euros la nuit pourvue d’une véranda de bois à pampres de vigne et luminaires automatiques – bref le paradiso subito…
Et déjà j’étais prié à souper: dès qu’installé, le jeune barbu, fils du propriétaire des lieux, m’avait proposé de partager le repas du soir avec les rares résidents de ce début d’automne, et voici que, d’autorité, son père proprio des lieux, Gian Carlo de son prénom, octogénaire fort en gueule et en gestes, me sommait de prendre place à ses côtés pour ne plus me lâcher de la soirée. Quatre heures durant, ensuite, je me suis régalé d’humanité comme dans aucun cinq étoiles. De pappardelle maison, bien sûr, et de chasse de saison, arrosés de Nero d’Avola, mais surtout de parlerie fraternelle avec ce vieux conquérant de l’inutile me racontant son équipée d’ado de quatorze ans au Piz Badile, ses virées avec le jeune gang de varappeurs dont Walter Bonatti était le plus talentueux et le plus fou, sa jeunesse au temps du Duce (son irrésistible imitation des discours du Duce), ses transhumances de son Milan natal à ces hautes terres – et la Madre se taisait à ses côtés, le Figlio parlait à une autre table avec deux belles, et deux Bâlois, attachés à ces lieux heureux depuis des lustres, nous avaient rejoints pour refaire le monde en langue alternée de Dante et de Goethe…
Un jour me disais-je, en regagnant ma capite à tâtons, un peu titubant, aussi cuité que vanné mais heureux quelque part, un jour j’amènerai Lady L. en ce lieu, tout en pensant: ou peut-être que non. Peut-être que si, me disais-je, car elle partage ton goût de la simplicité et du bon naturel, mais comment ne pas se dire, aussi, que ce quelque part est partout ? Or je lui avais déjà dit ce soir-là, débarquant à San Rocco, à elle qui se trouvait pour lors aux Amériques parmi les siens: je lui avais dit par SMS que j’avais trouvé là le lieu des lieux. Mais va: je te connais, je nous connais, nous avons déjà notre cabane au Canada – e la nave va…
°°°
Se faire réveiller par les doigts de la pluie tambourinant sur la tôle d’une caravane à douze euros la nuit relève du confort si l’on songe qu’il est des pays où il ne pleut jamais et dans lesquels douze euros représentent plus qu’une somme, mais cette musique matinale ne m’a pas enchanté ce matin que par défaut: c’est en effet que je préfère, en bohème demeuré, cette sorte de bien-être frugal au fade wellness à programme-santé et autres bains de bulles.
En outre la pluie incite à la lecture, et c’est ainsi que j’ai repris, sous ses pizzicati, celle de L’Université de Rebibbia de Goliarda Sapienza, me replongeant dans l’Italie du peuple et du Padre padrone d’hier soir, du seul côté cependant des femmes.
Goliarda est une artiste intello de haute volée, fille de grands militants du socialisme historique et elle-même célèbre à un moment donné sur les planches italiennes (elle fut en outre l’assistante de Luchino Visconti), qui s’est fait volontairement foutre en taule en chapardant les bijoux d’une amie friquée, et ce livre magnifique raconte comment, de la dépression où elle s’enfonçait, elle s’est sauvée en se mêlant aux femmes « perdues » de Rebibbia, voleuses ou junkies, meurtrières ou « politiques » liées au terrorisme de la fin des années 70 – telle étant l’université de Rebibbia, prison romaine pour femmes où Goliarda en apprend un bout de plus sur la vie.
°°°
La lecture et la prison sont de meilleurs refuges, quand il pleut, que les cimetières, mais le nom de MORCOTE m’est alors revenu je ne sais pourquoi, lié à quel souvenir d’enfance, et j’allais y aller ,mais j’ai noté encore cette phrase de Goliarda qui évoque un bonheur d’amitié lui venant en prison: « Le moment le plus beau – qui n’en a fait l’expérience ? c’est quand votre soeur vous passe autour des bras un écheveau de laine souple. On est assise sur le lit et elle commence à enrouler ce fil infini: petit cocon, au début, qui tout doucement, suivant la voix qui raconte, grandit jusqu’à devenir gros et rond comme un soleil »…
°°°
Et cela s’est fait comme ça: le temps de mon pèlerinage à Morcote, alors que je m’attardais dans le petit cimetière lacustre à terrasses superposées jouxtant l’église de Sant’Antonio Abate accrochée à la pente: le soleil a fendu la grisaille pour se poser sur cette femme de bronze noir, comme enclose dans son silence compact et doux à la fois, parfaite de forme et comme hors du temps, signée Henry Moore et veillant sur le repos durable de je ne sais quel riche notable du nom de Carlo Bombieri.
Goliarda Sapienza n’a pas eu droit à si prestigieux hommage, mais la pente de Morcote m’a rappelé celle de Positano cher à son souvenir, et la stèle funéraire élevée à Gaeta, où elle repose, porte cette inscription non moins pure et parfaite: À la mémoire d’une voix libre…
°°°
L’occidental tourisme avide de clichés moites n’en finit pas d’entretenir les images édulcorées d’un Sud de plaisance alors que le vrai Sud est âpre et noir ardent comme la pierre volcanique de Stromboli, dur comme une tête de mule sarde et aussi impavide que la tarentule ou son exorcisme dansé qu’est la tarentelle.
Or on retrouve les reliefs de cette âpreté dans les hautes vallées des Alpes méridionales, du Piémont au Frioul et bien au-delà, et le val Verzasca, plus encore que le val Maggia, en conserve encore quelques traces dans ses hameaux latéraux aux rustici non encore acclimatés, alors que le tout petit et non moins exemplaire musée ethnographique de Sognono, tout au fond du val s’évasant à l’ensoleillement, veille sur la mémoire des lieux sous la garde avisée de Jana la Tchèque…
C’est elle, Jana la Tchèque, quadra mariée en ces lieux depuis une vingtaine d’années et qui connaît, d’expérience, le caractère farouche des habitants du lieu, qui m’a fait visiter les petites salles de la vieille maison de pierre et de bois à trois étages, conservée en l’état de ses diverses pièces (cuisine commune pour deux familles, chambres à coucher mais aussi classe d’école), elle aussi qui, la première, m’a révélé l’existence des spazzacamini, enfants de la misère commis en petits groupes émigrants au ramonage des cheminées – la taille des plus petits favorisant évidemment le nettoyage des conduits les plus étroits – dont témoigne aujourd’hui une exposition en ces murs et toute une littérature.
°°°
D’aucuns ne voient de la Suisse que sa façade rutilante et satisfaite, et pas mal de nos compatriotes s’en frottent la panse en invoquant leur seul mérite. Or je n’aurai pas l’hypocrisie de leur cracher dessus, bénéficiant comme tous de notre prospérité récente, mais le souvenir des petits spazzacamini, figures à la Dickens dont on n’a longtemps parlé qu’avec honte tant ils symbolisaient la misère de ces régions, me rappelle que mes grands-pères maternel et paternel, contraints eux aussi à l’émigration, se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie, comme, me raconte Jana la Tchèque, de nombreux émigrés tessinois ont fait souche en Californie ou ailleurs. Nul folklore avantageux, au demeurant, dans ces remémorations, mais tels furent les faits, qui nuancent l’image d’une Suisse née coiffée…
Saison basse en France profonde
On se dit d’abord que tout ça n’a pas de sens. Au réveil, dans la froide lucidité d’avant l’aube, on s’est dit que ça ne rimait à rien de repartir. Et pourquoi faire ? Le froid et la pluie ne sont-ils pas partout pareils, les routes dangereuses, les autoroutes toutes semblables avec leurs aires de rien? Mais à quoi bon ? N’est-on pas ici mieux que partout, entre le feu et les oiseaux, le ciel sur le lac et la première neige sur les monts d’en face ?
Voilà ce qu’on s’est dit pour commencer, après quoi le jour s’est levé sur les valises toutes bien faites par la Bonne Amie, tout le barda bien arrimé et la roulante du chien Scoop, les sabretaches aux cartes appelant le territoire, et c’était parti – la vie nous reprenait au corps et toutes ses curiosités d’autres lieux et d’autres gens – c’était le moment, quoi, de se bouger !
On n’a pas eu à le regretter. De Dieu quand même que le monde est beau, s’est-on dit ensuite, passé le premier virage de la route dévalant des monts d’où le dernier des crétins arrivant en face à toute blinde nous aura ratés de peu, mais de là-haut déjà se déployait la haute lice flamboyante des vignobles de Lavaux tissée d’or et de pourpre, que nous avons traversée d’une traite de route en autoroute jusqu’au Jura et au-delà tandis que je lisais, pour nous deux, l’étrange histoire de Louisa, dans la nouvelle Emportés d’Alice Munro, première des Open secrets mal traduits par Secrets de polichinelle, où il est question des errances et aberrances de l’amour…
Entretemps les noms magiques s’étaient succédé le long des autoroutes puis des routes de Bourgogne, et voici que celui de Paray-le-Monial imposait une étape sous les grandes arches romanes fameuses jusqu’à Rome en suite de diverses apparitions ménagées à Sainte Marie Alacoque par Notre Seigneur lui confiant des messages persos à l’insu de son entourage; puis une autre apparition nous attendait un peu plus loin et plus haut, par delà le flamboiement d’or et de pourpre des vignobles de Pouilly & Fuissé, le long d’une route montueuse débouchant sur les collines du Morvan soudain irradiées par le soleil couchant.
De Dieu la rivière au premier plan de boue chocolatée, l’irrépressible montée des verts moirés de noir des pacages couturés de haies et semés de petits boeufs blancs du Charolais – de Dieu la beauté de tout ça !
Or le jour déclinait, comme la saison, et de fait la saison était au point mort à Saint-Honoré-les-Bains, coeur du Morvan aux belles demeures genre châteaux bourgeois soupirant derrière leurs volets clos ou leurs rideaux à lourdes paupières; et même point de rideaux, point de vitres non plus, rien que du vide cramé sur les hautes parois décaties de l’immense Hôtel du Parc, vaisseau de la Belle Epoque à l’abandon – mais juste en face se trouvait ce havre de bonne vie à l’enseigne de La Noiselée où nous attendaient une chambre claire et l’hôtelier disert, ancien maton de prison recyclé Maître gourmand. Alors lui, toute la soirée, de nous raconter les lieux et les gens de l’antique station des thermes romains recyclée de génération en génération par les clans locaux se mordant le museau, toute une France de province ressemblant si fort à tous le cantons de notre vieille Europe, et de nous régaler d’escargots bourguignons et de nous arroser de vins des coteaux circonvoisins…
On sourit en se rappelant la notion quelque peu solennelle de pays réel forgée au début du siècle passé (le XXe siècle, n’est-ce pas…) par certains nationalistes français, comme si la réalité des choses et des gens devait être requalifiée par les mots de l’idéologie.
Or, traverser la France des gens et des choses dans une voiture japonaise, alors que les Chinois débarquent un peu partout et que les Américains se posent en juges universels sur des bases d’argent, de pouvoir militaire et de morale à la petite semaine, est une bonne façon de revenir au réel du pays de France à nul autre pareil.
Toute une soirée durant, avant-hier à Saint Honoré-les-Bains, nous trouvant seuls clients de l’épatant hôtel de La Noiselée, entre saison de cure et saison de chasse, l’hôtelier chaleureux nous a entretenus, en bon Français, des sempiternels défauts des Français, de sa géniale chatte Fripouille aux mimiques de star de cinéma et qui lui fut dérobée un jour par on ne saura jamais qui, des grandes familles du lieu à la fois divisées entre elles et soudées par leur commune résistance à toute ingérence étrangère (leur refus d’intégrer un certain François Mitterrand à certaine époque), de la chasse au sanglier ou de la tradition d’accueil des nourrices du Morvan qui explique que tant de Parisiens haut placés restent attachés à ces terres…
Notre hôte, débarquant de Dijon, n’a pas eu moins de peine à se faire admettre des bourgeois de Saint Honoré que n’importe quel étranger en rencontrerait s’il s’avisait d’affronter les vieilles tribus hôtelières de Zermatt, mais son accueil à lui fait la différence, et sa cuisine aussi, son intelligence de la relation humaine – tout cela qui ne saurait se formater par les temps qui courent.
Le nom de Nevers chante à la mémoire, on se rappelle le nom d’Elle, dans Hiroshima mon amour ou La duchesse aux yeux verts de Dumas, et l’on est d’autant plus étonné de constater, en compulsant le Guide bleu, que nulle allusion, pas la moindre n’est faite au bombardement des Alliés, en juillet 1944, visant les dépôts ferroviaires de la ville et qui détruisit en bonne partie la cathédrale Saint Cyr-Sainte Juliette, qui reste aujourd’hui encore en chantier malgré la reconstruction et l’ajout de vitraux contemporains remplaçant les anciens, soufflés, entre autres « dommages collatéraux ». Bref, ledit Guide bleu, parfois utile en ceci ou en cela, montre décidément ses limites, ici au bord du déni de mémoire…
De la pierre de Bourgogne au tuffeau d’Anjou dans lequel, le long de la Loire, avant et après Montsoreau se découvrent de ravissants villages à parties troglodytes, l’on effeuille les couleurs du pays réel comme sur un nuancier délicat et changeant, qui se prolonge sur les toits et par la forme des maisons, entre bocage bourguignon, forêts domaniales immenses aux demeures secrètes (on pense au Grand Meaulnes en traversant la Sololgne) et flamboiements dorés des vignes de Seuilly, où révérence s’imposait à La Devinière de l’insupérable Alcofribas Nasier, dit Rabelais. Telle est la France, un peu cafardeuse le soir dans les petits bourgs, à croire que la culture des cafés s’est perdue, et qu’on retrouve bien vivante et gouleyante à l’étape, au bord du Louet, devant telle table gargantueuse à souhait…
C’est une expérience étrange, et parfois révélatrice, que de voyager en saison dite basse. On est alors comme dans un théâtre désert. Ou comme en coulisses. Mais avec un regard neuf sur le décor et les quelques gens qui restent là…
Ce matin, ainsi, nous restions seuls dans le château de Pélavé, à Noirmoutier, dont nous étions les derniers clients avant sa fermeture. Confiant comme pas deux, sur la seule foi de nos accointances découvertes depuis la veille à peine (une commune expérience de l’enseignement, découverte par ma bonne amie, et notre passion partagée pour la littérature et le non-conformisme), le fringant maître des lieux, Gérard Beaupère, nous avait laissés seuls en son majestueux logis, étant occupé dans la journée et nous priant juste de fermer l’hôtel à sa place…
Une fielleuse appréciation découverte sur Tripadvisor, réceptacle internautique des avis portés sur les auberges du monde entier, a beau décrier le château de Pélavé et son hôtelier hors norme: nous avons rencontré, sous son premier abord un rien bourru, la moustache en bataille et le verbe très libre, un honnête homme chaleureux régnant sur une maison remarquable, au milieu d’un grand parc, sous des arbres immenses et d’un confort parfait malgré l’absence de tout élévateur mécanique – rédhibitoire pour d’aucuns.
Mais tout de même: un hôtelier qui vous laisse fermer sa maison sans vous connaître depuis plus de deux jours, après vous avoir dit son impatience de se mettre enfin à écrire, non comme tout le monde mais au moins aussi bien que Chateaubriand, Voltaire ou Victor Hugo: vous ne le trouverez pas en option de n’importe quel voyage organisé…
Et puis c’est par Gérard Beaupère, aussi, que nous est venue l’idée de faire escale, après Noirmoutier, dans le marais poitevin où nous sommes arrivés en fin d’après-midi après deux heures d’autoroute meublées par la lecture d’une extravagante nouvelle d’Alice Munro, La vierge albanaise, et ensuite par le constat décidément consterné, amorcé depuis le début de notre traversée des arrière-pays de France, du fait que le bistrot de village, le troquet de bourg, le café de bourgade s’y fait de plus en plus rare.
De Coulon où nous avons d’abord débarqué, y ayant réservé une chambre en bord de rivière, à Niort la ville la plus proche: rien qui ressemble à ce qu’on puisse dire un café, pas un troquet, pas un bistrot ! Et tant de volets fermés sur la rue. Mais par Gargantua qu’arrive-t-il donc aux Français ? nous sommes-nous demandés, jusqu’à repérer, enfin, ce bar-tabac à journaux enfin accueillant où nous avons pu nous désaltérer en prenant connaissance des nouvelles de la région et de ce titre d’abord en tête d’une page de La Nouvelle République: Un cheval tombe dans une piscine…
Il y a quelque mélancolie, ces jours, autant que dans les rues quasi désertes du bourg charmant de Coulon: le long des berges dont les barques alignées pour le parcours des petits canaux du marais poitevin attendent le retour des beaux jours et les foules processionnaires de visiteurs impatients de se laisser glisser dans les multiples bras de ce labyrinthe de verdure.
En passant, nous n’avons pas moins été sensibles à la beauté du lieu, au silence le long de la rivière, aux reflets limpides des arbres dans les barques reposant parfois sous l’eau, à l’empressement enfin du jeune patron de La Pigouille, tout à côté, à nous servir de l’anguille grillée arrosée d’un bon vin de pays au ton de rubis…
C’était un samedi soir, mon Admirable Compagne (formule lénifiante des gendelettres dont je n’use qu’avec ironie) nous avait réservé par la Toile une chambre à l’hôtel Le Bosquet aux Ponts de Cé, tout près d’Angers, où nous nous pointâmes à cinq heures du soir pour tomber sur une porte close. Point de lumière ni trace de la moindre présence. Mauvais signe. Mais une pancarte annonçait: « La réception s’ouvre à 18h ». Et au téléphone une voix se voulant rassurante: « Pierre arrive ! Nous finissons les courses… »
Un hôtel, bien noté pour sa table, qui « fait ses courses » un samedi soir à 17heures, voilà qui eût pu nous inquiéter, voire nous impatienter après une journée plus que remplie de belles découvertes, du marché matinal de Blois à la descente de la Loire via Chenonceaux et La Devinière de Rabelais, les coteaux d’Anjou, Montsoreau et les tapeurs de pommes des caves creusées dans le tuf du même beau blanc crémeux que les petits bourgs se succédant – nous aurions pu faire aussi grise mine qu’aux quelques ondées du jour, mais non: Pierre arrivait bel et bien sur sa pétarelle, suivi bientôt d’autres jeunes gens affables au possible, puis du chef Régis LeGain, et deux heures plus tard tout un monde de dîneurs débonnaires se régalaient de concert – et ce soir tel vin d’Anjou nous parut le plus pur nectar…
À vrai dire nous sommes assez peu « gastro », ma bonne amie et moi: guère portés sur les cumuls de toques ou d’étoiles, mais les bonnes choses de la table nous semblent participer de l’âme d’un pays autant que ses belles personnes ou que toute forme d’art ou d’artisanat exprimant son fonds de Qualité comme un savoir-être par savoir-faire.
Et quelle plus belle et bonne manifestation, alors, de cette Qualité, que la Tapisserie de l’Apocalypse de Jean de Bruges et de cent mains tisserandes anonymes, exposée au formidable Château d’Angers, et déployant son extraordinaire bande dessinée où tous les effrois et les douleurs d’un siècle de guerre et de peste, de famine et de massacres, se mêlent aux appels à l’espérance et au recours à la grâce ?
L’accueil d’un hôtelier à La Noiselée, l’art d’un jeune chef décidé à redorer le blason d’un établissement sur le déclin, la lumière éperdue d’un sourire de reconnaissance sur le visage d’un mendiant le dimanche matin, et cette tenture arrachée à l’oubli des siècles et nous montrant le pire et le meilleur de l’homme – voici ce que nous cherchons, en somme, qui participe peu ou prou de la Qualité.
Or nous nous sommes retrouvés, ce soir, dans un décor à la Simenon, le long d’une digue de Noirmoutier, entre pacages à fleur d’eau et hauts fonds découverts par la marée basse où s’alignaient bateaux vivants et morts.
Dans la lumière orange voilée de bruine, le clocher de Saint Philbert m’a évoqué un instant celui de Combray, quelque part dans notre mémoire à tous; enfin sur le fond gris de l’eau et du ciel, juste là, le temps d’une immobile station, rien qu’un instant: ce trait d’encre plus foncé, ce pur hiéroglyphe d’un héron cendré.
Au fil des jours, en voyage, il nous arrive de passer par des moments de flottement, et c’est ainsi qu’hier, sans se l’expliquer, ma bonne amie s’est sentie comme désemparée, un peu perdue, sans repères, se demandant en somme ce que nous faisions là, plutôt qu’ailleurs, me le disant et sans me surprendre du tout vu que je me le demande à tout coup, moi aussi, et pas seulement en voyage: ce que je fiche là – à vrai dire je me le demande tous les matins sans en parler à quiconque, et puis la vie reprend son cours…
Et de fait il suffit d’en parler: le seul mouvement de recul consistant à se voir comme de l’extérieur, ou de partager son doute avec son compagnon de vie ou de voyage, et c’est reparti: tout se remet en place. Pas plus tard que cet après-midi, sur l’autoroute de Saintes à Bordeaux, j’ai d’ailleurs retrouvé la mention de cette double expérience, du doute et de son dépassement, au tout début de L’Usage du monde dont je nous faisais la lecture à haute voix, lorsque Nicolas Bouvier, rejoignant Thierry Vernet à Belgrade, en juillet 1954, pour se lancer dans le grand périple qu’ils sont censés vivre deux ans durant – l’écrivain voit son ami peintre hésiter, paniquant devant l’énormité du projet, prêt un instant à tout plaquer, et puis non: risquons le coup…
Notre projet à nous ne comporte aucun risque à vrai dire: nous avons choisi, simplement, de partir quelque temps à travers la France, l’Espagne et le Portugal, sans autre intention que de parcourir et découvrir des lieux encore inconnus, au gré de nos envies ou de nos intuitions. Or après cinq jours à peine il nous semble, déjà, avoir tiré le meilleur profit de ce début de périple, et les mots de Nicolas Bouvier sont là pour nous conforter aussi bien: « Un voyage se passe de motifs. Il ne tarde pas à prouver qu’il se suffit à lui-même. On croit qu’on va faire un voyage, mais bientôt c’est le voyage qui vous fait, ou vous défait ».
Cet exemplaire de L’usage du monde que j’ai emmené, avec une vingtaine d’autres livres, nous a été dédicacés par Nicolas Bouvier en 1985, l’année de la naissance de notre deuxième fille. Notre ami Thierry est mort huit ans plus tard, en 1993, et Nicolas a quitté ce monde en 1998. Or l’un et l’autre nous restent étrangement proches, de par leur présence au monde, précisément, et des voyages dans le voyage que nous refaisons régulièrement avec eux, comme aujourd’hui les retrouvant en Bosnie, puis à Belgrade, alors que nous traversions les vignobles du Bordelais…
Le rite consistant, pour ma bonne amie et moi, à lire des tas de textes ou de livres entiers tandis que nous roulons – elle conduit et je lis à haute voix-, nous aura valu maintes fois de voyager dans le voyage, si l’on peut dire, de façon incessamment roborative…
Sur une seule journée, ainsi, se seront superposés aujourd’hui les « textes » les plus divers: de notre conversation matinale avec Rodolphe Perrin, jeune hôtelier de Coulon qui a vécu sept ans en Suisse romande avec sa compagne et parle avec intelligence et ferveur de son métier; des jérémiades d’Alain Finkielkraut relayées sur une pleine page du Monde, où l’on voit une intelligence non incarnée nourrir une vision du monde racornie; du récit poétique de Claire Krähenbühl évoquant si finement le personnage d’une poétesse au prénom de Louise; de cette page de L’Usage du monde à laquelle je faisais allusion ou, ce soir, de la conversation du patron polonais de notre hôtel de Cap Ferret, du genre aventurier plutôt fortiche nous désignant les survivances de l’Authentique à découvrir dans le pays…
Enfin nous nous sommes trouvés, ce soir, devant l’Océan roulant son magma par delà les dunes de sable très doux, et là que dire grands dieux – comment douter de quoi que ce soit devant CELA ?
« Si vous cherchez de l’Authentique, ne manquez pas de passer à L’Herbe », nous avait lancé le Polonais de l’hôtel du Port, à Cap-Ferret, et son compère de zinc avait renchéri: « À main droite, vous aurez la Villa algérienne, et de l’autre côté vous trouverez les cabanes. Là c’est du vrai… »
Et de fait, le lendemain matin, nous nous sommes pointés à L’Herbe, pour découvrir d’abord la chapelle mauresque d’un ancien domaine de fameuse mémoire locale, et, sur une mince bande de rivage surmonté par des résidences plus rutilantes les unes que les autres, tout un labyrinthe de petites maisons de bois multicolores en front de mer, jouxtant une zone de travail où s’activaient de jeunes ostréiculteurs des deux sexes. Et là, entre les cabanons plus ou moins habités, je suis tombé sur un vieux pêcheur à figure boucanée – un « vrai de vrai » à ce qu’il m’a semblé sans que j’aie à lui demander son brevet d’authenticité -, qui m’a dit sa satisfaction d’échapper quelque temps à la folie estivale et celle, surtout. de voir se manifester la relève du métier…
Quant à l’Authentique évoqué par le Polonais, comment ne pas voir, en de tels lieux littéralement colonisés par l’industrie touristique, qu’il tient, sinon du folklore genre réserve d’Indiens, d’une réalité bien précaire, qu’on se réjouit évidemment de voir survivre mais qu’on respectera d’autant mieux qu’on n’en fera pas un objet de culte…
Je sais de quoi je parle, assis que je suis sur une espèce d’étroit tabouret de bois, à la fois brut et reverni comme une antiquité rurale, qui a dû servir en quelque ferme avant d’être recyclé dans le mobilier du Domaine de Bassilour où nous sommes descendus hier soir, accueillis par un affable jeune Suédois.
Ma bonne amie cherchait un hôtel acceptant les chiens, pas trop cher et ouvert en cette saison. Faute de mieux, on a passé sur le « pas trop cher » pour deux nuits à un tarif tout de même modeste selon les critères helvètes: niveau trois étoiles, 120 euros la nuit + petit dèje. Ma bonne amie y ayant trouvé le confort qu’elle désirait pour se reposer de 1500 bornes de conduite, depuis une semaine, et la vieille ferme basque, absolument au-then-tique, ne manquant pas de charme, je n’allais pas faire le protestant gâte-sauce malgré le peu de goût que j’ai pour le luxe rustique. Mais quel objet d’observation pourtant ! Pour un peu, j’ajouterai un chapitre à La Carte et le territoire de Michel Houellebecq, rubrique La Ferme garantie H.Q.E. (Haute Qualité Environnementale), avec installation géothermique, isolation de toiture au chanvre, poubelle en osier dans les chambres pour tri des déchets recyclables, système automatique d’arrêt de l’électricité quand vous sortez, gel de douche biodégradable et parking non goudronné. Le dalaï-lama est invoqué au début de la présentation du Domaine de Bassilour marqué au sceau de l’éco-label européen. On imagine, en prenant son petit dèje à 11 euros, ce que fut cette grande ferme basque jouxtant un vrai château comme il y en a un peu partout en France. Un extraordinaire objet, suspendu au mur de la salle commune aux immenses piliers de pierre, pourrait trouver sa place dans un musée d’art contemporain: superbe ensemble de planches ondulées aux mille pierres serties, évoquant des lames. Le jeune Suédois y voit un outil de traitement des peaux de moutons. Possible. Où est l’authentique explication ? Dans notre chambre admirablement rustique aux poutres apparentes et baignoire à sabots garantis vieille France que les au-then-tiques paysans de Bidarte n’ont pas dû connaître, le chien Snoopy, sous son baldaquin éco-label, médite…
°°°
Nous avons pensé d’abord, à l’arrêt dans les Landes, que c’étaient des outardes. Des oies sauvages. Les yeux au ciel, les entendant cacarder de loin (les oies cacardent, affirme le dictionnaire), puis déployant leurs formations géométriques en V ou en Y à systèmes variables, nous avons pensé à des bernaches. Bernique: c’étaient, dixit Wikipédia, probablement des grues cendrées. Mais pour l’Authentique, on prendra langue avec des connaisseurs…
Ce qu’attendant nous sommes remontés dans l’arrière-pays sur le conseil d’un ami voyageur et féru d’îles lointaines, Basque de souche et qui voulait que nous connussions (déclinaison verbale du verbe connaître sans équivalent en basque hivernal) les hauts de la Soule, la vallée du Saison, le village d’Aussurucq, la prodigieuse forêt des Arbailles, le dolmen caché, les chevaux sauvages et l’aigle circonspect, enfin la sublime architecture sans architectes de Saint Jean-Pied-de-Port !
°°°
Tout cela nous a émerveillés. Bordel que la France est belle! Et ils se plaignen. Avant-hier encore au zinc du bar jouxtant le Super-U d’Arès, le tenancier quadra Léon de Laval nous disait sa honte d’être Français: que les Français sont des feignants, que l’attentisme est la formule de la France actuelle, que les forces vives de la nation sont taxées et pressurées. Et comme on les comprend tous tant qu’ils sont ! Mais aussi: ruades! Français, soyez plus fiers ! Assez de jérémiades ! À tant vous croire supérieurs aux autres vous avez oublié que vous n’êtes qu’une partie du monde. Demain, d’ailleurs, nous serons en Espagne…
Une maison aux Asturies
On ne fait pas assez attention, en passant, à ce que disent les maisons des pays. J’y pense ce matin dans la belle demeure de la Dona Hermana Grande de La Fuente et de son hidalgo Don Ramon, aux Asturies, qu’on pourrait dire l’oeuvre d’un couple et la réalisation d’un rêve. En traversant le pays basque, déjà, cette observation m’est venue à l’esprit: que nous ne voyons pas assez les maisons.
Or les maisons du pays basque, le rouge ardent et le blanc pur des maisons basques, les colombages et les toits des maisons basques affirment une sorte d’assurance grave et de fierté qu’on retrouve des fermes aux demeures patriciennes. Venant de Suisse, où les maisons montrent des visages si contrastés selon les cantons , et après avoir traversé la France, où la pierre et le bois, les toits et les fenêtres, la gamme des gris et des blancs, du Morvan en Anjou, se distribuent de tout autre façon encore d’est en ouest et du nord au sud, ce qu’il y a de nordique et d’un peu farouche, dans ces hautes terres du sud-ouest à pierriers et palmiers, m’a paru se traduire par cette espèce d’orgueil assumé des maisons basques.
°°°
Aux Asturies, c’est encore une autre histoire que racontent les maisons, des granges aux palais, ou plus exactement: des tas d’histoires où les migrations d’un peuple pauvre relèvent de l’épopée personnelle et collective, des allers aux Amériques aux retours plus ou moins fortunés.
Dans le silence d’avant l’aube, ce matin à La Casona, l’envie d’entendre ces histoires m’est soudain venue: autant celle de La Casona, qui fut antérieurement la maison de la tribu Noriega, transformée ensuite et pourvue de tous les conforts imaginables, dans le meilleur goût, que les histoires des maisons serrées dans ce repli des contreforts des Pics d’Europe, entre pacages et falaises, sentiers côtiers et déferlantes océanes.
La culture terrienne, l’architecture sans architecte et les arts populaires ont encore beaucoup de choses à nous raconter, autant que les maisons et ce que déclinent les moindres objets de leur agencement : voilà ce que je me disais en apprenant par coeur, ce matin, une nouvelle phrase de tout débutant, en langue espagnole, prié de manipuler le levier de la chasse d’eau avec ménagement: Por favor apretar suavemente la palanca…
À vrai dire je me sens tout humble devant ce suavemente, tout impressionné, bien inculte en ces matières qui sont, pourtant, le matériau même de la culture et de la civilisation, plus que tant de clabaudages d’idées et de distinguos abstraits. Ainsi donc vais-je m’efforcer, désormais, de prêter plus d’attention à ce que racontent les maisons…
°°°
L’esprit de clan m’a toujours rebuté, mais la chaleur de la famille est autre chose, et j’aime assez le terme de tribu pour désigner ce qu’est aujourd’hui la famille qui se décompose et se recompose de façon apparemment désordonnée, non sans obéir peut-être à un autre ordre sous-jaçent, parfois meilleur qu’il n’était. Rien n’est à exclure. Le « familles je vous hais! » d’André Gide est typiquement une formule bourgeoise, aujourd’hui dépassée. On n’en est plus là. La tribu familiale est sûrement à réinventer.
Hier ainsi nous est arrivé un SMS-fleuve de mon neveu Nick, fils de notre frère aîné défunt, éducateur quadra au Service de Protection de la Jeunesse, affirmant que notre périple le rend fou jaloux et qu’il nous en félicite en même temps. Il se demande alors s’il lui faut assassiner son beau-père pour acquérir plus tôt sa liberté, puis se rappelle ses deux chenapans à charge, pour quelques années encore. Or j’aime son impatience envieuse. C’est elle qui les portera, lui et sa moitié bonne, à partir à l’aventure qu’ils imagineront demain à leur façon, par exemple sur les canaux de France qui les font rêver.
Vu de la Casona de Andrin, qu’on pourrait dire l’extension espagnole de notre tribu familiale à l’enseigne de laquelle le coureur de marathon new yorkais voisine avec le disciple de chamane bolivien, l’entrelacs de nos relations plus ou moins étroites est à la fois significatif et intéressant, reflet du mode actuel. Une certaine chaleur pondère les liens nouveaux, peu compatibles avec les anciennes normes. Nous nous en félicitons, ma bonne amie et moi. Les maisons, les enfants, les souvenirs communs, les projets en cours fondent de nouvelles relations possibles. Le dernier deal est celui-ci: que ma nièce Federica perde quelque kilos, à condition que don Ramon condescende enfin à écrire ses mémoires, qui seront celles des migrants asturiens passés par la Suisse et l’Amérique.
°°°
Les murs de la Casona de Andrin, qui ont des oreilles et une bouche, me racontent ce matin l’histoire qu’ils ont entendue hier soir. Je profite d’en écrire un peu, faute de pouvoir sortir vu l’humeur de massacre, ces jours, du Nuberu. Les Asturiens, qui ont un peu de mémoire celte, n’en veulent pas autrement au Nuberu, maître des nuées, pour le temps qu’il leur fait ces jours, telle étant la saison guère plus propice aux Xanes, enjôleuses fées de bords de rivières (les Asturiens sont étymologiquement gens de rivières), et le Trasgu, équivalent mythologique de nos servants, ne peut rien non plus contre la fatalité pluvieuse. Demandez-lui d’ailleurs de la conjurer: vous ne l’aurez plus dans vos meubles, car le Trasgu va se cacher dès lors qu’on lui demande l’impossible.
Resterait la technologie de pointe. J’en ai parlé aux proprios de la Casona de Andrin, dont chaque chambre est pourvue d’une douche réglable par système électronique haut de gamme distribuant la pluie fine, le crachin, l’arrosage latéral style buse ou le jet tournoyant. Reste à inventer le réglage des célestes pompes…
Don Ramon de La Fuente n’a pas cette prétention. En homme d’expérience, il se sera contenté, sa vie durant, de travailler, beaucoup, et de diriger, dans les pays où il a migré avec sa moitié, des chantiers de plus en plus importants. Issu de terre et de tribu pauvres, il était ouvrier spécialisé quand il a débarqué, avant sa trentaine, dans cette Suisse des années 60 qu’on appelait alors de la surchauffe. Marié dix ans plus tard, et bientôt père de deux secundos, il acquit assez de savoir pour endosser de croissantes responsabilités, notamment sur les autoroutes en construction, au titre équivalent d’ingénieur diplômé sur le tas. Vingt ans plus tard on le retrouvait au Venezuela avec les siens, propulsé à la hauteur des tours futuristes dont il dirigeait les travaux. Puis ce fut avec les Catalans de la Costa Brava qu’il tâcha de s’entendre, lui l’Asturien pur et dur engagé dans les nouvelles constructions de Palafrugell, avant de regagner la terre mère et de s’y établir, entre océan et pics farouches, pour fonder cette Casona de Andrin aux parfaits agencements de maison d’hôtes et dont l’âme irradie dans la pleine complicité de dona de la Fuente muy ejemplar y imprescendible – mi hermana grande…
°°°
Dans le genre Bed and Breakfast, la Casona de Andrin accueille chaque année des gens de toute sorte, dont les voix murmurent encore de chambre en chambre. Les chambres de la vie communiquent à tout moment, pour la énième fois j’écoute Paco Ibanez moduler sa Triste historia, à l’instant même où j’entrouvre ce livre d’un certain J.L. Rodriguez Garcia, dédicacé à ceux de la Casona comme esta historia triste, intitulé Al final de la noche et dont je ne comprends que deux mots sur trois de la présentation, notant qu’à la fin de cette nuit romanesque, « en la soledad y en la extension amenazadora de la noche, acaso pueda aun brillar una luz, que anuncie el comienzo de un dia hermoso »…
Or la hermana grande nous racontait, hier, le dernier séjour de l’écrivain à La Casona, l’été passé, accompagné de son épouse et de son jeune fils de seize ans commençant de ruer dans les brancards. Pas très original même pour un prof de philo, mais ainsi va la vie qui bifurque et se complique, ou devient plus sereine et limpide au contraire, de chambre en chambre et le temps passant…
°°°
Ou ce serait l’histoire de Doree, devenue femme de chambre après l’affreux événement survenu dans sa vie, et qui va revoir, dans son asile psychiatrique, ce « terrible accident de la nature » que représente à ses yeux celui que les autres tiennent plus précisément pour un fou monstrueux, qui a étranglé leurs trois enfants et prétend les rencontrer, désormais, dans une autre dimension.
Dimensions est le titre de la première nouvelle du dernier recueil traduit d’Alice Munro, Trop de bonheur, que je lisais hier dans un coin de La Casona tandis que mi hermana grande, à qui je venais de l’offrir, le lisait elle aussi dans un autre coin, tout à côté de ma bonne amie qui lisait, elle, la version originale de Dear Life, dernier livre de cette nouvelliste bonnement géniale à mes yeux, révélée par le plus beau Nobel de littérature de ces dernières années. Comparée, à tort je trouve, à Tchékhov, voire à Carver, Alice Munro est à vrai dire incomparable, ayant saisi de la vie ce qu’on pourrait dire l’insaisissable, l’impondérable, l’imprévisible horreur et la non moins effarante merveille – la vertigineuse relativité et la vérité sans fard captée à fleur de sensibilité, au fil de stories réinventant à chaque fois une nouvelle façon de raconter…
°°°
Les gens qui vous enjoignent de « profiter », s’imaginant peut-être que voyager signifie « se les rouler », se mettent décidément le doigt dans l’oeil. D’abord parce que cette hideuse notion de « profit » est exactement ce que nous fuyons. Ensuite du fait que mettre à profit (tant il est vrai qu’il y a profit et profit) une virée prolongée exige un effort de chaque jour qu’on peut dire un vrai travail, gage de vrai plaisir. Le vrai bonheur n’est pas de consommer mais de se laisser consumer par la flamme de la vie, productrice de chaleur et de lumière. Cela suppose un apprentissage approprié à l’évidence que des lieux et des gens où l’on va on ne sait à peu près rien, et le désir d’en savoir un peu plus aboutit au plaisir de la chose nommée, pour ainsi dire vécue, ingérée et digérée comme un bon fruit ou comme le Haricot Bien Gras de Molière…
°°°
Hier par exemple, dimanche de pluie, nous aurons fait quarante bornes, sous la conduite de don Ramon de La Fuente, jusqu’au Molin de Mingo, haut-lieu de la cuisine terrienne des Asturies qu’on atteint par des chemins bordés de précipices, dans la montagne aux loups et aux ours, franchissant enfin le torrent aux saumons et débouchant sur un méplat entouré de farouches monts boisés aux brumes vaguement chinoises; et c’est là, loin de tout, que nous aurons découvert cette auberge à peu près pleine d’Asturiens connaisseurs, pour y goûter d’abord le meilleur fromage du monde, selon les gens du cru (et du cuit), au nom de gamonedo et sous sa forme apprêtée en Crema de queso.
Or pas un instant l’on aura eu l’impression de profiter en savourant cette incomparable merveille évoquant la suavité d’un fruit presque liquide, à consistance un peu melliflue et au goût se cherchant dans l’aigre-doux à tendres résonances, entre le fluide vif du cabri et l’humide du veau de lait.
°°°
Je me rappelle à l’instant que c’est Georges Haldas, dans sa Légende des repas, qui a souligné le lien verbal entre saveur et sapience, qui en appelle à une vraie connaissance, appariée à ce qu’on appelle le goût et à l’éducation qu’il suppose. Or la notion de goût (vocable polysémique) est liée en espagnol à la notion de préférence et même d’amour, qui procèdent également d’un apprentissage, fût-il informel ou même sauvage – disons sur le tas.
C’est ainsi que l’appétit du voyage vous vient en goûtant aux choses et aux mots des pays que vous traversez, constituant la base d’une constant enseignement non pédant. Le goûter se dit, au pays de Cervantes, la merienda, et le banal WELCOME de McDo se traduit, à La Casona de Andrin où nous voici revenus ce soir, par Les deseamos una feliz estancia…
Sanctuaires naturels
Nous aurons donc « fait » las catedralas, comme nous avons « fait » los bufones. Les unes et les autres, également classés monuments naturels nationaux, constituent un must touristique côtier, avec une préférence aux cathédrales de pierre, par rapport aux bouffées d’écume, n’était-ce qu’à considérer les parkings et les aménagements bétonnés et autres marchands de pacotille pour celles-là.
Mais que sont donc las catedralas ? Ce sont des roches trouées et sculptées par l’eau, le sable, le vent et le temps. La main humaine n’y est pour rien. D’aucuns y voient le job de Dieu, mais ça se discute. Ce qui importe est d’ailleurs le résultat, espectacular assurément: à savoir les cavités voûtées, les pilastres semblant posés sur le sable doucement consentant, des esquisses de portiques rappelant un peu Gaudì et des arches ornées tout de même inférieures, artistement parlant, à celles d’un facteur Cheval, ce visionnaire à brouette.
°°°
Au fil de ses pérégrinations sur le Chemin de Compostelle, l’académicien randonneur Jean-Christophe Rufin qualifie de « tragédie contemporaine » le phénomène économique et culturel du tourisme de masse. En ce qui me concerne, j’y vois à la fois une comédie, qui n’a pas encore trouvé ses dignes chantres, à l’exception d’un Houellebecq. Goya s’est fait le contempteur véhément et génial des désastres de la guerre, mais pour le tourisme de masse, c’est peut-être Reiser qui en a été le premier illustrateur. On voit la nuance du tragique au comique…
À l’étape de las catedralas, une ravissante Joselita, visiblement en instance de mariage, folâtrant sous les arches en se prêtant au rite de la photographie, faisait virevolter sa robe virginalement blanche d’organdi ou de satin à traîne de tulle soyeux serpentant dans le sable. Or il est probable que Reiser l’eût épargnée, mais le comique y était…
Si l’encombrement des parcs souterrains de la sainte cité ne nous en dissuade pas, nous irons tout à l’heure « faire » la messe de Saint Jacques, avec moult véritables pèlerins et pèlerines dont nous ne sommes point. Ce qui ne nous empêche pas de rêver, solidairement avec le peuple espagnol et toutes les nations du monde menacés par La Dette et bénéficiant d’une nature inventive, à d’autres monuments naturels à classer.
Qu’on pense aux magnifiques forêts d’eucalyptus ou aux marées successivement montantes et descendantes de la côte: après les bufones et les catedralas, il y a là un potentiel marketing d’avenir. De même la lluva – rien que le mot fait saliver-, la pluie de novembre cantabrienne, asturienne voire galicienne est-elle à classer monument naturel avec ses variantes de subtiles bruines pénétrantes ou de trombes aussi tonitruantes que féroces.
Rien de naturel en revanche dans l’obstination du radiateur gris militaire de notre chambre de la belle maison de pierre sévère et de bois grave de l’hôtel Trabadelo, sur les hauts de Vegadeo, à rester aussi glacial que le regard du Grand Inquisiteur. J’ai noté « militaire » et je me rappelle alors la sentence du pertinent Clémenceau déclarant que le seul terme de « militaire » incite à la défiance, tant il est vrai que la justice militaire n’est pas la justice, ni la musique militaire n’est de la musique, et qu’un radiateur gris militaire a vocation de rester froid…
Compagnons de route
Quittant les Asturies avec un serrement de coeur, tant nous avons été bien reçus à la Casona de Andrin, nous ne nous sommes pas laissés abattre par la pluie harcelante, visant quelques nuances de gris bleuté vers la Galice, et nous encourageant avec le recours oral de bonne lectures alternant les sentences éternelles à la Pierre Dac (« Il vaut mieux qu’il pleuve un jour comme aujourd’hui, plutôt qu’un jour où il fait beau ») et la suite d’Un été avec Montaigne, l’épatant essai d’Antoine Compagnon – plus précisément le récit de la chute de cheval qui lui enseigna d’expérience qu’ « il ne faut pas craindre excessivement de mourir »…
Compagnon honore son nom, qui accompagne bonnement le lecteur dans les Essais en dégageant les multiples aspects de l’honnête homme par excellence, en butte aux guerres de religion et difficultés du gouvernement des hommes. Il en illustre bien la position (entre l’assiette du cavalier s’efforçant de rester droit dans un monde où tout branle, et la balance du relativiste conscient du mouvement constant et de la complexité du réel) et le clarté de son approche, à fines touches concentrées, n’a d’égale que la limpidité de son expression. En lisant ce qu’il écrit à propos des Indiens visitant la France à l’invite du jeune roi Charles IX, qui formulent leurs observations à la manière des futures Lettres persanes, j’ai resongé à notre conversation de la veille, à La Casona, à propos de la conquête espagnole et de ce qu’en a écrit Bartolomeo Las Casas, autre grand esprit porté à la tolérance…
Une autre lecture, à travers les hauts plateaux boisés de Galice, nous a ramenés à la fois à notre vieille amie Janine Massard – femme de coeur dont tous les livres sont lestés par les dures épreuves personnelles qu’elle a subies autant que par les tribulations collectives du siècle -, et aux eaux supposées pures et limpides du Léman, dans Gens du lac où elle évoque les menées de deux pêcheurs père et fils liés à la Résistance française, hommes libres levés avant tous et rencontrant sur le lac ceux d’en face, leurs collègues de Savoie – tout cela aussi sensible qu’intéressant par les détails observés, et l’épisode lié à l’engagement spontané des deux Ami (le père et le fils Gay) dans l’aide aux résistants et autres Juifs menacés par la Gestapo, qui donne du poids à ce nouveau roman de la chère lutteuse . Dans la foulée, on relève le passage en douce de Pierre Mendès-France sur une barque, entre la France occupée et le rivage d’Aubonne…
°°°
Le voyage dans le voyage que constitue à tout coup la lecture tous azimuts (les livres que je lis pendant que ma bonne amie conduit, mais aussi les paysages, des articles de journaux, les listes de mots des menus les noms de lieux et les bribes de guides style tuyaux du Routard) nous vaut parfois de vrais périples parallèles, comme ces jours les nouvelles d’Alice Munro, médium incomparable des destinées humaines.
Entre le Morvan et l’Anjou, l’Aquitaine et les Asturies et jusqu’à la descente, en Galice occidentale, sur Pontevedra et Samieira où nous voici, nous aurons vécu ainsi, sa traversée de tous les parcours existentiels des protagonistes de Secrets de polichinelle – huit nouvelles de plus en plus étonnantes, voire folles, qui donnent à la ville de Carstairs une existence quasi mythique.
Or, comme certains peintres changent notre vision des choses, et comme le voyage aiguise notre regard sur les lieux et les gens, l’on pourrait dire que cet écrivain nous fait voyager dans nos propres vies en les éclairant d’un jour nouveau…
Et voici qu’à l’étape d’A Maquìa, la bonne auberge de Samieira admettant les chiens (!) où nous descendons, prône aussi les livres, exposés à foison sur moult tables et rayons et des meilleurs: Garcia Marquez, Isabel Allende, Eduardo Mendoza, Mario Vargas Llosa, le Livre de l’intranquillité de Pessoa…
Merci à tant de bons compagnons, merci la vie…
Porto
Cela fait un vieux bien que de découvrir une belle grande ville, où l’on se dit tout de suite qu’on pourrait habiter. Je me le suis dit cent fois à Paris où je n’ai habité que de temps en temps, et à Berlin aussi, à Rome, à New York ou à Berlin, à Lisbonne mais pas du tout à Vienne dont les gens et Thomas Bernhard m’ont dépité, non plus qu’à Stockholm mais ce serait à réévaluer quarante ans plus tard, alors qu’à Porto je reviendrai comme nous reviendrons à Lisbonne ou à Madrid rien que pour le Prado ou le Rastro…
Ce qu’il y d’immédiatement splendide à Porto c’est que la ville, contrairement à Tokyo où l’on est toujours dedans et jamais avec assez de recul même au 60e étage d’une tour de Ginza, apparaît aussitôt et sous de multiples points de vue. Le fait qu’elle soit montueuse facilite évidemment les choses, comme à Rome ou à San Francisco, et les hautes rives du Douro, d’où l’on découvre l’ensemble de la ville ancienne, nous réservent des vues d’ensemble incomparables…
Je ne sais plus qui disait: « Dis-moi ce que tu relis et je te dirai qui tu es » ? Ce qui est sûr est qu’on pourrait dire la même choses des villes grandes ou moins grandes (je pense à Sienne et à Séville) dans lesquelles on revient pour les relire, et déjà je sais, même en ne faisant que passer à Porto, que nous y reviendrons comme nous reviendrons à Lisbonne. Nous n’avons passé que quelques heures à Porto mais son ton, la tranquille amabilité de ses gens, le sourire immédiat de ses gens – dont les Espagnols sont plus avares-, la beauté des jeunes gens dans tel bar ou tel café agréablement enfumé, le mélange de baroque un peu sud-américain de ses églises et le côté napolitain parfois de ses façades où sèche le linge, la bigarrure populeuse de ses rues passantes et l’aspect bordéliquement organisé de sa circulation, les ponts immenses et l’empilement enchevêtré des façades au graphisme évoquant un peu Vieira de Silva, en un mot l’habitus de Porto – tout cela nous a donné l’envie de revenir bientôt et de relire Porto…
Splendeur du Portugal
Il y a de l’agrément à se balader hors saison, mais aussi son revers. Hier par exemple, nous débarquons de Porto, à Luso plus précisément, non loin de la vénérable Coimbra, à la Vila Duparchy, au milieu d’un grand parc, style vaste demeure bourgeoise rose érigée en 1898 et tenue par un vieux couple de Portugais délicieusement prévenants, immenses chambres à hauts plafonds et hautes fenêtres donnant sur la piscine et la tour pseudo-médiévale, mobilier cossu et gravures pieuses, tout cela pour 65 euros la nuit à deux pelés mais tout seuls.
Avant Porto déjà, à la Casa Branca quatre étoiles donnant sur la mer, à 50 euros la nuit, nous n’étions que deux ou trois couples de tondus, mais il faut voir aussi le bon côté de la chose, qui facilite la conversation avec les hôteliers et le personnel ravis, au Portugal, de parler notre langue qu’ils ont souvent exercée entre Montreux et Villars, ou Lausanne et Verbier…
°°°
C’est par Internet que nous avons, via Booking, déniché la Vila Duparchy, signalée naguère par Le Routard, mais absente de la dernière édition. Peut-être trop « vieux jeu »pour le guide en question, mais le détour « vale pena », n’était-ce que pour le petit-dèje fastueux à confitures faites maison, le confort rappelant un peu la grande bourgeoisie provinciale des romans d’Antonio Lobo Antunes, et la prodigieuse cage à douche multifonctions, qu’on atteint par trois marches solennelles. Par un jeu de leviers et de manettes d’une sophistication quasi cybernétique, l’on peut ainsi régler diverses sortes d’arrosages et de massages hydrothérapiques de face et de profil autant que du haut en bas, en attendant juste que vienne l’eau chaude. Le maître des lieux précise, non sans onction et en français parfait: « Juste un peu de patience, car c’est une vieille maison »…
L’on a beau se défier des généralités: force est de reconnaître que les Portugais, les hôteliers et les sommeliers portugais, les étudiantes et les étudiants portugais, les bouquetières et les camionneurs portugais, jusqu’aux retraitées et aux fonctionnaires portugais défilant dans la rue en criant « rua » au gouvernement qui les tond au nom de l’austérité, sont plus gentils que les Parisiens ou les Suisses allemands, moins rogues aussi que les Espagnols. Or il n’y a aucune flatterie dans cette gentillesse portugaise. On la sent naturelle: venue de loin. C’est une forme aristocratique de la vieille bonté populaire. Il y a du souvenir des îles et des suavités pimentées du Brésil et de l’Afrique, revenues avec les caravelles, dans cette gentillesse un peu mélancolique que le fado module…
Or, dès que nous sommes entrés dans la grande demeure aux murs vieux rose sous les arbres immenses agités par le vent, il m’a semblé retrouver l’atmosphère de vieille bourgeoisie provinciale à complications familiales, murmures et chuchotements, des romans d’Antonio Lobo Antunes.
Ensuite, l’empressement immédiatement avenant de Madame, l’escalier de bois ciré aux tapis élimés, la vitrine aux saintes figures de porcelaine polychrome, la très grande chambre aux murs blancs ornée du chromo à la petite fille priant à genoux avec son petit chien (Forgive us our Trespasses), les deux lits chastement séparés, la componction de Monsieur m’expliquant avec gravité le fonctionnement de l’extravagante douche multifonctions, tout cela n’en finissait pas de murmurer et de chuchoter comme cela murmure et chuchote dans les romans de Lobo Antunes, avec un cri parfois dans les chuchotements…
°°°
Puis ce fut le deuxième et dernier soir et Madame nous convia, pour un verre de porto, dans le salons aux murs couverts de portraits de famille où Monsieur, à côté du feu de cheminée, suivait à la fois le match en cours (Benfica-Anderlecht) sur son ordi tout en prenant connaissance des dernières infos (divers ministères occupés à Lisbonne) non sans nous saluer aimablement. Et la conversation de rouler. Et Madame de nous révéler, à un moment donné, que Monsieur était l’aîné de sept frères. Alors moi de m’exclamer que c’était le cas, aussi, de l’écrivain Antunes qui m’avait raconté, à Paris, que son père les obligeait à parler français. Et Madame de s’animer soudain et de m’apprendre d’autres troublantes coïncidences. À savoir que, dans son livre intitulé Lettres de la guerre, rassemblant sa correspondance de jeune médecin participant à la guerre en Angola, Antonio Lobo Antunes, portant le même prénom que Monsieur, écrivait à sa première épouse, au même prénom que Madame, pour raconter les mêmes tribulations que Monsieur avaient vécues au Mozambique au même âge…
°°°
Au même siècle où des moines irlandais établissaient les premiers vignobles sur les coteaux de Lavaux surplombant les eaux limpides du Léman, leurs cousins bénédictins ibères installaient un ermitage parmi les pins et les chênes de la forêt primitive des abords de Luso. Dix siècles plus tard, ce furent les carmes déchaussés de Coïmbra qui développèrent, d’intense façon, la plantation d’arbres de multiples sortes qu’on découvre aujourd’hui dans la forêt de Buçaco, où voisinent 400 espèces indigènes et 300 essences exotiques, dont le cèdre du Mexique. Pour mémoire pieuse, il faut rappeler que ces lieux boisés à recoins furent interdits aux femmes en 1622 par une bulle papale de Grégoire XV, sous peine d’excommunication, et qu’un pontife ultérieur, Urbain VIII, menaça de la même mesure tout déprédateur des bois en question. Or la respectueuse tradition arboricole s’est perpétuée puisque, après l’abolition des ordres religieux au Portugal, en 1834, l’Administration royale, puis celle des Eaux et Forêts, ont maintenu et même développé cette prodigieuse forêt, tenue pour l’un des plus anciennes d’Europe.
Dans la foulée, l’on n’aura pas manqué de jeter un oeil, au moins de l’extérieur (l’intérieur est actuellement celui d’un palace ***** inaccessible aux fox-terriers et autres voyageurs bohèmes), à l’extravagant palais de Buçaco, typique de l’architecture fin de siècle (il date de 1897), plus précisément du néo-gothique manuélin cher aux Portugais, qui servit de palais de chasse aux derniers rois et fut converti en 1917 (chacun sa révolution) en hôtel de grand luxe…
Schopenhauer le grincheux affirme quelque part que « la vie n’est pas un panorama », mais nous n’en avons pas moins été émerveillés par la descente, de Coïmbra en Algarve, à travers les forêts de chênes-liège et de pins, les collines pelées rappelant la haute Toscane, les plaines tantôt ocre roux et tantôt gris bleu de l’Alentejo qu’on sait le coeur terrien et le grenier du Portugal. Sur la splendide autoroute à trois pistes à peu près déserte, je me suis rappelé néanmoins que la vie, pour le paysan portugais souvent « oublié » par la manne européenne, n’est certes pas un panorama…
Ce qui ne nous aura pas empêchés, à notre arrivée dans le petit port aux maisons blanches de Carvoeiro, d’apprécier le charme du lieu et le wunderschönes Panorama…
°°°
Nous faisons en somme, à notre façon, une espèce de grand tour dévié, contre toute logique touristique, hors saison et en nous guidant à l’instinct et au désir plus qu’en vertu des conventions.
Aux XVIIIe et XIXe siècles, le Grand Tour fut, à travers l’Europe, de Paris à Athènes via Venise (pour l’initiation érotique) et Rome, le voyage-école des fils de bonne familles supposés compléter leur formation littéraire ou militaire (l’un et l’autre s’accordant alors), esthétique ou commerciale, philosophique ou botanique, entre autres disciplines réputées former l’honnête homme et plus rarement, la jeune fille policée.
Tout cela est un peu révolu même si la notion de « tourisme » vient de là, qui voit aujourd’hui des cohortes de Chinois faire leur parodie de grand tour, de bijouteries suisses en boutiques de mode italiennes ou parisiennes et d’un Monument à l’autre, succédant aux ex-apparatchiks russes et autres émirs arabes. Dans le bled perdu d’Ocedeixe, à la frontière de l’Algarve et de l’Alentejo, la seule boutique ouverte, ce samedi, était un grand bazar chinois. On en trouve, désormais, dans toutes les villes d’Espagne et du Portugal…
Que nous le voulions ou non, le tourisme de masse est devenu le produit mondialisé du Système, et c’est avec « ça » qu’il faut faire. Mais comment y échapper ? Et le peut-on seulement ? Il me semble qu’on le peut, en déjouant les automatismes de la consommation de masse et en bravant les mots d’ordre du conditionnement publicitaire. En restant soi-même, chacun est capable de distinguer ce qui est frelaté de ce qui ne l’est pas, le toc ou le faux de ce qui n’en est pas.
Diaboliser le tourisme est aussi vain que de l’exalter: sachons juste rester éveillés…
°°°
Ce matin nous ferons route vers l’Algarve, où se passe une partie de celui que je préfère des romans d’Antunes, Explication des oiseaux. Hier soir nous n’avons pas parlé, avec Monsieur et Madame, des autres livres du grand écrivain, dont je n’ai pas l’impression, d’ailleurs, qu’ils les aient lus. Les incroyables coïncidences, à en juger par le peu de cas que paraît en faire Monsieur, ne sont probablement, à leurs yeux, qu’une curiosité de l’existence juste bonne à citer dans la conversation, avec un doigt de porto. Passons. La fiction, à la Vila Duparchy, trouve un décor assez idéal pour faire la pige à la réalité, qui n’en finit pas de tisser son roman…
L’amour à Carvoeiro
La diatribe amoureuse n’est pas gravée dans le marbre mais elle n’en reste pas moins indélébile, rédigée au Marker sur le dossier du banc de pierre propice aux épanchements amoureux des fins de soirées d’été, à mi-hauteur de l’escalier tortueux descendant à la prahia do Paraiso (la plage du Paradis), au pied des falaises ocres tombant à pic sur l’eau turquoise. On imagine la scène: vacances, visages dorés, parfums entêtants, musiques montant du port en foule et tournoyant partout, désirs en boucles. Et là-haut, cette première rencontre…
Le texte, à la fois douloureux et cinglant, signale son jeune romantique jurant que l’a trahi l’éternelle tentatrice à dégaine d’ange et coeur de diablesse. Le ton et la manière, le choix des mots, la scansion rageuse des images et des sons désignent le probable étudiant américain ou peut-être anglais, qui croyait rencontrer la créature de ses rêves et s’est fait larguer, à ce qu’il écrit, par une vraie bitch, laquelle lui inspire un final FUCK que Lord Byron, à Capri et dans les mêmes circonstances, eût remplacé par un mot peut-être plus choisi…
Mais il va de soi qu’on peut ne pas le prendre au mot, le Jim ou le Jack (ou le John, ou le Tom ?). Penser que son réquisitoire est d’un petit raseur phraseur. Que la démoniaque Dulcinée en question s’est détournée de lui pour de bonnes raisons ? Qu’elle l’a trouvé trop poseur ? Qui sait? Se la jouant victime véhémente, il prend à témoin l’humanité passante, s’abandonnant au pouvoir des mots: la romance tournant du miel au fiel. Mauvais littérature que tout ça ? Révolte d’un coeur sincère ? Narcisse se saoulant de son propre sanglot ? Qui, jamais, démêlera le secret de ce qui se joua dans ce décor de roman-photo du quartier du Paraìso, sur les hauts de Carvoeiro ?
°°°
Lady L. s’est fait du bien en Algarve, et plus précisément à Carvoeiro la blanche, au Castelo de la dona Eunice et de don Joao Bernardo Trindade, château d’hôtes dont les terrasses couleur vanille donnent sur la mer turquoise. L’art de vivre passe aussi par le vrai confort qui n’est pas tant de luxe que de goût et d’accueil, comme nous l’avons vécu de Noirmoutier, chez le compère Beaupère, à la Vila Duparchy de Luso, en passant par la Casona de Andrin chez la dona Hermana Grande et son hidalgo Ramon de La Fuente.
Chez les Trindade de Carvoeiro, au Castelo, l’accueil à la fois discret et généreux de don Joao Bernardo, et l’harmonieuse décoration conçue par dona Eudice procèdent en somme de la même culture conviviale qui s’est développée ces dernières décennies en marge de l’industrie hôtelière. Or le maisons que j’ai citées étaient toutes tenues par des « amateurs » éclairés, anciens profs ou autres sexas de professions diverses, et tous visaient le respect d’un certain bien-vivre plus que le profit; tous firent en outre bon accueil à notre ami Snoopy, dont les futures mémoires seront empreintes, sans doute, de la même suavidade…
°°°
Comme on le voit en Espagne ou en Tunisie et sur tout le pourtour méditerranéen colonisé par le tourisme de masse ou de luxe, il suffit de faire quelques kilomètres à l’intérieur du pays pour découvrir un aspect moins clinquant, et parfois plus attachant, parfois aussi plus attristant, du pays traversé, et c’est particulièrement vrai en Algarve. Passer ainsi d’Albufeira aux bourgs de l’arrière-pays, comme nous l’avons vérifié nous-mêmes en nous baladant, à quelques kilomètres à l’intérieur des urbanisations somptueuses de Carvoeiro, dans le centre populaire plus ou moins décati de Lagoa – nous rappelant un peu le même centre plus ou moins sinistré de Moknine, en Tunisie pauvre jouxtant les palaces côtiers -, revient à entrevoir une partie du Portugal « oublié » par la prospérité, dont la Crise européenne n’a pas aidé les gens…
°°°
Nous n’aurons fait que passer au Portugal. Dix jours à peine, du nord au sud, à peine un jour à Porto où nous nous sommes immédiatement promis de revenir, quelques jours en Algarve et déjà nous repartons pour l’Andalousie; mais cette traversée nous aura permis, tout au moins, de donner à la carte les visages d’un territoire. Miguel Torga et les monts âpres de son enfance, Antonio Lobo Antunes et le quartier de Benfica ou les demeures patriarcales écrasées de soleil de l’Alentejo, Pessoa aux quatre hétéronymes et ses multiples reflets de Lisbonne: le Portugal des poètes et des écrivains qui nous ont déjà marqués, par le coeur et l’esprit du verbe, auront aussi gagné à s’incarner en autres nuances et détails.
°°°
Mais c’est avec les journaux que nous quittons aujourd’hui le Portugal, et sur une note encourageante en somme. Nous lisons en effet, dans l’édition lusitanienne du Courrier international, ces mots que nous déchiffrons sans dictionnaire et qui ne laissent de nous réjouir avec Lady L. : « Apesar da instatisfaçao, portuguesses resisten ao populismo: em tempos de crise,Portugal dà uma liçao de moderaçao e, a contrario do resto da Europa, nao surgem partidos antieuropeus ou anti-immigraçao »…
Séville scintille
C’est en romancier visionnaire qu’Antonio Lobo Antunes a évoqué le retour des caravelles mythiques en plein vingtième siècle, mais nous pensions plutôt à leur départ en quittant le Portugal pour entrer en Andalousie, là-bas où, entre Palos et Moguer, les navigateurs se sont embarqués « comme un vol de gerfauts », ainsi que nous le récitions en écoliers appliqués sans savoir au monde à quoi pouvaient bien ressembler de tels volatiles.
Or nous remontions par les collines d’Andalousie, de pinèdes en plantations d »oliviers, j’avais commencé de lire Manuel le Gitan de mon socio David Fauquemberg, au rythme verbal illico scandé par le flamenco tel que le vit le protagoniste en son quartier gitan de Santiago, à Jerez de la Frontera ; puis nous avions écouté les chants du Mozambique rappelant à ma bonne amie son séjour, là-bas, au temps de l’indépendance, et voici que le nom de SEVILLE s’annonçait le long de l’Autovia où routiers et capitaines se pressaient de concert…
Ensuite il s’est trouvé, devant le dernier tombeau de Christophe Colomb, dans la cathédrale de Séville, que m’est revenu le souvenir de Simone Boccanegra le pirate de même origine, dont je connais les airs de l’opéra de Verdi par coeur. Notre génération de soixante-huitards n’a cessé de déconsidérer les héros, mais les deux Génois ont de quoi nous faire la pige, l’un au titre de la conquête et l’autre à celui de la liberté acquise et défendue au prix de la clémence…
°°°
L’histoire de l’Espagne est faite de reconquêtes, sur l’empire musulman, et de conquêtes quasi simultanées en d’autres lieux. La nouvelle Afrique est pantelante à ses côtes, d’affreux drames humains se perpétuent des rives d’Italie à celles du Portugal, mais partout aussi, du pays basque en Andalousie, ou de Séville à Cordoue, se rappelle notre histoire européenne à tous qui ne peut se vivre et survivre que dans la connaissance réciproque et le dépassement des prétentions exclusives: dans la reconnaissance attentive des autres cultures…
Certaines villes au monde ont une électricité particulière. Il y a de ça souvent à Paris et à Rome, et sûrement à Rio si j’en crois, mais à Séville cela bourdonne et grésille comme nulle part ailleurs – en tout cas c’est ma sensation et mon sentiment de la première fois, et dès que j’y suis revenu c’était relancé: cela grésille à Séville.
Or à quoi cela tient-il ? Probablement, me semble-t-il, à un mélange érotique de féminité en mantille et de rudesse sauvage des hommes-chevaux: à une vibration de l’air et des couleurs aussi qui ne se retrouve ni à Madrid ni à Barcelone non plus; et même à Grenade c’est autre chose de plus arabe, et c’est encore autre chose à Cordoue dont la poussière et la couleur des taxis n’ont pas l’immatérialité si subtilement sensuelle de Séville.
Car il y a aussi les cafés de Séville. Nulle part au monde, même à Cracovie, les cafés n’ont, me semble-t-il, le génie grave qu’ils ont à Séville, surtout pour les hommes il faut le reconnaître: les notables, les poètes et les amoureux largués.
Il est possible que les femmes de Séville l’entendent un peu autrement, de même que les femmes de Cracovie. Mais de toute évidence les cafés de Séville surpassent les cafés de Florence et de Rome voire ceux de Barcelone et de Madrid, au moins selon mes critères et ceux des poètes et autres médecins de l’âme, et compte non tenu des cafés de Montevideo ou de Buenos Aires dont nous sommes sans nouvelles récentes.
Un préjugé négatif, notamment en France, frappe le peuple espagnol de dureté ou de morgue. Or l’objectivité, fondée sur l’examen de l’Histoire, contraint à rétablir la vérité. De fait l’Espagne a de la mémoire: l’Espagne se rappelle les cruautés de l’Empire, confirmées par la déposition d’un Goya. Les Espagnols se rappellent la cruauté des Français, comme les Indiens se rappellent la cruauté des Espagnols, mais c’est une autre histoire…
Mieux vaut considérer le beau côté d’un peuple: La Fontaine chez les Français ou la pâtisserie chez les Espagnols, ainsi que la libraire, chez les Français et les Espagnols. Les voyages ne sont pas faits pour autre chose que ces vérifications. Après quoi l’on peut revenir chez soi mieux avisé d’un peu tout…
En terre andalouse
Les parfums de Grenade sont ces jours comme figés par le froid malgré les couleurs persistantes des bougainvillées se détachant sur le blanc des murs et le bleu pur du ciel de décembre, mais le sang de Lorca n’en finit pas d’entacher de rouge les mémoires de ceux qu’a marqués sa poésie.
La mort a frappé à sa porte en août 1936, sous les sinistres visages d’assassins dont on croit savoir aujourd’hui les noms et les motifs du crime: exécution crapuleuse, sur fond de haines familiales et de vindicte homophobe, plus que mise à mort à seul mobile politique; mais le fascisme franquiste a perpétué l’infamie en censurant l’oeuvre du poète vingt ans durant, avant la reconnaissance finale, combien tardive, en sa terre même.
En traversant l’Andalousie de part en part, tantôt verger et tantôt pierrier, tantôt fertile et tantôt âpre, évoquant parfois les collines de Provence ou de Toscane, et parfois les monts afghans entre failles rouges et hauteurs neigeuses, on découvre un grand pays dans les multiples pays d’Espagne, mais le même nom d’Andalousie revient, que Lorca disait consubstantiel à sa poésie – et les drames terriens de sa trilogie théâtrale (Noces de sang, Yerma et La maison de Bernarda Alba) l’illustrent mieux encore que les incantations de sa poésie, ainsi que le confirment ses propres paroles: « Mes premières émotions sont liées à la terre et aux travaux des champs . Sans cela, sans mon amour de la terre, je n’aurais pu écrire Yerma ou Noces de sang… »
°°°
Ayant quitté Grenade ce matin, nous nous retrouvons ce soir, un peu par hasard, tout proches des lieux où se passa le drame qu’on pourrait dire le plus caractéristique de l’âme andalouse, tissée de passion, de poésie et de violence, comme l’exalte le Romancero gitan.
La tragédie paysanne dont Lorca a tiré Noces de sang s’est passé en ces lieux âpres à la lumière intense, que le poète a connus en sa prime jeunesse, entre Almerìa et Nijar. En 1928, plus précisément, à Nijar, une fiancée abandonna son futur époux au jour de leurs noces pour s’enfuir sur une mule avec son cousin. Ce dernier fut tué par le fiancé alors que la promise se faisait tenir pour morte afin d’échapper à la mort. De ce fait divers sanglant, le poète a tiré un poème dramatique d’une puissance expressive liée à toutes les composantes familiales et psychologiques d’une passion empêchée, sublimées par la poésie – du plus pur Lorca somme toute, sous le ciel que nous avons vu, ce soir, saigner sur la mer .
Force fragile
La beauté de la ville debout, que figure par excellence la pointe de Manhattan, telle que l’a célébrée Paul Morand dans sa prose étincelante et magnétique de New York, se retrouve au même miroir marin de Benidorm dont certains gratte-ciel ont une réelle élégance dans l’effilement et les audaces architecturales – et c’est le cas, notamment, de l’Hôtel Bali, tenu quelque temps pour le plus haut établissement du genre en Europe. Or, monté, peu avant la fin du jour, sur sa terrasse du quarante-cinquième étage, je me suis rappelé les sentiments que, peu de mois après les attentats du 11 septembre, j’avais éprouvés à Toronto sur de semblables tours, concevant soudain physiquement le traumatisme des Américains qui découvrirent la fragilité de tels formidables bâtiments.
°°°
Un autre aspect de cette fragilité sa manifeste, à Benidorm, dans le spectaculaire arrêt de deux immenses chantiers, figés par l’aventurisme manifeste de leurs promoteurs et de leurs constructeurs. En pleine zone résidentielle du bord de mer, à Finestrat, c’est par exemple cette monstrueuse structure de béton et de ferraille immobilisée depuis cinq ans faute d’autorisations de poursuivre la construction. Plus frappante encore: la fantastique tour à deux arches, dite Residencial in tempo, haute de 200 mètres, qui devait symboliser le renouveau de la construction espagnole et que moult scandales et tribulations ont freinée voire paralysée, résultat de la folie des grandeurs d’une époque et de la course au profit à court terme.
Vu des hauteurs, le site urbain de Benidorm ne manque pas d’une certaine grandeur harmonieuse, qui fait mieux apparaître l’aberration de ces deux chantiers paralysés par l’incurie des hommes. Or il y a là, me semble-t-il, la marque même de la folie déséquilibrée d’un Système échappant à toute mesure et à tout contrôle, sous l’effet de ce que les Anciens appelaient l’hybris. À savoir: l’orgueil prétentieux, la vaniteuse démesure.
L’hybris a caractérisé les périodes de décadence et d’effondrements. C’est à cause de l’hybris que les empires se sont cassé la gueule, pour parler comme la cousine de César. Or on sait que les Anciens punissaient gravement l’hybris, le plus souvent de mort. Mais alors comment admettre que des financiers, des promoteurs, des ingénieurs marrons, des architectes frivoles imposent au candide peuple espagnol de telles pratiques ? Que fait le Gouvernement ?
Si nous étions citoyens de Benidorm, nous nous en inquiéterons: nous réclamerions même des têtes. Mais nous ne sommes que de platoniques passants helvètes et demain matin nous aurons quitté notre gratte-ciel modeste de 22 étages dont la finition n’appelle que des éloges. Soit dit en passant, un appartement de deux pièces, avec cuisine et corbeille à papier, vaste table à écrire et terrasse, en ce lieu surélevé, ne coûte que 55 euros la nuit, soit le tiers d’une méchante chambre au Niederdorf de Zurich (Suisse) tenue par des Chinois taciturnes. Qui plus est, le restau de la même tour est agrémenté le soir par un chanteur de charme distillant les succès des années 1955-1972, qui porte les résidents à danser librement le cha-cha-cha et le fox-trot. On ne voit pas qu’il y ait à redire à de telles moeurs, auxquelles les Anciens souscriraient…
Caps et deltas
On passe en moins d’un jour d’une Espagne à l’autre, ce qui ne saurait étonner des Helvètes qui accoutument de changer de climat en franchissant un de leurs innombrables cols en quelques heures, changeant du même coup de langue ou de confession, de type d’habitat et de coutumes.
Or je pensais aux multiples régions qui constituent la multiple Europe transitant, en quelques heures, de la plantation de buildings de Benidorm aux vastes étendues planes des rizières du delta de l’Ebre, avec toutes les métamorphoses humaines que cela suppose. Après avoir roulé de long en large le long des petits canaux quadrillant les grandes étendues inondées « au repos », jusqu’aux dunes du front de mer et aux urbanisations absolument désertes ces jours, nous avons fini par trouver, à la Casa Paca de Riumar, une seule auberge ouverte dont la tenancière nous a accueillis tout sourire, puis nous a préparé de quoi nous sustenter avant d’évoquer les travaux dans les rizières, en son adolescence, plantations en mai et récolte en septembre, images à l’appui…
Les parcs naturels se développent de plus en plus en Espagne, un peu partout, comme nous l’avons constaté des Asturies en Andalousie, au Cabo de Gata ou dans cette région du delta de l’Ebre, entre tant d’autres exemples. Or cette nouvelle mise en valeur des microcosmes régionaux m’a rappelé ce que me disait, il y a quarante ans de ça, l’un des visionnaires les plus intelligents de l’idée européenne, Denis de Rougemont, dont le ralliement à l’écologie n’avait rien de dogmatique ni rien d’abstrait, fondé sur une approche concrète des régions et des cultures.
Pour le grand écrivain de L’amour et l’Occident ou de Penser avec les mains, la seule Europe viable était, par delà les prérogatives égoïstes des Etats-nations, et bien sûr à l’opposé de l’Europe du fric ou des fonctionnaires: l’Europe des cultures et des régions. L’on a ricané à n’en plus finir et taxé le « poète » d’idéalisme: on ne voit pas moins aujourd’hui, alors que les séparatismes se ravivent – ces jours se constate même l’exacerbation du nationalisme catalan -, que Rougemont avait raison et que ce qu’on appelle « la crise » n’est rien d’autre que l’échec d’une Europe qui reste, on peut en rêver pour nos enfants, à venir…
°°°
On n’en finirait plus de marcher le long de la mer au déclin du jour, mais ces après-midi d’hiver il tombe soudain contre toute attente, et voici que la lumière cristalline tourne soudain à l’indigo flammé d’orange et que la côte aux forêts de pins se découpe bientôt sur le velours noir semblant tendu derrière la mer qui frémit d’ultimes reflets.
Entretemps on a marché sur la corniche de pierre orangée longeant les hauteurs de la baie, au-dessus des roches où se regroupent les oiseaux de mer, et l’on se rappelle les jours passés, les années au même rivage, les aubes et les crépuscules, nos vies qui refluent…
°°°
C’est entendu: il y a Benidorm et d’aucuns se lamentent: il y a tous les lieux gâchés par le béton ou pourris par l’argent, mais la mer et la terre ont encore des immensités à parcourir, et quarante jours durant nous l’aurons respiré, ce grand large encore possible, ces horizons, ces espaces, ces forêts immenses et ces collines, aussi, cultivées à main d’homme, ces dunes hier et ces terres maraîchères gorgées de riches alluvions du delta de l’Ebre – et tout ce qui non seulement nous soulève de joie sauvage mais se fertilise à vues humaines – le sauvage et le civilisé…
Magnifique est le monde et magnifiques sont les oiseaux. Devant la mer, ce soir, je me rappelle le vieil Alexandre Issaïevitch ouvrant les bras au monde et célébrant sa magnificence.
« Le monde est magnifique ! » clamait Alexandre Issaïevitch Soljenitsyne dans la forêt moscovite où le filmait Alexandre Sokourov, lequel venait de lui rappeler ses années de bagne et l’horreur du goulag – oui les hommes ont inventé le bagne et n’en finissent pas de s’entretuer, convenait le vieil indomptable, mais que de grâce dans le geste de l’enfant et de l’oiseau.
Ah, les enfants: magnifiques sont les oiseaux, et magnifique est le monde…
Au parc Rimbaud
Le voyage est une modulation particulière de l’observation de la réalité sous ses multiples aspects, où il n’est rien. La rue des Etuves de Montpellier, un samedi après-midi de la période de l’Avent, est un lieu aussi digne de visite, par sa prodigieuse diffusion d’énergie vitale et de chatoiement pictural, que les divers monuments recommandés par les Tours Operators aux touristes multinationaux, non tant d’ailleurs à Montpellier qu’à Paris ou à Monaco: faites la queue pour la Sainte Chapelle ou le Rocher, c’est tout comme crever douze heure à la porte des Offices de Florence dans l’éternuement énervé des scooters…
Toutes les rues piétonnes de Blois, de Porto, de Séville ou de Barcelone méritent d’ailleurs la même attention qu’à Montpellier: là converge l’Humanité bonne – et quelle fabuleuse librairie que celle de Sauramps sur la place de la Comédie où se démantibulent des danseurs de hip-hop sur fond de rythmes afro-cubains. Si vous avez un rendez-vous à fixer à des amis chers, ne cherchez pas plus loin: devant la librairie Sauramps, sur la terrasse dont la cantinière servira de l’eau à votre meilleur ami de l’homme.
°°°
L’an dernier à Portofino, dans la baie mythique idéalisée par des poètes en costumes blancs et des femmes fatales, un terrible paquebot américain mouilla et déversa moult chaloupes de touristes hagards qui tous se précipitèrent sur les boutiques de mode italienne, de sacs italiens de marques ou de pseudo-marques issus des ateliers clandestins du sud de Naples, de savates italiennes griffés à Taiwan ou de bijoux italiens aussi couteux que les montres suisses qui se débitent sur la Bahnhoftstrasse de Zurich où déferlent autant de cars chinois. Telle est la caricature hideuse du tourisme actuel que, sacré prince, j’interdirais aussitôt sous peine de déportation lointaine. Eussé-je été en mesure, pirate ce jour-là à Portofino, de couler ce paquebot de malheur et de noyer son entière cargaison de sous-humains suralimentés, que je m’y fusse employé avec mon équipage: au jus les touristes, et que les requins en fassent du sugo !
°°°
Qui, des Tours Operators sévissant aujourd’hui de par le monde, connaît le Parc Rimbaud de Montpellier ? Sans doute aucun et c’est très bien ainsi: cela donne aux amis le loisir de goûter le charme d’un lieu comme il en est partout pour qui se donne la peine d’aller voir, comme Alice derrière le lapin, de l’autre côté du miroir. Du parc Monceau de Paris aux jardins de Murillo à Séville, des terrasses florentines des Boboli au Mozart Park de Vienne: ces îles des villes où nous nous reposons du flux des rues sont propices aux moments où, dans notre lecture du monde, nous relevons les yeux. Et c’est ainsi, aussi, que nous respirons mieux…
Un retour de voyage qui ne serait pas une instance de nouveau départ laisserait un goût d’inachevé, à croire qu’on serait revenu pour rien alors qu’aussitôt tout se trouve replacé sous une autre lumière – et cela commence par tous les noms qu’on se rappelle et qui ont maintenant comme un visage ou comme un corps – comme une nouvelle coloration ou comme une odeur réellement humée – devenue réel humus de mémoire.
Ainsi le nom de notre Nevers d’aujourd’hui est-il différent du Nevers d’avant que seuls des livres ou des films évoquaient, et le nom de la Loire, roulant sous nos yeux ses eaux chocolatées, tout autre sous le ciel de novembre que celui du fleuve rutilant à la télé d’un château l’autre, sans parler de ce nouveau nom révélé à l’apparition dans les monts basques des petits chevaux en liberté: ces pottoks chevelus dans la forêt des Arbailles – le mot pottok, le nom d’Arbailles – chaque nom plus incarné serti dans la chaîne des mots désormais habités.
Enfin le retour, toujours, reste un peu déroutant. On se sent, tout à coup, comme dépossédé et titubant.
Le tas de choses à raconter se volatilise: on se sent un peu con, largué à la lecture, par les journaux, de tout ce qui s’est passé entre temps – que tout ça ait pu continuer d’exister en notre absence !
Mais l’actuelle communication est telle que rien ne nous surprend vraiment en l’aimable platitude de la vie ordinaire retrouvée. Après les vitraux de Bourges ! Altamira ! Les rues de Séville ! L’inscription VIVIR MATA sur les murs de Grenade ! La magie de tous ces noms ! La vie révélée par ces mots !
La culture contemporaine, ou ce qu’on appelle comme ça, donne souvent lieu à des malentendus, tant le paraître et l’être, le désir réel et le simulacre social, le goût personnel et le mimétisme collectif se mêlent sur fond de consommation à grande échelle. Après quelque 7000 kilomètres en un peu moins de cinquante jours, à travers la France, le Portugal et l’Espagne, avec Lady L., nous pourrions établir la liste des « monuments incontournables » que nous aurons zappés, tout en ayant l’impression d’avoir acquis et partagé une quantité d’impressions et d’émotions vivifiantes.
Avec Corto Maltese
Hier encore, nous étions à Grignan pour notre dernière étape. Or ce n’était ni pour y saluer Philippe Jaccottet ni pour nous incliner devant la statue de Madame de Sévigné. Au déclin du jour et dans une lumière orangée mêlant le brun et le mauve, nous avons juste flâné dans le vieux bourg en constatant qu’il s’y trouve plus de librairies et d’ateliers d’artistes qu’à Benidorm et La Grande Motte réunis, avant de souper dans un charmant restau à l’enseigne de L’Etable.
Au préalable, ma bonne amie, fatiguée par des heures de conduite, s’était reposée sous une belle gravure de Corto Maltese, à l’Hôtel Sévigné dont notre chambre déclinait le thème de la mer et des marins; et moi j’avais passé une belle heure en compagnie du libraire Jean François Perdriel, de chez lequel j’étais sortis avec des ouvrages aussi rares que ridiculement bon marché de Marcel Aymé et Jacques Audiberti, ainsi qu’un irrésistible Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des biens nantis, de Pierre Desproges, et l’essai de Benjamin Crémieux Du côté de Marcel Proust qu’un malotru ne m’a jamais rendu. Dans la foulée, après que je lui eus raconté mes deux visites au poète, le libraire m’a donné les dernières nouvelles de la santé de celui-ci (plutôt bonnes) et recommandé la lecture de son hommage funèbre à André du Bouchet. Et ce n’est pas de la culture, ça ?
Si nous n’avons visité ni le Musée des blindés de Saumur ni la cathédrale de Saint-Jacques, ni la Mezquita de Cordoue ni l’Alhambra de Grenade, nous avons « fait » la tapisserie de l’Apocalypse et sommes descendus dans la contrefaçon saisissante de la grotte d’Altamira avant de monter la rampe en 34 sections de la Giralda de Séville, ainsi que les 45 étages de l’hôtel Bali à Benidorm de la terrasse duquel on voit presque l’Afrique et peut-être même Dieu par temps clair.
Mieux: nous avons commencé à nous initier aux langues espagnole et portugaise que d’innombrables résidents étrangers s’opiniâtrent arrogamment à ignorer, et j’ai fait en voiture, à Lady L., la lecture de quatre recueils de nouvelles d’Alice Munro, prix Nobel de littérature 2013,constituant un fonds prodigieux d’observations humaines.
Cependant l’essentiel de ce périple n’aura pas été que de nature livresque ou borné à ce qu’on appelle la culture. Disons que nous aurons vécu: vécu chaque jour, vécu notre relation, vécu des amitiés, vécu des rencontres et des interrogations, vécu le sud et les séquelles visibles de la Crise, vécu l’immensité des pays et les particularismes de chacun, avec l’envie souvent (à Porto, à Séville, à Barcelone) d’y revenir, comme nous reviendrons peut-être à Carvoeiro ou à Tamariu…
Au demeurant le voyage continue. Sommes-nous vraiment arrivés, et étions-nous même partis ? Dites: vous savez ce que c’est, vous, que le voyage ?
Souriez, vous êtes en Tunisie…
Le jour s’est levé ce matin sur un décor himalayen de neige ourlée et de nuances de gris soyeux sur fond de camaïeu bleu- noir, après quoi les tendres adieux à Lady L. sur le quai Ouest, le tagadam feutré du train, le retard de l’avion passé à relire Pensées sous les nuages de Philippe Jaccottet, et le ciel, et la mer, et la nuit, les étoiles en dessus de Carthage et le retour terre à terre de l’interminable piétinement au Contrôle policier, m’ont ramené, trois ans après les folles espérances et les désillusions, en ces lieux où m’attendait, déjà furieux de ce que le contretemps ait ruiné notre projet de soirée avec son frère devenu ministre, mon ami Rafik le scribe vitupérant ensuite en crescendo – de quoi me réjouir vraiment !
De fait, la colère de Rafik Ben Salah me plaît, tant elle exprime la bonne rage de qui refuse l’inacceptable. Or, lui qui m’annonçait il y a peu de temps encore « quelque chose en train de changer », lui qui a poussé son frère à accepter le poste de ministre qu’on lui proposait, lui qui est revenu au pays après des années plombées par la dictature, m’accueille en déployant un tableau des plus accablants tandis que, sur la route du centre ville, des chauffards nous dépassent de tous les côtés comme pour justifier son ire !
« Tu vois ces flics: ce seront les premiers à griller le prochain feu rouge ! Et quand des islamistes parquent n’importe où au pourtour d’une mosquée, pas une contravention ! C’est le bordel ! Sauf qu’un bordel est mieux tenu ! »
Et d’aligner les griefs visant la dégradation générale des comportements, la muflerie croissante, le manque d’éducation de ses lycéens (les quinze qui daignent venir en classe sur une soixantaine d’inscrits) auxquels il doit interdire de manger pendant le cours, ou cette récente descente de police visant un centre culturel de Carthage, après les flambées de violence entretenues par les salafistes dans le sanctuaire lettré de la Manouba, transformée en Manoubistan. Et Rafik le mécréant, devant un bon verre de Magon rouge sang de buffle, de répéter une fois de plus que son pays ne pourra jamais se développer sans s’affranchir du joug de la religion.
« Tout le monde, dans ce pays, fait semblant ! », me disait Rafik hier soir au bar de l’hôtel El Hana International où ma bonne amie m’a retenu une vaste carrée à cinquante euros la nuit. Mais voici qu’après un petit-dèje à l’arabe dans une vaste salle bruissante de djellabas et de voiles ne faisant pas semblant de ne pas être musulmans – pas un Roumi dans le périmètre -, je me retrouve à une terrasse de l’avenue Bourguiba à lire, au soleil quasi printanier, les Chroniques du Manoubistan du prof Habib Mellakh, pêchées à la librairie El Katib où foisonnent les livres de toutes tendances – et dans la foulée j’ai emporté le pamphlet d’Adnan Limam balançant ses cinq vérités au parti islamiste Ennahda supposé faire le jeu du sionisme et des Américains, au même titre que les Frères musulmans, et ce roman plus avenant d’Habib Selmi dont je compte bien m’inspirer de l’intitulé: Souriez, vous êtes en Tunisie !
Ce qui se cache sous le voile…
Je ne pensais pas y revenir aussi tôt, vu que la Tunisie et les Tunisiens ont bien d’autres aspect moins répulsifs à faire valoir, mais les médias locaux de ces jours m’y ramènent, annonçant que le ministère de l’Intérieur va sévir contre le niqab, ou voile intégral.
Or, à peine avais-je passé en revue, ce matin sur une terrasse de l’avenue Bourguiba, les premières pages de La Presse, du Temps et du Quotidien, qu’une élégante silhouette toute noire au visage invisible, mais probablement jeune à en juger par sa tournure et les baskets de son compagnon, traversa mon champ de vision comme pour illustrer ma lecture…
Si l’argument invoqué aujourd’hui par les autorités implique le risque de dissimuler, sous le niqab, quelque terroriste armé, un récente affaire, hallucinante par les dimensions qu’elles a prises, de l’hiver 2011 au printemps 2012, prouve que l’arme de guerre du niqab est peut-être plus efficace quand elle devient ce qu’on pourrait dire la robe-prétexte du fanatisme – je veux parler de l’affrontement, parfois d’une extrême violence, qui a eu lieu des mois durant dans l’enceinte en principe protégée de la Manouba, université de Tunis, opposant UNE étudiante refusant de se dévoiler, soutenue par une camarilla de prétendus défenseurs de la liberté religieuse, par ailleurs étrangers à l’université, et les autorités et autres professeurs de celle-ci.
Vu de l’extérieur, un tel conflit pourrait sembler dérisoire, ne concernant en somme que les élites académiques. Or il faut y voir, au contraire, un exemple emblématique de l’utilisation perverse d’un précepte vestimentaire, d’ailleurs sans fondement théologique avéré, pour l’intimidation d’une communauté vouée, par nature, à la défense de la liberté de penser et d’agir.
De ce stupéfiant feuilleton, qui a impliqué jusqu’aux plus hautes autorités de l’Etat (fort peu glorieusement à vrai dire), face à un doyen (Habib Kazdaghli) faisant figure de héros, ces Chroniques du Manoubistan témoignent, signées par un professeur de non moins remarquable courage (Habib Mellakh) qui a lui-même été gravement molesté.
En voyant passer, sur le pavé de l’avenue Bourguiba, le gracieux fantôme noir de la fille au niqab, je me disais: et pourquoi pas si ça lui chante ? Cependant il en va tout autrement d’une étudiante supposée prendre place dans un auditoire, montrer à ses camarades son visage découvert et regarder bien franchement ses professeurs, dont on comprend qu’ils défendent plus qu’un principe: une façon de confiance réciproque, ainsi que l’exprime Habib Melkach en termes clairs et bienveillants.
°°°
Dans l’affrontement qui a opposé la porteuse de niqab et les autorités de la Manouba, le plus effarant est aussi bien le soupçon porté par les défenseurs du voile intégral contre les professeurs accusés de vouloir « dénuder » leur virginale étudiante. On a bien lu: dénuder. Montrer son visage équivaut à se dénuder. Et s’opposer à un tel délire reviendrait à céder à la libidinosité la plus crasse ?
Tout cela prêterait juste à sourire, une fois encore, si les Chroniques du Manoubistan ne révélaient, en fait, une affaire signalant, à tous les niveaux de la société, un véritable plan de déstabilisation et d’intimidation relevant du terrorisme obscurantiste. Autant dire que ça m’a fait me réjouir d’en rencontrer bientôt l’auteur et son pair doyen…
Visions du réel
Tel est le réel, me disais-je ce matin aux fenêtres de ma chambre du Bonheur International El Hana donnant, à l’arrière de l’immense bâtiment, sur le plus moche décor de façades borgnes et de bâtisses en voie de démolition.
Or une autre fenêtre virtuelle, tôt l’aube, s’était ouverte sur la page du Cahier de verdure de Philippe Jaccottet dont j’avais achevé, la veille, la présentation des Oeuvres en Pléiade, transmise avant minuit aux rédactions de 24 Heures et de la Tribune de Genève : « L’oiseau, dans le figuier qui commence tout juste à s’éclaircir et montre sa première feuille jaune, n’était plus qu’une forme plus visible du vent ».
Plus-que-réel de la poésie. Mais ce n’est pas Mallarmé qui va nous en imposer ce matin en pointant « l’universel reportage » à quoi tendrait la littérature arrachée à sa tour d’ivoire. Faire pièce au nivellement va sans dire, mais puisse tout le réel demeurer et aussi têtu que les faits, dont la fiction fera aussi bien son miel, autant que la poésie.
°°°
Le réel, ce matin, serait alors cette terrasse ensoleillée du Grand Café du Théâtre, en face du Bonheur international, où je me repasse quelques séquences de nouveaux films tunisiens vus ces derniers jours à la requête du directeur du festival romand de cinéma documentaire Visions du réel.
Du panopticon d’observation jouxtant la table de trois étudiantes voilées, avec la clameur proche d’une manifestation très encadrée – forces de l’ordre déployées et frises de barbelés -, devant le trop fameux Ministère de l’intérieur, je me suis ainsi rappelé le couple de la mère indomptable et du fils teigneux, dans C’était mieux demain de Hinde Boujemaa, passant d’un squat à l’autre comme des rats en fuite; la vieille Italo-Française de La Goulette évoquant, dans La maison d’Angela d’Olfa Chakroun, la dérive et le déclin de sa chère « petite Sicile » sous les coups de boutoir des bétonneurs ; ou le retour à la case Révolution de Laïcité Inch’Allah de Nadia El Fani, en ces lieux mêmes où déferla la colère populaire, et dont la projection d’octobre 2011 aboutit à un chaos de violences assorties de menaces de mort sur la tête de l’impie…
Vendredi soir prochain, le réel sera celui de La Mémoire noire, nouveau documentaire signé Hichem Ben Hammar consacré à la répression, à la fin du règne de Bourguiba, de la contestation progressiste du groupe Perspectives, dont les jeunes militants furent torturés, par la père de la nation, « pour leur bien »…
Dans l’immédiat, cependant, c’est dans le cadre le plus hautement raffiné que j’ai rejoint mes amis Jihène et Rafik, sous les arches séculaires du Dar El-Jeld, antique maison de tradition aux murs couverts de zelliges polychromes, où nous nous régalons effrontément et parlons beaucoup sur fond de Qanûn – le vieux Magon ne laissant de faire monter les rires sur le mode plus-que-réel…
Plaisir sans voile
Le grand navire Night tout blanc du Bonheur International reposait sur le flanc, dans mon rêve de minuit, lorsque le premier gémissement, qui m’a d’abord semblé de douleur, m’est parvenu de la chambre d’à côté, assez lancinant pour me réveiller, bientôt suivi de toute une suite de soupirs de croissante intensité modulant les vagues de plus en plus débridées de la plus réjouissante volupté et me rappelant alors, dans le film Padre Padrone des frères Taviani, la saisissante séquence nocturne durant laquelle, du haut des montagnes et de loin en loin, on entend exulter la même jouissance des femmes en amour…
Or, m’étant levé ce matin bien dispos, sous le ciel bleu de Tunisie, je resongeais à ce concert nocturne quand, du seuil de ma chambre, je vis surgir, de celle d’à côté, une silhouette voilée de noir de la tête au pied, suivie d’un très grand jeune homme beau de visage et le regard sombrement doux – le type même du salafiste à longue barbe de soie floche et robe grise.
Cependant une plus grande surprise m’attendait, quelques instants plus tard, dans la vaste salle du petit-dèje à l’arabe où se pressait tout un monde de vieux enturbannés aux femmes pieusement voilées – on m’avait parlé de pèlerins algériens de passage -, lorsque je surpris, derrière une colonne, le visage absolument découvert, la même soupirante de la nuit sirotant son café. Alors là le choc: la grâce, sans rien de soumis ni d’humilié en apparence – le rayonnement de la pure beauté juvénile.
En bonne logique occidentale ou moderniste, surtout après ce que je savais des conflits liés au voile intégral, j’aurais dû, ce matin-là, trouver un argument de plus contre ce fameux niqab, voilant en l’occurrence une telle merveille ; et puis non, curieusement, peut-être aussi me rappelant les ébats nocturnes de ces deux jeunes gens, je me dis qu’en somme, en dépit de cette irruption involontaire dans leur sphère intime, je ne savais rien d’eux, de leur vie, de leur monde; que je n’étais ici qu’un passant – un étranger comme tant de regards me le rappelaient à tout instant -, et toute envie d’en juger me parut alors dérisoire…
Un bonheur entaché
En marchant ce matin par les rues populaires de la médina, recommençant de m’imprégner de l’atmosphère de la rue arabe dans ce qu’elle a de plus naturellement chatoyant, le sentiment croissant de retrouver la bonne vieille humanité m’a rempli de reconnaissance alors qu’un soleil déjà printanier flamboyait au-dessus des pyramides d’oranges soigneusement érigées par les marchands; mais un peu plus loin, en direction de la Kasba, à l’écart des étals bien tenus, les rues se muaient en véritable dépotoir où s’amoncelaient ordures et détritus laissés là depuis des jours à ce qu’il semblait.
Or quelques chose m’a frappé dans ce contraste, qui me semblait dire quelque chose, mais quoi ?
Dans les souks, ensuite, et notamment dans le dédale alternant féerie de couleurs et retraits pénombreux, autour de la grande mosquée de la Zitouna, entre parfums et fripes, j’ai retrouvé avec un égal bonheur cet univers des petites boutiques paraissant perpétuer leur commerce depuis des siècles ; puis, à quelques ruelles de là, c’étaient des passages de traverses encombrés de sacs d’ordures que se disputaient chats faméliques et rats tenaces. Et qu’en dire ?
Et cette troisième image, d’une cette vaste décharge à ciel ouvert, juste à côté du building de trente étages de je ne sais quel établissement bancaire des États du Golfe, et là encore cette proximité d’une façade clinquante et d’un total laisser-aller m’a suggéré un début de réflexion.
Quant à dire que je pourrais en tirer des conclusions liées à la nouvelle donne de la réalité tunisienne, je m’en gardais pour le moment.
De l’ordre et du laisser-aller
Du moins la question de l’ordre et du désordre me semblait-elle se poser à ce moment-là, liée à un malaise latent que jamais je n’avais observé en Tunisie. De fait, autant l’obsession du propre-en-ordre, bien connue des Suisses, peut relever de la névrose, autant il me semble pertinent de s’interroger sur ce que signifient des symptômes récurrents de désordre dont, par exemple, les rues de Tunis étaient devenues le théâtre réellement déprimant.
Dès le dimanche soir de mon arrivée, mon ami Rafik m’avait averti: tu vas voir se déchaîner la meute ! Et deux jours plus tard à peine, j’avais failli me faire écraser quatre fois (le piéton n’ayant plus droit à aucun égard à ce qu’il semblait), constaté que nombre de voitures de flics passaient au feu rouge et vu deux chauffeurs de taxi en venir aux mains après le léger accrochage qu’ils avaient provoqué, forçant une dizaine d’autres conducteurs à s’en mêler dans un concert de klaxons furieux. C’est cela même et j’y insiste: quelque chose de furieux…
On connaît la circulation de Paris, de Rome ou de Naples: le crescendo est notable, mais le désordre hargneux de la circulation en ville de Tunis m’a semblé d’une autre nature: comme si sa fureur venait d’ailleurs.
Ordures qui s’empilent: mauvais signe. Rivages pollués à outrance: pas bon pour la saison touristique à venir si rien ne se fait. Rengaine des médias trois semaines seulement après l’entrée en fonction d’un nouveau gouvernement de compétence: mais que font-ils ?
La dernière fois que nous y étions avec Lady L., en juillet 2011, les discussions les plus animées se poursuivaient à n’en plus finir, pleines d’espérance en les lendemains qui chantent. Une Tunisie pariait pour un avenir meilleur. Si belles rues alors, si belles terrasses à Sidi Bou. Puis une autre Tunisie s’était laissé séduire par moult promesses et cadeaux, qui vota pour un parti totalitaire pseudo-religieux à visées putschistes, foncièrement incapable d’assurer le redressement économique du pays. Quittant le gouvernement, le redoutable Rached Ghannouchi avait promis que son parti garderait le pouvoir par la rue. Hélas, il ne semble pas qu’Allah ait trouvé de dignes éboueurs pour entretenir les rues menant à jusqu’à lui…
Retour amont
C’était en 1970, j’avais 23 ans et je venais de débarquer à Kairouan la « cité des mosquées », une vraie féerie nocturne. J’avais remarqué la mention V.I.P. sur la feuille de route de mon guide, Moncef, moins de la trentaine et qui m’avait accueilli à Monastir. Ainsi me collait-on un rôle notable : n’étais-je pas l’envoyé de La Tribune de Lausanne, chargé de rendre compte du séjour d’un groupe de braves quadras-sexas suisses romands inaugurant pour ainsi dire la nouvelle formule des voyages à la fois culturels et balnéaires, à l’enseigne de la firme Kuoni : plus précisément, une semaine dans l’arrière-pays, via El Djem et Matmata, jusqu’à Nefta au seuil du désert, puis une seconde semaine de détente à laquelle je ne participerais pas.
Ma mission d’alors revêtait donc un certain aspect publicitaire, mais j’entendais bien rester lucide et critique à propos de ce nouveau phénomène qu’on appelait le « tourisme de masse ». Mes camarades de la Jeunesse progressiste espéraient même une « lecture marxiste », mais là je ne garantissais rien, tant je me sentais en porte-à-faux par rapport au dogmatisme et aux schémas plaqués sur la réalité.
Pour lors, je me baladais ce soir-là tout seul, dans l’univers magique, tout blanc et dont montaient de lancinantes mélopées, remarquant que de nombreux marchands avaient disposé, devant leurs échoppes, autant de radios que de petits téléviseurs retransmettant, tous ensemble, le discours paternel de Bourguiba à ses enfants soulagés de le voir enfin sortir de l’hôpital…
J’ignorais, alors, qu’en ces années le « père de la nation » faisait arrêter et torturer les étudiants rêvant d’une Tunisie plus libre. Et pour ce qui touchait aux toubabs, ce n’est que trente ans plus tard que j’appris que mon ami Rafik Ben Salah, neveu du ministre socialiste de l’économie, avait mis en garde son oncle contre le tourisme fauteur de servilité : « Vous allez transformer notre pays en lupanar ! » – « Ferme ton caquet, blanc-bec, tu n’y comprends rien ! »
°°°
Dans le premier de ses Récits tunisiens, intitulé Bédouins au Palace, Rafik Ben Salah décrit, très savoureusement la subite fortune qui enrichit, d’un jour à l’autre, le « bédouin empaysé » Ithmène, auquel on révèle un jour que les cinq hectares de terrain sablonneux et ronceux qu’il possède en bord de mer, en pleine zone de boom immobilier récent, vaut « des centaines de millions » maintenant que le sable devient « aurifère sous l’action du soleil »…
Certains récits ancrés dans la réalité, et plus encore dans le langage des gens, dûment transmuté par le verbe en verve, en disent plus long que tous les reportages et autres analyses de spécialistes.
En retrouvant le brave Ithmène, j’ai pensé au triste spectacle des palaces déserts du front de mer, vers Hammamet, en juillet 2011, et je me suis pris à espérer, contre l’avis de Rafik, que la saison à venir ramène des toubabs à l’économie chancelante de ce pays, histoire d’échapper au pire…
Ceux de La mémoire noire
J’ai maudit les Chinois en longeant l’interminable muraille aveugle qui entoure leur ambassade à Tunis, sûrement aussi vaste que la place Tian’anmen, puis je suis enfin arrivé, à l’autre bout de l’avenue Jugurtha, devant cette élégante petite résidence dont l’enseigne n’était pas moins chargée de connotations historiques et politiques: Fondation Rosa Luxemburg !
Rosa eût-elle apprécié le petit apéro déjà préparé sur la terrasse ? Sans doute ! On connaît le faible des révolutionnaires authentiques pour les douceurs: seuls les rebelles fils de bourgeois évitent petits fours et loukoums.
Bref: un colosse m’avait repéré de loin, en lequel j’avais déjà reconnu Hichem Ben Ammar, qui me remercia d’avoir fait ce grand détour à pied à seule fin de voir son film, La Mémoire noire; et d’autres personnages aux dégaines impressionnantes, l’un m’évoquant Terzieff ou Artaud par sa belle tête émaciée, et l’autre de stature non moins impressionnante, mais avec plus de rondeur – « mes protagonistes ! », se contenta de me lancer Hichem, deux d’entre les quatre apparaissant dans le film, avec lesquels un débat était prévu après la projection.
°°°
Le point commun des régimes autoritaires consiste à « bouffer de l’intello », comme le relève le professeur Habib Melkach au début des Chroniques du Manoubistan, et ce qui frappe alors, dans la répression exercée par Bourguiba contre ses « enfants », est à la fois la disproportion entre les délits reprochés aux étudiants ( pas un ne peut être qualifié de terroriste) et autres affiliés au groupe Perspectives, et leur traitement, d’une incroyable brutalité. C’est de cela, sous tous les aspects de la relation entre militants et bourreaux, qu’il est question dans La mémoire noire, dont la portée va bien au-delà de cet épisode historico-politique.
°°°
Hichem Ben Ammar ne documente pas les faits avec trop de précision. L’histoire du mouvement Perspectives est connue, notament documentée par le récit intitulé Cristal, de Gilbert Naccache, ou tel autre témoignage qui a fait date, La Gamelle et le couffin, dont l’auteur, Fathi Ben Haj Yahia, est également très présent dans le film. Le propos du réalisateur est de faire parler ses personnages, quasiment en plan-fixes et comme sous une loupe restituant le grain des peaux, l’éclat des regards, le moindre frémissement d’émotion. Nullement indiscret, son regard est à la fois proche et respectueux, et les thèmes abordés (la tortures dans les caves du Ministère de l’intérieur, le bagne, les relations avec l’extérieur, la lettre bouleversante que lit une femme de prisonnier, l’avilissement inéluctable des tortionnaires, etc.)
Sans trace d’esthétisme douteux, il y a du poème dans ce film aux images laissant en mémoire une empreinte indélébile.
Notre ami le ministre
Il est arrivé les mains dans les poches, en pull, à bord de sa propre voiture, sans escorte. Je l’ai charrié sur cette apparente insouciance, puis il nous a expliqué qu’il prenait son dimanche et le laissait du même coup à ses gardes du corps, tandis que Nozhâ s’occupait de leurs petits-enfants.
Nous avons pris place, avec son frère Rafik le scribe, dans le restau libanais de ces hauts de Tunis et je l’ai pressé de questions sur ce qu’il avait vécu ces derniers temps, après la divine surprise de la Constitution et son accession au gouvernement de transition.
En fait, il n’a guère changé depuis nos dernières soirées, en juillet 2011, où son frère furieux nous annonçait les pires lendemains. J’aimais bien sa rondeur, fondée sur un sûr savoir d’avocat et de prof de droit rodé sous toutes les latitudes. Je me suis rappelé un certain cours qu’il nous avait donné sur les institutions suisses, arrosé de vieux Magon, et ce qu’il m’a raconté sur son entrée au gouvernement de transition m’a fait sourire. En fait, Mehdi Jomaâ, le premier ministre, lui a a tapé sur l’épaule en lui lançant comme ça: « Dis moi, Hafedh, toi qui n’a pas fait ton service militaire, ce serait peut-être le moment de servir ton pays ». Et comme il hésitait, Rafik a fait valoir à son frère cadet qu’en effet il ne pouvait se dérober.
Moi qui ne connais rien à la politique, je ne sais s’il est fréquent qu’une équipe dirigeante qui a fait la preuve de son incompétence soit écartée du pouvoir et remplacée momentanément, par un groupe de dirigeants supposés non corrompus et non partisans, qualifiés ici de technocrates. D’ordinaire, cette appellation est plutôt mal vue, désignant de froids gestionnaires. Or, d’après ce que m’a raconté Hafedh Ben Salah, il s’agit là, plutôt, de ministres de transition choisis pour leurs compétences et non pour leurs affiliations politiques, qui vont tâcher de remettre la machine économique sur les rails avant les élections de la fin de l’année.
°°°
En écoutant parler le nouveau ministre de la Justice transitionnelle et de Droits de l’Homme, qui aura ces prochains jours pas mal de pain sur sa planche, comme on s’en doute, je pensais à cette smala pas comme les autres des Ben Salah, pas vraiment de haute bourgeoisie privilégiée puisque le père de Rafik et Hafedh était un simple instituteur menant les siens au bâtons d’âne – surtout l’insupportable Rafik -, mais qui a donné une flopée de soeurs et de frères très éduqués ; je me suis rappelé l’amertume de Rafik, qui n’a jamais pardonné à son père le fait de tenir sa mère dans son état d’analphabète, même si le personnage est de ceux qui, dans la culture berbère non écrite, en savent parfois plus que les fins lettrés…
Mon compte Facebook censuré…
Je ne dirai pas que je l’ai cherché : pas vraiment, mais sans doute n’était-ce pas très futé, de ma part, de marquer mon début de séjour en Tunisie en diffusant, sur Facebook où je compte plus de 3000 « amis », et sur mon blog perso, qui reçoit ces temps plus de 1000 visiteurs par jour, deux textes évoquant le « niqab arme de guerre », à propos des Chroniques du Manoubistan dont je faisais l’éloge
Comme j’avais trouvé l’ouvrage en question dans la vitrine de la librairie
voisine, El Kitab, je n’ai pas pensé une seconde qu’en parler serait mal pris; en revanche, ma liste du jour, intitulée Ceux qui en ont ras le niqab, aura peut-être provoqué l’attaque en raison de son ton ironique voire sarcastique, typique des chiens de mécréants que nous sommes.
En tout cas, le fait est que, dès le surlendemain soir de mon arrivée au Bonheur International, mon profil Facebook m’était devenu inaccessible, tout en restant lisible de l’extérieur par mes amis. Quant à mon blog, l’attaque s’y montrait plus subtile, tout formatage de mes textes y étant devenu impossible.
Bref, j’avais oublié tout ce que nos amis nous avaient dit en été 2011 à propos des ruses inventées par les révoltés depuis des mois, face aux vigiles plus ou moins hackers du pouvoir, je m’étais montré crâne et sot, imbu de ma conception de la liberté et ne pensant même pas qu’elle pût déplaire. Mais aussi, j’ai l’habitude de prendre tout en terme d’expérience et celle-ci me disait quelque chose, évidemment, sur la réalité tunisienne…
Or une semaine plus tard, à la Manouba, lorsque je racontai cette péripétie au recteur de la Manouba, Habib Kazdaghli, qui avait vécu les événements du Manoubistan au premier rang des affrontements avec un courage et une ténacité impressionnants, le cher homme me sourit avec un clin d’œil éloquent signifiant « bienvenue au club », lui-même ayant subi le même genre d’attaques.
°°°
Dans la foulée, c’était un honneur exceptionnel, sans rien d’académique, que de pouvoir retrouver les deux Habib à la cafète de la Manouba où ils nous avaient rejoints entre deux cours – je me trouvais là avec Rafik Ben Salah et deux profs des lettres assez girondes -, tant leur double action avait relevé de la résistance à l’inacceptable. Quelques jours plus tôt, notre ami Hafedh Ben Salah, désormais ministre de la justice transitionnelle, m’avait expliqué la signification symbolique de La Manouba, creuset de l’intelligentsia d’élite, et donc de la critique possible (Bourguiba l’avait déjà à l’oeil) en pointant tout le travail incombant à son ministère « pour que cela ne se reproduise plus »…
Or, me trouvant tranquillement, dans la lumière de Midi, en face du Doyen Habib Kazdaghli, j’ai tâché de me représenter la force morale et la détermination physique que cet homme d’étude, historien de formation, a dû puiser en lui pour résister aux fanatiques. Je me le suis figuré en face des deux niqabées hystériques déboulant dans son bureau, y ravageant ses papiers avant que l’une d’elle, jouant la victime, prétendument giflée, se fasse conduire à l’hôpital. La scène, inouïe, mais filmée par un témoin qui a prouvé l’innocence du Doyen, fut la base d’un procès à la fois ubuesque et de haute signification politique. Mimant devant moi ce qu’on lui reprochait, à savoir gifler la joue droite d’un jeune femme voilée se trouvant en face de lui (il a esquissé le geste par-dessus la table, bien que je ne fusse point voilé, et a conclu qu’un droitier ne pouvait bien gifler la joue droite de son vis-à-vis sans faire le tour de la table – Allah en est témoin), il nous a fait rire comme on rit des pires énormités.
°°°
Cependant il n’y a pas de quoi rire des événements de la Manouba. Rappelant le rôle de procureur du ministre de l’Enseignement «qui n’a fait qu’encourager les agresseurs », Habib Kazdaghli affirme que « l’agression contre la Manouba était bel et bien une phase d’un vaste projet voulant imposer un modèle sociétal à tout le pays en passant par la mise au pas de l’université tunisienne. »
Un aperçu des pratiques en cours, donné le 7 mars 2012 par Habib Mellakh, fait froid dans le dos : « Ce groupuscule politique qui a pris en otage aujourd’hui notre faculté était composé d’une centaine de salafistes et de membres du parti Ettahrir, arborant les drapeaux de leur partis respectifs. Ces miliciens dont certains ont été reconnus comme des commerçants ayant pignon sur rue dans les quartiers populaires voisins de la faculté et qui rappellent par leurs uniformes – habit afghan et brodequins militaires – leur comportement violent, leurs chants, les groupuscules fascistes et extrémistes qui ont défilé dans d’autres contrées, sont venus réclamer la démission du Doyen élu de la Manouba »…
Le scribe et les étudiants
Mais quel bel endroit que la Manouba sous le soleil printanier, et que de belles étudiantes, voilées ou pas, s’égaillaient à présent sur les pelouses en attendant de rejoindre la salle où devait se donner la lecture d’une nouvelle (corsée) de Rafik Ben Salah, Le Harem en péril, dont elles tâcheraient d’imaginer une suite en atelier d’écriture…
Autour des tables regroupées de la classe d’écriture créative, pour parler à l’américaine, se retrouvaient à présent une majorité de chattes, deux chiennes, un dauphin et deux footballeurs, plus un bison berbère. La belle grande prof à la coule avait eu cette idée par manière de premier tour de table: que chacune et chacun énoncerait son prénom et l’animal en lequel elle où il s’identifiait. Or la mine de la prof s’allongeait en constatant la foison de chattes pointant le museau, elle qui eût préféré visiblement de franches tigresses.
Et de me confier en aparté : « Pas moyen de les faire sortir de leur schémas de soumission et de leur ronron féminin. Ainsi, l’autre jour, l’une d’elles, à qui je demandais de qualifier la révolte d’Antigone, m’a répondu que cette réaction était d’un homme et pas d’une femme ! »
°°°
L’ami Rafik a captivé son auditoire en moins de deux, avec une nouvelle qui en dit long sur les relations entre hommes et femmes telles qu’elles subsistent assurément dans le monde arabo-musulman. Le Harem en péril évoque ainsi l’installation d’un jeune dentiste dans un bourg de l’arrière pays – on pense évidemment au Moknine natal de l’écrivain -, dont les hommes redoutent à la fois les neuves pratiques acquises en ville, les instruments étincelants destinés à pénétrer les bouches féminines, et plus encore le siège sur lequel les patientes semblent impatientes de s’allonger.
Une première rumeur qui se veut rassurante évoque les mœurs du dentiste, probablement comparables à celles du coiffeur ou du photographe, mais l’inquiétude reprend quand le jeune homme reçoit ces dames à des heures de moins en moins diurnes, pour des séances qui se prolongent.
Au début de la séance d’écriture créative, les deux jeunes gens s’identifiant à des footballeurs (animaux fortement appréciés sur les stades tunisiens comme on sait), n’avaient pas vraiment l’air concerné ; mais le charme et la vivacité du récit, la saveur des mots renvoyant au sabir local, et la malice un peu salace de la nouvelle ont suffi à « retourner » nos férus de ballon rond, autant que chattes et chiennes…
°°°
Dans sa dédicace ajoutée à celle de Habib Mellakh sur mon exemplaire des Chroniques du Manoublistan, le Doyen Kazdaghli évoque le « combat tunisien pour la défense de valeurs en partage entres les deux rives de la Méditerranée », et j’ai pensé alors à tous les contes populaires du pourtour méditerranéen marqués (entre tant d’autres traits) par l’inquiétude des machos confrontés à la séculaire diablerie féminine; aux nouvelles fameuses de l’Espagne ou de l’Italie picaresques, ou au « théâtre » de Naguib Mahfouz.
Et le fait est que le récit de Rafik a suscité un immédiat écho chez ces jeunes gens dont certains, en peu de temps, composèrent des compléments parfois piquants à sa nouvelle – surtout les chattes les moins voilées…
Cette expérience, trop brève mais visiblement appréciée par les uns et les autres, laissera-t-elle la moindre trace dans la mémoire des étudiants de La Manouba ? J’en suis persuadé. Je suis convaincu que le passage d’un écrivain dans une classe, la lecture commune d’un bon texte et la tentative collective d’en imaginer une suite, relèvent d’une expérience rare et sans pareille, comme je l’ai vécu moi-même moult fois.
Et puis il y avait cette lumière, en fin de rencontre, ces ronronnements de chattes, cette impression de vivre un instant dans ce cercle magique que la littérature seule suscite, à l’enseigne des minutes heureuses…
Mendiants et prédateurs
Ma conviction de longue date est que les mendiants nous honorent en nous demandant l’aumône. Je parle des mendiants et non des prédateurs qui vous assaillent, murènes et sangsues.
Le long de la rue de Marseille où se mêle tout un populo, ou sur l’Avenue Bourguiba où la scène de théâtre s’élargit en fluviales processions, j’ai vite repéré les vrais mendiants à qui je savais que, tous les jours, je donnerais la pièce ; mais tout aussi vite fus-je repéré par les murènes et les sangsues des abords du Bonheur International.
Au deuxième soir déjà, crevant la dalle et me dirigeant vers le restau Chez Nous qu’on m’avait recommandé, voici qu’un jeune type, la trentaine acide de regard, plutôt bien sapé, sûrement un portable dans sa veste de cuir, m’alpague d’autorité et me lance : « Alors toi, le Français, tu es mon ami, tu me paies une bière ? J’aurais quelque chose à te proposer… ». Et moi : « Ton ami, si tu veux, mais la bière sera pour une autre fois. Pour le moment, j’ai faim. Allez, bonsoir ! ». Et lui déjà teigneux : « Ah c’est pas un ami, ça, tu ne serais pas raciste ? »
Un autre soir, dans l’encombrement routier dantesque de l‘avenue Mohammed V, coincés dans la Twingo de Rafik pestant plus que jamais, voilà que, surgie de nulle part, une poignée de chenapans très sales et très effrontés nous cerne soudain, dont l’un, aux grands yeux noirs terribles me rappelant les Olvivados de Bunuel, me fixe intensément en agitant le chiffon avec lequel il prétend nettoyer notre pare-brise. Mais Rafik : « Je n’ouvre pas ! »
Et moi de sortir une pièce dont la dorure fait exploser illico mon cher râleur : « Deux dinars ! Non mais quoi encore ? Tu sais ce qu’il peut faire celui-là, avec deux dinars ? Il peut s’acheter cinq pains ! » Alors moi, tel l’imperturbable marabout : « C’est pourquoi, mon frère, tu vas ouvrir cette putain de fenêtre afin que je puisse donner, à cet enfant, ces deux dinars dont j’espère sincèrement, par Allah, qu’il ne les convertira point en colle à sniffer »…
Au fil des jours, j’ai vu les mendiants me reconnaître, j’ai commencé de voir le visage de chacune et chacun, je leur filais la pièce sans me dorloter la conscience pour autant. On m’avait dit que de nouveaux pauvres, après Ben Ali, étaient apparus ainsi dans les rues de la capitale, et que certains groupes organisés avaient pris les choses en main à l’instar de nos mendiants européens.
Du moins me semblait-il identifier « mes » vrais mendiants, autant que j’avais repéré, dans l’instant, la murène du deuxième soir, à laquelle avait succédé une sangsue non moins caractérisée me revenant tous les jours avec un air plaintif, soi-disant photographe de presse (j’avais eu l’imprudence de lui payer une bière, de lui parler un peu de mon travail et de lui« prêter » vingt dinars), me guettant à la sortie de l’hôtel ou à chacune de mes rentrées et me suppliant d’acheter les photos qu’il me ferait avec son Nokia – ou alors tu me prêtes encore cent dinars…
Génération dégage
Un court métrage sortant pour ainsi dire du four, très bien cadré et pensé, très bien réalisé aussi, (magnifiques images et montage à l’avenant), apporte aujourd’hui un témoignage kaléidoscopique précieux sur la perception de la « révolution » tunisienne par ceux qui l’ont vécu entre enfance et adolescence.
Les auteurs, Amel Guellaty et Yassine Redissi, sont eux-mêmes de tout jeunes réalisateurs, qui insistent, ce qui se discute, sur le fait que la révolution ait essentiellement été le fait de la jeunesse tunisienne. Le tout début de la première moitié du film tend ainsi à privilégier l’aspect festif et juvénile des manifestations. Puis s’enchaînent, sur des thèmes variés, les propos recueillis auprès d’une brochette d’enfants de 7 à 15 ans, tous issus de la classe moyenne citadine éduquée, reflétant souvent l’opinion familiale.
On pense aussitôt à la série romande mémorable des Romans d’ados en regardant Génération dégage, dont les auteurs ont la même façon de faire « oublier » la caméra aux premiers cinq enfants « typés » autant qu’on peut l’être à cet âge.
Il y a là Seif, le seul garçon, 9 ans, qui a son profil sur Facebook, constate que la démocratie oblige à porter le niqab ou la barbe (il trouve ça sale) et se réjouit de voir partir Ennahdda. Il y a la petite Maram, 7 ans, qui n’aime pas la démocratie au nom de laquelle on a « tué des tas de morts ». Il y a Chahrazed, 13 ans, qui ne dit que des choses pensées et sensées. Il y a Sarra, 12 ans, qui estime que l’Etat ne doit pas se mêler de religion. Les thèmes défilent (la démocratie, la violence, la politique, Facebook, les manifs), suscitant autant de propos naïfs ou pertinents que la sociologue Khadija Cherif commente à son tour avec tact et réalisme.
En sa deuxième partie, réalisée dans une école préparatoire mixte de Maktar, dans le gouvernorat de Siliani, le ton et le discours de ces enfants de chômeurs et de paysans pauvres changent complètement. Timides devant la caméra, les ados répondent sans hésiter, au prof qui les interroge, que c’était mieux « avant » la révolution : que les seuls changements qu’ils ont observés depuis les élections se limitent à la hausse des prix et à l’augmentation du chômage. Après une hésitation, l’un des garçons, qui daube sur les salaires des dirigeants, lâche d’un air accablé : « Ils nous ont rien laissé, M’sieur ». Un autre, visiblement le fort en thème de la classe, qui affirme qu’il fera de la politique plus tard afin d’aider son pays, constate que même avec les meilleurs résultats les chances de poursuivre des études sont de plus en plus difficiles. Une jeune fille, enfin, évoque la situation de sa famille, où son père chômeur ne parvient pas à offrir des études à ses quatre filles.
On n’est plus ici dans l’ambiance politico-médiatique de la Tunisie des manifs, dont la fraîcheur juvénile se veut réjouissante dans la conclusion du film, mais dans la réalité terre à terre de la Tunisie profonde, dont le regard des jeunes, fixant la caméra sans trace de cabotinage, interpelle et fait mal.
En un peu plus de trente minutes, alliant un propos cohérent de part en part et de très remarquables qualités plastiques, les jeunes Yassine Redissi et Amel Guellaty ont composé un tableau évidemment partiel mais dont les « couleurs » fortement contrastées sont d’un apport déjà considérable dans l’aperçu d’une réalité tunisienne à multiples faces.
Or à quoi ressemblera la Tunisie à venir de ces enfants confrontés, dès leur plus jeune âge, à des notions idéologiques encore abstraites et des réalités très concrètes, des débats et des manifestations vécus en famille, des tensions religieuses, des sacrifices de martyrs (l’immolation de Mohammed Bouazizi) ou des meurtres politiques (l’assassinat de Chokri Belaid) vécus comme des traumatismes collectifs ?
Le premier mérite de Génération dégage est de nous les montrer, ces très jeunes Tunisiens, ou tout au moins quelques-uns d’entre eux, à la veille de nouvelles élections et de nouvelles données qu’on souhaite bénéfiques à leur cher pays…
°°°
J’ai revu Taoufik trois fois durant les douze jours que j’ai passés à Tunis. Nous avons sympathisé dès notre première rencontre, sur la terrasse du Grand Café du Théatre où j’étais en train de lire les Chroniques du Manoubistan. C’est lui qui m’a abordé et sans me demander, pour une fois, si j’étais Français ou Juif new yorkais. Il m’a dit avoir suivi les événements de la Manouba depuis Paris, où il enseignait l’histoire. Après quelques échanges je lui ai raconté le piratage de mon profil Facebook par ceux que j’appelais les salaloufs, le faisant bien rire; je lui ai parlé de Rafik le mécréant ne discontinuant de les vitupérer, et c’est là qu’il a commencé d’évoquer son propre séjour chez son frère Ibrahim, la gueule qu’on lui a fait pour le manque de clinquant de ses cadeaux, et la métamorphose de sa belle-sœur Yousra, visiblement impatiente de transformer sa maison en lieu saint où lui-même se repentirait bientôt, devant tous, d’avoir épousé une Parisienne au dam d’Allah et de ses allahloufs.
La deuxième fois nous nous sommes retrouvés, par quel hasard épatant, à proximité du pédiluve de l’hippopotame du zoo du Belvédère que je ne m’impatientais pas de ne voir absolument pas bouger. Taoufik était accompagné du petit Wael, son neveu de sept ans, qu’il m’avait dit inquiet de ses rapports avec Allah l’Akbar, et dont je vis surtout, pour ma part, la joie de courir d’animal en animal, jusqu’au petit de l’hippo tremblotant sur ses courtes pattes. En aparté, pendant que le gosse couratait sous le soleil, Taoufik eut le temps de me narrer la visite, chez Ibrahim, de son frère aîné l’éleveur de poulets, roulant Mercedes et pas encore vraiment remis de la chute de Ben Ali. Comme je lui avais répété les premières observations de mon ami Rafik sur l’ambiance générale de cette société où «tous font semblant », il m’a regardé sans me répondre, le regard lourd, triste et qui en disait long.
Enfin nous nous sommes revus, la dernière fois, au souk des parfumeurs de la médina, où il venait de quitter son ami Najîb très impatient lui aussi de se trouver une femme française ; et c’est là qu’il m’a raconté le dénouement atroce des tribulations de la belle Naïma, littéralement lynchée par ses voisins, plus précisément : livrée à la police sous prétexte qu’elle avait reçu chez elle un homme non identifié comme parent.
« Et c’est mon propre frère qui a fait ça ! » s’est exclamé Taoufik, qui m’avait dit la relation d’affection et de complicité, jusque dans leurs dragues, qui le liait à son benjamin : Ibrahim, que Taoufik avait surpris la veille en compagnie d’une prostituée, et qui venait de livrer Naïma aux flics, s’en félicitait vertueusement et s’en trouvait félicité par sa vertueuse épouse et leurs vertueux voisins
Cette histoire odieuse, qui m’a atterré autant que le pauvre Taoufik, impatient maintenant de regagner la France, m’a hanté plusieurs jours avant que, dans le même dédale du souk des parfumeurs, je ne me retrouve dans le patio de ce lieu de culture et d’intelligence que représente le Foundouk El-Hattarine.
°°°
À l’invite de l’éditeur Habib Guellaty, que j’avais rencontré à la Fondation Rosa Luxemburg, lors de la projection de La Mémoire noire d’Hichem Ben Ammar, je me réjouissais d’entendre, en lecture, le livre tout récemment paru d’Emna Belhaj Yahia, auteure déjà bien connue en ces lieux, intitulé Questions à mon pays et que j’avais acquis et lu d’une traite dans la première moitié de ma journée.
Philosophe de formation, romancière et essayiste, Emna Belhaj Yahia, dont je n’avais rien lu jusque-là, m’a tout de suite touché par la simplicité ferme et droite de son propos, qui se module comme un dialogue entre la narratrice et son double.
Sans un mot lié aux embrouilles politiques du moment, ce texte limpide et sans trace de flatterie, m’a paru s’inscrire au cœur de l’être politique de la Tunisie actuelle, fracturé et comme paralysé dans sa propre affirmation. Revenant sur le paradoxe vertigineux qui a vu une société se libérer d’un dictateur pour élire, moins d’un an après, les représentants d’une nouvelle autorité coercitive hyper-conservatrice, l’essayiste en arrive au fond de la question selon elle, lié à l’état désastreux de l’enseignement et de la formation dans ce pays massivement incapable en outre, du point de vue des élites culturelles (écrivains, artistes, cinéastes) de présenter un front commun, identifiable et significatif. J’y ai retrouvé les questions que je n’ai cessé de me poser depuis trois ans et plus : où est la littérature tunisienne actuelle ? Que disent les cinéastes de ce pays ? Comment vivrais-je cette schizophrénie dans la peau de mon ami Rafik ? Or me retrouvant, ce soir-là, dans cette vaste cour carrée de l’ancien caravansérail où un beau parterre de lectrices et de lecteurs entouraient Emna Belhaj Yahia, j’ai été à la fois rassuré par la qualité des échanges, impressionné par les propos clairs et mesurés de l’écrivaine, et sur ma faim quand même, peut-être sous l’effet de cette lancinante et décapante lecture cessant de dorer la pilule ?
J’étais un peu maussade ce matin-là. Il faisait gris aigre au Bonheur International, dont l’isolation défectueuse de ma chambre solitaire laissait filtrer de sournois airs glaciaux, mais il fallait que je fisse bonne figure, tout à l’heure, à la Radio tunisienne où j’avais été invité, avec Rafik Ben Salah, par la belle prof de lettres de la Manouba se dédoublant en ces lieux, au journal de treize heures.
Titubant plus ou moins de fièvre le long de l’interminable enfilade d’avenues conduisant de l’avenue Bourguiba à l’Institution en question – Rafik m’avait dit que j’en aurais pour dix minutes mais ne demandez jamais votre chemin à Rafik Ben Salah -, je finis en nage, essoufflé, au bord de la syncope dans les studios décatis de la grande maison où l’on m’attendait avec impatience.
Mon ami le scribe s’étant défilé entretemps, j’allais me retrouver seul au micro national à raconter mon séjour d’à peine douze jours. J’avais dit à la belle prof que je n’en voyais guère l’intérêt, mais elle s’était récriée et m’avait demandé « plus d’infos », aussi lui avais-je balancé par mail quelques données bio-bibliographiques concernant mon parcours terrestre incomparable et mes œuvres en voie d’immortalité. Comme tout auteur est un puits de vanité et que je reste ouvert à toute expérience, cette impro radiophonique en direct m’amusait d’ailleurs, finalement, en dépit des premières attaques de la toux .
«On a dix minutes pile ! » m’annonçait à l’instant la belle prof présentatrice…
Huit minutes plus tard, j’avais à peu près tout dit de mes observations et rencontres, les torturés de l’avenue Jugurtha et la soirée avec le ministre, les orgasmes de la niqabée et la sage soirée au Foundouk El Hattarine, quand ma fringante interlocutrice entreprit, pour souligner l’importance cruciale de mon témoignage, de présenter mon Œuvre et d’aligner les prix littéraires que celle-ci m’a valus à travers les années.
Lorsque j’appris alors, par la voix de la crâne présentatrice, que je m’étais signalé dès mon premier livre, La Prophétie du chameau, comme un jeune auteur en osmose particulière avec le monde arabo-musulman, j’étais tellement estomaqué de voir confondre mon premier opuscule (une espèce d’autobiographie soixante-huitarde romantique de tournure et d’écriture kaléidoscopique) avec le premier roman de Rafik Ben Salah, que je restai baba. Rectifier le tir en direct, alors que la dame énonçait les autres titres de mon oeuvre si tunisienne d’inspiration (Le Harem en péril ou Récits tunisiens, sans parler des redoutables Caves du minustaire), m’eût semblé la mettre en position délicate, alors qu’elle me félicitait maintenant pour le Prix Schiller (effectivement reçu dans mes jeunes années, à l’égal de Rafik) et le Prix Comar (distinction tunisienne dont Rafik Ben Salah et Emna Belhaj Yahia ont bel et bien été gratifiés), mais nous en étions aux dix minutes accordées, il me restait à dire merci pour l’honneur insigne, sourires rapides et promis-juré: la prochaine fois nous vous prendrons une heure…
Quant à moi, rarement j’aurai tant ri (au téléphone illico, avec ce lâcheur de Rafik, en sortant des studios) d’une situation si cocasse et si caractéristique à la fois, en l’occurrence, d’une incurie que je n’avais pas envie, pour autant, de juger en aucune manière. La chère dame, prof de lettres cachetonnant à la radio, avait mélangé ses fiches et je n’eus même pas le cœur de le lui faire remarquer après l’émission…
Je n’en dirai d’ailleurs pas plus. Je ne m’en sens pas le droit. Emna Belhaj Yahia est mille fois mieux habilitée que moi au commentaire particulier ou général de l’état de la culture en Tunisie. Quant à moi j’avais hâte, la crève me prenant au corps, de lever le camp. Il nous restait juste, ce soir-là, à marquer nos adieux amicaux, à La Mamma, en compagnie de Rafik et de son amie Jihène. Nous ririons encore un peu de ce loufoque épisode, pour nous libérer du poids du monde comme il va ou, plutôt, ne va pas…
Trois ans après la « révolution », j’aurai retrouvé la Tunisie en étrange état, mais comment généraliser de sporadiques impressions personnelles ? Mon ami Rafik Ben Salah, moins prudent que moi en tant que Tunisien helvétisé redoutant plus que jamais le retour du pire, m’a parlé d’une ambiance d’après-guerre. Quant à moi je ne sais pas…
À mon retour en Suisse, mon vieil ami l’historien Alfred Berchtold à qui je faisais part de mes pensées, m’a dit comme ça: «On se sent dépassés. » Avant d’ajouter : « Mais Obama aussi a l’air dépassé ». Et le merveilleux octogénaire, que ses camarades de la communale, à Montmartre, appelaient Pingouin, de conclure : «Nous sommes tous dépassés, mais la vie continue. Avec Madame Berchtold, à l’Institution, nous nous exerçons l’un l’autre à nous réciter par coeur des poèmes…»
Sud des Alpes
Il n’est pas de vert plus vert que celui du Lac Majeur, de ce vert émeraude de l’eau qui tourne au noir sur les monts à la péruvienne que le subit et grondant orage d’été dramatise encore, et nulle pluie n’est si drue et si liquide et si fraîche et si limpide et si vivement mouillée que celle qui tombe en trombes de ce ciel tessinois du partage des eaux du Nord et du Sud évoquant à la fois les fjords et le Brésil – le plus sévère et sensuel mélange de l’alpin et du latino…
Les mots chantent ici comme nulle part en Suisse, les mots et les noms aussi, pergola et Solari, zoccoli et Solduno, les mots chantent ici autrement qu’en Italie, en Italie on ne dit pas grotto comme ici, en Italie on hésiterait tout de même à baptiser une montagne Monte Generoso, ou une autre Monte Verità, il y a là quelque chose de terrien et de lyrique à la fois, de pierreux et de fluide, d’âpre et de soleilleux comme le vin d’un rouge un peu noir et d’un goût un peu dur qui se retrouve dans les visages des vieux aux yeux candides…
En remontant la Maggia l’on passe de la Polynésie languide aux marmites d’eaux glacées où les corps mortels et les âmes suressentielles se purifient, et c’est dans un bleu d’agate qu’on se plonge et se frotte et se lustre, il y a là de quoi revigorer les peaux jeunes et vieilles, nulle part au monde sauf peut-être au Japon l’eau n’est si belle et bonne que dans cette rivière tombée du ciel et polie par la pierre…
°°°
La descente vers le Sud, des Alpes à la Riviera dei Fiori, ne m’avait jamais semblé une telle plongée, et de fait il n’est aucune voie, me semble-t-il, en Italie et peut-être même dans toute l’Europe et le monde quadrillé d’autoroutes, qui donne, autant que l’A6, reliant Torino à Savona, le sentiment-sensation qu’avec son véhicule on est plus que lancé : précipité sur un toboggan, entrecoupé des innombrables tubes fermés que sont les tunnels, dans une dévalée vertigineuse qui tend bientôt à annuler tout autre paysage que celui des monts boisés affleurant les viaducs, au-dessus des toits roses des villages, avec le souci constant d’échapper aux poids lourds de plus en plus pressés à ce qu’il semble de rejoindre les ports et autres hangars du bord de mer.
Dino Buzzati a tout observé et pressenti, dans son Voyage aux enfers du XXe siècle, de ce que deviendraient les villes tentaculaires et les terres partout urbanisées du monde à venir, et encore l’A6 en octobre échappe-t-elle aux migrations massives des vacanciers, mais l’ultime plongée sur la ville aux grandes cheminées et aux voies suspendues tournoyant au-dessus des zones industrielles a bel et bien de quoi donner le vertige, comme au débouché des tunnels sur Gênes, sur quoi l’on aperçoit là-bas la mer étale dans son indifférence bleutée, et le nom de Via Aurelia nous fait passer d’un temps à l’autre avant que le nom de Riviera s’accorde enfin aux couleurs encore vives des bougainvillées…
°°°
Notre goût partagé, avec Lady L., nous a toujours fait fuir les étalements balnéaires et les foules estivales, et c’est donc en ambiance connue que nous retrouvons cet hors-saison de la côte s’incurvant entre Alassio et San Remo, foison d’anciens petits ports saturés par l’industrie vacancière et cependant, merci la chance, voici que la Pensione Maruzzella où nous nous retrouvons ce soir, bourdonnante de gens peu portés à se pavaner, nous évoque la fin des vacances de Monsieur Hulot ou quelque chronique populaire du meilleur aloi.
Après le repas du soir (Strozzapreti alla Sorrentina arrosés de Nero d’Avola par trop dur et froid je trouve), en compagnie nombreuse et fourmillant de petits enfants qu’ont emmenés leurs parents profs en vacances, nous marchons dans la nuit déserte jusqu’aux quais déserts bordés d’hôtels déserts et de discos non moins admirablement désertes, muettes, toutes paupières baissées, stores verrouillés – la fête est finie sauf dans nos cœurs…
°°°
Ce matin m’est venue l’idée, dans la pénombre de l’hôtel anonyme, et après une nuit interrompue par une longue insomnie (séquelle du Nero d’Avola trop acide d’hier soir), que ce n’est pas la pensée-sensation de la mort qui plombe ma première conscience de l’éveil, à chaque aube, depuis quelques années, mais au contraire la pensée de la vie, l’angoisse et presque l’épouvante à la conscience exacerbée de ce qu’est la vie et de ce qu’elle sera de plus en plus, avec la pensée-sentiment que je n’en fais pas assez pour la mériter vraiment, que je la galvaude et la vilipende au lieu de travailler sans relâche à la transmutation du plomb en or, pensée-sentiment qui recoupe très exactement celle que Tolstoï module dans La mort d’Ivan Illitch et qu’on retrouve dans le génial Vivre d’Akira Kurosawa, dont les protagonistes, pris à la gorge par l’annonce de leur mort prochaine.
°°°
Or j’y repensais ce soir en nous attardant, après la longue montée dans les ruelles médiévales aux belles couleurs passées ou rafraîchies du vieux Menton, par les allées du petit cimetière en plein vent enclos, au sommet de la colline, et donnant donc sur la mer, dans les ruines de l’ancien château ; je pensais à tant de vies peut-être brillantissimes, de princes russes et de duchesses austro-hongroises, entre autres Lords et Ladies anglais, venus se réfugier en ce semblant de paradis terrestre, précédés ou suivis de leur progéniture plus ou moins perdue de tuberculose, et dont ne témoignent plus que quelques monuments usés ou cassés, quelques inscriptions souvent effacées, et cette kyrielle de noms prestigieux (Troubetzkoi, Volkonski, Souvarov, Henkel von Donnersmarck) qui ne disent quasiment plus rien aujourd’hui à personne de moins de trente-trois ans – et loin de me sentir accablé je me rappelai l’herbe qui repousse sur la tombe du bon Illia Illitch Oblomov, sous le ciel brodé des mêmes étoiles qui ornaient sa très vaste et très douce robe de chambre d’éternel paresseux…
°°°
On monte le long de venelles à marches d’âne, le grand bleu revenu fait aux murs vanille ou safran, mauves ou verts, une toile de fond qui se fond presque là-bas au bleu cependant scintillant de la mer , c’est le plein silence de l’après-midi d’après la haute saison, en ce bourg d’anciens pêcheurs de corail, les murs renvoient un peu de chaleur encore, et plus haut se découvre la blanche façade ornée de la grande église baroque en gloire de San Giorgio de Cervo, dans la pénombre de laquelle m’attend cette toute petite effigie d’un Christ aux douleurs, la vraie présence de ces lieux, en un autre lieu pourtant…
Mais un vilain verrou, bouclant une haute grille, interdit l’accès de la petite église hors-les-murs de San Nicola, qui nous tient ainsi à distance du Cruciflé, là-bas, tout émacié mais de bois dur ivoirin, taché de sang et la peau déchirée par le fouet et les bâtons, quelque chose du supplicié de Grünewald ou de quelque autre maître ancien arrachant la scène à toute sensualité pour exacerber l’expression de la Douleur mais sans pathos de théâtre pour autant – même de loin on perçoit cette figure de vérité que le cadenas protège probablement des immondes pillages de sbires d’antiquaires…
°°°
Et sous le même ciel se tortillent les deux pimbêches et les chauves tout cuir à créoles de macs qui les cornaquent, tout enveloppées de peignoirs et prêtes là-dessous à tous les déguisements, au théâtre frelaté de Portofino, toutes les poses, les lascives et les langoureuses, laquées et lustrées, les lèvres et les ongles peints des mêmes roses violacés – c’est la Dolce Vita de Gabbano pour pubs de demi-luxe, les chauves se font pitbulls aux chevilles de qui materait de trop près ; c’est l’Italie putanisée du Cavaliere que nous regardons avec cet œil amusé que nous a enseigné le Maestro Fellini…
On descendait en Italie, dans les années 50 et 60, par les premières autoroutes européennes, avec les allemandes, qu’on appelait alors des autostrades, et ce matin nous nous retrouvons sur cette Via Aurelia dont le nom fleure l’antique et qui, de San Remo, file vers Savona et ensuite, changeant de nom, vers Genova et La Spezia, Livorno et Roma ou plus bas vers l’Italie africaine…