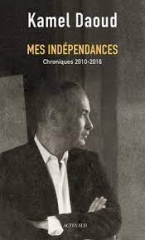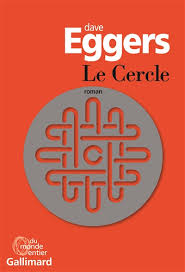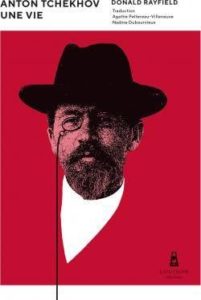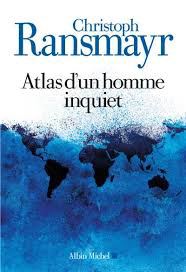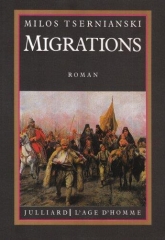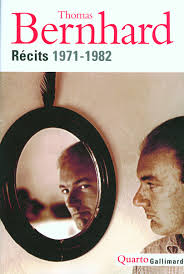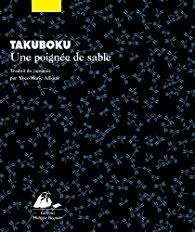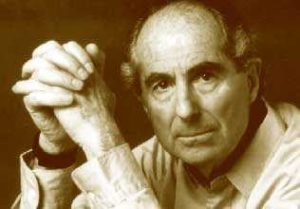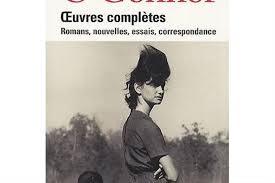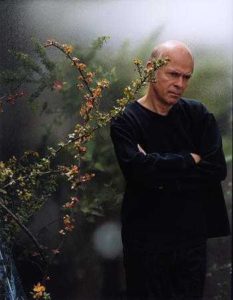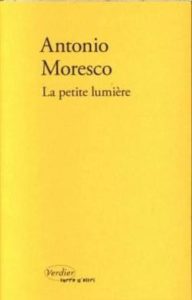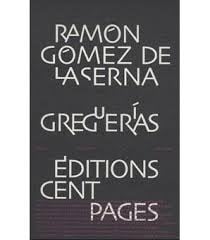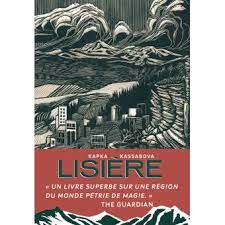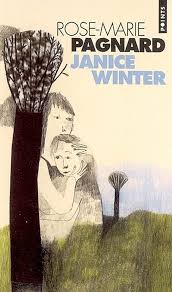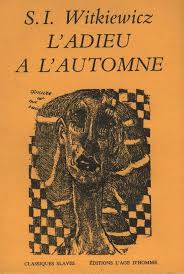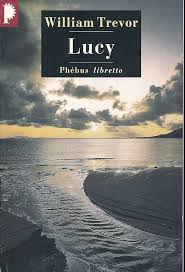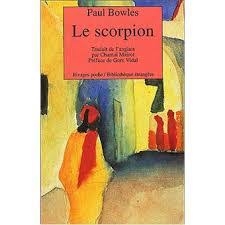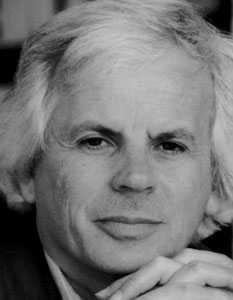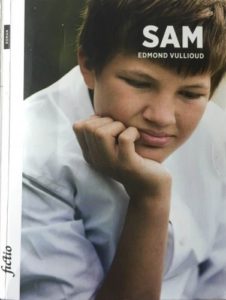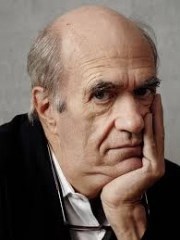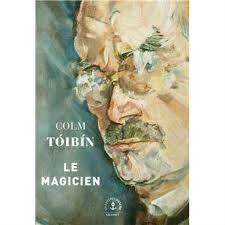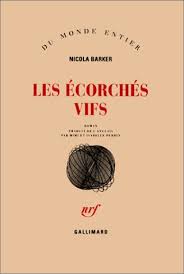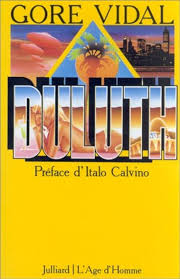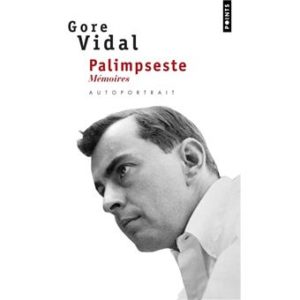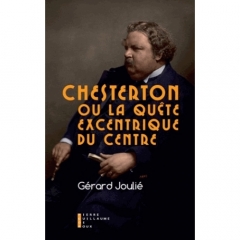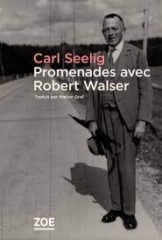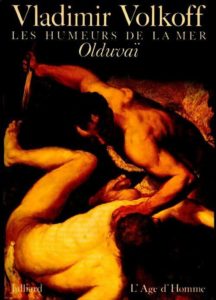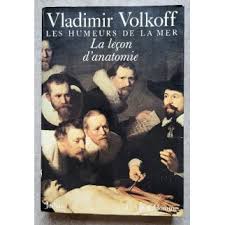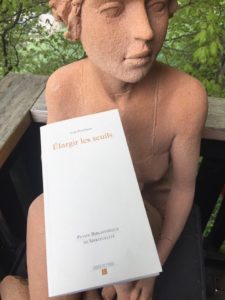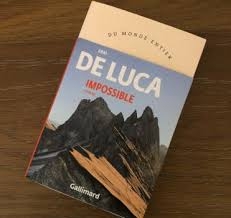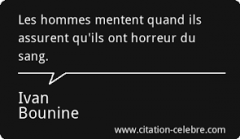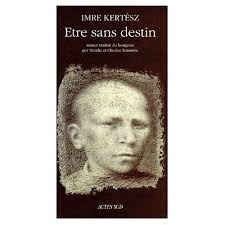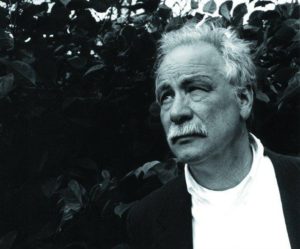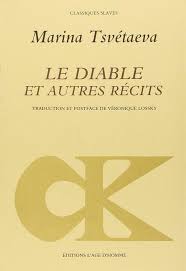Chroniques de JLK
(2017-2025)

Dessin: Matthias Rihs
1.La chronique, charme de paix,
arme de guerre…
Contre la fuite du temps et la perte du sens, trois chroniqueurs à pattes d’écrivains modulent, sur des tons très personnels et des styles non moins vifs, cet art combinant travail de mémoire et commentaire des temps qui courent, almanach fantaisiste ou fronde résistante. Dans Résumons-nous, voici l’irréfutable Alexandre Vialatte retrouvé en ses débuts juvéniles dans l’Allemagne de la montée du nazisme, entre autres émerveillements saisonniers; avec Mes indépendances, Kamel Daoud affronte les démons du terrorisme en Algérie et célèbre la belle et bonne vie; et Jean-Francois Duval se rit lui aussi des idéologies mortifères, tout en distillant un Bref aperçu des âges de la vie en épicurien doux-acide…
Alexandre Vialatte pourrait dire, à sa façon devenue parodique, que la chronique remonte à la plus haute Antiquité, à l’image de la femme des cavernes en veine de confidences et de son macho soucieux de marquer son nom aux Annales de la grotte.
La chronique, dont le nom suggère que Chronos la travaille au corps, et qui signale justement le désir de ne pas se laisser croquer par ce monstre vorace, est bel et bien tissée de temps humain, voire trop humain comme disait un philosophe à moustache de fil de fer: elle dit les faits, bienfaits et méfaits imputables à notre espèce dans une série linéaire précisément dite chronologique ; elle déconstruit les fake news depuis la nuit des temps et rapièce tout autant de ces vérités momentanées qu’on dit éternelles ; elle a varié de forme selon les empires et les tribus ; elle ne s’est fixée dans notre langue qu’au XIXe siècle dans la forme que nous lui connaissons aujourd’hui encore, avec ses belles plumes de toute espèce et ses oiseaux bariolés plus rares, tel Alexandre Vialatte.
Or, l’image du sémillant Auvergnat de Paris, mordant contempteur du politiquement correct avant tout le monde, mais jouant le plus souvent sur l’érudition joyeuse et la gaîté cocasse en concluant invariablement que « c’est ainsi qu’Allah est grand » – cette image de fantaisiste à nœud pap’ élégant en prend un coup à la lecture de la première partie « allemande » des plus de 1300 pages de Résumons-nous, troisième volume, après les Chroniques de la Montagne, consacré à son œuvre par la collection Bouquins.
De fait, regroupés sous le titre vialattien au possible de Bananes de Königsberg, les textes de sa « période rhénane », courant de 1922 à 1929, témoignent à la fois de l’immédiate originalité du jeune écrivain (il est né en 1901) et de sa progressive désillusion devant l’évolution de cette Allemagne dont il avait une image idéalisée par ce que lui en chantait sa mère en son enfance, et qui se révèle sous un jour de plus en plus inquiétant, jusqu’en 1945 où il chroniquera le procès des nazis du « camp de repos et de convalescence » de Belsen dont il saura détailler l’ignoble banalité des dépositions plombée par la bonne conscience de ceux qui n’ont fait qu’obéir, n’est-ce pas…
Le « Kolossal » au sombre avenir
En 1922, à Mayence, le jeune Vialatte, dans son bureau de rédacteur de la Revue rhénane censée rapprocher les peuples allemand et français, écrit à son ami Henri Pourrat, futur arpenteur de la forêt magique des contes populaires, qu’il s’embête à voir « des brasseries pareilles à des cathédrales, des villas pareilles à des châteaux forts, des briquets pareils à des revolvers, des policiers semblable à des amiraux, dans ce pays de surhommes pour lequel il faut des surbrasseries, des survillas, des surbriquets et des surpoliciers ».
Et cela ne va pas s’arranger avec les années malgré la bonne volonté de l’observateur du redressement économique de l’Allemagne, où tout n’est pas que bruit de bottes. Mais « n’importe quel grain peut germer », écrit-il, dans ce « chaos des genèses sur quoi souffle le vent de tous les enthousiasmes », et le fond d’inquiétude de ses chroniques s’accentuera jusqu’au moment où il deviendra témoin direct de l’atroce.
Vialatte n’était pas un idéologue mais un artiste, un poète, un honnête homme, une nature aussi joyeuse que sérieuse, et son témoignage n’en est que plus marquant. C’est par respect humain qu’il vomit l’antisémitisme nazi, comme il défendra plus tard les harkis algériens lâchés par la France. Son naturel n’est « politique » que par réaction nécessaire, et la meilleure preuve en est la foison de chroniques égrenées dans son Almanach des quatre saisons, inénarrable brocante où son gai savoir fait merveille autant que dans ses éloges d’écrivains (de Buzzati à Kafka ou Audiberti, notamment) ou ses engouements de cinéphile occasionnel. Quelle sage loufoquerie et quelle lucide générosité !
Le « vœu de parole » de Kamel
Lucide et généreux : on pourrait en dire autant de Kamel Daoud, sorti de son « village de silence » pour faire « vœu de parole », selon les mots de Sid Ahmed Semiane, chroniqueur algérois saluant son compère d’Oran dans sa préface à Mes indépendances, dont le titre même marque l’écart d’une position personnelle .
Semiane rappelle le désastre de la guerre civile, dans les années 90, et la désespérance régnant dans ce chaos : « Il n’y avait plus rien pour faire un tout, et tout était réuni pour que rien ne soit. Chacun rendait responsable l’autre de ce qui n’était pas censé relever de sa responsabilité. Et comment dire ? Comment penser l’impensable ? Comment créer sa propre « musique » dans ce vacarme ? Kamel Daoud se jeta dans cette arène folle à ce moment précis où le seul « bien vacant » était le marché de la mort ».
Mais en quoi cela nous concerne-t-il, et pourquoi les chroniques de Kamel Daoud nous touchent-elles ? Simplement, comme chez Vialatte, parce qu’une voix humaine s’y exprime. Parce que la parole fragmentée et avilie, émiettée en nébuleuses d’opinions vaseuses, marque aussi le monde atomisé dans lequel nous vivons, où tel président américain à la raison vacillante prétend que la vérité ne sera que ce qu’il décidera qu’elle soit !
Ce que rappelle aussi Semiane à propos de son compère Kamel, de plus en plus vilipendé et même menacé de mort par un imam, c’est que le chroniqueur n’aura cessé vingt ans durant de « créer de la pensée quotidiennement » et de « créer du sens » dans un monde apparemment vidé de toute autre substance que celle de la pensée unique. Dans la foulée, Daoud lui-même relèvera le rôle vital de la chronique en ces années terribles, où un public nombreux et fervent trouvait un formidable exutoire.
Diagnosticien du présent, au sens où l’entendait un Michel Foucault, le « libéral » Kamel Daoud est devenu suspect numéro un dans son pays (et ailleurs) du fait de ses positions et de la renommée internationale que lui a valu son roman Meursault contre-enquête, mais le chroniqueur n’épargne pas pour autant les alliés occidentaux des fourriers du terrorisme. Ainsi vient-il de tonner contre l’aveuglement opportuniste de l’Occident après les attentats en Catalogne !
Les chroniques réunies dans Mes indépendances ne sont pas des sermons anti-islamistes, pas plus qu’ils ne flattent les tiers-mondistes hors sol, les athées dogmatiques, les néoconservateurs ou les affairistes cyniques. On y découvre une clairvoyance rare et un aplomb d’un grand courage intellectuel, un sens du détail révélateur accordé a un bonheur inventif de la formule signalant l’écrivain à part entière, brassant notre langue avec un allant jouissif. Et puis il voyage, et puis il aime la vie !
Mais sa colère n’est pas moins vivace. Dans sa chronique intitulée L’Arabie saoudite, un Daesh qui a réussi, parue en novembre 2016 dans le New York Times, Daoud décrit ainsi l’industrie de persuasion émanant de ce qu’il appelle la Fatwa Valley : « Il faut vivre dans le monde musulman pour comprendre l’immense pouvoir de transformation des chaînes de TV religieuses sur la société par le biais de ses maillons faibles: les ménages, les femmes, les milieux ruraux. La culture islamiste est aujourd’hui généralisée dans beaucoup de pays – Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie, Egypte, Mali, Mauritanie. On y retrouve des milliers de journaux et des chaînes de télévision islamistes (comme Echourouk et Iqra), ainsi que des clergés qui imposent leur vision unique du monde ».
Or, qu’avons-nous à opposer à la propagande théologico-politique de la Fatwa Valley ? Je me le demandais récemment, en Californie, en assistant au matraquage publicitaire des chaînes de télé américaines. Je me suis demandé aussi comment résister à la persuasion clandestine véhiculée par les big data de la Silicon Valley, ou aux vérités falsifiées des médias et de leur minable accusateur présidentiel, plus menteur qu’eux ? Kamel Daoud, pas plus qu’Alexandre Vialatte, ne nous donne de réponses « politiques » à ces questions, mais leurs chroniques sont autant d’actes libérateurs, bons pour les sens et la tête !
Le rêveur Duval a la sagesse folâtre

Pareil en ce qui concerne Jean-Francois Duval, dans son Bref aperçu des âges de la vie, qui prouve qu’on peut être philosophe en méditant assis devant un couteau à pamplemousse ou en observant tendrement sa vieille mère peinant à nouer ses lacets…
Journaliste avant d’être écrivain, Jean-Francois Duval, auteur d’une dizaine de livres, a longtemps disposé de ce sésame qu’est une carte de presse, qui lui a permis de rencontrer quelques grands auteurs et autres clochards célestes dont il a documenté la vie quotidienne et recueilli les pensées ailées. C’est à ce titre sans doute qu’il a rencontré Alexandre Jollien, qui le gratifie ici d’une préface affectueuse.
Jolie anecdote à ce propos quand, en promenade au parc Mon-Repos lausannois dont les volières jouxtent un bassin à poissons rouges, Alexandre demande à Jean-François : « Plutôt oiseau ou poisson ? » Et Jean-François: « Plutôt oiseau, avec des ailes pour gagner le ciel ». Mais Alexandre : « Plutôt poisson, pour échapper aux barreaux»…
Ainsi ce Bref aperçu des âges de la vie fait-il valoir de multiples points de vue qui, souvent, se relativisent les uns les autres sans forcément s’annuler, et c’est là que l’âge aussi joue sa partie.
Puisant ses éléments de sagesse un peu partout, Duval emprunte à Jean-Luc Godard, rencontré à Rolle au milieu de ses géraniums, l’idée selon laquelle les âges les plus réels de la vie sont la jeunesse et la vieillesse. Georges Simenon pensait lui aussi que l’essentiel d’une vie se grave dans les premières années. Pour autant, Duval se garde d’idéaliser l’enfance ou l’âge de la retraite (ce seul mot d’ailleurs le fait rugir), pas plus que le commensal de Charles Bukowski n’exalte les années 60 en général ou Mai 68 en particulier.
Philosophiquement, Jean-Francois Duval s’inscrit à la fois dans la tradition des stoïciens à la Sénèque ou des voyageurs casaniers à la Montaigne, et plus encore dans la filiation des penseurs-poètes américains à la Thoreau, le « philosophe dans les bois ». Le nez au ciel mais les pieds sur terre, il constate plaisamment l’augmentation de la presbytie liée à l’âge, qui nous fait trouver plus courts les siècles séparant les fresques de Lascaux des inscriptions numériques de la Silicon Valley, et plus dense chaque instant vécu.
Rêvant de son père, le fils décline franchement l’offre de poursuivre avec celui-ci une conversation sempiternelle dans un hypothétique au-delà, en somme content de ce qui a été échangé durant une vie où le non-dit, voire le secret, gardent leur légitimité; et ses visites à sa mère nonagénaire ne sont pas moins émouvantes, mais sans pathos.
Un bon livre est, entre autres, une cabane où se réfugier des pluies acides et des emmerdeurs furieusement décidés à sauver le monde. Dans ses observations de vieil ado hors d’âge, Jean- François Duval constate que la marche distingue l’adulte pensif de l’enfant (et du jogger ou du battant courant au bureau), de même que la station assise caractérise le penseur et son chien, tandis que le noble cheval dort debout dans la nuit rêveuse – tout ça très Vialatte aussi…
De fait, la fantaisie émane du plus ordinaire chez notre Genevois peu calviniste que sa tondeuse à gazon mécanique emporte au-dessus des pelouses tel un ange de Chagall. Alexandre Vialatte dirait que c’est ainsi qu’Allah est grand, alors que Jollien souligne le bon usage de tous nos défauts (inconséquence et paresse comprises) dans notre effort quotidien de bien faire, rappelant l’exclamation du poète Whitman: « Un matin de gloire à ma fenêtre me satisfait davantage que tous les livres de métaphysique ! »
Alexandre Vialatte : Résumons-nous. Préface de Pierre Jourde. Robert Laffont, collection Bouquins. 1326p, 2017.
Kamel Daoud. Mes indépendances. Chroniques 2010-2016. Préface de Sid Ahmed Semiane. Actes Sud, 463p, 2017.
Jean François Duval, Bref aperçu des âges de la vie. Préface d’Alexandre Jollien. Michalon, 238p, 2017. Sans oublier son autre délectable recueil intitulé Et vous, faites-vous semblant d’exister ?, paru aux Presses universitaires de France en 2010 avec une préface de Denis Grozdanovitch.
***
2. Comme un cercle vicieux

Dessin: Matthias Rihs
Le Big Brother de l’ère numérique est une hydre mondialisée. Les uns y voient la fin robotisée de l’humanité. Les autres une mutation qu’il s’agit de maîtriser. Fabuleux terrain d’observation et d’exercice pour l’imagination des écrivains et des artistes…
Bientôt vingt ans après le Truman show, le romancier Dave Eggers, avec Le Cercle, brosse une fresque critique étincelante à la Orwell. Et Don DeLillo, dans Zero K, observe les retombées humaines de l’idéologie transhumaniste en mal d’immortalité.
Droit au but! Droit au but? Droit au but ce sera, pour tout de suite, le paradis, et pour plus tard la vie éternelle. Est-ce que ça vous tente? Si c’est le cas, on embarque! D’abord pour la Californie, ensuite pour la Confluence.
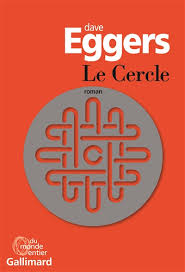
Donc tout de suite, voici le paradis du Cercle où la jeune Mae Holland débarque un jour de son trou de province. Le Cercle? C’est d’abord l’Entreprise, au top mondial depuis quelques années, qui concentre plus de 10 000 collaborateurs dans son campus des abords de San Francisco, noyau dur d’une constellation planétaire comptant des millions d’affiliés et dirigée par un trio de Sages.
L’Entreprise, ce serait Google+Facebook+Amazon+XYZ en un seul multipack soumis à la même idéologie-qui-gagne, en un mot: le paradis où tout est fun et rentable, à quelques conditions (infernales) près.
Et le trio des Sages, formé d’un geek génial du numérique en sweat à capuche, d’un manager richissime vivant comme un richissime manager et d’un communicateur grave sympa, il est démarqué de personnages réels non moins typés, de Bill Gates à Steve Jobs, ou de Jeffrey Preston Bezos à Mark Zuckerberg ou Sundar Pichai, entre autres.
Ici l’on positive!
L’entrée du paradis, pour la jeune Mae Holland, 24 ans et toutes ses dents de croqueuse ambitieuse, est radieux sous l’azur californien et ses vastes pelouses sont pavées de pierres dont les inscriptions signifient autant de bonnes intentions: «Rêvez!», «Participez!», «Rejoignez la communauté!» «Innovez!», «Respirez!».
Illico Mae sent qu’elle doit à son amie Annie, ancienne coloc de fac qui fait désormais partie du Top 40 des responsables du Cercle, et à laquelle elle doit son engagement dans la communauté des élus, cette seconde naissance. En quelques heures, puis en quelques jours, elle va découvrir les merveilles réelles de ce paradis où tout est possible, tandis que nous, pauvres pécheurs lecteurs, nous pressentons le piège de moins en moins virtuel…
En moins d’un jour, visitant les bâtiments mirifiques du Cercle, les immenses bureaux en open space pleins de gens souriants, les restaus conviviaux, les boutiques ludiques, les espaces dancingo-sportifs, la phénoménale bibliothèque d’un des trois Sages, les immenses salles de «réu» et j’en passe, Mae Holland est éblouie et transportée au septième ciel, et ce d’autant plus que les amis d’Annie ont vite fait de l’initier (principes basiques du Cercle) et de l’appareiller (bureau perso, ordis griffés dernier cri et à son nom, etc.).
En quelques jours ensuite, dûment connectée et briefée, elle va constater que tous positivent autour d’elle, qu’elle existe pour tous, que tous attendent d’elle quelque chose («Il faut penser communauté» sera la première règle), que sa bonne volonté fait vite d’elle une star éventuelle, mais attention: chaque geste qu’elle accomplit est aussitôt noté et évalué de près (Annie et le staff l’ont à l’œil) autant que de loin: ses milliers de followers sont prêts à l’acclamer ou à s’inquiéter du moindre de ses manquements.
Car non seulement il faut «penser» communauté, mais il faut agir et réagir en phase avec les préceptes et les nouveautés géniales issues des cerveaux du Cercle. Et gare, Mae, si tu ne partages pas ta passion du kayak ou si tu ne dis pas au Cercle que ton père a la sclérose en plaques, vu que pour les assurances et le suivi médical le Cercle assure!
Premier exemple d’innovation conçue par l’un des Sages et en voie de commercialisation mondiale: la mini-caméra connectée, à 50 dollars l’unité, qui va vous renseigner sur ce qui se passe dans le jardin de votre voisin ou ce que font les djihadistes à Mossoul, sur telle rue de Corée du nord ou tel camp de réfugiés en Libye (vocation de surveillance politico-humanitaire du Cercle), étant entendu que plus rien des actes inappropriés des Terriens n’échappera désormais à l’œil de Big Mother Data. D’ailleurs certains politiciens seront les premiers à se réclamer de cette transparence et à se prêter à l’expérience proposée par les Sages du Cercle.
Tous connectés, tous transparents
Ceci pour la transparence sociale et politique, mais nous sommes tous concernés, et Mae Holland va la vivre, cette transparence au quotidien, en devenant le cobaye, puis la mascotte du Cercle, pour les idéologues duquel la vie privée de chacun et le moindre secret personnel sont des atteintes à l’idéal communautaire.
A ce propos, relançant le thème de la langue de bois (novlangue) d’Orwell, dans 1984, où le mensonge devient la vérité et vice versa – un peu comme dans la tête à l’envers de Donald Trump –, Dave Eggers synthétise quelques-uns des préceptes moraux et sociaux du Cercle par des formules-choc reçus et intégrés par Mae et ses followers comme des articles de catéchisme :
LES SECRETS SONT DES MENSONGES
PARTAGER C’EST AIMER
GARDER POUR SOI C’EST VOLER…
Dans un tout autre contexte, le logicien soviétique Alexandre Zinoviev, grand démystificateur de l’idéologie communiste, écrivait dans L’Avenir radieux: «Même la vérité nous la mentons, et quant au bien nous le faisons comme le mal».
Quant à Dave Eggers, il réactualise en somme Le Meilleur des mondes selon Aldous Huxley (publié en 1932) évoquant déjà une dictature aux dehors de démocratie, prison sans mur dont les prisonniers n’auraient pas l’idée de s’évader, système de dépendance fondé sur la consommation et le divertissement dont les membres bien soumis (bonjour Houellebecq!) préféreraient leur servitude soft à une liberté plus hard.
Les failles du système
Comme on peut s’y attendre, cependant, la mise à nu de la vie publique et privée de la jeune femme, suivie et commentée 24 heures sur 24 par la meute de ses «amis», ne sera pas tout à fait sans faille, et le sexe sera la paille dans le mécanisme après sa rencontre d’un personnage pas vraiment net qu’elle a dans la peau.
Et puis il y a Mercer, l’ex un peu pataud de Mae Holland, artisan-artiste sculptant des bois de cerfs et dirigeant sa petite entreprise, ni branché ni connecté et déplorant que toute communication avec son amie se trouve répercutée sur les réseaux sociaux, au dam de tout contact personnel ordinaire.
Or Mae, devenue superstar du Cercle, ne saurait tolérer aucune critique de ce paumé à bajoues naissantes (à 25 ans!) outrageusement imbu de son indépendance. Ainsi entreprend-elle, pour le sauver, de le traquer publiquement au moyen d’une caméra mobile, au fil d’une véritable chasse à l’homme en pleine nature sauvage, rappelant les plus sombres épisodes de la série critique Black Mirror ou la fuite du protagoniste de Truman show, jusqu’à la mort «accidentelle» du dissident.
Belle fable romanesque, limpide et lisible par tous, adaptée au cinéma de manière assez superficielle par James Ponsoldt, avec Emma Watson dans le rôle de Mae Holland, Le cercle de Dave Eggers illustre bien la formidable emprise des empires numériques sur notre vie quotidienne (un clic et je balance cette chronique sur BPLT via le cloud, touchant virtuellement mes 4026 amis Facebook) autant que sur le commerce et l’industrie, la Bourse et la gouvernance politique.
Mais jusqu’où ira le pouvoir des big data? C’est la question que posent Marc Dugain et Christophe Labbé dans L’Homme nu, qui constitue en somme la version documentaire factuelle de l’univers évoqué par Dave Eggers, où les auteurs décrivent un homme de demain entièrement inféodé aux grandes entreprises dominant les technologies nouvelles de l’information, plus puissantes que les institutions et les autorités politiques. Sous couvert de démocratie, la Technologie et l’Argent règnent en réalité, même si le Président tweete que c’est lui le boss!
Dans la foulée, les auteurs abordent une question plus fondamentale encore touchant à l’avenir de l’humanité et à l’idéologie dite du transhumanisme, laquelle postule l’avènement d’une sorte de surhomme robotisé.
Dave Eggers
De la complétude à la Confluence
A un moment donné, dans Le Cercle de Dave Eggers, qui ne développe pas vraiment cette thématique, une nouvelle inscription apparaît cependant sur l’une des pierres de la pelouse vert espérance du campus, proposant de «Penser la complétude», et de «compléter le cercle». Cela faisant allusion, sans doute, à la nouvelle philosophie transhumaniste où d’aucune voient le prochain avenir radieux. Dans la même optique, et tout récemment encore, un grand titre et un dossier du magazine Le Point présentaient la Silicon Valley comme une nouvelle Athènes, dont les penseurs seraient les Platon et les Aristote de demain avec, en point de mire, l’immortalité garantie par la déesse Science.
Si Marc Dugain et son compère Labbé peignent le diable numérique sur la muraille, dans L’Homme nu, alors qu’un Luc Ferry, dans La révolution transhumaniste, se veut plus nuancé, et que Michel Serres, dans une tribune libre de la revue Philosophie, s’oppose à la vision panique d’une humanité esclavagisée par les robots, c’est finalement dans le dernier roman de Don DeLillo, Zero K, que j’aurai trouvé pour ma part, comme dans Le Cercle, mais en plus vertigineux, la projection la plus vivifiante d’une imagination achoppant à la réalité nouvelle autant qu’aux fantasmagories de notre drôle d’espèce.
Un vrai roman doit passer par le mystère de l’incarnation, si j’ose dire, et c’est dans la chair travaillée par le désir et la maladie, l’irrationnel et la mort que le livre Dave Eggers échappe aux stéréotypes de la dystopie, de même que c’est par la stupeur et les tremblements de Jeffrey Lockart, fils du milliardaire Ross décidé à «offrir» à sa jeune femme, atteinte d’une maladie mortelle, une «suspension cryonique» sous congélation, en attendant son accession à la Confluence immortelle, que Zero K fait participer le lecteur à la «réalité augmentée» de la littérature.
Dave Eggers. Le cercle Traduit de l’américain par Emmanuelle et Philippe Aronson. Gallimard, 2016
Marc Dugain et Christophe Labbé. L’Homme nu. La dictature invisible du numérique. Laffont, 2016
Don DeLillo. Zéro K, traduit de l’américain par Francis Kerline. Actes Sud, 2017
Luc Ferry, La révolution transhumaniste. Plon, 2016
Michel Serres, Philosophie, août 2017.
***
3. Le roman d’Anton Pavlovitch
nous révèle un autre Tchekhov

Dessin: Matthias Rihs
Bien plus que la seule bio quasi exhaustive du grand écrivain russe, qui modifie de beaucoup son image trop souvent édulcorée, voire diaphane, c’est une traversée de son œuvre de nouvelliste et de dramaturge que nous propose «Anton Tchekhov – une vie» de Donald Rayfield, et un aperçu prodigieusement vivant de son univers familial, du milieu littéraire et théâtral qu’il fréquenta et de la société russe de la fin du XIXe et du début du XXe siècle.
Anton Pavlovitch Tchekhov (1860-1904) n’a pas signé un seul roman, comme il y aspirait à certains moments et malgré le fait que certains de ses longs récits – à commencer par La steppe qui lui valut sa première grande popularité –, tendent à la dimension romanesque, et ce n’est pas le moindre paradoxe que la vie de ce petit-fils de serfs très peu académique fasse l’objet, sous la plume d’un vénérable prof d’université anglais, d’un aussi formidable «roman» qu’ Anton Tchekhov – une vie.
Comme le relevait Henri Troyat (né Lev Aslanovitch Tarassov), qui lui consacra lui-même une biographie chatoyante parue en 1984, Tchekhov est resté longtemps à moitié méconnu en France, où son théâtre était certes célébré dès les années 1920, notamment grâce à Georges Pitoëff, alors que sa production narrative, comptant plus de deux cent cinquante récits, tantôt très brefs et satiriques (à ses débuts surtout de tout jeune étudiant en médecine), et de plus en plus développés et lestés de pénétration incisive ou de mélancolie, représente une véritable comédie humaine à la russe.
Brassant catégories sociales et types humains, Tchekhov y montre une connaissance de notre drôle d’espèce affûtée par sa pratique de la médecine dans les milieux les plus humbles et la clientèle la moins relevée – notamment les prostituées moscovites dont il soignait au mieux les «maladies de peau» – la syphilis –, après avoir perdu son pucelage à treize ans dans une maison close de son bled natal de Taganrog, sur les rives de la mer d’Azov…
La myopie d’Elsa Triolet et une certaine méconnaissance
Avant Henri Troyat, Elsa Triolet avait été la première biographe de Tchekhov en langue française, dans le premier des 20 volumes présentant l’œuvre aux Editeurs français réunis, dès 1951, mais cette introduction lourdement plombée par les considérations «léninistes» de la camarade évidemment déçue de ne pas voir Anton Pavlovitch, ami du peuple présumé, embrasser la cause révolutionnaire, souffrait en outre d’un manque d’archives qu’on ne saurait lui reprocher – et notamment de l’énorme correspondance divulguée par la suite, que les lecteurs de langue français ont découverte en 2016 dans la collection Bouquins sous le titre de Vivre de mes rêves , avec une préface épatante d’Antoine Audouard.
Enfin, l’on se doit de citer une autre biographie antérieure, publiée en 1962 par le médecin et écrivain Quentin Ritzen, dans la collection Classiques du XXe siècle, bien plus fine et détaillée (quant aux récits de Tchekhov) que celle de Triolet, mais sans l’ampleur extraordinaire du (succulent) pavé de Donald Rayfield que chacune et chacun se procurera avec un tube de bonne colle à sa portée vu que sa reliure brochée à la diable se désosse dès qu’on ouvre le bouquin!
Un biographe qui scanne l’époque et sonde les cœurs
Donald Rayfield, digne septuagénaire professeur de russe et de littérature ukrainienne à l’université Queen Mary de Londres, est sorti de son cabinet capitonné de philologue lettré pour sillonner la Russie, de bibliothèques en centres d’archives et par tous les lieux qui ont gardé des traces de Tchekhov, de Moscou à Taganrog, et de Saint-Pétersbourg à Yalta ou Badenweiler, exception faite de l’île de Sakhaline et de Hong Kong…
Comme il l’explique dans sa préface, il a eu recours à l’immense fonds d’archives représenté par les lettres non détruites ou censurées de Tchekhov (cinq mille lettres) et de ses correspondants (sept mille lettres dont la moitié n’a jamais été utilisée), alors que des centaines de lettres du magnat de la presse Alexei Souvorine, protecteur et ami d’Anton Pavlovitch, mais aussi personnage influent proche du pouvoir et des milieux réactionnaires, contenant probablement des secrets d’Etat, restent inaccessibles.
Cela pour le travail d’investigation, déjà énorme, de l’historien anglais, ne constituant que la première moitié de sa tâche de biographe, la seconde consistant à raconter tout ça de manière si possible captivante.
Or c’est là que son «tissage», nourri par les multiples témoignages (notamment) épistolaires et truffé de citations, devient ce «roman» que j’ai dit, merveilleusement vivant et nuancé, avec sa foison de personnages hauts en couleurs et de situations souvent abracadabrantes.
L’attention des lecteurs pourrait se noyer dans cet océan de faits rapportés avec la plus grande minutie, et pourtant il n’en est rien: de son enfance de «martyr heureux», si l’on ose cet oxymore correspondant à l’exacte réalité, à sa double carrière de médecin (sa vraie femme, comme il aimait à le dire) et d’écrivain (la littérature étant sa maîtresse), l’invraisemblable saga de la famille Tchekhov et les multiples liaisons féminines d’Anton Pavlovitch esquivant à tout coup le mariage, pour céder enfin à l’opiniâtre Olga Knipper qui l’accompagnera jusqu’à sa dernière nuit: tout est là ou peu s’en faut – car maints secrets demeurent – et comme Donald Rayley sait également tout de l’œuvre, nous voyons mieux comment le moindre détail vécu devient sujet d’un récit ou élément d’une pièce de théâtre à venir.
Peut-on être un enfant «martyr», battu par son père dès l’âge de cinq ans, comme son père le fut par son grand-père, et parler quand même de ce paternel bigot et violent, moralisant et jean-foutre, avec autant de rancune que de respect, non sans se rappeler avec reconnaissance d’inoubliables jeunes années?
On le peut en effet quand on a le caractère trempé d’Anton Tchekhov. Ainsi, à dix-neuf ans, écrit-il à son frère Alexandre: «Le despotisme et le mensonge ont si bien défiguré notre enfance que son souvenir inspire la nausée et l’horreur».
Mais à la même époque il écrit aussi: «Mon père et ma mère sont, pour moi, les seules personnes sur cette terre pour lesquelles rien ne me paraîtra jamais trop beau. Si je parviens un jour à quelque chose, ce sera grâce à eux. Ce sont des gens excellents et, à lui seul, l’amour sans limites qu’ils portent à leurs enfants les place au-dessus de toute louange, fait écran à tous leurs défauts qu’une vie difficile peut faire apparaîtra».
Or cette «vie difficile», Tchekhov va la rencontrer partout et l’affronter à sa manière unique faite de réserve solide et d’humour. Soutien effectif de famille à seize ans, après la faillite de son père fuyant à Moscou, il ne rejettera jamais ni l’indigne autocrate ni ses frères – ces ivrognes invétérés – et pariera toujours pour «le progrès» à proportion de l’état lamentable de la société sans se laisser tenter – moujik dans l’âme et sachant les défaut des moujiks – par aucune idéologie, religieuse ou politique.
Indifférent? Bien plutôt, méfiant envers le mensonge des beaux parleurs, à l’écoute des gens sans les juger.
À ce propos, Henri Troyat écrivait très justement: «Du moujik au prêtre, de l’instituteur au marchand, du juge au délinquant, toutes les catégories sociales, tous les métiers, toutes les déchéances, toutes les ambitions sont représentés dans ses récits. L’activité du Tchékhov médecin lui a permis de pénétrer dans les intérieurs les plus divers et d’en capter, subrepticement, les secrets, et quand il aborde un thème, il n’a qu’à interroger sa mémoire pour qu’elle lui restitue l’atmosphère d’un logis, le parler d’un paysan, les minauderies d’une coquette. Lire ces récits aux multiples facettes, c’est accomplir un voyage vertigineux dans le passé de la Russie, avec, pour guide, un homme clairvoyant, moqueur et fort. C’est découvrir non seulement un écrivain, mais un pays».
L’inatteignable amoureux, la maladie et la mort
Ce qui saisit à la lecture de cette somme, c’est la façon dont Donald Rayfield rend compte de ce qu’on peut dire «l’épaisseur de l’Histoire», entre vies minuscules et séismes d’époque. Ici ‘, ce sont les embrouilles familiales à n’en plus finir, et là ce seront la censure d’Etat imposée aux écrivains ou la sauvage répression suivant l’assassinat du tard, etc.
Avec un sens tout anglais, pragmatique, réaliste à qui-on-ne-la-fait-pas, le biographe accumule, tirés des innombrables sources consultées, les détails apparemment les plus anodins de chaque vie, tout en insérant chaque personnage dans la fresque sociale entre vertus publiques et vices privés, ou le contraire…
Tchekhov se disait lui-même atteint d’«autobiographophobie» et protégeait farouchement sa vie privée, non sans archiver le moindre bout de papier, et cela vaut pour toutes ses relations, notamment féminines, autant que pour le roman de ses relations avec Alexei Souvorine le potentat «raspoutinien» de la presse nationaliste dont il critiquera vertement les positions antisémites au moment de l’affaire Dreyfus.
Et les femmes? Un poème, car il les fait toutes craquer, et le feuilleton n’a rien d’éthéré, qui passe – entre maintes virées chez «ces dames» – par des romances où l’épouse légitime (la médecine) et la première maîtresse (la littérature) dissuaderont le plus souvent les multiples butineuses de façon parfois cruelle, à quelques exceptions près…
Le mariage? Non sans malice frottée de cynisme, Tchekhov écrit à Souvorine qui le presse de faire le pas: «Soit! Je me marie, si c’est ce que vous voulez. Mais voici mes conditions: rien ne doit changer, c’est-à-dire qu’elle doit vivre à Moscou et moi à la campagne d’où je viendrai la voir. Un bonheur qui en effet se perpétue de jour en jour, d’un matin à l’autre –je ne le supporterai pas (…) Je promets d’être un excellent mari, mais donnez-moi une femme qui, comme la lune, n’apparaîtrait pas dans mon ciel chaque jour. N.B. Me marier ne fera pas de moi un meilleur écrivain».
Et la mort de Tchékhov? On connaît la scène, à Badenweiler où, avec Olga, il achève son combat contre la maladie; la bouteille de champagne rituellement commandée par le docteur Schwörer, et son dernier mot: «ich sterbe», avant de boire son dernier verre et de rendre son dernier souffle comme en s’excusant – comme il s’est excusé après son premier crachement de sang à vingt-quatre ans – on connaissait tout ça.
Mais là encore les mille détails supplémentaires rapportés par Donald Rayfield sur les relations d’Olga avec la famille avant et après la mort d’Anton, le transport du corps dans un wagon d’huître fraîches, la sarabande des quatre mille pelés et tondues, fervents lecteurs ou curieux sordides, accompagnant la dépouille d’Anton Pavlovitch au cimetière de Novodevitchi sous le regard effondré de son ami Gorki – et Chaliapine s’exclamant en pleurant: «et c’est pour cette racaille qu’il a vécu, pour elle qu’il a travaillé, enseigné, dénoncé», tout ça brassé par une vie et une œuvre – et quelle vie, quelle œuvre! –, tout ça se trouve bel et bien restitué dans Anton Tchekhov – une vie…
Donald Rayfield. Anton Tchekhov – une vie. Traduit de l’anglais par Agathe Peltereau-Villeneuve,et du russe par Nathalie Dubourvieux. Editions Louison, 553p. 2019.
Anton Tchekhov. Vivre de mes rêves – lettres d’une vie. Traduites et annotées par Nadine Dubourvieux. Editions Laffont, coll. Bouquins, 1053p. 2016.
***
4. Plus fort que la mort

En 2001 paraissait l’un des plus beaux livres de Janine Massard, et certainement le plus émouvant: Comme si je n’avais pas traversé l’été.
Il est certains livres qu’il paraît presque indécent de «critiquer» tant ils sont chargés de composantes émotionnelles liées à un vécu tragique, et tel est bien le cas du nouveau roman de Janine Massard, tout plein de ses pleurs et de sa révolte de femme et de mère confrontée, en très peu de temps, à la mort «naturelle» de son père, puis à celle de son mari et de sa fille aînée, tous deux victimes du cancer.
La volonté explicite de tirer un roman de cette substance existentielle et l’effort de donner à celui-ci une forme distinguent pourtant cet ouvrage d’un simple «récit de vie» où ne compteraient que les péripéties.
Autant pour se ménager le recul nécessaire que pour mieux dessiner ses personnages et pour «universaliser» son récit, Janine Massard revendique le droit à l’invention, et c’est aussi sa façon de faire la pige au «scénariste invisible, ce tordu aux desseins troubles, qui a concocté cette histoire à n’y pas croire».
Cette transposition littéraire ne saurait être limitée à un artifice superficiel: en véritable écrivain, Janine Massard l’investit avec vigueur et légèreté, quand tout devrait la terrasser et la soumettre au poids du monde. Alia (dont le prénom signifie «de l’autre côté» en latin) endosse ici le rôle principal d’une femme qu’on imagine dans la cinquantaine, du genre plutôt émancipé, protestante «rejetante» peu encline à s’en laisser conter par le Dieu fouettard de sa famille paternelle, et fort mal préparée aussi à l’irruption, dans sa vie de rationaliste, de la maladie et de la mort.
En écrivain, Janine Massard se montre hypersensible au poids des mots, lorsque bascule par exemple le sens de l’adjectif «flamboyant» (marquant la victoire de la lumière) pour qualifier la «tumeur flamboyante» qui frappe soudain Bernard, le mari de la protagoniste.
De la même façon, la romancière recrée magnifiquement les atmosphères très contrastées dans lesquelles baigne Alia, entre pics d’angoisse et phases d’attente-espoir, que ce soit dans la lumière lémanique (Alia, comme son père, étant «du lac» et très proche de la nature maternelle), les couloirs d’hôpitaux où se distillent les petites phrases lamentables des techniciens-toubibs si peu doués en matière de relations humaines, ou en Californie dont les grands espaces et la population déjantée conviennent particulièrement à sa grande fille nique-la-mort.
Par ailleurs, le recours à l’humour multiplie les ruptures heureuses, par exemple pour faire pièce au désarroi solitaire d’Alia: «Elle devrait mettre à cuire une tête de veau, ça ferait une présence sur la table, en face d’elle…»
Livre de la déchirure et du scandale de la mort frappant la jeunesse, ressentie comme absolument injuste par la mère qui a porté l’enfant pour qu’il vive (nul hasard qu’Alia, soudain atteinte d’eczéma atopique, se compare au Grand Gratteur Job vitupérant le Créateur), le roman de Janine Massard est aussi, à l’inverse, un livre de l’alliance des vivants entre eux, des vivants et des morts, un livre du courage, un livre de femme, un livre de mère, un livre de vie. A un moment donné, rencontrant la Bosniaque Hanifa de Sarajevo, Alia découvre «l’explosion de l’expression créatrice apparue comme la seule réponse à la barbarie».
Or, elle-même va «racheter», en écrivant, à la fois son passé et l’enfance de ses deux filles, les beaux moments passés avec Bernard et la force salvatrice du rire ou de la solidarité, la valeur du rêve aussi et la puissance insoupçonnée de l’irrationnel qu’un initié aux pratiques zen va lui révéler en passant, la soulageant physiquement et moralement à la fois. Elle qui se moque volontiers de ceux qui lui recommandent à bon compte de po-si-tiver («il paraît qu’il faut apprendre à vivre sa mort au lieu de mourir sa vie, parole de vivant, ça cause distingué un psy bien portant») ne tombe pas pour autant dans la jobardise New Age, mais découvre bel et bien une nouvelle dimension de l’existence aux frontières du visible et des certitudes.
Dès le début de son livre, Janine Massard affirme «qu’une mort vous aide aussi à vivre», et cette révélation est d’autant plus frappante que cette nouvelle vie, cernée de mort mais d’autant plus fortement ressentie, est «sans mode d’emploi»…
Janine Massard. Comme si je n’avais pas traversé l’été. L’Aire, 205 pp.
***
5. Christoph Ransmayr,
grand arpenteur des lieux et du temps

Christoph Ransmayr
Autant par son éblouissant talent de chroniqueur, dans Atlas d’un homme inquiet, que par sa verve inventive de romancier, avec Cox ou la course du temps, l’auteur autrichien s’impose au premier rang des écrivains européens.
J’étais là et c’est maintenant…
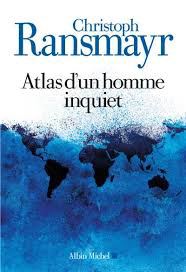
Évoquant la tombe d’Homère qu’il retrouve, perdue dans les hauteurs de l’île d’Ios si présente à mon souvenir, Christoph Ransmayr écrit ceci qui m’évoque toute la Grèce de tous les temps sous le ciel des Cyclades: «À travers le bruissement du vent, j’entendais confusément les si nombreuses voix qui s’étaient élevées au fil des millénaires et jusqu’à aujourd’hui pour affirmer qu’un homme appelé Homère devait forcément être immortel du simple fait qu’il n’avait jamais existé. Nul homme, nul poète ou conteur ne pouvait avoir eu la force d’engendrer à lui seul une foule pareille de héros, de dieux, de guerriers, de créatures vouées à l’amour, au combat, au deuil, nul ne pouvait avoir eu la force de chanter la guerre de Troie et les errances d’Ulysse en usant pour ce faire de tonalités, de rythmes si divers, d’une langue aux nuances si infiniment variées, non, cela ne pouvait avoir été que l’œuvre de toute une théorie de poètes anonymes, d’aèdes qui s’étaient fondus peu à peu en une forme fantomatique baptisée Homère par les générations ultérieures.
Dans cet ordre d’idées, un tombeau édifié il y a deux ou trois mille ans sur l’île d’Ios ou sur quelque bande côtière de l’Asie mineure ou du monde des îles grecques ne pouvait être qu’un monument à la mémoire de conteurs disparus».
Chaque récit de cet Atlas d’un homme inquiet commence par l’incipit m’évoquant la formule fameuse: «J’étais là, telle chose m’advint », mais c’est ici un «je vis» auquel la traduction française donne le double sens de la vue et de la vie : «Je vis le séjour d’un dieu par 26° 28 ‘ de latitude sud et 105° 21’ de longitude ouest : loin, très loin dans le Pacifique, une île rocheuse prise dans un tourbillon d’oiseaux de mer», «Je vis une silhouette lointaine devant une tour de guet délabrée de ce rempart de près de neuf mille kilomètres de long appelé Wànli Chang Chén – mur inconcevablement long dans le pays de ses bâtisseurs, muraille de Chine dans le reste du monde», «Je vis une tombe ouverte à l’ombre d’un araucaria géant», «Je vis un serveur s’étaler de tout son long sur le parking d’un café de la ville côtière californienne de San Diego», «Je vis une chaîne de collines noires, rocheuses, sur laquelle déferlaient des dunes de sable», « Je vis un taureau de combat noir andalou par un radieux dimanche des Rameaux aux grandes arènes de Séville», «Je vis une jeune femme dans un couloir d’une éclatante propreté du service psychiatrique d’un établissement nommé Hôpital du Danube, un vaste complexe de bâtiments situé à la lisière est de Vienne»…
Et ainsi à septante reprises et en septante lieux de la planète et des temps alternés de la splendeur naturelle et de la guerre des hommes, de la forêt pluviale et d’un chemin de croix, sur une place de village autrichien où un vieil homme qui fait semblant de dormir ne fait pas semblant de mourir, et c’est le monde magnifié malgré le Laos défolié par les bombardiers, c’est l’humanité partout accrochée à la vie : «Je vis une chèvre noire au bord d’un court de tennis envahi par les roseaux», «Je vis un gilet de sauvetage rouge au bord d’un champ d’épaves flottant dans l’océan indien», «Je vis un homme nu à travers mes jumelles de derrière un fourré de buissons-ardents poussiéreux où je me tenais caché», «Je vis une femme éplorée dans la sacristie de l’église paroissiale de Roitham, un village des Préalpes autrichiennes d’où l’on avait vue sur des massifs portant des noms tels que monts d’Enfer et monts Morts», «Je vis une étroite passerelle de bois qui menait dans les marais de la mangrove sur la côte est de Sumatra», «Je vis une fillette avec une canne à pêche en bambou au bord de la rivière Bagmati, à Pashupatinath, le secteur des temples de Katmandou», «Je vis des îles de pierres plates émergeant de l’eau lisse du lac Kunming au nord-ouest de Pékin», et chaque fois c’est l’amorce d’une nouvelle fugue à variations inouïes…
Mais où se trouve-t-on donc ? Dans un film de Werner Herzog ou dans un recueil de nouvelles de Dino Buzzati ? Dans un roman de Joseph Conrad ou dans un récit de Francisco Coloane ? À vrai dire nulle référence, nulle influence, nulle comparaison, ou des tas de comparaisons et de relances, quantité d’images en appelant d’autres et d’histoires nous en rappelant d’autres se tissent et se tressent dans ce grand livre hyper-réel et magique à la fois, accomplissant comme aucun autre le projet d’une géopoétique traversant les temps et les âmes, évoquant les beautés et les calamités naturelles avec autant de précision et de lyrisme qu’il module pudeur et tendresse dans l’approche des humains de partout, pleurs et colère sur les ruines et par les décombres des champs de guerre, jusqu’à l’arrivée sur le toit du monde : « Je vis trois moines en train de marmonner dans une grotte surplombant un lac de montagne aux rives enneigées, à quatre mille mètres d’altitude, dans l’ouest de l’Himalaya».
Le temps d’un chef-d’œuvre
Dessin: Matthias Rihs
Avec Cox ou la course du temps, Christoph Ransmayr nous confronte, dans une Chine fabuleuse et non moins inquiétante, à l’antique obsession de l’homme se rêvant maître du temps.
On se trouverait d’abord comme en un rêve éveillé dans lequel on verrait le Très-Haut de ces cantons chinois, dit aussi le Seigneur des Dix Mille Ans, ou l’Auguste, composer au pinceau d’eau, sur une pierre blanche, un poème parfait dont les idéogrammes s’évaporeraient dans l’instant d’être écrits sous l’effet de la chaleur solaire.
Ensuite on serait prié d’imaginer une horloge à vent, sous la forme d’une jonque miniature toute faite d’argent, aux entrailles pleines de petits coffres remplis de minuscules jouets, offerte à l’Empereur désireux d’un objet reproduisant les temps propres à l’enfance, sensible donc au moindre caprice des brises; puis on verrait s’élaborer une horloge de feu, dont la forme imiterait un segment de la Grande Muraille et qui évoquerait le terrible temps compté des condamnés à mort.
Ces images ne tomberaient pas du ciel ni ne seraient gratuites: elles ponctueraient les épisodes d’un des plus beaux romans de ces dernières années, intitulé Cox ou la course du temps et confirmant une fois de plus, après l’inoubliable suite de l’Atlas d’un homme inquiet, le génie absolument singulier de l’écrivain autrichien Christoph Ransmayr.
De la réalité au rêve
Le ton et le tranchant du roman s’affirment dès sa première phrase: «Cox aborda la terre ferme chinoise sous voiles flottantes le matin de ce jour d’octobre où l’empereur de Chine, Qianlong, l’homme le plus puissant du monde, faisait couper le nez à vingt-sept fonctionnaires des impôts et agents de change».
Immédiatement intrigués, voire alléchés (telle étant l’humanité) par cette promesse de supplice, la lectrice et le lecteur se demandent de qui et de quoi l’on parle, et je ne crois pas leur gâcher le plaisir incessamment surprenant de 316 pages de lecture en révélant illico ce que l’Auteur précise «pour finir», à savoir que tout est vrai dans ce roman pour l’essentiel, qui touche à notre condition de mortels et aux questions que cela nous pose, alors même que les quelques faits historiques avérés ne sont qu’une base partielle et bidouillée…
Mais Qian Long (1711-1799), quatrième empereur de la dynastie Qing, a bel et bien régné, flanqué de ses quarante et une épouses et de quelque trois mille concubines, et ce fut un collectionneur d’horloges et d’œuvres d’art avisé. Cependant il ne rencontra jamais l’Anglais James Cox, fameux créateur d’horloges qui ne mit jamais les pieds dans la Cité interdite et se prénomme Alistair dans le roman, en grand deuil d’une petite fille de cinq ans et désespérant de voir sa moitié, la douce (et imaginaire) Faye, lui revenir du tréfonds de son désespoir.
Bref, ceci précisé, la lectrice et le lecteur seront brièvement horrifiés, comme Cox et les trois artisans-artistes qui l’accompagnent (Jacob Merlin, inscrit aux annales historiques sous le prénom de Joseph, et ses compères Aram Lockwood et Balder Bradshaw, virtuoses de micro-mécanique), par l’exécution publique du supplice des nez, comme ils le seront plus tard par le sort atroce réservé à deux médecins convaincus de menterie par le Très-Haut et dépecés vivants, mais ces cruelles chinoiseries ne sont que noirs détails (le vilain bout du nez du loup dans le chaperon rouge) dans la course aux horloges.
Celle-ci fut une réalité, on le sait, et les automates extravagants de Cox firent le bonheur du Chinois autant que du Tsar de Russie, mais la littérature, et plus précisément la poésie, traitent d’une autre dimension du réel, et l’on retrouve alors, chez Ransmayr, le mélange unique d’éléments concrets, tirés ici des mille complications de l’horlogerie et des rituels impériaux en la Ville pourpre (Zi jin cheng), ou de l’observation de la nature dans la double tradition des romantiques allemands et des peintres chinois, et de données humaines, affectives ou esthétiques (la Beauté est une composante majeure du roman), spirituelles ou philosophiques. On se rappelle en passant les pyrotechnies verbales d’un Raymond Roussel ou, pour les spéculations vertigineuses sur le temps, Le pendule de Foucault d’Umberto Eco, même si Ransmayr développe une poétique incomparable.
L’invisible rit et sourit
Christoph Ransmayr semble connaître la Chine comme sa poche, qu’il évoquait déjà dans son Atlas d’un homme inquiet, notamment lors de la rencontre d’un hurluberlu anglais spécialiste des chants de territoire des oiseaux, sur la Grande Muraille, puis à l’observation de moines calligraphes peignant des poèmes sur des pierres – déjà !
Rien de très étonnant à cela : un vrai poète va partout, et Ransmayr, grand voyageur à plein temps, est géographiquement à l’aise en tout lieu, sur tel volcan du Costa Rica aussi bien que sur telle île grecque où il se fait un selfie devant le tombe d’Homère, autant qu’il l’est, ici, historiquement, en pleine Chine impériale menacée au nord par des hordes musulmanes – déjà !
De surcroit, ses personnages ont une présence humaine vibrante, jusqu’au Très-Haut, d’abord invisible, qui donne ses directives de derrière un paravent, puis qui surgit à l’improviste en rieur débonnaire, et qui sourit une autre fois avant de partager, avec le maître horloger, un saisissant instant de présence partagée – la lectrice et le lecteur apprécieront.
Christoph Ransmayr est lui-même un maître de l’horlogerie romanesque, connaisseur des rouages de la psychologie – de l’émoi sidérant suscité par telle femme-enfant, à la mélancolie amoureuse des mal aimés – autant que des contrastes entre cultures, et ses évocations de la nature sont d’un peintre-musicien de la langue qu’on lirait volontiers en chinois traduit de l’allemand faute de savoir aussi bien la langue de Goethe que son (très remarquable) traducteur Bernard Kreiss – mais lire le chinois ne nous sera donné que dans une autre vie où l’on espère juste ne pas se faire couper le nez.
L’Horloge éternelle
Si vous avez une collection de thermomètres dans votre héritage biparental, gardez-en précieusement le vif-argent. C’est en effet grâce à la très précieuse matière première du mercure, à raison ici d’un quintal dont la réquisition en milieu naturel scandalise les mandarins de la cour, très jaloux des Anglais, qu’Alistair Cox va mettre au point le mouvement éternel de l’horloge que lui a commandée le Très-Haut, qui en fera l’usage final le plus inattendu par la lectrice et le lecteur.
Les bons contes font les bons amis de la sagesse, et Cox ou la course du temps en est une preuve étincelante, notamment durant le séjour de l’empereur et sa cour en sa résidence d’été de Jéhol, où le temps s’arrêtera avant de s’écouler à reculons, si l’on peut dire, jusqu’à l’accomplissement du chef-d’œuvre du Maître horloger.
Entretemps, une scène sous la neige a vu l’Auguste apparaître dans toute sa fragilité humaine, amant dédaigné confronté à la douleur rivale de son protégé, mais là encore tout l’art du poète est de suggérer plus que de conclure, et telle est aussi la fin de ce roman-poème aux détails magnifiquement finis, du point de vue de l’artisanat littéraire, et aux résonances infinies touchant à la nature de l’art et au sens de la vie, etc.
Christoph Ransmayr. Cox ou la course du temps. Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss. Albin Michel, 316p.
***
6. Annie Dillard au plus-que-présent

En lisant et en annotant Au présent, recueil de notes, ou Apprendre à une pierre et ses autres notes dans l’esprit d’En lisant, en écrivant…
Il y a, chez Annie Dillard, une sorte de proximité de l’intime et du cosmique qui se perçoit, notamment, dans sa façon de parler de la nature, il faudrait plutôt dire : d’écrire dans la nature, sans qu’il y ait trace chez elle d’effusion convenue (ô nature ! etc.) ni de pose de type bas-bleu écologisant, plutôt la curiosité et, souvent, le saisissement devant la simple présence de l’environnement naturel (dont les êtres humains font partie au même titre que les écureuils gris ou les étoiles), et cette « intimité cosmique » s’allie en outre à un sens du comique qui lui permet, précisément, de rompre avec toute sentimentalité niaise à la Bouvard et Pécuchet ou à la Michel Onfray.
Le moment que nous vivons est extraordinaire, semble nous dire cette sacrée bonne femme, mais ce n’est rien de le dire: il n’est que de le vivre et de mille façons diverses qui procèdent du même éveil et du même bond les yeux ouverts devant la merveille.
«Merveille des merveilles sous le lilas fleuri, merveille: je m’éveille», écrivait le poète Jean-Pierre Schlunegger qui finit, désespéré, par se jeter d’un pont, non loin d’où nous vivons, pour se fracasser sur les rochers de la rivière, tout en bas.
Or nous vivons tous ces jours sous la double instance de telle merveille et de son envers mortel, et ce n’est pas d’hier, nous l’oublions trop souvent, mais quelque temps nous voici comme au pied d’un mur et c’est le bon moment – le beau moment d’apprendre à voir le monde les yeux ouverts et d’apprendre à parler à une pierre.
La merveille des merveilles est à la portée de chacune et chacun , et ma conviction s’en est trouvée confortée, l’autre jour, en notre quarantaine à tous, lorsque tel cher ami m’apprit au téléphone que tous les matins il conduisait son petit lascar Luca de dix ans et son compère Arthur de trois ans son aîné familier par son père argentin des colibris de la jungle de son pays, à la lisière des bois vaudois où ils s’enfoncent tout appareillés d’instruments d’observation et autres chasses subtiles – toute la journée rien qu’à eux, fous de ferveur curieuse et de joyeuse adulation des multiples espèces de végétaux ou d’animaux divers tels les castors d’un soir passé – en somme prédisposés à apprendre un jour a parler aux pierres à l’imitation de ce jeune Américain dans la trentaine exerçant, dans sa cabane perdue en pleine nature, le rituel censé faire parler une «pierre à souhaits»…
Certains livres sont des départs et d’autres des arrivées. Certains livres ouvrent des fenêtres et d’autres explorent les multiples recoins qu’il y a dans la maison. Certains livres ne font que passer et d’autres vont rester. Certains livres ne sont que des aspects de la vie et d’autres en font la somme; et c’est un peu tout ça que je ressens en revenant sans cesse aux récits et aux réflexions, aux observations et aux intuitions émaillant l’œuvre incomparable d’Annie Dillard, à commencer par les deux recueils de fragments que représentent Au présent et Apprendre à parler à une pierre.
On est là dans la maison du monde en parcourant ce livre à la fois très physique et vertigineusement métaphysique, hyperréaliste et non moins réellement habité par l’Esprit qui s’intitule Au présent et conjugue les pires effrois et les plus hauts émois du cœur et de l’âme.
Le théâtre actuel de la pandémie, avec ses milliards d’histoires individuelles bouleversantes ou affligeantes de médiocrité, ses rages et ses courages, ses bontés discrètes et ses vilenies étalées, n’est guère différent des univers explorés par Annie Dillard dans les archives illustrées des «troupes humaines» victimes des pires monstruosités congénitale (nains à têtes d’oiseaux ou nourrissons sirénomèles, entre autres produits de la fantaisie «divine» salués par autant d’hymnes par les diverses traditions religieuses) ou sur le terrain de nos contemporains chinois ou palestiniens, sur les traces du paléontologue Teilhard de Chardin aux rêveries mystiques ou le long des fossés à ciel ouvert révélant une armée de combattants chinois de terre cuite enterrés comme le furent, encore vivants, tant de sujets d’un certain empereur Qin adulé par son descendant Mao…
Annie Dillard est ce qu’on pourrait dire une pure poétesse de la pensée dont le génie – sans le moindre des chichis de ce que j’appelle la «poésie poétique», souvent obscure et prétentieuse, ou bavarde comme les pies des réseaux sociaux -, procède par fulgurants rapprochements, parlant aussi bien de la stupéfaction qu’elle éprouve à la rencontre inopinée d’une fouine au coin d’un fourré ou à la vision de ce vieux lecteur du Coran assis contre le pilier d’une mosquée de Jérusalem filant discrètement des bonbons en papillotes aux gamins pieds nus, des prodiges émaillant les vies de saints hassidim ou d’un chevreuil piégé se débattant dans la jungle amazonienne, de la formation des déserts et des nuages ou de la naissance de tel enfant à longue queue et fentes brachiales au cou semblables à celle du requin qui nous incite à penser que «si l’homme devait appréhender pleinement la condition humaine il deviendrait fou». Et les énumérations d’aligner leurs chiffres avérés, et le rappel d’innombrables faits remarquables ou affolants (140.000 noyés ce jour-là au Bengladesh, etc.) d’alterner avec les statistiques même pas bonnes à soutirer des larmes aux pierres…
De son propre aveu, l’auteure d’Une enfance américaine, de Pèlerinage à Tinter Creek – dont la verve naturaliste évoque si fort le «philosophe dans le bois» Henry Thoreau -, ou encore de la stupéfiante chronique de la conquête de la côte pacifique nord-ouest des States par les puritains amis ou ennemis des Indiens, intitulée Les vivants – fut une enfant si étonnamment étonnée et étonnante que sa propre mère se demandait ce qu’on pourrait jamais en faire dans ce monde…
Et que faire des livres d’Annie Dillard, honneur littéraire d’une nation dont le Président est la honte; que faire de cette bonne fée dans un monde dont le personnage supposé le plus puissant présente tous les traits d’un mufle inculte, terrifiante incarnation d’un empire du vide et du faux?
Simplement ceci: les ouvrir et leur permettre de nous éveiller…
Annie Dillard. Au présent. Traduit de l’anglais (USA) par Sabine Porte. Editions Christian Bourgois, 220p.2001.
***
7. Ainsi va toute beauté sur terre
À propos de Migrations de Milos Tsernianski. Première traduction de ce chef-d’œuvre de la littérature serbe : 850 pages d’ un lyrisme et d’ une richesse incomparables. Le roman de l’ exil, de la fidélité, de l’ espoir et de la mélancolie. Reportage en Serbie avec Vladimir Dimitrijevic, en 1987.

Milos Tsernianski (Pierre Omcikous)
Il émane de ce livre une lumière la fois intime et cosmique, chaleureuse et spiritualisée, comme d’une icône orthodoxe. Mais c’est également un poème épique de chair et une fresque romanesque pétrie de chair et de sang que Migrations, de Milos Tsernianski, constituée de deux parties publiées respectivement en 1929 et en 1963 : la chronique des tribulations du peuple serbe au milieu du XVIIIe siècle ou, plus précisément, l’évocation d’un exode massif en Russie auquel participa la tribu des Issakovitch, dont les figures inoubliables se dressent au premier plan plan de la narration.
En outre, outre, par-delà le seul destin des des Serbes, c’est par excellence le roman du déracinement et de la fidélité, de l’errance et de la nostalgie de ceux qui ont été arrachés à leur mère patrie ou des mélancoliques en exil dans ce monde, qui tous aspirent à quelque terre promise.
Or, ce qui c’est distingue premièrement ce roman, c’est son aura, l’empreinte très pure qu’il laisse au cœur, et sa profonde beauté. Sans doute y a-t-il, la littérature, des romans plus géniaux, plus novateurs ou plus éblouissants dans telle ou telle de leurs parties. Mais la beauté de Migrations nous paraît sans égale, qui ne comble pas, au reste la seule exigence esthétique. De fait, le sentiment de plénitude que nous éprouvons à la lecture de ce chef- d’œuvre procède à la fois de sa sensualité terrienne et de ses résonances affectives, où le détail le plus minutieusement observé s’intègre dans l’ensemble comme la pierre scintillante d’une immense mosaïque en mouvement – et de la mélancolie qui l’imprègne, de l’extraordinaire plasticité de sa langue. Et de sa symbolique spirituelle. Il y a, dans Migrations, un alliage subtil et rare d’éléments opposés qui se confrontent et se complètent à la fois.
C’est ainsi que se mêlent l’épique et le poétique, la vérité du chroniqueur et celle du romancier, le froid de l’Univers et le chaud des intimités, les séductions enivrantes et les aspirations inaltérables, la chevauchée des héros et la patience vigilante des mères et des épouses, la gloire des empires et le sacrifice des minorités, l’innocence des purs et la duplicité des malins, le temps des vivants et celui des morts – et c’est à ce jeu de tensions et d’équilibres que ressortit la beauté de Migrations, ressaisie de par l’énergie transfiguratrice de la poésie.
Beauté barbare d’un départ à la guerre : et c’est le formidable première scène du premier livre, où l’on voit le commandant Vouk Issakovitch, sabreur vieillissant sous ses dehors d’auroch, s’arracher à l’étreinte et aux soupirs de sa jeune femme afin de rejoindre son régiment dans les brouillards fantomatiques de l’aube danubienne. Beauté fatale de Daphina, séduisante en ses atours de princesse gitane, mais humiliée par Vouk, et se consolant, pour leur malheur à tous, dans les bras du disgracieux Archange, son beau-frère le négociant. Beauté terrible de la guerre à la veille des batailles ou dans l’hallucination du combat. Beauté même de ces visions de néant : « Ils ont vagabondé comme des mouches sans tête, ils ont mangé, ils ont bu, ils ont dormi pour, finalement, enjambant le vide, courir à grands pas vers la mort, selon le bon vouloir et pour le compte des autres ». Et déjà le rêve d’une terre plus accueillante illumine la fin de ce premier livre, et quelle promesse de beauté c’est encore…
Beauté de la créature. avec ses qualités individuelles et ses ombres aussi. Beauté des femmes de Migrations, de l’amante enjôleuse à celle qu’on n’a pas su aimer, ou à cette autre demeurant inatteignable.
Beauté plus fruste des Issakovitch. de Et voici l’irradiante figure de Pavle dont l’éclat, resplendissant tout au long du deuxième et du troisième livre, n’est jamais entamé, mais au contraire humanisée par les termes mordants que lui valent son allure et ses attitudes. Combien nous l’aimons ainsi, cet échalas plein d’orgueil, ce paon ombrageux, cet ours perdant tous ses moyens devant les femmes mais narguant les puissants de ce monde, et combien nous aimons, aussi, la candeur mal dégrossie de ses trois cousins : Petar le jeune faraud, Yourat le bon vivant et Trifoun le simple en proie au démon de midi. Beauté de ces soudards au bon cœur, sanglés dans leurs uniformes de poupées rococo, floués plus souvent qu’à leur tour et qui mourront pour la gloire d’empires ingrats, sans sépultures connues. Et miracle cependant que tout cet arroi de joies et de peines s’élève et converge dans la lumière au lieu de se disperser en cendres sous le ciel rampant de l’amertume et du ressentiment. Beauté de tant de souvenirs comme incorporés notre mémoire.
Tel fut le grand cercle parcouru par Vouk Issakovitch durant sa dernière campagne, du printemps 1744 à l’été 1745. Souvenir d’une sorte de cauchemar éveillé, jusqu’en Lorraine, avant que Vouk ne ramène ses braves dans leurs masures de Tserna Bara.
Et, pendant ce temps, ce fut la mort de Daphina. Ce fut ensuite, dix ans plus tard, la migration des Issakovitch entraînés par Pavle, fils adoptif de Vouk, accomplissant le rêve que nourrissait celui-ci de fonder une Nouvelle Serbie par-delà les Carpates.
Souvenir du défi de Pavle, se dressant contre l’émissaire de Vienne chargé de de signifier aux Serbes la volonté l’impératrice de les établir comme sujets paysans et de les sépultures connues. Et miracle cependant que tout cet arroi de joies et de peines s’élève et converge dans la lumière au lieu de se disperser en cendres sous le ciel rampant de l’amertume et du ressentiment. Il est vrai que, après les avoir finalement accompagnés les et aimés, nous verrons les protagonistes perdre dans la poussière des bilans d’archives évoquant les généalogies légendaires de l’Ancien Testament ou de quelque Livr des Morts. Mais leurs visages nous resten et, de même que la langue serbe aura sensemencé la terre russes de ses graines verbales,, le nom des isskovitch nous riendra lieu dlsormais de signe de reconnaissance,Beauté de tant de souvenirs comme incorporés à notre propre mémoire…
Ce fut le grand cercle parcouru par Vouk issakovitch durant sa dernière ca,mpagne du printemps 1744 à l’été 1745. Souvenir d0une sorte de cauchemar éveillé , jusqu’en Lorraine, aavnt que Vouk ne ramène ses braves dans leurs masures de Tserna Bara.
Et pendant ce temps, ce fut lamort de Daphnia. Ce fut ensuite, dix ans plus tard, la migration des Issakovitch, entraînés par Pavle, fils adoptif de Vouk, accomplissant le rêve de celui-ci de fonder une Nouvelle Serbie par delà les Carpates.
Souvenir du défi de Pavle, se dressant contre l’émissaire de Vienne chargé de signifier aux Serbes la volonté de l’impératrice de les établir comme paysans et de les convertir au catholicisme, arpates. convertir dans au la catholicisme. Sur quoi ce fut, dans la prison où Pavle s’en alla croupir, l’apparition en songe de sa jeune femme morte en couches et dont il découvrit soudain qu0il n’avait jamais su l’aimer de son vivant. Souvenir de cette révélation, et de la fuite de Pavle sur chevaux fous. Ce fut tout ce que Pavle raconterait plus tard aux siens ses tractations à Vienne, dans un monde futile et corrompu, les missions dont le chargea l’ambassa-deur de Russie et la suite de ses démarches à Tokay.
Ce fut aussi ce qu’il tairait à sa tribu ses amours ancillaires et sa rencontre d’une certaine Eudôxie aux charmes évoquant Rubens. Souvenir, aussi, de la Monténégrine aux yeux verts rencontrée dans un lazaret et qu’il ne retrouva que pour la perdre à jamais. Et du côté de la tribu, pendant ce temps-là, ce furent des chamailleries à n’en plus finir. Enfin, ce fut la migration, le passage des Carpates dans une féerie automnale faire à chanter une pierre, et ce fut l’hiver, Pavle cinglant sur Kiev en traîneau, et l’inimaginable printemps de Russie et là-bas, dans la mer infinie où s’était déversé le fleuve des Serbes, ce furent d’autres humiliations, d’autres désillusions et le rêve probable, un jour, d’autres migrations…
Milos Tsernianski (Crnjanski) Migrations. Editions L’Age d’Homme/Julliard, 1986. Traduit du serbo-croate par Vélimir Popovic. Introduction de Nikola Milosevic.
Sur les traces des Issakovitch
De la colline surplombant la petite ville de Verchats, la frontière roumaine du Banat yougoslave, nous découvrons une vaste plaine qui se perd dans les brumes d’automne. Â moins d’une journée de cheval, au nord, se trouve Temichvar, l’ancienne Timisoàra, la petite Vienne d’où partirent les Issakovitch. Mais nous ne verrons pas les acacias qui frémissaient sur la mahala, le quartier turc de jadis. En revanche, nous étions hier sous les acacias des bords de la Drina aux galets multicolores. Et là, nous avons rencontré le dernier des Issakovitch, la soixantaine recuite et l’air matois, en jeans…
Le même jour, du côté de Tserna Bara, le camarade-président du Parti local recevait, l’œil fuyant sous l’effigie de Tito, l’apatride Vladimir Dimitrijevic, ennemi du peuple de naissance, exilé notoire et néanmoins éditeur de la première traduction française de Migrations.

Photo JLK: Vldimir Dimitrijevic sur les bords de la Drina, en 1987
Or, d’une tournée de raki l’autre, de tel jardin merveilleux au club des écrivains de Belgrade où surgit tout coup la figure fellinienne du cinéaste Alexandre Petrovic nous annonçant le prochain tournage de Migrations, en coproduction yougoslave, ou des hauteurs de la Fruska Gora, chère à Trifoun Issakovitch, au monastère de Studenitsa, haut lieu des origines de la nation et de la culture serbes, nous pensions à cet immense brassage de sang et de larmes, et d’espoir et de foi, qui amarqué cette terre meurtrie, dépecée et recousue, envahie et reconquise. Et tout l’heure, assistant la rencontre de notre ami l’éditeur et de l’évêque du Banat en son petit palais austro-hongrois un personnage imposant, en dépit de sa jeunesse, aux yeux de mystique et connu dans tout le pays pour son intelligence et ses terribles exigences en matière de desserts nous ne pouvions qu’associer, l’alliance de ces deux regards frères, celui de cet autre exilé que fut Milos Tsernianski, qui écrivit une partie de son chef-d’œuvre à Londres et mourut de tristesse à Belgrade, en 1977.
À charge pour nous de témoigner à notre tour, à ces hommes de courage et de cœur, notre reconnaissance…
Portrait de Milos Tsernianski: Pierre Omcikous.
Photo JLK: Dimitri au bord de la Drina, en 1987
***
8. Les merveilles d’Alice
Le dernier recueil traduit de la grande nouvelliste canadienne, Trop de bonheur, est aussi le meilleur. Le Nobel a révélé une oeuvre majeure en consacrant une dame de coeur.
Alice Munro (1931-2024) est sans doute l’une des plus remarquables nouvelliste de la littérature mondiale actuelle, très justement récompensée par le Prix Nobel de littérature 2013.
Le triple mérite de celui-ci fut de consacrer une femme, Canadienne anglaise donc un peu décentrée, et cantonnée dans le genre de la nouvelle assez peu prisé, surtout en langue française.
Parfois comparée à celles de Tchékhov ou de Raymond Carver, l’oeuvre d’Alice Munro est à vrai dire d’une totale originalité, tant par sa perception du monde que par sa poésie hyperréaliste.
Divorce, avortement, émancipation des moeurs, destinées personnelles sur fond de tragédies collectives, femmes en fuite, familles éclatées et recomposées: il y a de tout ça dans ces nouvelles dont le plus surprenant est leur façon de nous situer dans le temps. Que sommes-nous devenus avec les années ? Telle est la question qui revient à tout moment chez Alice Munro, dont le réalisme hypersensible, extrêmement attentif à l’intimité de chacun, va de pair avec le sentiment que nos vies, à tout moment, peuvent bifurquer et se refaire, sans aucune règle.
Alice Munro avait passé le cap de ses 78 ans lorsqu’elle publia Trop de bonheur, rassemblant dix nouvelles plus étonnantes les unes que les autres.
Le recueil s’ouvre sur le récit insoutenable de Dimensions, nous confrontant à une folie meurtrière. La figure du psychopathe est très présente dans la littérature contemporaine. Or les gens on beau parler de « fou criminel » à propos de Lloyd, le père de ses trois enfants: la narratrice voit surtout en lui un « accident de la nature » et continue de lui rendre visite dans l’institution où il est incarcéré. De ce triple infanticide évoqué en cinq lignes quant aux faits précis, la nouvelliste tire un récit d’une trentaine de pages modulant le point de vue de Doree, qui continue de rester attachée à celui qui est taxé de « monstre » par son entourage, sans lui céder en rien pour autant.
Dans Trous-profonds, Alice Munro revient sur un thème qu’elle a souvent traité: la fuite et la disparition d’un proche, retrouvé des années plus tard. Or cette histoire d’un ado surdoué, accidenté en ses jeunes années, jamais vraiment reconnu par son père à l’ego envahissant, et qui s’éclipse pendant des années après avoir plaqué ses étude sans crier gare, reflète quelque chose de profond de notre époque, qu’on pourrait dire le désarroi des immatures de tous âges.
Sans préjugé doloriste, Alice Munro est extrêmement sensible aux êtres fragilisés d’une façon ou de l’autre, comme il en va du narrateur de Visage, rejeté par son conosaure de père du fait de la tache de vin qui marque son visage. Or le vrai thème de cette nouvelle, également récurrent, touche à une passion enfantine jamais avouée. Sans complaisance, la nouvelliste lève ainsi le voile sur les secrets de tous les âges (comme dans Jeu d’enfant) et de tous les milieux, sans jamais faire du « social » ou du « psy », juste à fleur de sentiments.
Alice Munro va partout, pourrait-on dire, dans tous les milieux, à tous les étages de la société, sans aucun préjugé. Peu d’écrivains parlent si librement et si naturellement de la sexualité, sans une once de provocation.
Comme un Tchékhov, la nouvelliste ne démontre rien: elle montre. Au lecteur ensuite de conclure…
Dans la merveilleuse nouvelle intitulée Bois, nous voici dans foulée d’un menuisier-ébéniste qui va choisir ses arbres dans la forêt, évoquée avec un souffle et une connaissance technique et poétique rappelant Jack London.
Ou nous voilà, avec Trop de bonheur, remonter le courant de l’Histoire à la rencontre d’un extraordinaire personnage féminin. En concentré romanesque de cinquante pages, inspiré par le personnage réel de Sofia Kovalevskaïa, mathématicienne et romancière, Alice Munro retrace une destinée de femme libre et sa fin bouleversante. Une fois de plus, comme dans la dizaine de recueils traduits à ce jour, s’exerce son prodigieux don d’observation reliant sans cesse le moindre détail à l’ensemble, sensible en même temps au tragique de la condition humaine et au comique de la vie, et trouvant à tout coup une nouvelle manière de raconter.
Alice Munro. Trop de bonheur. Traduit de l’anglais (Canada) par Jacqueline Huet et Jean-Pierre Carasso. L’Olivier, 2013, 215.
***
9. L’emmerdeur vital

Thomas Bernhard en ses récits et autres proférations.
Quel plus grand bonheur, me dis-je ces jours, quelle plus allègre perspective que celle de se replonger dans la prose effrénée de Thomas Bernhard, quel plus beau rendez-vous chaque matin, pour faire pièce aux relents de désespoir de l’éveil, de se faire secouer de bonne rage tonifiante par l’énergumène ?!Voici donc 942 pages rassemblant en un volume onze des récits que TB disait lui-même «autobiographiques», où l’on se doute que le pacte du genre est plus ou moins tenu, à savoir L’Origine, La Cave, Le Souffle, Le Froid, Un enfant, Oui, L’imitateur, Les Mange-pas-cher et Le neveu de Wittgenstein, plus deux inédits (Trois jours et Marcher), plus un entretien avec André Müller, plus une première préface excellente de Jean-Marie Winkler, plus la non moins éclairante introduction de Bernard Lortholary au recueil repris de la collection Biblos, plus un dossier bio-historique complémentaire assorti de nombreuses illustrations – bref de quoi rugir de mécontentement radieux.
À ce propos, Hugo Loetscher, l’un de nos meilleurs auteurs alémaniques, me disait un jour : « Jawohl, c’est clair, Thomas Bernhard est un grand écrivain, mais je souris quand même à l’idée de ce type se retrouvant tous les matins devant son miroir et se disant: «Maintenant, je vais me mettre en colère !»
Or, avant toute chose, il faut se jeter sur le texte initial intitulé Trois jours, lié à la préparation d’un film consacré à TB, où celui-ci lance son moulin à paroles au fil de pages immédiatement électrisantes par lesquelles il définit une première fois ce qu’on pourrait dire sa manière noire avant d’expliquer d’où tout ça lui vient, comment la putain d’écriture lui est venue, cet affreux bonheur, comment cette funeste allégresse l’a pris au corps alors qu’il gisait en haute montagne, malade et solitaire, malade à tel point qu’on lui avait déjà fait le coup de l’extrême-onction, seul en face d’une putain de montagne à devenir fou, «et alors j’ai simplement attrapé du papier et un crayon, j’ai pris des notes et j’ai surmonté en écrivant ma haine des livres et de l’écriture et du crayon et de la plume, et c’est là à coup sûr l’origine de tout le mal dont il faut que je me débrouille maintenant ».
Ceci après avoir précisé cela de basique qu’ «en ce qui me concerne, je ne suis pas un écrivain, je suis quelqu’un qui écrit».
Quelqu’un qui écrit. On entend : quelqu’un, mais on n’entend pas qu’il écrit, parce qu’on est dedans, à la cave, dans le souffle, dans le corps de l’esprit mortel, au rythme de son pied vif qui bat la mesure, dans son âme exécrant d’amour, et c’est parti pour la musique…
Depuis Céline et Faulkner et Thomas Wolfe et Walser il n’y a pas au monde une musique pareille, un pareil souffle, une pareille voix.
J’ai mis un certain temps à voir toute la mélancolie et la pureté, toute la douleur et le sérieux de Thomas Bernhard, agacé par la secte de ses adulateurs aussi pâmés que les adulateurs de Robert Walser et Céline et Faulkner, et je ne crois pas être un inconditionnel pour autant de TB: son théâtre et sa poésie ne me touchent pas du tout autant que sa prose, et dans sa prose bien de ses romans me semblent forcés par moments, à tout le moins inégaux, alors que les récits «autobiographiques» me prennent par la gueule et ne me lâchent pas avant de me ramener à ma propre solitude et à ma rage et à ma haine du crayon et de la plume, au poids du monde et au chant du monde…
Dans la vrille de Maîtres anciens.
C’est un peu l’histoire de l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours que cette narration entortillée de Maîtres anciens, au fil de laquelle un type nous raconte ce que pense un autre type qu’il admire, à propos d’un peu tout.
Le narrateur est un chercheur un peu en retrait, qui se nomme Atzbacher et aurait probablement des choses à dire et publier, mais qui se tait pourtant, préférant parler de ce qui lui en impose et qu’il respecte.
Tout de suite alors Atzbacher s’efface devant Reger, le vieil homme avec lequel il a rendez-vous au Musée d’art ancien (Kunsthistorisches Museum) de Vienne à 11 heures et demie du matin, et qu’il attend d’aborder comme il est arrivé avec une heure d’avance, tout le livre s’inscrivant dès lors dans cette heure d’attente.
Reger est en effet un maniaque de la ponctualité, qui ne supporte pas les turbulences anarchiques en dépit de son esprit complètement indépendant et même intempestif. Reger aime qu’on arrive à l’heure punkt, tout en vouant aux gémonies le conformisme philistin, et notamment dans son incarnation pendablement autrichienne. Reger, comme Kant en sa tournée quotidienne, vient s’asseoir régulièrement au Musée d’art ancien en face de L’homme à la barbe blanche de Tintoret. Il a besoin, pour penser, d’être là quotidiennement. Besoin de cette lumière et de cette atmosphère. Sa banquette lui est réservée par on ne sait quelle loi non écrite, de sorte que lorsqu’un Anglais vient y poser ses fesses, en prétendant de surcroît qu’il dispose à la maison d’une autre version de L’homme la barbe blanche de Tintoret, tout le bel ordre de l’univers menace de s’effondrer.
Ajoutons à cela que Reger est tout fait méconnu de ses concitoyens. Nul n’imagine que ce musicologue suréminent collabore au Times depuis trente-quatre ans, ni ne se doute des idées véhémentes qui fleurissent sous son front chenu.
Au filet de la parole qu’a puisée Atzbacher, l’on comprend que Reger est un «philosophe personnel». C’est-à-dire que Reger pense par lui-même. Reger aime ce qui est bon et ce qui est beau, sachant de quoi il retourne. Reger se fout de ce qu’on croit qu’il faut admirer par convenance sociale ou culturelle. Reger déteste les spécialistes d’art et de culture qui n’aiment pas vraiment personnellement ce qu’ils défendent et illustrent. Reger déteste les historiens d’art, qui se planquent derrière leur savoir abstrait pour défendre des momies. Reger aime à découvert. Il aime Pascal. Il aime Montaigne. Il aime Voltaire. Il déteste la perfection obligatoire. Il déteste les livres «à lire absolument». Tout cela lui paraît du flan, du nanan. Comme Thomas Bernhard, Reger déteste l’admiration d’Etat, la prosternation de concert, et tout ce qui va bêlant dans le même sens.
On le croit démolisseur à l’entendre conchier à peu près tout: la prose de Stifter, la musique de Mahler et de Bruckner, la peinture «effroyable» de Dürer, et l’épouvantable Heidegger qui selon lui a «kitschifié» la philosophie. On désespère de lui en l’entendant grommeler qu’il déteste les hommes, pour l’entendre sitôt après corriger qu’ils furent son «unique raison de vivre»…
Introduits dans la vie de Reger par son ami Atzbacher, nous découvrons un homme qui ne se paie pas de mots ni d’expériences à la petite semaine. Qui croit effectivement à l’art. Qui s’estime depuis son enfance un «artiste critique». Qui se bat l’œil des mondains mais se ferait hacher menu pour une œuvre qu’il aime et qu’il respecte. Or ce qui distingue le respect de Reger de l’admiration béate des philistins, c’est que ceux-ci se fichent à vrai dire de ce qu’ils prétendent vénérer.
La passion de la plupart des gens, à en croire Reger, c’est le bricolage et non du tout Mozart ou Dostoïevski. L’idéal moyen de l’Autrichien, c’est la boîte à clous et la salopette du samedi.
Et tel est le Suisse, le Texan, le Français moyen, ajouterons-nous tranquillement, sans mépris. Et de même lorsque Reger, dans la foulée de Thomas Bernhard, vitupère la «foire ignoble de la vulgarité», qu’il situe au Prater, faut-il comprendre qu’il incrimine ce monde décervelé triomphant partout à l’heure qu’il est, que le génial Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dans les années vingt de notre siècle, prophétisait exemples l’appui.
Ce qu’attaque Thomas Bernhard n’est pas autre chose que ce qu’attaquait Léon Bloy quand il vitupérait le Bourgeois gavé de lieux communs, devenu l’homme normal des temps qui courent, consommateur pour lequel il n’y plus d’autre angoisse que celle de «gérer» son plaisir. Que la musique devienne un bruit de fond provoque la révolte de Reger, de même que tout affadissement des expériences fondamentales de l’existence. Ainsi comprend-on bientôt que ce nihiliste est un défenseur véhément des valeurs humaines essentielles, et non du tout le cynique qu’il parait être.
À cet égard, tout ce qui concerne la mort de sa femme est bouleversant, qui resitue finalement le soliloque rapporté du personnage dans la perspective d’une destinée humaine. De même la véhémence panique de Maîtres anciens produit-elle finalement, un effet tonique sur le lecteur. À l’opposé de tant de discours lénifiants qui nous empoissent par les temps qui courent, la scie circulaire de Thomas Bernhard agit comme un scalpel dans la chair de nos cervelles amollies.
Avec les Mange-pas-cher
On se croirait d’abord dans une parodie de Thomas Bernhard, tant les premières pages de ces Mange-pas-cher sont marquées, de répétitions martelées en reprises cycloïdes, par la «manière» si particulière de l’écrivain autrichien, de plus en plus accusée au fil de ses récits, confinant parfois au maniérisme (en tout cas ressent-on cela dans les versions françaises, notre langue analytique ne rendant pas toute la rythmique et l’envoûtante musique de cette prose), comme l’illustre par exemple la première page de ce récit en cascades où il est question d’un personnage qui a «pu revenir, après une longue période, d’une pensée parfaitement sans valeur concernant sa Physiognomonie à une pensée utilisable et même en fin de compte incomparablement utile, et donc à la reprise de son écrit, que, dans un état d’incapacité à toute concentration, il avait laissé en plan depuis le temps le plus long déjà, et dont l’aboutissement, disait-il, conditionnait finalement un autre écrit dont l’aboutissement conditionnait de fait un autre écrit dont l’aboutissement conditionnait un quatrième écrit sur la physiognomonie reposant sur ces trois écrits qu’il fallait absolument écrire»…
Que le lecteur se rassure pourtant : ce n’est pas un trop «monstre» morceau de Sachertorte qui lui est enfourné là en dépit de cette première apparence, mais le récit de la vie d’un homme qui, au contraire, a toujours fait passer l’esprit avant le chocolat, les valeurs spirituelles avant le confort bourgeois, et qui sacrifie tout à sa mission, sa passion, sa conviction qu’il a une œuvre personnelle à faire, tournant autour de sa fameuse Physiognomonie, projet fou d’une synthèse pour ainsi dire mathématique et non moins philosophique de ce qu’il a observé depuis qu’il est au monde (il ne l’avait pas demandé) et plus précisément dans la Cantine Publique Viennoise, genre de soupe populaire, où il a rencontré les Mange-pas-cher, ces exemplaires rarissimes (il sont quatre) de l’humanité en laquelle il s’est reconnue un jour.
C’est en somme l’histoire de Thomas Bernhard lui-même qui a choisi un jour, jeune homme, comme il le raconte dans les magnifiques chroniques de sa jeunesse, de marcher à contre-sens; ou bien c’est l’histoire de l’artiste, du poète éternel, de l’inventeur ou du philosophe iconoclaste s’opposant à «la masse».
En l’occurrence, le récit de Koller, qui s’est toujours voulu un «homme de l’esprit», maladif à proportion de son aspiration, est recueilli par un employé de banque en tout son contraire, mais qui sera aussi le témoin d’élection auquel il racontera son observation décisive des Mange-pas-cher. Au préalable, il va raconter dans quelles circonstances hasardeuses (en réalité : «mathématiquement» prévues), la morsure d’un chien, l’amputation de sa jambe gauche et la somme qu’il a mise de côté après avoir traîné le propriétaire du chien en justice, lui ont permis de rejoindre les Mange-pas-cher et de vivre royalement – comme un pauvre.
Il y a du comique de film muet, du théâtre de l’absurde, et une noire sagesse dans cette fable anti-fable, où Thomas Bernhard passe toutes les «positions» de ses personnages à la moulinette du langage. Ses litanies n’ont rien de gratuit pour autant, mais il faut les «vivre» phrase à phrase, en scrutant l’entre-deux du discours et de ses «scies», pour discerner bientôt d’autres voix et une autre musique sous les mots et débordant de toute part, parlant de pauvres gens qui se débattent, de vous, de nous et de nos chiens…
Du bon usage des prix littéraires…
On sourit tout le temps à la lecture de Mes Prix littéraires, et le rire éclate même aux passages les plus cocasses de ce recueil consacré en partie à de mordantes considérations sur les circonstances dans lesquelles TB a reçus diverses récompenses dès ses débuts d’écrivain, à quoi s’ajoutent trois discours de réception.
Comme on s’en doute, TB n’a pas une très haute opinion des prix littéraires, et moins encore de ceux qui les décernent. La comédie qui se joue autour des prix littéraires n’est pas moins grotesque, à ses yeux, que toute comédie sociale à caractère officiel. L’honneur qui s’y distribue lui paraît une bouffonnerie, et il se fait fort de l’illustrer.
Ainsi, lorsqu’il se rend à Ratisbonne, ville allemande qu’il déteste, en compagnie de la poétesse Elisabeth Borchers, lauréate comme lui, pour y recevoir le Prix du Cercle culturel de l’industrie allemande, et que le président de ladite institution, sur son podium, se réjouit d’accueillir et de féliciter Madame Bernhard et Monsieur Borchers, nous fait-il savourer ce que de telles cérémonies peuvent avoir de plus grotesque.
Mais le propos de TB ne vise pas qu’à la dérision, pas plus qu’à tourner en bourriques les philistins incompétents ou les gens de lettres qu’il estime ridicules. Il y a en effet pas mal d’autodérision dans ses évocations où la vanité de l’Auteur n’est pas épargnée, ni l’inconséquence qui le fait accourir pour toucher l’argent que lui rapportera aussi (pour ne pas dire surtout) ces prix…
Il faudrait être bien hypocrite, au demeurant, pour reprocher au jeune TB, en 1967, d’accepter les 8000 marks que lui vaut le Prix du Cercle culturel de l’industrie allemande, alors que, très gravement malade, il a payé un saladier pour être admis dans un mouroir de la région viennoise – celui-là même où il rencontre Paul Wittgenstein, dont il parle dans l’inoubliable Neveu de Wittgenstein.
Le recueil s’ouvre sur le récit, assez irrésistible, de l’achat d’un costume décent, une heure avant la remise du Prix Grillpartzer à l’Académie des sciences de Vienne, par le lauréat qui, trop pressé, acquiert un costume d’une taille inférieure à la sienne, dans lequel il va souffrir quelque peu, durant la cérémonie, avant de retourner au magasin de vêtements pour hommes Sir Anthony, et y prendre une taille au-dessus – et de dauber sur le costume qui a participé à la remise d’un prix littéraire prestigieux avant d’être rapporté au marchand…
Paul Léautaud affirmait qu’un prix littéraire déshonore l’écrivain. Mais c’était après s’être pas mal agité dans l’espoir d’obtenir un éventuel Goncourt pour Le petit ami, et l’on présume qu’il aurait mis un mouchoir sur son honneur pour recevoir telle ou telle distinction qui lui eût permis d’améliorer l’ordinaire de ses chiens et de ses chats.
Thomas Bernhard, pour sa part, se réjouit de pouvoir se payer une Triumph Herald blanche avec les 5000 marks du Prix Julius-Campe qu’il reçoit après la publication de Gel, son premier livre que la presse autrichienne descendra en flammes.
Le récit de son «bonheur automobile» est d’ailleurs épatant, autant que celui de la collision finale sur une route de Croatie et des démêlés qui en découlent avec les assurances yougoslaves se soldant, contre toute attente, par une extravagante «indemnité vestimentaire».
La rédaction de ce recueil date des années 80-81. TB se proposait de le remettre à l’éditeur en mars 1989, mais l’ouvrage n’a finalement été publié qu’en 2009, pour les vingt ans de la mort de Thomas Bernhard. C’est un document très amusant et intéressant à de multiples égards, notamment pour ce qu’écrit l’auteur à propos de son travail et de la foire aux vanités littéraires…
10.Une féroce empathie

L’humanité lancinante de William Trevor, romancier et nouvelliste hors pair.
Il est peu d’écrivains contemporains qui, autant que William Trevor, parviennent à capter tout ce qui fait le sel et le miel, la douleur et la dérision, le tragique et le comique de la vie. Sans hausser jamais la voix ni forcer le ton, sans noircir le tableau du monde actuel ni l’édulcorer non plus, le romancier et nouvelliste irlandais est une sorte de météorologue des sentiments et des pulsions d’une prodigieuse porosité, qui ne se contente pas d’observer ses semblables mais s’ingénie, le plus souvent, à ressaisir des mentalités ou des situations à valeur représentative.
Que ce soit dans les grandes largeurs du roman, comme se le rappellent les lecteurs d’En lisant Tourgueniev (désarrois d’une femme hypersensible en milieu bigot-alcoolo d’Irlande profonde), de Ma maison en Toscane (séquelles d’un attentat terroriste vécues par quelques victimes) ou de Lucy (désespoir d’un couple fuyant au bout du monde après la mort supposée de leur enfant), ou dans la forme plus dense et ramassée de la nouvelle, William Trevor, à la manière d’un Tchékhov contemporain – sa perception des changements de mentalité récents, entre autres phénomènes d’acculturation, est unique -, détaille la détresse des individus les moins aptes à se défendre (souvent femmes ou enfants), en butte à la grossièreté, à la cruauté, à l’injustice ou à la simple imbécillité.

C’est par exemple, dans Foyers brisés, l’une des onze nouvelles de L’Hôtel de la Lune oisive, le choc de deux mondes incarnés, respectivement, par une très vieille dame toute paisible en dépit du long chagrin qu’elle traîne depuis la mort de ses deux fils à la guerre, et par un groupe d’ados effrénés (ils ont l’excuse d’être sans foyers) que lui envoie, pour repeindre sa cuisine (la dernière chose qu’elle désire), un prof barjo tout imbu d’humanitarisme qui impose despotiquement sa vision des « relations intercommunautaires ».

Autant qu’un Tchékhov, William Trevor se défie des battants et des arrogants de la nouvelle société. Jamais il ne s’exprime en sociologue ni en théoricien de la psychologie, mais ses nouvelles foisonnent néanmoins d’observations aiguës sur une société déshumanisée, atomisée, «branchée à mort» et non moins vivante, pleine de gens auxquels on a envie de sourire malgré tout, jusqu’au gros con de boucher de Choisir entre deux bouchers, redoutable portrait d’un père faraud et nul vu par son fils de sept ans…
S’il montre en général de la compassion, étant entendu que la bêtise ou la méchanceté ne sont souvent que les contrecoups de vies disgraciées, Trevor ne transige pas en revanche devant le cynisme ou l’absence de respect humain. La plus saisissante illustration en est donnée dans une nouvelle noire à souhait, C’est arrivé à Drimaghleen, où l’on voit une fois de plus deux univers sociaux antinomiques se percuter: ici la vieille Irlande rurale et le journalisme à sensation.
Au lendemain de la mort tragique de leur fille, massacrée par son petit ami qui s’est fait justice après avoir fusillé sa mère jalouse, les Mc Dowd, paysans un peu frustes, se voient traqués par la journaliste Hetty Fortune et un collègue non moins avide de retracer la story de manière plus saignante et parlante dans leur magazine à scandale. Anecdote policière ? Bien plus que cela: plongée soudaine dans les aléas abjects du vampirisme médiatique.
Jusque dans les situations les plus scabreuses (car il a le sens, comme un Reiser, en plus distingué, du tragi-grotesque des vies les plus banales), Trevor se garde de juger, de moraliser, de railler ou de sangloter entre les lignes. Il regarde la vie comme elle est, sans dorer la pilule. Mais son regard est plein d’humanité, et lire Trevor a cette vertu rare, en définitive, de nous rendre à notre tour un peu plus poreux et donc plus humains…
De très bonnes mauvaises nouvelles
Observateur d’une rare finesse, que son oreille rend capable de rendre toutes les nuances du parler propre à ses personnages fort variés, généralement entre très petite et très moyenne bourgeoisie, William Trevor a également un sens aigu des situations symboliques. Ses nouvelles sont donc à la fois chargées émotionnellement et intéressantes du point de vue social ou psychologique, sans jamais donner dans la démonstration. En outre, ce sont des bijoux du point de vue de l’élaboration, où la concision (maestria du dialogue) va de pair avec la force d’évocation plastique et la profondeur de la perception et de la réflexion.
Ainsi, la première des dix Très mauvaises nouvelles, intitulée Torridge, est exemplaire à cet égard. Comme dans le film Festen de Thomas Vinterberg, son thème est le dévoilement public d’un secret refoulé et la mise en cause de l’hypocrisie sociale. Humilié en son enfance, le dénommé Torridge (surnommé «Porridge» pour son visage évoquant un pudding) fait scandale, trente ans plus tard, à la fin d’un repas où ses anciens camarades de classe et leurs familles l’ont invité pour se payer sa tête une fois de plus
Or, à la veulerie grasse de ses condisciples, Torridge oppose la finesse acquise d’un homme libre, qui fracasse le conformisme ambiant par la révélation d’un drame remontant aux années de collège et impliquant les moeurs des admirables pères de famille.
Cependant, rien n’est jamais simple dans la psychologie des personnages de Trevor, qu’il s’agisse (Amourettes de bureau) de telle jeune secrétaire culbutée sur la carpette le lendemain de son entrée en service par un séducteur «marié à une malade», ou (dans Une nature compliquée) de tel monstre d’égoïsme, esthète et glacial, dont on découvre soudain l’imprévisible humanité.
Les personnages de William Trevor ont tous quelque chose de vieux enfants perdus, comme le trio de Présente à la naissance, où le baby-sitting et les soins palliatifs se fondent à l’enseigne d’un délire inquiétant, la grosse «limace blanche» qui se prélasse (dans Ô, grosse femme blanche!) dans le parc d’une école où un enfant battu se meurt, les couples débiles (dans Le pique-nique des nounours) qui se retrouvent avec leur mascotte sous le regard assassin d’un des conjoints, ou cette paire de doux dingues (dans Les péchés originelsd’Edward Tripp) dont le mysticisme fêlé détermine la conduite délirante.
S’il lui arrive d’être aussi féroce qu’une Patricia Highsmith, dont il est souvent proche par la noirceur autant que par sa sourde compassion – comme dans la terrible Rencontre à l’âge mûr où un type vieillissant doit servir d’alibi adultérin à une horrible mégère -, William Trevor pratique à vrai dire cette «bonne méchanceté» qui nous blinde, à doses homéopathiques, contre l’adversité et le mal rampant. Ses nouvelles, comme celles d’une Flannery O’Connor, sont autant de toniques.
Au cours d’une croisière touristique qui les fait se rencontrer à Ispahan, deux personnages de William Trevor (dans une des Mauvaises nouvelles) échangent ces paroles: à la femme qui demande «pourquoi pensez-vous que je vous ai confié ce secret?», l’homme répond «parce que nous sommes des navires qui se croisent dans la nuit».
Une tragédie irlandaise
Le sentiment mêlé de la cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins remarquable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de William Trevor.
Roman de la fatalité et de la fidélité, de la faute et du pardon, de l’attachement à une terre et de l’exil, de l’amour empêché et de sa sublimation, Lucy entremêle l’histoire d’une femme et celle de l’Irlande contemporaine, du début de l’ère dite «des troubles» à nos jours.
« C’est notre drame, en Irlande, dit l’un des personnages du roman, que pour une raison ou pour une autre nous soyons encore et toujours obligés de fuir ce qui nous est cher ».
Développé à fines et douces touches, tout en délicatesse, ce roman de William Trevor me semble traversé, en dépit de la profonde mélancolie qui l’imprègne, par une lumière indiquée par le prénom même de la protagoniste, en laquelle on peut voir l’émanation ou l’aura d’une âme pure. Or la beauté intérieure et la noblesse de coeur ne se borne pas à ce personnage, qu’on retrouve aussi bien chez sa mère et son père que chez ses parents adoptifs et l’homme dont elle aurait pour faire le bonheur, et jusque chez le pauvre Hoharan qu’elle ira visiter des années durant à l’asile sous le regard perplexe des gens raisonnables.
Si le moment des retrouvailles du père et de la fille est particulièrement bouleversant, c’est cependant au fil du temps et de la vie ordinaire, dans l’acceptation progressive et, pour Lucy, dans la pure jubilation qu’elle éprouve à réaliser de belles broderies et à les offrir, que William Trevor module sa propre vision de romancier à la si pénétrante compréhension.
***
11. Sortilèges de l’âge tendre

L’univers magique de Fleur Jaeggy
C’est d’abord l’histoire d’une enfant farouche jamais guérie d’avoir été rejetée par sa mère, et qui cherche, à l’approche de ses seize ans, à mieux connaître son père le temps d’une croisière de quatorze jours sur un bateau battant pavillon yougoslave et portant le nom de Proleterka. Le périple tient un peu du rituel convenu, style “voyage en Grèce, le père et la fille”, accompli en groupe par la Corporation alémanique à laquelle est affilié le père, dernier ressortissant d’une famille d’industriels argoviens du textile dont la ruine est consommée. Du genre taiseux et froid, propre et gris, cet homme atteint en son enfance de vieillissement prématuré (ce que sa fille n’apprendra qu’à son éloge funèbre), marié par sa mère à une femme probablement séduite par sa fortune plus que par lui-même, laquelle épouse ne lui aura jamais fait de plus beau cadeau que de s’en aller, ne sera qu’un père empêché puisque les femmes liguées (mère et grand-mère de l’enfant) décident seules de son droit sur sa fille.
C’est donc le récit d’une traversée qui a valeur initiatique, puisque l’adolescente y décidera son initiation érotique en s’offrant “sans douceur” à deux hommes de l’équipage, mais aussi, et surtout, c’est un voyage à travers ses souvenirs d’enfance et d’adolescence “guidés” par la figure tutélaire d’Orsola, mère de sa mère à l’”affection glaciale” et, plus amplement (car le récit commence des années après, alors qu’elle a passé la cinquantaine), à travers toute une vie revisitée dans la préoccupation tardive d’accueillir les morts qui “viennent vers nous tardivement”, se rappelant à nous “quand ils sentent que nous devenons des proies et qu’il est temps d’aller à la chasse”.
Dans une atmosphère magique propre à l’enfance, où les objets et les chambres ont leur existence et leur langage propres (le piano maternel devenant un “cheval aux sabots d’or” dont le son restera à tout jamais “promesse de paroles de mort et de condamnation”, mais auquel elle continuera néanmoins de se confier à l’age adulte), la narration mêle les temps et les âge de la narratrice qui dit tantôt “je” et tantôt se dédouble avec cette “grâce du détachement” propre à certains enfants dont elle fut sans doute.
Roman des filiations refusées ou contrariées, Proleterka illustre autant les abus de pouvoir sévissant dans les familles que la puissance subversive de l’amour, avec une implacable distinction de la tendresse lucide et du faux semblant incarné par l’affreux “vrai père” biologique se révélant à la toute fin et lui disant la vérité “pour son bien”. Extraordinairement incisive et concentrée, mais aussi nimbée de mystère et de beauté, l’écriture de Fleur Jaeggy est ici, plus que jamais, un remarquable instrument de connaissance et de réfraction “musicale”.
Un récit fascinant, Les années bienheureuses du châtiment, nous a fait découvrir l’univers empreint de troublante poésie de Fleur Jaeggy, dont un recueil de nouvelles non moins saisissant, La peur du ciel, modulait plus fortement encore les thèmes de l’enfance blessée et de l’expérience du mal, des élans affectifs ou sensuels butant sur les murs du conformisme, dans un climat exacerbé – profondément helvétique par ses multiples connotations, mais sans rien de local – où s’opposent les passions individuelles et les lourdes règles familiales ou sociales. On pensait ainsi à la Suisse de Robert Walser en lisant le premier livre traduit de cet auteur né à Zurich et s’exprimant en italien (Fleur Jaeggy, établie à Milan, est l’épouse du grand éditeur et écrivain Roberto Calasso, fondateur et directeur des éditions Adelphi), comme on se rappelle le Tessin ou la Zurich étouffante de Zorn en lisant Proleterka, dont la substance intime excède évidemment toute désignation ou limite “nationale”. C’est ainsi que, par sa perception de la douleur, autant que par sa révolte contre les accroupissements sociaux, Fleur Jaeggy peut rappeler, à l’exclusion de toute référence religieuse, l’univers “bernanosien” d’une Flannery O’Connor. “Je condamne les religions qui n’ont pas pitié des suicidés”, déclare la protagoniste de Proleterka, dont les parents sont des “suicidés ratés” de père en fils… “je condamne qui condamne. Je condamne le mot pécheur.” Parce que ces mots “entraînent la vengeance” sous couvert de vertu, et que l’enfant en elle refuse que la haine s’exerce “par amour de la vérité” ou “pour son bien”…
Fleur Jaeggy, Proleterka. Traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro. Gallimard, collection Du monde entier, 132p.
Portrait photographique de Fleur Jaeggy: Gisèle Freund
***
12. Le chaman au dépotoir
À propos de La Patience du brûlé de Guido Ceronetti
C’est à une sorte d’ardent travail alchimique que nous convie Guido Ceronetti dans La patience du brûlé, dont les 453 pages tassées m’évoquent ces fichiers « compactés » de l’informatique dont le déploiement peut nous ouvrir magiquement 4530 voire 45300 feuillets en bruissant éventail.
Une bévue éditoriale fait paraître cette première version française sous l’absurde appellation de Roman. Gisement précieux conviendrait mieux. Ou: Réserve d’explosifs Ou bien: huche à pain, ruche à miel, que sais-je encore : strates, palimpseste, graffiti par chemins et bouquins ?
En tout cas Notes de voyage, même si c’est de ça qu’il s’agit, ne rend pas du tout le son et le ton de cette formidable concrétion de minéralogie sensible et spirituelle dans le mille-feuilles de laquelle on surajoute à son tour ses propres annotations.
Pour ma part, ainsi, dès que je m’y suis plongé, j’en ai fait mon livre-mulet du moment. S’y sont accumulés notes et croquis, recettes, régimes, billets doux et tutti quanti. Une aquarelle d’un ami représentant l’herbe du diable, et le détail des propriétés de celle-ci, en orientent la vocation magique, confirmée sur un fax à l’enseigne de la firme Operator par la papatte du compère apprenti sorcier qui me rappelle que «le premier artiste est le chaman qui voit sur la paroi de la grotte l’animal dessiné par la nature et ne fait qu’en marquer le contour de son bout de bois calciné ».
De son bâton de pèlerin, Guido Ceronetti fait tour à tour une baguette de sourcier et un aiguillon ou une trique. Ses coups de sonde dans l’épaisseur du Grand Livre universel ne discontinuent de faire jaillir de fins geysers. A tout instant on est partout dans le temps et les lieux, au fil de fulgurantes mises en rapport. Qu’un quidam le prenne pour un «prêtre», genre dandy défroqué, ou peut-être pour un « frère », teigneux et courtois à la fois, lui fait remarquer qu’en effet il «sacrifie à l’aide du mot».
Et de chamaniser en relevant les vocables ou les formules aux murailles de la Cité dévastée (sa passion pour toute inscription pariétale du genre CATHOLIQUES ET MUSULMANS UNIS DANS LA NUIT ou, de main masculine, ATTENTION ! ILS VEULENT A NOUVEAU NOUS IMPOSER LA CEINTURE DE CHASTETE !, ou encore l’eschatologique LES CLOUS NOIRS REGNERONT) en boutant à l’onomastique le feu du (non)sens ou en soufflant sur les braises de mille foyers épars dans le dépotoir. Bribes alternées des noms de rues et des lieux-dits, des visages et des paysages sans couleurs de l’infinie plaine urbaine, langage grappillés dans les livres de jadis ou de tout à l’heure, des tableaux, des journaux, des gens (le « geste antique » d’un marchand de beignets) ou du bâtiment qui va (« ce petit couvent aussi délicat qu’une main du Greco ») quand tout ne va pas…
Parce que rien ne va plus dans la « mosaïque latrinaire » de ce monde uniformisé dont l’hymne est le Helter Skelter de John Lennon. Venise et Florence ont succombé à la CIVILISATION DES TRIPES et donc à «l’infecte canaille des touristes indigènes transocéaniques».
Place de La Seigneurie, voici les «tambours africains amplifiés par le Japon, hurlement américanoïde de fille guillotinée». Voici ces « jeunes auxquels on a raclé tout germe de vie mentale », autant de « tas d’impureté visible et invisible » qui implorent un coup de « Balai Messianique »…
Il y a du Cingria catastrophiste et non moins puissamment ingénu, non moins follement attentif à la grâce infime de la beauté des premiers plans chez Ceronetti. Le même imprécateur criant raca sur l’arrogance humaine fauteuse de génocides animaux et sur le règne des pollueurs de toute nature, industriels ou chefs de bandes nationalistes devenues « essentiellement d’assassins », ainsi que l’illustrent les derniers feuilletons de la Chaîne Multimondiale (toutes guerres sans chevaux), le même contempteur des aquarelles d’Hitler « irrespirables d’opacité » et qui s’exclame dans la foulée que désormais « presque tout est aquarelle d’Hitler dans le monde nivelé et unifié », le même vidangeur de l’égout humain (« c’est encore homme, ce truc-là ?) est un poète infiniment regardant et délicat qui note par exemple ceci en voyant simplement cela : « Un moineau grand comme un petit escargot près du mur. Vol d’un pigeon. Une cloche »…
Car il aime follement la beauté, notre guide Guido (qui lit Virgile qui guidait Dante que nous lisons), et d’abord ce « geste extrême anti-mort de la Beauté italienne, sourire infini que nous avons oublié et tué », et c’est Giorgione et à saute-frontière c’est Goya, ou dans un autre livre (Le lorgnon mélancolique) c’étaient Grünewald ou la cathédrale de Strasbourg, et les oiseaux mystiques ou quel « regard ami » qui nous purifiera.
Dans l’immédiat, pour se libérer des « infâmes menottes du fini », le voyageur lance à la nettoyeuse des Bureaux Mondiaux : « Au lieu d’épousseter, femme, couvre ces bureaux de merde ». Et déjà le furet du bois joli s’est carapaté en se rappelant le temps où nous étions « croyants du Bois Magique ». Et de noter encore ceci comme une épiphanie : « Petit vase de fleurs fraîches, violettes, resté bien droit, celui d’à côté renversé – des quilles, la vie… »
Guido Ceronetti. La Patience du brûlé. Traduit de l’italien par Diane Ménard. Albin Michel, 1995.
A lire aussi : Le silence du corps, prix du Meilleur livre étranger 1984, repris en Poche Folio.
Ou encore : Une poignée d’apparences, Le lorgnon mélancolique, Ce n’est pas l’homme qui boit le thé mais le thé qui boit l’homme. Etc.
Le Maestro en chemin…
Cioran voyait en lui un « admirable monstre », Fellini raffolait de son théâtre de marionnettes, et La Patience du brûlé signale un écrivain d’une saisissante originalité.
« La vie fait passer, à travers notre pauvre chair, des projectiles, et des poignards », murmure le petit homme à l’imper soigné et au joli béret basque, qui manie notre langue avec un raffinement souverain, à peine voilé d’un accent.
Il sort de prendre les eaux à Yverdon-les-Bains. C’est là que je l’ai rejoint.
« On est blessé, mais aussi cela aiguise. Somme toute j’ai vécu en curieux. En amateur. Tout ce que j’écris vient de la vie. C’est en feuilletant la vie que j’ai découvert des choses… »
De ces « choses de la vie » dont les journaux sont pleins, Guido Ceronetti s’étonne que ses pairs fassent si peu de cas. « Je ne comprends pas que les écrivains italiens d’aujourd’hui se désintéressent à ce point du monde terrible qui nous entoure. On dirait qu’ils vivent en aveugles. Seul, peut-être, mon ami Guido Piovene avait le sens des problèmes de l’époque. Pour ma part, je me suis toujours passionné pour le crime. Il y a là un tel mystère. Et c’est la base, en outre, de toute légende… »
Est-ce un écrivain « engagé » au sens habituel qui s’exprime ainsi, un « témoin de son temps » selon l’expression consacrée ? Et Guido Ceronetti aura-t-il jamais donné dans la narration criminelle ? Pas à ma connaissance. Mais on sait l’implication virulente du chroniqueur de La Stampa dans la réalité italienne.
Anticommuniste en un temps où cela valait d’hystériques condamnations, puis s’en prenant aux pollueurs industriels et aux barbares de la décadence culturelle, il s’est fait détester tous azimuts par sa virulence d’imprécateur et sa position de franc-tireur sans grands moyens.
Car Ceronetti vit de rien dans un bourg de Toscane, loin des cercles littéraires ou académiques. Il n’écrit point de romans à succès mais des poèmes et des sortes d’essais très concentrés, où les aphorismes déflagrateurs (« Comment une femme enceinte peut-elle lire un journal sans avorter ? », « L’arme la plus dangereuse qui ait été inventée est l’homme », « Qui tolère les bruits est déjà un cadavre », « Si le Mal a créé le monde, le Bien devrait le défaire ») voisinent avec des développements plus amples sur les thèmes essentiels du rapport de l’homme avec son corps et avec le Cosmos, impliquant donc la maladie et l’érotisme, l’obsession quasi maniaque pour la diététique et une détestation non moindre de la technique (« un serviteur admirable, savez-vous, si parfait qu’il va nous supprimer »), la réflexion métaphysique et la méditation sur l’Histoire passée et présente, entre autres intuitions mystiques, digressions philologiques, émerveillements artistiques, vibrations sensibles enfin du médium un peu sorcier qui a recréé la vie à bout de fil en qualité de manipulateur de marionnettes, à l’enseigne de son fameux Teatro dei Sensibili très prisé du Maestro Fellini.
Un cathare en haute Toscane
Dans sa postface au Silence du corps (prix du Meilleur Livre étranger 1984), Cioran disait que l’impression donnée par Ceronetti est « de quelqu’un de blessé, à l’égal de tous ceux à qui fut refusé le don de l’illusion ». De son ami roumain, Ceronetti partage au reste la vision gnostique du monde.
« C’est vrai, je suis une sorte de cathare. Peut-être cette vision dualiste est-elle fausse. Je ne sais trop, mais j’ai besoin de penser ainsi… »
Répugnant à parler de lui-même, cet « ascète raté », ainsi qu’il se présente lui-même, se fait beaucoup plus loquace dès lors qu’on l’interroge sur l’Ancien Testament, citant par cœur des strophes entières de L’Ecclésiaste, dont, avec celles du Livre de Job, les âpres vérités et la sagesse contradictoire l’imprègnent depuis sa jeunesse.
Sombre Ceronetti ? Certes très pessimiste sur l’avenir de l’espèce : « Le monde actuel va devoir affronter un terrorisme de type apocalyptique. Voyez le nouveau nihilisme à caractère religieux qui se développe dans le monde, notamment chez les islamistes et les sectes : il semble qu’il n’y ait aucune possibilité de paix, et que l’humanité doive s’enfoncer ainsi dans cette boue sanglante… »
Prophète de malheur, mais aussi porteur de quelle lumière intérieure, tel est Guido Ceronetti dont rayonne, de loin en loin, le sourire d’enfant.
***
13. La lumière d’écrire dans la nuit de vivre
Une rencontre avec Charles Juliet, en 1992, qui fut l’occasion d’un entretien…
En un temps où, par médias interposés, triomphent apparemment les habiles et les bavards, il est certaines fréquentations qui ont la vertu de nous ramener à une plus discrète et plus juste approche de toute chose, dans l’accord et l’intensité d’une vraie présence et d’une voix singulière.
L’oeuvre de Charles Juliet, dont le sillon conduit du plus noir désespoir aux lueurs d’une sérénité gagnée de haute lutte, ménage cette sorte de rencontre en vérité. Or il m’a paru bon de prolonger ce compagnonnage de lecture avec l’auteur au naturel. C’était le 3 septembre dernier à Jujurieux, village natal de Charles Juliet qu’on peut situer entre Genève et Lyon, au pied des collines boisées du Bugey, où l’écrivain et son épouse M.L. accoutument de passer la belle saison.
Dès la découverte du premier livre de Charles Juliet, paru à Lausanne en 1973 à l’initiative de Georges Haldas qui le préfaça de surcroît, ce fut une voix qui nous toucha. Sous le titre de Fragments, cet extrait initial du Journal à venir nous révélait un homme en proie à une difficulté d’être extrême, dont chaque mot paraissait lesté de souffrance lancinante. Mais ce qui saisissait, à la fois, tenait à la densité et à l’intensité de cette parole scrupuleuse et dépouillée, à la force sourde qu’on sentait sous les hésitations et les timidités de cette voix, à la substance revigorante de ces pages pétries de détresse. Et de même perçoit-on, à la rencontre de Charles Juliet, ce mélange de fragilité presque diaphane et de vigueur terrienne, de réserve songeuse et d’attention cordiale, de détachement et de présence.
Après la parution de son premier livre, et au fil de publications régulières, Charles Juliet s’est acquis l’attachement et l’estime d’un public demeuré longtemps restreint. C’est que, des substantielles Rencontres avec Bram Van Velde, qui relèvent de l’entretien «pour l’essentiel» bien plus que de la glose picturale, aux poèmes abrupts de L’oeil se scrute, entre dix autres recueils, Charles Juliet n’a jamais cherché la séduction.
Dans l’introduction à l’édition en trois volumes de son Journal 1957-1981, aux pages duquel il faut revenir et revenir comme aux carnets d’Haldas ou au bouleversant Journal d’Etty Hillesum, l’auteur exprime, sous forme quasiment mythique, la difficulté et le sens de son acharné combat.
Plus récemment cependant, en 1989, la parution de L’année de l’éveil devait marquer la rencontre de Charles Juliet avec le grand public, consacrée par un prix très populaire et l’adaptation du livre au cinéma. Rappelons qu’il s’agit du récit autobiographique des terribles et mémorables années que l’auteur passa aux enfants de troupe, marquées par l’humiliation et la violence, autant que par l’amitié et les feux de la passion illicite liant l’adolescent à la femme de son mentor. Dans le sillage de Jules Renard ou de Giovanni Verga, ce récit prolonge son exorcisme, et parfois avec plus d’acuité mordante et de souffle lyrique, avec une nouvelle mosaïque de textes parus cette année sous le titre L’inattendu.
Aux confins de la fiction, pudeur et secret oblige, l’on y voit apparaître les figures de la famille d’adoption et quelques beaux personnages de cette chère et dure campagne où le poète conserve de profondes racines.
A Jujurieux, où j’imaginais, au temps du Maréchal, le gosse pieds nus menant paître ses vaches dans les champs pierreux cernés de forêts, ce sont les petits chameaux à peluche mitée d’un cirque de passage qui m’ont accueilli ce jour-là dans la rue en pente. Un peu plus haut, sur la place de la mairie, je savais la maison de l’écrivain jouxter le monument aux morts, reconnaissable à sa façade couverte de lierre.
Quant à mes hôtes, ils se tenaient sur le seuil, tous deux de bleu vêtus, lui comme en retrait d’abord et elle présidant à l’accueil — elle qui soutint son poète pendant tant d’années de doute et d’obscur labeur, souriante et solide, aux petits soins et se révélant bientôt aussi fine lectrice qu’exquise cuisinière. Tout, au reste, dans la haute et claire carrée aux quelques meubles précieux et aux tableaux en harmonie, traduit le même alliage de solidité terrienne et de lustre civilisé. Avouerai-je que je craignais vaguement, parce qu’il y a du Job et du Jérémie dans ses écrits, d’avoir à affronter un personnage ombrageux et farouche, voire même ravagé ? Or en dépit d’un tension intérieure toujours manifeste, c’est bien plutôt sous l’aspect de la simplicité et du naturel que m’est apparu Charles Juliet pour cette première rencontre.
— L’idée que nous devons aspirer à une deuxième naissance vous a beaucoup préoccupé. Voudriez-vous nous en entretenir pour commencer ?
— Cette deuxième naissance est à vrai dire la seule chose qui m’intéresse et c’est ce qui gouverne tout ce que j’écris. Cela peut être plus ou moins explicite, mais c’est toujours présent, lié à cette immense aventure qu’est la connaissance de soi. Qu’est-ce que se connaître ? C’est plonger en soi-même pour aller à la découverte de tout ce qui constitue l’individu, avec cette idée qu’on doit résoudre ses conflits et ses contradictions, s’efforcer de se mettre en ordre afin d’avoir des rapports plus simples, plus immédiats avec les autres et avec la vie. Pour moi, l’écriture a toujours été soumise à une exigence éthique, et seules m’intéressent vraiment les oeuvres qui rendent compte d’une telle aventure.
— Lesquelles citeriez-vous notamment ?
— Je pense à Tolstoï et aux mystiques que j’ai beaucoup fréquentés. Quoique n’ayant aucune croyance religieuse, j’ai découvert que cette aventure que je vivais, avec les moyens et les limites qui sont les miens, avait été celle aussi des mystiques.
— À quel moment la rupture avec la foi catholique, qui a marqué votre éducation ainsi qu’en témoigne L’année de l’éveil, s’est-elle consommée ?
— Il n’y a pas eu de rupture, mais bien plutôt un lent éloignement. Je ne pense pas que ma croyance d’adolescent avait des racines bien profondes. A partir du moment où j’ai commencé de réfléchir, je me suis éloigné de tout cela sans qu’il y ait le moindre déchirement. Cependant, l’expérience de l’art telle que je la conçois relève de l’aventure spirituelle rigoureuse, telle que je la retrouve chez Van Gogh, chez Cézanne ou chez Rembrandt. Cette aventure conduit, à un moment donné, à passer par une mort à soi-même. Cette mort, je l’ai vécue moi-même avec une intensité dramatique. Ce n’est pas une figure de style: il y a là, vraiment, l’acceptation du fait inéluctable qu’on va disparaître. Or c’est dans la mesure où l’on accomplit ce passage par la mort, qui est autant mort de l’âme que du corps, que par la suite peut s’épanouir une pensée qui ne soit plus assujettie à des considérations strictement personnelles. Alors on s’affranchit du moi et de l’individuel.
— Vous parlez de votre souci de vous tenir dans «le neutre». Qu’entendez-vous exactement par là ?
— Le neutre, pour moi, est un lieu géométrique où se rencontrent les contradictions. J’écris dans cette zone de tension. Cela signifie par exemple, si l’on se situe à un extrême, consistant à célébrer la vie et ses beautés, à entrevoir au même moment la violence et la barbarie humaines. Le souci du neutre conditionne mon écriture et mon style, si j’en ai un. Je crois qu’écrire doit l’être avec gravité, simplicité, sans enjoli-vures, sans afféterie, sans littéra-ture, sans rhétorique.
— Est-ce une règle conquise, ou cela vous est-il naturel ?
— Cela m’a été imposé. Depuis toujours, ainsi, et même lorsque je me trouvais dans une grande confusion, je me suis trouvé empêché d’entrer dans certaines oeuvres.
— Par exemple l’oeuvre de Julien Gracq, que je respecte hautement, mais qui me semble appartenir à la seule littérature. Or à mes yeux, une oeuvre doit toujours se situer du côté de la morale plus que de la rhétorique. Je n’aime pas qu’un écrivain me donne le sentiment qu’il se laisse emporter par les mots, par son talent, par sa langue. C’est pourquoi j’aime particulièement, aussi, les textes de la Bible tels que Le Livre de Job, le Cantique des cantiques, L’Ecclésiaste ou les Prophètes.
— Dans votre Journal, vous écrivez que «le poète répète le Christ». Qu’est-ce à dire plus précisément ?
– Le grand poète, s’il existe, ne peut être qu’en total accord avec l’enseignement délivré par le nouvel Evangile. De quoi s’agit-il en effet ? D’une exigence d’humilité, de bonté, de respect des autres. Je pense que l’amour, sauf pour quelques privilégiés, est à conquéir sur notre égocentrisme, notre goût du pouvoir et de domination, sur l’envie, sur tout ce que j’appelle le moi et qui enferme l’individu à l’intérieur de limites très étroites.
— Vous êtes entré en littérature comme en religion, rompant avec vos études de médecine et ne vous consacrant plus, dès l’âge de vingt-trois ans, qu’à l’écriture. Comment l’avez-vous vécu, et comment votre entourage l’a-t-il accepté ?
— J’ai senti que cette exigence était si impérieuse et si ardente que je ne pouvais rien faire d’autre que de m’y consacrer entièrement. Cela n’a pas été sans mal. Je suis resté des années et des années sans rien publier ni gagner un centime, sans donner la preuve matérielle que je travaillais, ce qui ne pouvait manquer de me faire passer pour un type un peu fêlé. Cependant je travaillais bel et bien. J’ai d’abord écrit un roman, intitulé L’humiliation, évoquant ma vie aux enfants de troupe, mais qui n’avait rien de commun avec L’année de l’ éveil. C’est qu’il y avait beaucoup de choses que je n’osais pas encore aborder, à commencer par le récit de ma passion amoureuse. En outre, le livre était plein de ressentiment. Puis j’ai écrit deux pièces de théâtre, des nouvelles et des poèmes, mais je st entais que tout ça n’était pas bon et qu’il fallait que je travaille encore beaucoup. Bien souvent j’ai failli perdre pied, mais je sentais obscurément que mon temps n’était pas encore venu. Par la suite, tout s’est arrangé comme malgré moi. Ainsi, lorsque j’ai rencontré Georges Haldas, qui m’a proposé de publier mon premier livre, l’on aurait dit que les circonstances me souriaient enfin parce que j’y étais prêt. »
Quant à la réaction de mon entourage, elle fut variée. Du côté de ma famile adoptive, composée de gens très simples, on ne savait pas trop ce que cela représentait. En revanche, la famille de ma femme l’a beaucoup moins bien toléré. Etant alors assoiffé d’affection, j’ai beaucoup souffert du refus qu’on opposait à mon choix. Mais cela ne m’a jamais fait dévier de ma voie. C’est curieux, parce qu’autant je puis apparaître comme quelqu’un de détruit par le doute, autant j’ai cette opiniâtreté du paysan qui se dit qu’après avoir ouvert un sillon c’est jusqu’au bout qu’il faut aller.
— La reconnaissance publique découlant de vos succès récents a-t-elle compté pour vous ?
— Cela m’a fait, sans doute, beaucoup de bien. J’y ai puisé un regain de confiance en moi, quand bien même je reste plein d’incrédulité devant ce qui m’arrive. En outre, et surtout, j’ai été très touché par l’abondant courrier que je reçois, qui me prouve que ce que je croyais être seul à endurer l’est souvent par des gens qui n’ont même pas les moyens de l’exprimer, et qui me témoignent leur reconnaissance pour avoir dit ce qu’ils ressentent, les aidant en somme à vivre.
— De ces longues années de tâtons reste aussi votre Journal. Ce que vous en publiez représente-t-il le tout ou seulement des morceaux choisis ?
— Tout est publié. Mais notez qu’à l’origine, ces notes que je prenais sur des feuilles volantes ne l’étaient pas du tout en vue d’une publication. Raconter mes journées ne m’intéressait aucunement. J’ai toujours conçu le joural comme un instrument de connaissance et de clarification.
— Vous avez fait, au cours de votre vie, quelques rencontres importantes. Il y eut d’abord le peintre Bram Van Velde, et Beckett aussi vous a fortement marqué. Qu’en retenez-vous aujourd’hui ?
— L’émotion est, pour moi, ce qui prime à tous égards. De là vient que je n’ai jamais été attiré par les recherches de l’avant-garde littéraire, trop sophistiquées à mon goût. En revanche les oeuvres de Beckett ou des artistes silencieux tels Ubac ou Bram Van Welde m’ont touché en cela qu’elle sont traversées par la même aspiration à l’immuable. Parmi les écrivains d’aujourd’hui, ce fut en outre une joie de découvrir les livres de Christian Bobin. qui sait dire des choses essentielles dans un langage tout simple et primesautier, d’une fraîcheur qui m’émerveille. Trop souvent on voit des oeuvres qui naissent de la culture ou du talent, mais qui ne sont pas irriguées en profondeur. Ma propre solitude a pris fin dès lors que j’ai découvert Tchouang-tseu. Ceci dit, je crois que l’aventure humaine est une. On peut mettre ainsi, côte à côte, des passages de Beckett, de Saint Jean de La Croix ou de Tchouang-tseu pour former un texte d’un seul tenant. Dans le même éat d’esprit, et pendant des années, j’ai rêvé de concentrer, en un seul poème, tout ce qu’au monde j’avais à dire…
14. Pour l’amour de soi
Des Chants de l’amour de soi à Ceux qu’on oublie difficilement, le jeune poète japonais Takuboku (1886-1912) nous reste plus proche, en sa rage individualiste, que maints de nos contemporains confits de narcissisme insipide…
Ishikawa Takuboku pleure beaucoup dans le cycle poétique de L’Amour de moi – titre choisi dans la traduction fort élégante de Tomoko Takahashi et Thierry Trubert-Ouvrard, auquel Yves Marie-Allioux, moins littéraire et probablement plus proche de l’original, préfère les Chants de l’amour de soi, constituant la première partie du recueil intitulé Une poignée de sable, désormais classique de la poésie japonaise au même titre que l’œuvre d’un Rimbaud.
Un tanka résume le mélange très particulier de tristesse et de drôlerie qui caractérise le ton du jeune poète mal dans sa peau de citoyen révolté, de mari et de père: «Larmes larmes / Que c’est mystérieux ! / Comme je le lavais avec des larmes mon cœur a voulu faire le pitre»…
Dans la foulée, on peut rappeler que le tanka est un bref poème traditionnel, de forme un peu plus ample que le haïku, et passablement rénové par Takuboku qui l’accommode à tous les instants fugitifs ou transitoires de la vie quotidienne, entre autres «minutes heureuses» et cris ou chuchotements.
Larmes du fils: «En salivant sur un morceau de terre / j’ai modelé une effigie de ma mère en train de pleurer / Non mais quelle tristesse!» Ou encore : «Pour plaisanter j’ai pris ma mère sur mon dos / elle était si légère que j’en ai pleuré / avant d’avoir fait trois pas»…
Larmes ravalées. «Ressentant une angoisse profonde / je me fige / et finis par me masser doucement le nombril». Larmes de l’esseulé: «Seul face à l’immensité de la mer / sept huit jours / pour pleurer j’aurai quitté mon foyer». Larmes de crocodile métaphysique: «Oh la tristesse de ce sable sans vie! / Ce doux bruit / quand on le saisit avant qu’il ne tombe d’entre les doigts».
Ou cette lucidité sur soi qui est le contraire du narcissisme complaisant: «Lorsque j’entends des flatteries / de colère se soulève mon cœur / Trop se connaître soi-même quelle tristesse!».
Ou cette bonne rage contre ceux qui l’ont humilié: «Ah que ceux qui ne fût-ce qu’une fois m’ont fait baisser la tête / que tous ces gens crèvent! / m’est-il parfois arrivé de souhaiter».
Ou cette colère du jeune homme contre la société inégalitaire et matérialiste qu’il exècre: «Insupportables sont les visages serviles de mes compatriotes / tels qu’ils apparaissent à mes yeux aujourd’hui / je m’enferme chez moi»…
Phosphorescences quotidiennes
Les citations des Chants de l’amour de soi que je viens de recopier ici proviennent de la version d’Une poignée de sable signée Yves-Marie Allioux, qui a accompagné sa traduction d’une série de notes explicatives très précieuses et d’une postface non moins éclairante, intitulée Ishikawa Takuboku ou la phosphorescence de la vie courante, par allusion au discours prononcé à Stockholm par Patrick Modiano à la remise de son prix Nobel de littérature.
Cet extrait en oriente le propos: «J’ai toujours cru que le poète ou le romancier donnaient du mystère aux êtres qui semblent submergés par la vie quotidienne, aux choses en apparence banales – et cela à force de les observer avec une attention soutenue et de façon presque hypnotique. Sous leur regard, la vie courante finit par s’envelopper de mystère et par prendre une sorte de phosphorescence qu’elle n’avait pas à première vue mais qui était caché en profondeur. C’est le rôle du poète et du romancier, et du peintre aussi, de dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouvent au fond de chaque personne»…
Où la poésie transcende la méconnaissance
L’idée que la poésie ne soit qu’une sorte d’enjolivure du réel, ou qu’un rébus cérébral à usage d’élite, perdure aujourd’hui du plus basique (la pseudo-poésie déferlant sur les réseaux sociaux) au plus raffiné (la «poésie poétique» plus ou moins instituée), et c’est contre cela que réagissait Takuboku en affirmant que «la poésie ne doit pas être une soi-disant poésie» mais «doit être une relation rigoureuse des variations de la vie émotionnelle de l’être humain (il doit toutefois exister une expression plus adéquate), un journal tenu en toute honnêteté»…
***
15. Albert Cohen ou la fusion des contraires
Partagées par une dualité fondamentale, la vie et l’œuvre du grand écrivain trouvent leur unité dans le miracle d’une écriture fondée en humanité et visant un idéal fraternel. Anne Marie Jaton, dite la Professorella, après ses remarquables approches de Cendrars, Bouvier, Cingria, Chessex ou Queneau, éclaire les deux faces d’une œuvre de folle verve et de noire lucidité.
C’est d’abord l’histoire, à valeur de scène primitive, d’un garçon de 10 ans sortant à peine des verts paradis où il fut l’enfant-dieu de sa mère, pour se trouver soudain confronté à l’abjection de notre drôle d’espèce.
Cela se passe en 1905 dans une rue de Marseille où la famille Coen s’est réfugiée à la suite de graves persécutions antisémites en l’île de Corfou, et voici qu’un camelot, vantant dans la rue les vertus d’un détachant «universel», s’en prend soudain au gosse à teint bistre et boucles noires du premier rang en lequel il identifie un «youpin», qu’il houspille avant de lui conseiller d’aller voir à Jérusalem s’il y est…
Comme nul ne prend, alors, la défense de l’enfant insulté, celui-ci vit l’agression comme une révélation de sa «différence» et d’un motif possible de rejet et d’exclusion. Un an plus tard, le Juif Dreyfus sera innocenté, au soulagement du père Coen, mais l’antisémitisme fera désormais partie de la vie d’Albert, ajoutant plus tard un h à son nom, même s’il n’est pas lui-même un Juif pratiquant, véritable macédoine identitaire à lui seul puisqu’il est Gréco-Turc par son père et Vénitien par sa mère, Genevois d’adoption à l’âge d’amorcer des études de droit, et ensuite Français de culture, Occidental aimant et détestant l’Occident (où Goethe et Mozart n’excluent pas Hitler) comme il aime et déteste sa filiation juive, jamais réconcilié avec un Dieu qui a «vu» l’anéantissement du ghetto de Corfou et les camps de la mort sans lever le petit doigt.
Dès ses premiers poèmes (répudiés par la suite), Albert Cohen a d’ailleurs marqué sa distance par rapport au Dieu biblique. Cependant, toute sa vie durant, une espèce d’inquiétude «pascalienne» le hantera, liée à la place de l’homme sur cette terre, cerné de mystère dès sa naissance et conscient, voire obsédé (c’est son cas) par l’idée de la mort, parfois même tenté par le suicide.
Ma sœur, passeur (e), la Professorella…
Le féminin de passeur est, en langue inclusive, passeure, mais je lui préfère quant à moi, s’agissant d’Anne Marie Jaton, le surnom de Professorella, au motif que celle-ci, issue de milieu lausannois plus que modeste, devenue titulaire de la chaire de littérature française à la prestigieuse faculté des lettres de Pise, incarne elle aussi, à mes yeux, le miraculeux mariage des contraires par sa façon de conjuguer l’érudition joyeuse et l’intelligence du cœur, avec une vraie passion de transmettre.
Or me demandant ce qui l’a intéressée chez Albert Cohen après ses livres consacrés à Cendrars et à Nicolas Bouvier, à Jacques Chessex et à Raymond Queneau, je me dis là encore: le mariage des contraires. De Cendrars, en effet, elle a montré la double nature épique et mélancolique; de Nicolas Bouvier, le mélange de curiosité universelle et de repli inquiet; de Chessex, la sensualité revendiquée et l’ombre puritaine; de Raymond Queneau, l’apparente fantaisie et la gravité secrète.
Autant dire qu’il n’est pas si étonnant que cette universitaire atypique couverte de chats et de chiens, épouse d’un vieux sage du barreau italien qui ne fut pas pour rien dans la fondation des auberges de jeunesse de la réconciliation européenne, fasse ami-ami avec le fringant Solal, l’adorable Ariane de Belle du seigneur, les Valeureux de Céphalonie et toute la smala des personnages de Cohen.
Anne Marie Jaton est, en outre, une lectrice infiniment poreuse, capable d’autant d’attention à l’égard du dernier épisode de la série du commissaire sicilien Montalban qu’à la réflexion proposée par René Girard sur le mimétisme amoureux. C’est ce qui fait de sa lecture d’Albert Cohen une possible (re)découverte vivifiante.
Entre l’alcôve, le bureau et les camps.
Lorsque son fils Albert étudiait le droit à Genève, non sans courtiser diverses dames avant d’en trouver une dans la bonne société calviniste, sa mère adorante, à Marseille, continuait de placer son couvert sur la table, en réservant les meilleurs morceaux à l’Absent au jour de son anniversaire. On peut ricaner, mais ce serait ne pas voir la grandeur quasi mythique de cette relation dont le père (ce gorille) est exclu, et qui prépare une singulière révision de ce qu’on appelle la passion amoureuse, telle que l’a décrite Denis de Rougeneont dans son fameux Amour et l’Occident.
La Professorella, à qui on ne la fait pas – on n’enseigne pas les subtilités de l’amour en littérature aux jeunes étudiants italiens férus de séries télévisées sans en tirer quelque expérience -, souligne justement l’importance de l’extravagante introduction de Belle du seigneur, fantastique illustration de la passion mimétique, avant de relever aussi le génie satirique d’Albert Cohen, dans son évocation des bureaux kafkaïens des institutions internationales où pontifie Adrien Deume – cela pour la tétralogie incluant Solal, Belle du seigneur, Mangeclous et Les Valeureux, qui ne devraient faire qu’un.
Solal le magnifique, dont le nom suggère la double nature solaire et solitaire, se déguise en vieillard hideux dans l’ouverture de Belle du Seigneur afin de séduire la belle Ariane qui lui a tapé dans l’œil lors d’une soirée. La mascarade introduit illico un thème récurrent de toute l’œuvre romanesque de Cohen, sur fond de comédie sociale tissée de mensonges : celui de notre réalité mortelle que nous ne cessons d’éluder. Ensuite le séducteur pourra revenir à la charge à visage découvert, mais c’est sa propre image, et celle de l’amour idéalisé, qui se fracassera après les feux de la passion, reflétant la vision pessimiste, voire parfois désespérée, de l’écrivain qui, là encore, produit un flamboyant chant d’amour au revers désenchanté.
Et puis il y a la mort semée par les hommes, à l’horizon de l’histoire avec une grande Hache. Dans la partie de l’œuvre qu’Anne Marie Jaton appelle «les œuvres du moi», et plus précisément dans Ô vous frères humains, Albert Cohen a parlé des camps de concentration, comme le narrateur des Valeureux
exprime son horreur au moment du départ de ses cousins pour Marseille : « Soudain me hantent les horreurs allemandes, les millions d’immolés par la nation méchante, ceux de ma famille à Auschwitz et leurs peurs, mon oncle et son fils arrêté à Nice, gazés à Auschwitz ».
Et dans ses Carnets de 1978, trois ans avant sa mort, c’est à Dieu lui-même que l’écrivain s’adresse en revenant sur l’incompréhensible horreur : «Tu as accepté tant de malheurs sur le peuple de Ton choix. Auschwitz, Dachau, Treblinka. Tant de malheurs injustes et tant de bonheurs immérités. Seigneur Dieu, explique Ton silence, justifie Ton indifférence».
Et la Professorella de conclure : «C’est sur cet appel, sur l’évocation de cette obscure énigme, l’une des plus angoissantes du 20 et du 21e siècles et sur laquelle se sont interrogés théologiens et philosophes – en particulier Jans Jonas dans Le concept de Dieu après Auschwitz – que se termine l’œuvre du moi».
Sur le même thème, Anne Marie Jaton a publié, en 2015, avec Fabio Ciaralli, un passionnant aperçu de la littérature suscitée par l’extermination, où les témoins directs, de Primo Levi à Imre Kertsez ou Elie Wiesel, Etty Hillesum ou Charlotte Delbo, ont osé exprimer, avec leur âme et leurs tripes, mais aussi leur talent, en écrivains ou en poètes, ce qu’on croyait indicible.
Terrible traversée que celle de ce livre (non encore traduit en français), qui s’achève sur un poème de Charlotte Delbo faisant écho à l’appel de Cohen à ses frères humains en nous interpellant d’un déchirant Ô vous qui savez : «Vous saviez que les pierres des routes ne pleurent pas / Qu’il n’y a qu’un seul mot pour l’épouvante / Un seul mot pour l’angoisse ? Vous saviez que la souffrance n’a pas de limite / L’horreur aucune frontière ? / Vous le saviez, vous qui savez ? »
La fraternité au bout de la nuit
Mais on verra que les Valeureux incarnent aussi cette forme d’amour «malgré tout» que représente l’humour, sur la face lumineuse de l’œuvre, et que toutes les contradictions liées à la condition humaine, la dualité des individus, la méchanceté née de la peur ou du besoin de dominer, les fractures culturelles ou les dissensions idéologiques peuvent être dépassées.
Il ne s’agit pas de dorer la pilule mais d’aspirer, selon l’expression de Cohen lui-même, au «mariage miraculeux des contraires». Le macho Solal reste à certains égards un enfant, les personnages les plus vivement épinglés par le satiriste, tel le pauvre Adrien Deume, ont droit finalement à la même tendresse que le père de l’écrivain, longtemps perçu comme un rival écrabouilleur.
Parfois déconcertante par son baroquisme échevelé à l’orientale, les monologues pléthoriques d’Ariane ou ses dissonances musicales à la Mahler, l’œuvre d’Albert Cohen, dont le langage est à la fois de sel et de miel, selon l’expression de la Professorella, est finalement concertante en cela qu’elle exprime «en musique» qu’un accord avec le monde, et même avec notre terrible espèce, ne relève pas que du pipeau…
Anne Marie Jaton. Albert Cohen, le mariage miraculeux des contraires. Presses polytechniques et universitaires romandes, collection Le Savoir suisse, 121p
Anne Marie Jaton et Fabio Ciaralli. Andata e (non) ritorno, la letteratura dello sterminio fra storia e narrazione. Edizioni ETS, 2015.
(Dessin: Matthias Rihs.)
***
16. L’innocence perdue
À propos de Pastorale américaine, de Philip Roth, premier volet d’un triptyque magistral.
C’est le roman d’un Américain modèle, sûr d’être un type bien, qui se fait cracher à la gueule et démolir par sa propre fille. C’est le roman des incendiaires des années 60 déboulant dans le salon bourgeois de Monsieur Bonhomme. C’est le roman du terrorisme exacerbé par l’idéologie. C’est le roman du traumatisme provoqué par le guerre du Vietnam. C’est le roman d’une rupture de filiation. C’est le roman d’une cassure profonde qui n’a pas affecté, cela va sans dire, la seule société américaine, mais dont les effets s’observent partout, aujourd’hui encore. C’est tout cela que Pastorale américaine, premier volet d’une trilogie aujourd’hui achevée.
Pastorale américaine est intéressant comme le sont les romans de Balzac. C’est d’ailleurs un roman balzacien. A l’ère post-post-moderne, cela pourrait faire un peu vieux jeu. Mais on continuera de lire Pastorale américaine bien après qu’on aura oublié le post-post-post-modernisme.
Intéressant, ce roman l’est à la fois par sa matière et par les points de vue qui modulent l’observation de celle-ci. La densité psychologique et sociale (je dirai même anthropologique pour faire plus sérieux) suffirait à en faire un roman passionnant sur une époque, mais la forme du récit et la position du narrateur aboutissent à ce qui me semble réellement un grand roman, transparent au premier regard (avec l’élan épique d’un Thomas Wolfe et la clarté d’un Hemingway) et développant en sourdine un un thème, fondamental pour le romancier, qui touche à l’énigme constituée par chaque individu et au moyen de surmonter ( ?) le malentendu de toute relation ou de tout jugement univoque.
Les grands romans ne courent pas les rues en cette fin de siècle, dont on puisse dire qu’ils cristallisent l’esprit d’une époque, comme il en fut des Illusions perdues de Balzac ou des Démons de Dostoïevski. Comme Balzac, Philip Roth ressaisit pourtant la matière sociale et psychologique de quatre décennies, aux States d’après-guerre, par le truchement d’un observateur d’une porosité sans limite.
A partir d’un microcosme (une famille d’artisans industriels gantiers de la banlieue de Newark) et d’un personnage à dégaine de héros de stade (le champion de lycée par excellence, splendide athlète blond surnommé le Suédois alors qu’il est juif, qui défie son père en épousant une catholique d’origine irlandaise), le romancier fait le portrait vivant, après la reddition du Japon, « l’un des plus grands moments d’ivresse collective » de son histoire, dont l’ « océan de détails » roule ses vagues puissantes et chatoyantes dans la première partie du livre, intitulée Le Paradis de la mémoire.
Or la mémoire ne travaille pas, dans Pastorale américaine, qui se poursuit en trois temps avec La chute et Le paradis perdu, de façon linéaire ou monophonique. D’entrée de jeu, nous savons que le narrateur (l’écrivain Zuckerman bien connu des lecteurs de Roth, la soixantaine et se remettant d’un cancer – comme l’écrivain) se trompe en ce qui concerne le Suédois, idole de sa jeunesse qu’il retrouve en 1995 et qui lui montre la façade la plus rutilante alors qu’il est mourant et porte en lui le secret d’une défaite.
L’histoire de ce secret, constituant la trame du roman, devient alors, par delà la mort du « héros », le fait du romancier, dont la réalité imaginée revivifie la partie supposée « réaliste » du tableau d’époque. Ainsi, à la première image du parfait Américain figurant « l’incarnation de la platitude », se substitue celle d0un homme beaucoup plus complexe et attachant, type du bâtisseur de bonne foi formé à la longue et difficile discipline du métier de son père (lequel métier nous vaut un véritable « reportage » balzacien sur les gantiers de Newark, dont la déconfiture adviendra lors des cataclysmes sociaux de Newark) et dont les affaires prospères ne font que matérialiser son loyalisme tous azimuts.
Face à cette Amérique positive, la révolte de Merry, fille adorée du Suédois, relève du mystère dostoïevskien ou de ce que René Girard appelle la « médiation interne », et c’est alors que Pastorale américaine s’enrichit d’une composante réellement tragique puisque la « pureté » de la jeune fille va conduire successivement à l’attentat politique et à son autodestruction « mystique ».
« Qui de nous a connu son frère ? Lequel d’entre nous a déjà pénétré dans le cœur de son père ? Qui de nous ne demeure à jamais étranger et seul ? », peut-on lire en exergue à L’Ange exilé de Thomas Wolfe, grand roman du rêve américain de la première moitié du XXe siècle dont le Suédois paraît sortir avant que de perdre son innocence, sans pénétrer le cœur de son propre enfant, dans ce roman des illusions perdues que constitue Pastorale américaine.
Philip Roth. Pastorale américaine. Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Josée Kamoun. Gallimard, coll. Du monde entier, 1999. 433p. Disponible en poche Folio.
***
17. Enfances d’un sage

À propos de La Leçon interrompue de Hermann Hesse.
L’arrière-fond de toutes ces nouvelles se partage entre l’enfance et les années d’apprentissage de l’auteur, dans un climat mêlé d’effusion radieuse et de mélancolie.De l’un à l’autre des cinq récit très judicieusement rassemblés ici et traduits par Edmond Beaujon sous le titre de celui qui clôt le volume, l’on se balade de fait dans le même univers de sensations et de rêveries dont on dirait qu’ol émane des paysages d’Allemagne méridionale chantée par les romantiques, de Tübingen à Calw et jusqu’aux rives du lac de Constance.
Loin de constituer, au demeurant, des souvenirs d’enfance ou de jeunesse au sens conventionnel, ces récit nous proposent, sous des angles forts différents – deux d’entre eux datent des débuts de l’écrivain, tandis que les trois autres sont du septuagénaire –, une méditation marquée au sceau du temps sur les évènements , significatifs ou parfois insignifiants, qui ont contribué à façonner la personnalité de l’auteur.
On sent à l’évidence, dans les trois nouvelles extraits des proses tardives –composées en 1948 et 1949 -, des préoccupations faisant écho à la crise de conscience européenne dont Hesse fut un témoin solitaire et non conformiste, mais le fond de sa perception du monde et des êtres n’en apparaît pas moins d’un seul tenant dans l’ensemble de l’ouvrage, et notons alors la remarquable maturité intérieure du jeune écrivain qui compose, entre 19 et 26 ans les deux parties de Mon enfance.
Dès ces années, Hermann Hesse a de son enfance une image où le symbole prime sur l’anecdote. Interrogeant ses souvenirs les plus reculés, jusqu’en deça de la troisième année, à la façon d’un Andrei Biély dans Kotik Letaev, l’auteur cherche à cristalliser la figure de contemplation de cet âge d’or.
L’enfant essentiel
Cela étant, Hesse se garde bien d’idéaliser une enfance où le mal à sa part, sa nostalgie l’y portant non parce qu’il y situe le lieu de la parfaite innocence, mais parce que chaque chose y a encore sa fraîcheur et sa densité, sa part de gravité et de mystère. L’enfant que sa mère berce de contes merveilleux, et dont le père dirige la curiosité avec la plus grande bienveillance, pose en toute ingénuité les premières grandes questions de la vie : d’où viennent la pluie et la neige ? Pourquoi sommes-nous riches alors que notre voisin le ferblantier est pauvre ; et quand on meurt, est-ce pour toujours ? Interrogations qui associent, sous le même signe de l’absolu, l’enfant et le sage.
Et l’écrivain de relever alors que «l’existence de bien des personnes gagnerait eu sérieux, en probité, en déférence, si elle conservaient en elles, au-delà de leur jeunesse, quelque chose de cet esprit de recherche et de ce besoin de questionner et de définir».
Rien de mièvre, en outre, dans cette remémoration des expériences enfantines de l’auteur : qu’il s’agisse du premier affrontement sérieux opposant le garçon aux siens, du souvenir de la mort précoce d’un de ses camarades de jeu, de certaines missions le délivrant momentanément de sa prison scolaire (dans La leçon interrompue) pour le confronter aussitôt après à la fatalité qui s’acharne sur certains destins, ou d’une scène lui révélant (dans Le mendiant) la probité digne et charitable à la fois de son père, Hesse se garde, dans ves rêveries méditatives, et du prône moralisateur et du seul charme incantatoire de la narration.
Une réelle magie se dégage pourtant de la plus accomplie de ces nouvelles, intitulée Histoire de mon Novalis. Dans une tonalité qui l’apparente aux romantique allemands, ses frères en inspiration, le jeune Hesse (qui avait alors vingt-trois 23 ans) se plaît, par la voix d’un aimable bibliophilr, à retracer, de mains en mains, l’itinéraire d’une « quatrième augmentée » datant de 1837, des œuvres de Novalis, imprimée à Stuttgart sur papier Java… L’on fait alors connaissance, à Tübingen, de braves étudiants jurant « par le Styx » et rêvant à de blondes et pures fiancées, de studieux précepteurs et de compères chantant leurs joyeux refrains sous les tonnelles – tout cela fleurant bon les nuits claires et mélancolique.
La perte de l’innocence
Trois des récits insérés dans La Leçon interrompue datent d’après la Deuxième Guerre mondiale. Irréductible non converti, le vieux sage auxquels fut décerné le prix Nobel de littérature en 1946, parle non sans amertume de l’impossibilité de raconter des histoires en toute innocence, comme cela se pouvait encore au siècle passé. L’ambiguïté et le doute frappant désormais toute chose, la narration ne peut plus, décemment, ne pas tenir compte des bouleversements de l’époque. «Ce n’est que très lentement, note l’écrivain, et malgré moi, que arrivais, avec les années, à constater que mon mode d’existence et ma conception du récit ne correspondaient plus l’un à l’autre; que par amour de la narration bien faite, j’avais plus ou moins déformé la plupart des événements et des expériences de ma vie, et que je devais ou bien renoncer à écrire des histoires ou bien me résoudre à devenir un mauvais narrateur. Mes tentatives en ce sens, à partir de Demian et jusqu’au Voyage en Orient, me conduisirent toujours plus loin hors des voies de la bonne et belle littérature narrative.
Dans La leçon interrompue, le lecteur sentira tout particulièrement ce passage d’un monde à l’autre, d’une conception de l’homme à l’autre, en dépit de la fidélité à soi-même d’une des grandes consciences de ce temps.
Hermann Hesse, La Leçon interrompue. Éditions Calmann-Levy, 1978.
***
18. Lorsque l’esprit s’incarne
Après avoir lu Dans Khartoum assiégée d’Etienne Barilier…
Le génial romancier anglo-américain Henry James estimait que ce qui caractérise un grand roman tient au fait que tous les personnages y ont raison, et c’est ce qu’on se dit aussi bien en achevant la lecture du roman intitulé Dans Khartoum assiégée dont les protagonistes «historiques », semi-fictifs ou imaginés par l’auteur nous semblent avoir, sinon raison dans l’absolu, du moins leurs raisons respectives que le romancier détaille avec une remarquable équité, s’agissant par exemple d’une jeune religieuse italienne torturée ou d’un aristocrate français trafiquant d’ivoire et d’esclaves d’une abjection caractérisée, entre tant d’autres…
Au premier rang de tous, héros déjà fameux au moment où il est envoyé à Khartoum par le gouvernement anglais, le général Charles Gordon est lui-même l’incarnation d’une contradiction fondamentale en sa double qualité d’âme sensible et de militaire, mystique lisant tous les soirs l’Imitation de Jésus-Christ et comptant à son actif divers massacres « au nom de Sa Majesté », tendre avec les enfants et les animaux et non moins inflexible en sa fonction, notamment en Chine où il a réprimé la révolte des Taïpings dans le sang.
De la même façon, « face » à Gordon, qui ne le rencontrera jamais en personne, le chef de guerre « de droit divin » Mohammed Ahmed, dit le Mahdi (terme supposé tombé de la bouche même du Prophète, signifiant le Bien-Guidé) est à la fois un héritier de la plus haute spiritualité islamique (ses maîtres inspirateurs ont été les mystique soufis Al Ghazali et Ibn Arabi), le libérateur autoproclamé du peuple soudanais colonisé, un conquérant fanatique et un grand seigneur prêt à sauver la vie de son adversaire respecté au prix de sa conversion, sinon pas de quartiers au nom d’Allah miséricordieux !
Or tel est le premier mérite de ce roman : de camper sans parti pris (ou peu s’en faut, tant celui du Mahdi semble difficile à endosser jusqu’au bout) deux grandes figures «absolutistes» et des personnages «secondaires » non moins importants, qui constituent la chair vivante du roman de Barilier, illustrant le microcosme de Khartoum.
Ville «jeune» (elle n’a été fondée qu’en 1823) et décatie à la fois, menacée de ruine à tout moment en ses murs de terre croulant en boue, garnison de colonie anglaise finissante sous-traitée par le khédive égyptien, ramassis d’aventuriers pratiquant (notamment) les trafics d’ivoire et d’esclaves, avec quelque chose d’un rêve oriental, des jardins édéniques le long du Nil, une mission chrétienne à l’adorable chapelle franciscaine et des bordels, une place pour les exécutions publiques, des marchés bigarrés en veux-tu et des intrigues pourries en voilà : telle est Khartoum à cette époque même où Rimbaud traficote au Harrar…
Le pouvoir anglais, les religieux catholiques, les oulémas, les mercenaires égyptiens, les Soudanais dressés à la courbache ou ployant sous les dettes : un vrai souk en plan large. Et en cadre plus serré : quels personnages !
Voici donc, au masculin singulier, Hansal le consul d’Autriche-Hongrie, flanqué de sa femme soudanaise et figurant l’homme plutôt débonnaire et même bon ; le comte français Alphonse de Veyssieux, débarqué à Khartoum sans un sou, enrichi dans les trafics à la tête d’une armée de forbans, tenant les Noirs pour des «singes» et cependant passionné de cartographie et d’ornithologie ; Pascal Darrel l’ancien communard, journaliste et écrivain qui voit en le Mahdi un révolutionnaire incarnant l’avenir de l’Afrique ; ou l’archéologue autrichien Karl Richard Lepuschütz en quête d’une élucidation « sur le terrain » de l’écriture méroïque, langue non encore déchiffrée de l’antique royaume de Koush…
Ou voilà, au féminin pluriel, si l’on passe un peu vite sur une lady anglaise anti-esclavagiste entichée (pas pour longtemps) de Gordon : la figure lumineuse de Marie, fille de Darrel vouée à la garde de son père et au service des enfants – du pur Barilier ; ou sœur Matilda, pendant féminin du général, en plus impénétrable – elle lit le nihiliste Leopardi et tentera de s’ouvrir les veines –, et au sort final non moins affreux…
Enfin, à part celles-ci et ceux-là, sortis de l’imagination du romancier : trois « anges » d’innocence au destin également déchirant, en les personnes des jeunes James et Lual, qu’on pourrait dire les fils adoptifs de Gordon ; et de sœur Concetta venue de Vérone toute soumise au service de son Seigneur doux et tombée aux mains des mahdistes qui lui réservent une fin de martyre relatée dans l’un des plus beaux et terribles chapitres du roman, intitulé « Nativité »…
La tragique prise de Khartoum en janvier 1885, par les troupes du Mahdi, fait figure aujourd’hui de « scène primitive » d’un affrontement à la fois terrestre et « cosmique » qui n’en finit pas de ravager le monde contemporain, quand bien même l’origine du conflit remonterait à la nuit des siècles.
Une métaphore astronomique marque d’ailleurs l’ouverture du roman sous la forme d’une comète dont l’apparition sera interprétée fort différemment (!) par les uns et les autres, présage de victoire ou de déroute ; et c’est bien de la multiplication des points de vue, que se nourrit ce roman combinant la vue générale (de Sirius, sinon de la comète) et l’immersion nous faisant croire que nous sommes, lecteurs, plongés dans le maelström humain de cette ville dont la topologie se construit comme « autour » de nous…
Friedrich Dürenmatt – que Barilier a beaucoup traduit, soit dit en passant, et auquel il fait un clin d’œil en inventant le couple de serviteurs nubiens Hamza & Hamza employés par l’infâme Veyssieux – disait écrire entre le cendrier et l’étoile, et de même pourrait-on dire que Barilier écrit entre le cognac, qu’il fait boire à Gordon de manière compulsive, et le cosmos où son personnage lit son propre avenir «éternel» entre deux méditations empruntées au cardinal Newman, mystique et poète.
Dans l’essai percutant intitulé Vertige de la force, paru en 2016, Étienne Barilier a déjà montré sa parfaite connaissance du « sujet islam » en abordant, avec une rare largeur d’esprit, la question de la violence par « devoir sacré » englobant celle des croisés chrétiens, de l’Inquisition espagnole ou du djihadisme actuel.
Or Dans Khartoum assiégée nous fait passer de l’essai au roman filtrant tous les aspects de la réalité, laquelle est captée, dans sa profusion, par le détail. Comme on se rappelle l’épisode, dans Tintin, du sparadrap collé au nez ou au talon du capitaine Haddock, le roman de Barilier grave en notre mémoire une profusion de détails significatifs.
«Laissez venir l’immensité des choses», disait Ramuz, et c’est, pour ne prendre que ces exemples, le recours récurrent de Gordon l’ascète à sa bouteille de cognac, ou le télescope avec lequel, juché sur le toit de son palais comme un veilleur à la Garcia Marquez, il surveille la progression des troupes du Mahdi par-delà les eaux du fleuve.
Du détail à l’ensemble, le romancier se fait ainsi ingénieur, stratège au fait de la pose des mines et du consolidement des fortifications, peintre orientalisant (une scène fameuse de danse du ventre où l’archéologue se fait plumer par ceux qui sont supposés le guider), érudit ou théologien (Barilier est fils de pasteur comme Dürrenmatt), historien ou sondeur d’abysses métaphysiques…
Si tous les personnages de ce roman ont raison, c’est que le romancier est allé partout à leur rencontre et à leur écoute. Aucun détour, aucune digression, aucune invention romanesque n’y sont gratuits. Tout sonne juste parce que tout est vrai. On devine l’énorme documentation accumulée par l’auteur pour aboutir à cette prodigieuse masse d’informations filtrées, dont le poids ne se fait jamais sentir, alors que la tension et l’émotion montent quand le siège impose famine après force trahisons et fuites in extremis, jusqu’au grand massacre final.
Or une sorte de basse continue traverse tout le roman, qu’on pourrait dire la conscience lucide du tragique de la condition humaine, vécue par Gordon comme une inguérissable douleur d’enfance et une mort annoncée et finalement assumée « pour l’honneur » non sans augmenter l’horreur imposée aux autres, présente aussi chez l’athée Darrel et muettement subie par la religieuse Matilda qui se défénestre pour échapper à la meute des violeurs – et dans la mêlée ce sera Gordon décapité, des dizaines de milliers d’innocents à ajouter aux « dommages collatéraux » des causes diverses, le Mahdi mort peu après du typhus mais son sang roulant dans les veines de ses descendants revenus au pouvoir, bénis en 1990 par un certain Ben Laden, et sus aux impies !
Comme je l’ai rappelé à propos de Martin Amis, René Girard a décrit, dans Mensonge romantique et verité romanesque, le processus qui, dans la création littéraire, tend à une façon de purification spirituelle, et c’est cette élévation que nous vivons, précisément, par-delà la montée aux extrêmes des derniers chapitres de ce roman, où la tragédie historico-politique se trouve à la fois dite dans le moindre détail, jusqu’à l’atroce, et comme sublimée par le chant du poète.
Dans Khartoum assiégée, cinquante-troisième livre d’Étienne Barilier, constitue sans doute le chef-d’œuvre de l’écrivain à ce jour. Pas un roman de cette envergure n’a été publié en Suisse depuis C. F. Ramuz et Max Frisch, et quel équivalent en France actuelle ?
Il y avait de l’enfant de chœur inspiré et du pur-sang farouche dans les premiers romans de Barilier (surtout Laura et Passion, d’une ligne ardente et pure), évoquant les premiers feux de l’amour juvénile (dès Orphée et L’Incendie du château) ou les vertiges du mimétisme (avec le voyeur de Passion), et la figure du junger Bursche surdoué, tiraillé entre la quête du « grand pourquoi » et les occurrences du couchage, court à travers le labyrinthe romanesque de l’écrivain outrageusement fécond (le milieu littéraire romand lui reprochera de trop écrire, et il répondra dans le percutant Soyons médiocres !), mais parallèlement se développeront des essais de haute volée qui font de lui l’un des humanistes européens les plus remarquables, dans la filiation de Denis de Rougemont.
Un premier sommet, dans l’œuvre romanesque, sera atteint avec Le Dixième Siècle, splendide évocation de la Renaissance italienne dont les personnages, cependant, de Laurent le Magnifique à Pic de la Mirandole ou Machiavel, en passant par Savonarole et Michel-Ange, ne seront pas tout à fait incarnés «en pleine pâte », à proportion et dans le mouvement fondu du roman. Or ce travers persistera dans les romans ultérieurs de Barilier, comme si la grande intelligence et la vaste culture de l’auteur le contraignaient encore et l’empêchaient de toucher au « mystère de l’incarnation », si j’ose dire, qu’il atteint en revanche avec son dernier livre que son premier éditeur Vladimir Dimitrijević, notre cher Dimitri, devrait apprécier de son balcon en plein ciel…
(Ce texte est extrait du recueil de Lectures et Rencontres intitulé Les Jardins suspendus, paru en 2018 aux éditions Pierre-Guillaume de Roux)
***
19.L’honneur de la Russie
Mikhaïl Chichkine en résistance non surveillée

Mikhaïl Chichkine (Yvonne Böhler)
Avec Le cheveu de Vénus, écrit entre Zurich et Rome, fêté en Russie et traduit en Chine après avoir été déclaré « meilleur livre de l’année », Mikhaïl Chichkine a signé un grand roman marqué au sceau du génie poétique.Entretien avec Mikhaïl Chichkine. Zurich, le 31 août 2007.

C’est un extraordinaire concert de voix que le troisième roman de Mikhaïl Chickkine, après La Prise d’Ismail (Fayard, 2004) qui lui valut déjà le Booker Prize russe. Amorcé à Zurich dans un bureau d’accueil pour requérants d’asile où le protagoniste (comme l’auteur d’ailleurs) fait office de traducteur, un jeu vertigineux de questions-réponses plonge le lecteur dans la mêlée du monde et des siècles, de Tchétchénie en Grèce antique, via la Russie blanche d’une cantatrice centenaire et Rome où mènent tous les récits. Déjà connu du lecteur francophone pour sa mémorable virée Dans les pas de Byron et Tolstoï (Paru chez Noir sur Blanc et lauréat du Prix du meilleur livre étranger 2005), et pour son captivant panorama de La Suisse russe (Fayard, 2006), Mikhaïl Chichkine incarne la nouvelle littérature russe dans ce qu’elle de moins frelaté. C’est sur une terrasse d’Oerlikon que nous l’avons rencontré à la veille de son départ pour les Etats-Unis, où il va passer quatre mois.
– Quelle sorte d’enfant avez-vous été ?
– On ne me l’a jamais posée en interview, mais c’est une bonne question. Je crois que tous les écrivains ont la même enfance, plus solitaire que les autres, passée à jouer avec les livres. Ils lisent, et ensuite, n’ayant plus de livres avec lesquels jouer, ils en écrivent. Mes parents étaient séparés. Ma mère, prof de littérature et directrice de l’école que je fréquentais, n’avait pas de temps à me consacrer. Mais les livres étaient là, dont mon frère, de six ans mon aîné, était lui aussi fou. Lorsque j’avais douze ans, c’est lui qui m’ révélé les auteurs interdits. Des grands écrivains comme Pasternak ou Mandelstam étaient alors proscrits ou introuvables, sauf en versions épurées. Lorsqu’il s’est agi de dissidents à la Sakharov ou Soljenitsyne, mon frère est entré en conflit avec ma mère, que sa fonction obligeait à être du parti, lequel symbolisait pour nous la société du mensonge. Je me suis bientôt rallié à mon frère, qui s’est retrouvé en prison à cause de ses idées. Quant à l’écriture, j’y ai accédé de manière presque inconsciente, puisque j’ai composé mon premier roman à neuf ans. Il faisait une page. Ma mère, d’abord ravie, a changé de visage lorsqu’elle a lu ce que j’avais écrit, me recommandant aussitôt de parler plutôt de choses que je comprenais. Le thème de mon roman était la séparation… Depuis lors, je n’écris hélas qu’à propos de choses que je ne comprends pas. (Rires)
– Pourquoi avez-vous choisi d’étudier l’allemand ?
– Je ne l’ai pas choisi : j’aurais préféré l’anglais. Mais au lycée, c’étaient les meilleurs qu’on choisissait dans la section anglophone, et les autres étaient bons pour l’allemand. Je n’étais pas mauvais élève, mais ma mère m’y a poussé pour faire taire les autres parents qui voyaient en moi une graine de dissident. Quoi qu’il en soit, cela m’a permis de découvrir Max Frisch, qui m’a fasciné en tant que premier représentant de la littérature occidentale. Ensuite j’ai lu en allemand Rilke et Hermann Hesse, entre autres granfds auteurs.
– D’entre ceux-ci, lesquels ont le plus compté pour vous ?
– Comme adolescent, je ne pouvais lire que les classiques russes ou les auteurs soviétiques conventionnels, qui écrivaient une langue morte. Par ailleurs, certaines parties des œuvres de Boulgakov, de Babel ou de Platonov étaient accessibles. A seize ans. J’ai découvert un livre russe qui m’a estomaqué par son travail sur la langue : L’école des idiots de Sacha Sokolov, célébré par Nabokov. Des classiques aux modernes, ensuite je crois avoir tout lu de ce qui importe dans la littérature russe. Celle-ci m’apparaît comme un grand arbre. Les racines plongent dans la Bible et les textes sacrés. Le tronc est constitué par la littérature du XIXe siècle, et du tronc se jettent des branches et des rameaux dont nous sommes les petites feuilles vivantes et vibrantes… Au XXe siècle, il y a le rameau d’un génie sans descendance : Platonov. Une autre branche va de Tchékhov à Bounine, Nabokov et Sokolov, et c’est là au bout que pousse mon propre millimètre de feuillage…
– Votre livre est saturé de traces de contes, de légendes, de mythes et d’histoires de toute sorte. Cela remonte-t-il à votre enfance ?
– Pas vraiment, car les contes russes que nous lisions n’avaient plus rien de la source populaire, tout aplatis qu’ils étaient par les écrivains soviétiques. C’est plutôt comme adulte que je me suis intéressé à la source folklorique, notamment avec les contes réunis par Afanassiev. Cela étant, c’est à toutes les sources que je m’abreuve dans Le cheveu de Vénus, que j’ai conçu comme une sorte de « livre des livres ». J’ai voulu concilier, en outre, les deux traditions russe et occidentale. Dans la tradition, qui est celle du « petit homme » à la Gogol, l’auteur aime son personnage, comme un Dieu aimant ses créatures. Cette chaleur caractérise à mes yeux la littérature russe. A la littérature occidentale, j’ai emprunté l’art et les techniques complexes du roman contemporain.
– Entre Dostoïevski le « nocturne » et l’apollinien Tolstöi, comment vous situez-vous ?
– Dostoïevski est pour moi le plus « vital », mais littérairement Tolstöi est beaucoup plus important pour moi. Ceci dit, je refuse de choisir entre les deux. La prose de Dostoïevski est très mauvaise, que le français améliore peut-être ? (rires). Dès que j’ouvre un livre de Tolstoï, en revanche, je ne puis m’arrêter…
– Qu’avez-vous ressenti après avoir achevé Le cheveu de Vénus ?
– C’est mon troisième roman. Pour chacun d’eux, il m’a fallu six ou sept ans de travail, après quoi je me suis senti chaque fois dévasté, au milieu d’un monde en ruines, famille comprise. Après mon premier roman, j’ai pensé que j’avais tout dit. Puis le temps a passé, occupé à la rédaction d’un essai « de transition ».
– Pourquoi vous êtes vous installé en Suisse ?
– C’est à Moscou que j’ai rencontré ma première femme, traductrice originaire de Zurich, et nous y sommes venus pour lui simplifier la vie, avec notre enfant. J’ai donc écrit mes quatre livres les plus importants en Suisse, où je réside depuis 1995.
– Quelle impression vous font les Suisses ?
– Au commencement, je voyais en effet des Suisses, puis je n’ai plus vu que des êtres humains. C’est en général comme ça que ça se passe quand on séjourne dans un autre pays que le sien, nicht wahr ?
– Dans quelle mesure le protagoniste du roman, traducteur du russe dans un bureau d’accueil de requérants d’asile zurichois, est-il Mikhaïl Chichkine ?
– Comme le plus souvent dans un roman, c’est à la fois la même personne et un tout autre personnage…
– Quel a été le « sentiment » déclencheur du roman ?
– Le premier sentiment découlait de l’insatisfaction dans laquelle m’avait laissé La prise d’Ismail, mon roman précédent. Le thème principal du roman était la conquête de la vie. Le père, dans ce roman, dit au fils qu’on doit prendre la vie comme une place forte. La conquête se faisait à la fois à travers l’enfantement et les mots. Lorsque je suis venu en Suisse, se sentiment d’une vie à conquérir m’a quitté. A l’image de la « place forte » s’est substituée celles du temps et de la mort. C’est là contre que j’avais à combattre désormais. Le cheveu de Vénus est une lutte contre la mort par les mots, mais les mots eux-mêmes doivent être revivifiés. Et pour cela il n’y a que l’amour. En exergue, en complément d’une citation de Baruch, j’ai conclu sur une sentence de mon cru: « Car le Verbe a créé le monde et par le Verbe nous ressusciterons ». Dans ce livre se déversent toutes les cultures et se mêlent les voix de gens qui ont vécu en de multiples lieux et à de multiples époques.
– La femme joue un rôle très important dans votre roman. Le personnage de l’institutrice est-il inspiré par votre mère ?
– En partie. Plus largement, il incarne le sentiment maternel « à la russe », car les institutrices soviétiques remplaçaient la mère et marquaient les enfants par leur façon de « dire le monde ». C’est une incarnation de la patrie. La « matrie » russe (rires)… L’autre personnage du roman, Bella Dimitrievna, la chanteuse de romances qui a traversé tout le XXe siècle, a une source personnelle Peu avant sa mort, ma mère m’a en effet remis son journal. Alors qu’elle était étudiante, elle l’a tenu à l’époque la plus noire du stalinisme. Or elle ne disait rien des arrestations, des procès ou des camps. Cela m’a choqué et c’est ça qui m’a donné l’idée de développer ce journal d’une femme qui ne pense qu’à être aimée. J’ai voulu montrer que le silence de cette femme sur l’époque n’était pas de l’égoïsme mais une forme de combat vital contre les ténèbres. En outre, ce personnage répond à mon besoin de toujours de savoir ce qu’est une femme. Un romancier peut facilement s’identifier à un personnage masculin, mais une frontière le sépare de la femme, et j’ai voulu franchir cette frontière en rédigeant le journal de Bella. Lorsque j’étais en Suisse, j’ai pensé que je devais faire quelque chose avec ces archives familiales de ma mère, confiées à mon frère dont la maison de campagne a été détruite pas le feu. Cela m’a choqué et donné l’impulsion de composer ce journal d’une femme opposant son besoin d’amour à l’horreur du monde. Un autre modèle du personnage est une chanteuse célèbre, amie de mon père, qui a bel et bien vécu cent ans : Ysabella Yourieva, qu’on a redécouvert à l’époque de la perestroïka. Elle n’a rien raconté de sa vie, et je ne savais rien de Rostov, mais j’ai rencontré un vieil émigré à Lausanne qui avait beaucoup écrit sur cette époque. C’est de là que je sais tant de choses sur les lycées de jeunes filles de Rostov (rires).
– Un autre grand thème du roman est la trace de l’homme subsistant par l’écriture…
– Oui, songez à ces générations qui se sont succédées depuis l’Antiquité, dont rien ne reste, sauf quelques écrits. Mon personnage lit l’Anabase de Xénophon, et tout à coup, dans le flux du roman, les noms de héros grecs se confondent avec ceux des habitants massacrés d’un village tchétchène. C’est ainsi que se perpétue la mémoire de l’humanité…
– Que désignez-vous exactement par l’expression Mlyvo ?
– On trouve ce terme dans les livres traitant de mythologies sibériennes, qui désigne un « autre monde ». J’en ai un peu varié le sens, dans l’optique d’un monde parallèle, souterrain ou double, sans l’expliquer clairement. Mais les Russs eux-mêmes ne comprennent pas cette notion de Mlyvo. Or je pense que tout ne doit pas forcément être expliqué. Mon traducteur préféré, qui est chinois et sait le russe mieux que moi, m’a dit après avoir lu le roman qu’il l’avait lu et n’y avait rien compris. En fait, je n’écris pas de la prose mais de la poésie. Lorsque je parle la langue de Bella, c’est une chose à laquelle je me tiens, mais dès que je me laisse aller à ma langue, alors j’écris vraiment sans comprendre. Selon les manuels de russe, je dois mal écrire, mais toute poésie est fausse selon les manuels…
Mikhaïl Chichkine. Le Cheveu de Vénus. Traduit du russe (admirablement) par Laure Troubetzkoy. Fayard, 444p.
Au miroir de l’autobiographie
Après de grands romans couverts de prix et de mémorables essais, dont «La Suisse Russe», le plus helvète des auteurs moscovites nous revient avec un ensemble de textes personnels infiniment attachants évoquant sa mère, une impossible passion amoureuse, Robert Walser dans son «modeste coin» ou une visite à Montreux au fantôme de Nabokov, notamment.
Les circonstances particulières que nous vivons, depuis quelque temps, nous rappellent tous les jours, et à titre pour ainsi dire mondial, que notre vie ne tient qu’à un fil; et c’est cela même, dès son titre, que le dernier livre de l’auteur russe Mikhaïl Chichkine, bientôt sexagénaire et donc avec le début de recul d’un sage, nous suggère à son tour en filant la métaphore de manière bien concrète et vécue. De fait, c’est par le «fil» de la martingale de son manteau d’enfant que sa mère, un jour, l’a sauvé en le retenant au moment où il allait tomber d’un quai de gare sous le train; et longtemps l’idée que ladite martingale eût pu céder à ce moment-là hantera la chère mère de son souvenir à la fois angoissant et béni.
Ce bref épisode de la martingale s’inscrit dans la première des nombreuses «histoires» que raconte Mikhaïl Chichkine en s’adressant à son lecteur comme s’il se parlait à lui-même ou à ses enfants, et plus précisément encore à sa mère défunte avec laquelle il a vécu les séquelles d’un divorce, les rigueurs d’une autorité «sévère mais juste», comme on dit, jamais favorisé par cette institutrice et directrice d’école dont il dépendait directement; et plus tard les croissantes dissensions «politiques» opposant le fils, proche des dissidents, et sa mère fidèle au Parti jusqu’à en découvrir les failles et même la vilenie de certains camarades.
Cette première «histoire», à valeur d’exorcisme personnel et de quête d’un pardon mutuel, d’innombrables jeunes Russes de la génération de l’écrivain (né en 1961) qui assista à la chute du communisme, l’auront sans doute vécue, mais c’est en homme de cœur que Chikchine y revient, sans complaisance pour autant, avant de se lancer dans le récit d’une deuxième «histoire» aussi extraordinaire qu’emblématique.
Le dilemme entre Amour et Révolution
Rien de ce qui fut humainement vécu, au XXe siècle et même avant, entre la toute petite Suisse et la très grande Russie, n’est étranger à Mikhaïl Chichkine, un peu grâce à sa mère qui le poussa (contre son gré) à étudier l’allemand plutôt que l’anglais, avant qu’une jeune Helvète conjugue avec lui le verbe «aimer» et qu’il la suive à Zurich pour y vivre maritalement en exerçant un job de traducteur à l’accueil de ses compatriotes et autres migrants, ainsi qu’il l’évoque d’ailleurs dans un de ses romans et le préambule de deux essais de grand apport documentaire: Dans les pas de Byron et Tolstoï; du lac Léman à l’Oberland bernois (2005) et La Suisse russe (2007).
Or c’est en préparant ce dernier ouvrage que Mikhail Chichkine «tomba» sur un lot de six mille lettres et cartes postales dont l’échange constitue un poignant roman d’amour «empêché» entre deux futurs médecins tombés amoureux l’un de l’autre pendant leurs études: la Russe passionnée Lydia Kotchetkova et le brave Fred Brupbacher, tous deux férus d’idées nouvelles, celui-ci participant plus tard à la fondation du parti communiste suisse et celle-là, figure du parti socialiste –révolutionnaire, flirtant à un moment donné avec les terroristes.
Mélange de passion folle et de douceur mélancolique, le récit des amours de Lydia Kotchetkova et de Fritz Brupbacher évoque à la fois les «démons» de Dostoïevski et les récits de Tchekhov. Du premier, Lydia incarne en effet les héroïnes idéalistes indomptables, et du second elle réitère l’expérience terrifiante de la réalité russe à laquelle, devenue médecin dans un trou de province, elle se frotte tous les jours jusqu’à désespérer des moujiks ivrognes et pillards; et le bon Fritz, qui aimerait bien vivre plus tranquillement avec elle après leur voyage de noces catastrophique à Venise (elle est maladivement horrifiée par la chair) est lui-même un médecin des pauvres à la manière du bon Anton Pavlovitch. Enfin, déçue par ses camarades révolutionnaires autant que par le peuple idéalisé, elle finira dans la solitude, s’accusant de stupidité et demandant pardon à son cher Fritz qu’elle n’a su aimer qu’à distance…
Robert Walser, entre oubli et adulation posthume
Avant de faire figure aujourd’hui d’auteur «culte», au point qu’un certain mythe assez convenu en magnifie parfois l’image à outrance, Robert Walser fut successivement un jeune écrivain des plus originaux, au talent reconnu par des auteurs prestigieux (tels Hermann Hesse, Kafka ou Robert Musil), mais au premier succès confidentiel qui l’incita à «monter» à Berlin pour essayer de faire carrière auprès de son frère artiste Karl, alors que sa vocation de pur poète excluait les ronds-de-jambe sociaux. Son mythe tient surtout au fait qu’il passa les dernières décennies de sa vie dans un asile où il finit par griffonner ses textes au crayon en lettres minuscules, plus ou moins considéré comme un charmant toqué et finalement oublié d’à peu près tout le monde, avant sa renaissance posthume.
De cette destinée de présumé raté, Mikhaïl Chichkine a tiré la plus longue des «histoires» qu’il raconte dans Le manteau à martingale, que Paul Nizon (dans sa préface) a raison de dire un «texte tout à fait éblouissant», même s’il est dénué de tout clinquant littéraire.
A préciser qu’un autre homme de qualité, avant Chichkine, en la personne du journaliste zurichois Carl Seelig, aura rendu justice au vrai Walser qu’il visita maintes fois en son asile d’Herisau et en fit avec lui d’immenses balades dans la nature dont il a tiré ses Promenades avec Robert Walser, parues peu après la mort de celui-ci et qui nous révèlent un vieil homme d’une parfaite lucidité, qui parle de la vie, de la politique, des idéologie, de l’histoire et de la condition humaine avec un bon sens et une liberté sans faille.
Le même sens commun et la même indépendance d’esprit marquent toutes les «histoires» racontées dans Le Manteau à martingale par Mikhaïl Chichkine, dont l’empathie ne vire jamais au sentimentalisme prêté à «l’âme russe», autre cliché, même quand il évoque le sort des milliers d’internés russes en Suisse qui payeront parfois le retour au pays de leur vie, entre autres faits tragiques.
En romancier-conteur, l’écrivain passe allègrement du détail révélateur au tableau d’ensemble, dont le meilleur exemple est son pèlerinage dans l’ancienne suite du Montreux-Palace où il va vérifier la présence d’une certaine tache d’encre dans un tiroir du bureau de Vladimir Nabokov, accompagnant un ancien camarade d’étude devenu businessman plein d’arrogance et qui finira assassiné…
Ainsi la «petite» et la «grande» histoire ne cessent-elles de se repasser les plats, si l’on ose dire, des 10 000 Suisses engagés par Napoléon dans sa campagne de Russie au fils d’une institutrice soviétique devenu l’un des meilleurs auteurs de son pays, qui ne cache pas sa vive opposition au régime de Vladimir Poutine et que Paul Nizon, qui fut lui-même auxiliaire dans le placement des internés russes en ses jeunes années, définit «soit comme un Russe suisse, soit comme un citoyen helvétique russe»…
Mikhaïl Chichkine. Le Manteau à martingale, Editions Noir sur Blanc.

Ne parlons pas de Poutine !
(Lettre ouverte de Mikhaïl Chichkine « pour notre et votre liberté »)
Cette guerre n’a pas commencé aujourd’hui, mais en 2014. Le monde occidental n’a pas voulu le comprendre et a fait comme s’il ne se passait rien de grave. Pendant toutes ces années, j’ai tenté,dans mes interventions et mes publications, d’expliquer aux gens d’ici qui était Poutine. Je n’y suis pas parvenu. Maintenant, Poutine a tout expliqué lui-même.
Je suis Russe. Au nom de mon peuple, de mon pays, en mon nom, Poutine est en train d’accomplir des crimes monstrueux.
Poutine, ce n’est pas la Russie. La Russie ressent de la douleur, de la honte. Au nom de ma Russie et de mon peuple, je demande pardon aux Ukrainiens. Et je comprends que tout ce qui se fait là-bas est impardonnable.
Chaque fois qu’un de mes articles était publié dans un journal suisse, la rédaction recevait des lettres indignées de l’ambassade de Russie à Berne. À présent, ils se taisent. Peut être qu’ils sont en train de faire leurs valises et d’écrire pour demander qu’on leur accorde l’asile politique ?
Je veux rentrer en Russie. Mais dans quelle Russie ? Dans la Russie de Poutine, on ne peut pas respirer – la puanteur des bottes policières est trop forte. Je rentrerai dans mon pays, sur lequel j’ai écrit une lettre ouverte en 2013 déjà, quand j’ai refusé de représenter la Russie de Poutine dans les salons du livre internationaux – avant l’annexion de la Crimée et le début de cette guerre contre l’Ukraine : « Je veux et je vais représenter une autre Russie, ma Russie, un pays libéré de ses imposteurs ,un pays avec une structure étatique qui protège non le droit à la corruption, mais le droit de la personne, un pays avec des médias libres, des élections libres et des gens libres.»
L’espace d’expression libre, en Russie, était déjà précédemment réduit à Internet, mais maintenant, la censure militaire s’applique même sur la Toile. Les autorités ont annoncé que toutes les remarques critiques sur la Russie et sa guerre seraient considérées comme une trahison et punies selon les lois martiales.
Que peut un écrivain ? La seule chose en son pouvoir est de parler clairement. Se taire, c’est soutenir l’agresseur. Au 19e siècle, les Polonais révoltés se sont battus contre le tsarisme, « pour votre et notre liberté ». À présent, les Ukrainiens se battent contre l’armée de Poutine, pour votre et notre liberté. Ils défendent non seulement leur dignité humaine mais la dignité de toute l’humanité. L’Ukraine, en ce moment, est en train de défendre notre liberté et notre dignité. Nous devons l’aider autant que nous le pouvons.
Le crime de ce régime, c’est aussi que la marque de l’infamie retombe sur tout le pays. La Russie aujourd’hui est assimilée non à la littérature et à la musique russes, mais aux enfants sous les bombes.
Le crime de Poutine, c’est d’avoir empoisonné les gens avec la haine. Poutine partira, mais la douleur et la haine peuvent rester longtemps dans les coeurs. Et seuls l’art, la littérature, la culture pour aider à surmonter ce traumatisme. Le dictateur, tôt ou tard, termine sa vie misérable et inutile, et la culture continue : ainsi en a-t-il toujours été, ainsi en sera-t-il après Poutine.
La littérature ne doit pas parler de Poutine, la littérature ne doit pas expliquer la guerre. Il est impossible d’expliquer la guerre : pourquoi est-ce que des gens donnent l’ordre à un peuple d’en tuer un autre ? La littérature, c’est ce qui s’oppose à la guerre. La vraie littérature traite toujours du besoin d’amour de chacun de nous, et non de la haine.
Qu’est ce qui nous attend ? Dans le meilleur des cas, il n’y aura pas de guerre atomique. J’ai très envie de croire que le fou n’aura pas accès au bouton rouge, ou que l’un de ses subordonnés n’exécutera pas ce dernier ordre. Mais c’est, semble-t-il, la seule bonne chose à espérer.
La Fédération de Russie, après Poutine, cessera d’exister sur la carte en tant que pays. Le processus de désagrégation de l’Empire continuera. Quand la Tchétchénie sera devenue indépendante, d’autres peuples et régions suivront. Une lutte pour le pouvoir s’engagera. La population ne voudra pas vivre dans le chaos, et le besoin d’une main ferme apparaîtra. Même en cas d’élections aussi libre que possible- si elles ont lieu- un nouveau dictateur prendra le pouvoir. Et l’Occident le soutiendra, parce qu’il promettra de contrôler le bouton rouge.
Et qui sait, tout se répétera peut être encore une fois…
(Traduit du russe par les éditions Noir sur Blanc)
Dernier livre paru en traduction de Mikhaïl Chichkine: Le manteau à martingale et autres textes. Noir sur Blanc, 2020.
***
20. Mohamed Mbougar Sarr exorcise
l’horreur du réel par le roman
Avant la consécration combien justifiée du Prix Goncourt 2021, l’auteur de La plus secrète mémoire des hommes avait publié deux romans témoignant d’un courage impressionnant: Terre ceinte et De Purs hommes.
Le premier détaillait l’emprise d’une «Fraternité» islamiste imposant sa terreur aux habitants d’une petite ville imaginaire ; et le second s’en prenait à la persécution des homosexuels, au Sénégal d’aujourd’hui. D’abord célébré dans son pays, le jeune écrivain n’a pas tardé à être vilipendé par les intégristes et leurs ouailles…
C’était à prévoir, me suis-je dit en lisant récemment De purs hommes, après avoir découvert le formidable roman de Mohamed Mbougar Sarr justement récompensé par le Prix Goncourt, et d’ailleurs les premières réactions avaient précédé le succès international du jeune auteur après la première édition du roman.
De fait, au lendemain du salamalec présidentiel saluant l’honneur national que représentait, pour un auteur sénégalais, la consécration du prix littéraire le plus prestigieux de francophonie, l’on pouvait s’attendre, en fièvre virale sur les réseaux sociaux, à un retour de flamme de ceux qui se firent un devoir vertueux de rappeler que l’écrivain fêté n’était autre qu’un suppôt de la décadence occidentale appliqué à défendre cette maladie précisément importée d’Occident qu’est l’homosexualité.
Mais qu’est-ce à dire ? Le roman De purs hommes fait-il l’apologie de l’homosexualité ? Nullement, mais encore faut-il le lire pour voir, de bonne foi, qu’il n’en est rien. Par ailleurs, faut-il s’affliger de cette réaction vive, quoique sans commune mesure avec la fureur assassine soulevée en 1988 par Les Versets sataniques de Salman Rushdie, correspondant au choc de deux cultures ? Je ne le crois pas du tout, car cette réaction prouve que la littérature peut encore, aujourd’hui, non pas choquer gratuitement mais exposer une situation complexe et faire réfléchir sur la base de situations vécues, incarnées par des personnages de chair et de sang parfois déchirés entre plusieurs « fidélités »…
Le prof, l’infâme vidéo et Verlaine censuré…
Lorsque Ndéné Gueye, le narrateur de De purs hommes, encore estourbi de volupté amoureuse partagée avec la superbe Rama, est prié par celle-ci de regarder une vidéo «virale» infectant tous les téléphones portables de la capitale sénégalaise et environs, où l’on voit deux forcenés, encouragés par une meute hurlante, déterrer le cadavre d’un jeune homme, sa seule réaction, devant son amante, est, quoique choqué, de ne pas trop «savoir qu’en penser», supposant du moins que le malheureux était un «góor-jigéen» (littéralement un homme-femme, un homosexuel en langue wolof), sans se douter que cette réaction mollement dilatoire provoquerait la colère la plus vive de sa compagne.
Aussi bien est-ce avec une violente intransigeance que Rama, d’ «intelligence vive et sauvage», prend son apparente indifférence, lui lançant à la figure qu’il est «finalement semblable aux autres. Aussi con ». Puis d’ajouter que « les autres au moins ont parfois l’excuse des ne pas être des professeurs d’université, de supposés hommes de savoir, éclairés ». Et de conclure : « Ce n’était qu’un góor-jigéen, après tout, hein ? », avant de l’envoyer promener…
Aussi secoué par cette admonestation que par la vidéo, le jeune prof va faire, peu après, un autre expérience qui achèvera de le déstabiliser, quand une note du ministère de l’enseignement ordonnera d’ «éviter l’étude d’écrivains dont l’homosexualité est avérée ou même soupçonnée», tel Verlaine dont il se fait un devoir et un plaisir de parler à ses étudiants.
Au demeurant – et c’est tout l’art de Mohamed Mbougar Sarr de plonger dans la complexité humaine – , le jeune homme a été troublé par la vision du corps déterré et exposé d’obscène façon, et le mélange de la scène éminemment érotique qu’il vient de vivre avec Rama, d’un souvenir personnel mêlant désir et violence, et de l’effroyable souillure imposée à un défunt, sur fond d’interdit social (l’homosexualité reste punissable au Sénégal) et de préjugés omniprésents, vont l’amener à s’interroger sur l’identité et le vécu réel du déterré, avec des conséquences inimaginables pour lui et combien révélatrices pour nous autres lecteurs.
Et vous qu’auriez-vous donc fait, Monsieur le pape, et vous Monsieur l’imam ?
En 1555, au lendemain de la paix religieuse d’Augsbourg signée la même année, un certain Gian Pietro Carafa, devenu pape sous le nom de Paul IV, se signala par l’introduction du ghetto obligatoire pour les Juifs et par le rétablissement de bûchers destinés aux hérétiques (il fit exécuter vingt-quatre marranes deux mois après son intronisation), tout en instaurant l’Index des livres prohibés qui ne serait aboli que par un autre Paul, sixième de la série, en 1963…
À relever que le charmant Paul IV s’illustra également par cette déclaration fameuse: «Même si mon propre père était hérétique, j’irais moi-même chercher le bois pour le brûler». Or ce sont les mêmes mots, inspirés par une violence de «droit divin» parallèle, que nous retrouvons dans la bouche des religieux musulmans de divers grades, qu’ils soient confrontés aux homosexuels, dans De purs homme, ou au couple de jeunes amants non mariés exécutés dès les premières pages, atroces, de Terre ceinte, par les « frères » islamistes jugeant leur conduite immorale…
Quant à Ndéné Gueye, narrateur de De purs hommes, qui demande à son père, faisant office d’imam dans sa communauté , comment il réagirait s’il avait un fils homosexuel, et qui entend le même discours d’intolérance, à ses yeux intolérable – d’autant plus qu’il est tenu par un père respecté et aimé -, c’est bel et bien à partir de là qu’il va développer une véritable enquête à laquelle Rama, dont il a retrouvé la confiance, participera activement avec une autre amie non moins libre d’esprit.
Comme on l’a vu dans La plus secrète mémoire des hommes, les femmes jouent un rôle majeur dans l’univers romanesque de Mohamed Mbougar Sarr, et cela vaut tout autant pour Terre ceinte que pour De purs hommes où l’on trouve, plus précisément, quelques pages d’une saisissante intensité émotionnelle, d’une profondeur de réflexion bien rare chez un auteur trentenaire, et d’une rare beauté d’écriture, relatives au deuil de la mère dont on a injustement bafoué le fils défunt…
Le roman pour mieux comprendre, au lieu de juger
Avec les moyens intellectuels dont il dispose, son éducation (fils de médecins), sa formation (en hautes études sociales) et sa culture personnelle (notamment littéraire) , Mohamed Mbougar Sarr aurait fort bien pu combattre l’homophobie et l’islamisme radical en intellectuel engagé, si tant est que ces deux «sujets» l’eussent mobilisé à ce point, mais nous toucherait-il autant qu’avec les deux romans qui abordent ces deux questions, dont chacun inscrit celles-ci dans un contexte social, familial et psychologique général, avec une foison de personnages illustrant les diverses perceptions de la liberté sexuelle et de la religion en dialogue ou en conflit dans la société sénégalaise actuelle – et a fortiori dans toute société ?
Un peu comme les personnages «questionneurs» de Voltaire, Candide ou Zadig, le protagoniste de De purs hommes, type de l’intellectuel qui se croit ouvert plus que les autres, découvre peu à peu une réalité multiple qui ne se réduit pas à l’opposition du noir et du blanc, de l’hétéro garant de stabilité sociale et de l’homo «malade» ou «pervers», alors qu’un de ses collègues plus âgés (homo prudemment resté dans son placard) s’oppose à la provocation publique des gays fiers de l’être, ou qu’un travesti célèbre – et toléré dans la rue pour ses extravagances – lui révèle qu’il n’ «en est pas».
Surtout, il va découvrir, et c’est valable partout, qu’un seul soupçon de manquement à la virilité suffit parfois à provoquer une rumeur, à nourrir l’opprobre et à déclencher la chasse au «différent» et à l’ «impur», la question fondamentale de la pureté ressurgissant alors en force dans les injonctions du patriarcat en mal de cohésion sociale, soucieux de surveillance et de punition – l’impureté sexuelle reliant évidemment la question de l’inversion et du transgressif amour libre, tout en renvoyant le protagoniste à ses propres pulsions et contradictions.
S’il a une intelligente clarté qu’on pourrait dire voltairienne, Mohamed Mbougar Sarr, comme il l’a surabondamment illustré dans La plus secrète mémoire des hommes, écrit en français mais pense, perçoit, exprime aussi son ressenti en Africain fils de sa langue et rejeton de plusieurs cultures, mais aussi en mec puissant, sensuel et conscient des pulsions multiples qui cohabitent dans un corps d’homme ou de femme, enfin en romancier d’une porosité aussi exceptionnelle que sa grâce verbale.
Henri James dit quelque part qu’un grand romancier donne raison à tous ses personnages, ce qui ne signifie pas pour autant que tous aient raison aux yeux du lecteur, mais le romancier, plus que le prédicateur ou que le défenseur d’une thèse, applique en somme la devise de Simenon qui était de «comprendre et ne pas juger», au dam de ceux qui tranchent, édictent, proclament, surveillent et punissent sans un début de compréhension, au nom des Bonnes Mœurs ou d’un Dieu vengeur justifiant bûchers et lapidations, etc.
Mohamed Mbougar Sarr, Terre ceinte, Présence africaine, 354p. 2017.
De purs hommes. Editions Philippe Rey /Jimsaan, 190 p. Réédité en 2021.
***
21. Dame de coeur et de cran
Retour sur Le cinquième enfant de Doris Lessing. Avec un entretien de 1990.
Doris Lessing compte au nombre des plus grands écrivains anglo-saxons contemporains. Gratifiée du Prix Nobel de littérature en 2007, elle était néanmoins restée d’une parfaite simplicité. A l’occasion de la parution de son (superbe) roman intitulé «Le cinquième enfant», je l’avais rencontrée à Paris, d’abord par hasard sur un banc du Luxembourg, puis à une terrasse proche du siège de son éditeur….
Pétris de chair et de sang, les romans de Doris Lessing puisent leur substance dans la vie de l’écrivain, tout le contraire d’un bas-bleu! De fait, cette petite dame discrète, au beau visage qu’éclaire un regard doux et intense, en a vu de toutes les couleurs avant de publier son premier roman.
Ainsi a-t-elle roulé sa bosse de Perse, où elle est née au lendemain de la Grande Guerre, en Rhodésie raciste, où elle grandit au milieu des plantations de son père et des animaux sauvages (un monde- qu’elle évoque notamment dans ses Nouvelles africaines), et de Salisbury, où elle fit ses débuts de jeune fille au pair, à Londres, où, en 1949, elle émigra avec son fils Peter après deux divorces et maintes autres tribulations relatées dans les grands cycles romanesques des Enfants de la violence et du fameux Carnet d’or.
Communiste en ses jeunes années, Doris Lessing a partagé les désillusions de nombreux militants, sans renoncer à son combat contre l’injustice. Récemment encore, elle consacrait un livre-cri, Le vent emporte nos paroles, à la condition tragique du peuple afghan, dont elle a rencontré les réfugiés au Pakistan. Tout en se défendant d’envoyer des «messages» par le truchement de ses romans, Doris Lessing n’en est pas moins de ces écrivains qui travaillent activement, en artistes, au projet d’une terre moins inhumaine.
Terrible et fascinante histoire que celle du dernier roman de Doris Lessing, Le cinquième enfant, où l’on voit un jeune couple pas comme les autres se trouver subitementconfronté à la nature étrange, pour ne pas dire monstrueuse, de son dernier rejeton, qui tient à la fois du troll et du chef de gang en puissance.
Primitif et violent, cruel avec les animaux et les autres gosses, le petit Ben est d’abord soustrait à sa mère et placé dans un mouroir pour handicapés mentaux, évoqué en quelques pages insoutenables. Puis c’est le récit de l’impossible acclimatation du garçon, arraché par sa mère à ses oubliettes, et qui ne s’intègre finalement que dans une tribu de hooligans.
D’un thème éminemment actuel – la difficulté persistante d’admettre la moindre déviance – la romancière tire une fable aux résonances profondes, évoquant à la fois le monde clair-obscur des légendes, les ténèbres des souterrains psychiques à la Dostoïevski et les caprices angoissants de la génétique-fiction…
— Comment l’idée de ce roman vous est-elle venue ?
– A vrai dire, il y a plusieursthèmes qui s’entrelacent dans Le cinquième enfant. L’idée du gnome est une vieille hantise de nombreux folklores. La pensée qu’il puisse y avoir, tout près de nous, un tel petit peuple, et que nos routes puissent se croiser, me fascinait depuis longtemps. A ce thème se greffe celui de la régression possible du cerveau humain, qui me paraît également très intéressant. Et puis j’avais envie de parler de cette attitude de certains jeunes gens qui se font, du passé, une image par trop idéalisée. Harriet et David, mes protagonistes, sefigurent qu’il suffit de faire beaucoup d’enfants pour rétablir l’âge d’or dela famille. Cela me paraît une belle illusion. Dans un premier temps, leur grande maison attire en effet un tas de monde. Mais dès que la poisse leur tombe dessus, c’est la débandade…
-Justement, à ce propos, ne faites-vous pas trop peu de cas de la solidarité entre proches?
– Je crains bien que non. Après la publication de mon livre enAngleterre, j’ai reçu de nombreuses lettres de mères d’enfants anormaux qui ont vécu cette situation. Non seulement on leur tournait le dos, mais on les traitait de criminelles! Cela rappelle ces messagers de l’Antiquité qu’on tuait parce qu’ils apportaient de mauvaises nouvelles. Pareillement — et nous en venons au thème principal du roman – le pauvre Ben, qui n’a pas choisi d’être ce qu’il est, ne peut être toléré. Pas plus que, dans d’autres circonstances, l’homosexuel, le Noir ou tout autre individu dérogeant à la norme du groupe dominant.
– Dans un livre récent (Des petits enfers variés), Christine Jordis prétend que vous exaltez la lutte entre la femme et l’homme, celui-ci étant assimilé à l’«ennemi». Qu’en pensez-vous?
– Cela me paraît tout faux. Jamais je n’ai pensé ni écrit cela, même si le conflit entre les sexes est effectivement un de mes thèmes. Mais parler d’«ennemi»! C’est contre la vie! Bien entendu, j’ai toujours lutté pour la reconnaissance de nos droits à l’égalité économique et sociale. Mais décréter la haine de l’homme, ainsi que l’ont fait certaines féministes hystériques des années soixante, c’était se couper de l’a grande majorité des femmes. De même le sectarisme politique a-t-il abouti à l’affaiblissement du mouvement. En ce qui me concerne, je suis incapable d’établir des hiérarchies en fonction de ces barrières si artificielles que sont les sexes, les races ou les religions. Ce qui m’importe, c’est la qualité d’un individu, voilà tout.
– Pensez-vous que, en dépit de vos observations souvent catastrophiques, la compréhension puisse s’améliorer entre les hommes?
– Je le crois et je l’espère. En tout cas, je m’efforce d’y contribuer. Il me semble très important, en priorité, d’apprendre aux jeunes à comprendre le monde qui les entoure. J’ai été’ effarée, dans les meilleurs collèges américains, de constater l’ignorance des gosses. Ils suivent des études très coûteuses et ne savent rien de ce qui se passe dans la société. On en fait des techniciens sans aucun esprit critique, pas le moindre recul par rapport aux médias ou au fonctionnement du pouvoir. Des pions à manipuler! Ils’agit en outre de rompre avec l’horrible philosophie du «chacun pour soi» à laThatcher. La semaine passée, des amis me racontaient que des yuppies, dans un pub, avaient brûlé un billet de dix livres sous le nez d’un mendiant. Je trouve cela révoltant. Mais il y a bien des signes, aussi, qui nous incitent à ne pas désespérer. Suis-je pessimiste? Pas vraiment. Le cinquième enfant paraît trop dur à certains? Mais la réalité est-elle plus tendre? Il ne faut pas se voiler la face devant la souffrance du monde.
– Si vous étiez une bonne fée dotée d’un pouvoir magique, que donneriez-vous aux hommes de ce temps?
– Je leur donnerais la capacité de faire ce qu’ils doivent faire: ce qu’ils savent qu’ils doivent faire. Car nous savons très bien ce que nous avons à faire pour notre bien et le bien de tous.
Doris Lessing. Le cinquième enfant. Traduit de l’anglais par Marianne Véron. Albin Michel, 230p.
images,
Le Prix Nobel de littérature a été attribué Doris Lessing en 2007. Elle est décédée à Londres en 2013.
***
22. Grandeur d’un petit maître
En lisant et relisant Le Fracas des nuages de Lambert Schlechter…
Grappilleur sans pareil de savoirs et de sensations, de saveurs et d’émotions, érudit voyageur et poète, sybarite avéré et mystique mécréant en ses minutes heureuses, tel est le poète à proseries merveilleuses que figure l’écrivain luxembourgeois…
Avec Le Fracas des nuages, troisième volume de l’ensemble intitulé Le murmure du monde, (très beau titre qui fait écho au mémorable Bruit du temps de Mandelstam), Lambert Schlechter poursuit une suite kaléidoscopique majeure dont la forme composite évoque, toute proportions gardées, les Essais de Montaigne et le Zibaldone de Lepoardi, qu’il présente lui-même en ces termes approximatifs : « Cela pourrait être un journal métaphysique, un petit traité eschatologique, un grimoire de commis-voyageur, cela pourrait être un reportage sur les choses du siècle, une description du continent bien tempéré, un compte rendu d’inoubliables lectures – ce n’est rien de tout cela. »
Lui qui lit et écrit tout le temps, sans pour autant se claquemurer dans sa ratière de bibliomane ou sa tour d’ivoire, note comme un adolescent grave :« Un jour je commencerai à écrire »…
Or ce fabuleux fatras -nullement chaotique au demeurant, mais dont tous les points de la circonférence sont reliés au même noyau vibrant -, procède à la fois d’un recommencement de tous les matins (quoique Lambert Schlechter ne ressasse guère à la manière d’un Georges Haldas, qu’il cite d’ailleurs avec affection) et d’une expérience reliant « le cendrier et l’étoile », selon la belle expression de Dürrenmatt, le très intime (la geste infiniment délicate, en dépit de ses saillies érotiques, de l’amoureux à genoux devant la « fleur » féminine) et le très fracassant et récurrent orage d’acier que le poète qualifie de « murmure du monde », des massacres bibliques aux pogroms du début du XXe siècle, ou des tortures de l’Inquisition très chrétienne à la Kolyma ou à Lampedusa…
Il faudrait tout citer du saisissant Eloge du livre amorcé (p.55) par ces mots : « Les mots sont l’absolue exception, je veux dire : le texte est l’absolue exception, je veux dire :l’intention de fixer quelque chose dans des phrases, – toutes les paroles dites se sont dissoutes et se dissolvent sans cesse, celles chuchotées sur une couche d’amour, celles échangées à une table de cuisine, celles étouffées au bord d’une fosse à cadavres pendant que crache la mitraillette, puis l’alignement des phrases dans L’Homme sans qualités , et quelques centaines de personnes qui lisent ça », etc.
Or Lambert Schlechter dit à la fois l’aporie du langage et vit (parfois) la folle tentative de Joyce et de Céline d’aller au-delà de l’ordinaire langage articulé (Finnegans Wake ou Guignol’s Band), en tout cas par sursauts soudains rythmés par les battements d’aile d’un ange au prénom de Gabriel…
Il y a du mystique chez cet iconoclaste, du philologue nietzschéen chez ce brocanteur de formules poétiques à la Gomez de La Serna ou à la Jules Renard, du chroniqueur intimiste proche parfois d’un Rozanov (« Sous la couette dans l’hivernale chambre, je me tiens au chaud dans & par ma propre chaleur, c’est un bonheur élémentaire ») ou de l’observateur du corps autant que du fantastique social rappelant un Guido Ceronetti et nous ramenant souvent, aussi à sa propre lecture, combien fervente et généreuse, d’un Pascal Quignard.
Rien enfin chez Lambert Schlechter d’un pédant ou d’un littérateur affecté, inclassable mais lié de toute évidence à ce que Georges Haldas appelait « la société des êtres » et, comme écrivain, à toute une nébuleuse d’auteurs au nombre desquels je compte une Annie Dillard ou un Ludwig Hohl, un Alberto Manguel (qui raffolerait du Fracas des nuages) ou un Louis Calaferte, entre autres.
Or lui-même, sans fausse modestie, se décrit en humble artisan : « C’est dans les petits, tout petits maîtres que, lucidement, je me range. Mon échoppe n’a pas pignon sur rue, j’exerce dans l’arrière-cour d’une venelle traversière où, de temps en temps, un flâneur s’égare ; et c’est assez pour moi. Les grandes usines de chaussures sont dans d’autres zones ; ici ce n’est qu’un cordonnier qui fabrique sa paire de savates avec un bout de cuir, quelques clous, un peu de colle et un marteau…
Lambert Schlechter. Le Fracas des nuages. Le Castor astral, 293p.
***
23. Le spectre du Mal
Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, de Cormac McCarthy.

Cormac McCarthy est sans doute l’un des écrivains américains les plus importants de ce tournant de siècle, découvert dans notre langue avec L’obscurité du dehors et, d’une pureté terrifiante qu’on retrouve dans son dernier livre, Un enfant de Dieu, que suivirent six romans non moins marquants, de Suttree à la fameuse Trilogie des confins (De si jolis chevaux, Le Grand passage et Des villes dans la plaine), en passant par cette autre merveille que fut Méridien de sang, tous traduits à l’Olivier.
Il y a chez Cormac McCarthy un mélange de noirceur fataliste et de lancinante tendresse, pour ses personnages, qui évoque à la fois Faulkner (dont il a souvent la puissance d’évocation et le lyrisme sauvage) Nathanaël Hawthorne ou Flannery O’Connor, en plus ancré dans les ténèbres de la violence américaine contemporaine – parent alors, en plus profond dans sa perception du mal, d’un James Ellroy ou d’ un James Lee Burke, notamment.
Un sentiment dominant se dégage aussi bien de Non, ce ne pays n’est pas pour le vieil homme (dont le titre est emprunté à un poème de Yeats), et c’est celui que le mal gagne dans ce monde, et par des moyens qui défient de plus en plus la bonne volonté des honnêtes gens, ici représentée par le shérif Ed Tom Bell, dont la litanie lancinante des réflexions sur la perversité croissante du crime alterne avec le récit des faits abominables auxquels il est mêlé et dont il échappe assez miraculeusement, avant de jeter l’éponge avec le sentiment d’une défaite.
« Je crois que si on était Satan et qu’on commençait à réfléchir pour essayer de trouver quelque chose pour en finir avec l’espèce humaine, ce serait probablement la drogue qu’on choisirait », remarque Bell au cours de ses méditations, et de fait, la drogue et l’argent de la drogue sont au cœur de ce thriller « théologique », dont le pouvoir d’attraction et de contamination fondent toutes les relations et jusqu’aux péripéties du roman, qu’on dirait précipitées dans une sorte d’entonnoir vertigineux à une seule issue, fatale pour la plupart des protagonistes, à commencer par le jeune Moss. Celui-ci, tenté de s’arracher à sa petite vie de brave garçon au moment où, par hasard, il découvre en pleine nature où il chassait, sur les lieux d’un massacre de trafiquants, une véritable fortune en dollars serrés dans une serviette, va payer de sa vie le geste de s’emparer, sans témoins, de cet argent semblant doté d’une espèce de rayonnement radioactif. De la même façon toutes les instances du crime, dans le roman, semblent liées entre elles par une espèce de lien obscur et de connivence fantomatique qui fait fi de tous les obstacles.
Commis aux basses œuvres de Satan, face au shérif Bell qui ne le rencontrera qu’à travers ses traces sanglantes, le personnage maléfique d’Anton Chigurh agit ainsi en parfait expert du crime, doublant son art démoniaque d’une véritable morale criminelle, si l’on ose dire.
Dans la foulée, on aura remarqué qu’il est dit que Chigurh ressemble à « n’importe qui », comme le protagoniste, fort compétent lui aussi, des Bienveillantes. Cependant, à la différence du roman de Jonathan Littell, celui de Cormac McCarthy module les degrés du mal et du bien par le truchement de toute une gamme de personnages se débattant dans les filets de la nécessité.
Si la violence semble faire partie de la destinée fatale de l’Amérique, comme l’illustre le retour de Bell dans son propre passé, avec l’ombre portée de deux guerres européennes et du Vietnam, d’où chacun est revenu avec son poids de péché, c’est finalement à l’avenir de l’humanité en tant que telle, dans un monde désacralisé et privé de tout référentiel, qu’achoppe ce roman implacable et proche de la désespérance, que pondèrent, en fin de parcours, les lueurs de l’amitié et de la tendresse indestructible scellant le couple formé par Bell et sa compagne Loretta. Marqué par une sorte de tristesse révoltée à la Bernanos, ce roman est à lire et relire pour tout ce qui y est écrit comme entre les lignes. D’une écriture à la fois tranchante et infiniment suggestive, tissé de dialogues denses aux résonances se prolongeant bien après la lecture, Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme est sans doute l’une des grandes choses à lire cette année.
Cormac McCarthy. Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme. Traduit de l’anglais par François Hirsch. Editions de l’Olivier, 292p.
24. La source et le feu

Sur les carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas.
C’est une expérience sans pareille que la lecture des carnets de L’Etat de Poésie de Georges Haldas, du fait que l’engagement de l’auteur engage aussitôt le lecteur à son tour, sous peine d’incompréhension ou de non-rencontre.
Nul «journal», sauf peut-être celui d’Amiel, ne nous plonge dans un tel état d’immersion, mais Amiel ne nous implique pas du tout de la même façon que les carnets d’Haldas. Nous pouvons aimer Amiel ou en être excédé, trouver admirable sa langue, sublimes ses évocations de paysages ou de moments du jour, pénétrantes ses analyses de caractères et ses portraits de femmes ou ses plongées en lui-même, passionnantes ses vues sur l’Histoire ou les œuvres des écrivains et des philosophes qu’il lit plume à la main, émouvants et parfois même bouleversants ses aveux candides, mais jamais Amiel ne nous porte à la présence, et même à l’«hyper-présence», pour citer Haldas lui-même, avec l’intensité et l’ardeur que suscite la lecture de L’Etat de Poésie.
C’est que nous touchons, avec ces carnets, à une expérience limite de la littérature. Maintes fois, Haldas a répété qu’il ne s’agissait pas d’un journal intime, précisant que ces carnets figurent l’«atelier intérieur» d’un «scribe voué à l’essentiel». Mais là encore on pourrait se tromper. Après tout, un Paul Nizon lui aussi nous plonge en état d’immersion et tient ses carnets d’atelier. Rien à voir cependant! Et rien non plus avec le Journal littéraire de Léautaud ni avec les Journaliers de Jouhandeau. Et ce n’est pas parce que la préoccupation religieuse, évangélique plus précisément, est de plus en plus présente dans les notes quotidiennes d’Haldas que celles-ci s’apparentent avec les journaux de Charles du Bos ou de Claudel, de Bloy ou de Calaferte. Pour la tentative de saisir à tout moment l’indicible, de capter le souffle même de la présence, de rendre une sorte de parole immédiate, nous pourrions évoquer les Feuilles tombées de Vassily Rozanov, et pourtant L’Etat de Poésie est encore autre chose. Qu’est-ce alors? Disons que c’est une sorte d’exercice de présence continue, au gré d’un travail incessant d’absorption et de combustion. «Dans L’Etat de Poésie, il ne s’agit nullement de fournir des informations», explique le scribe pour la énième fois, «mais d’apporter une nouvelle manière de voir, de sentir et de dire ce que l’on voit et sent».
A tout moment Haldas se démarque du penseur («Dès que la souffrance entre en jeu, les théories s’effacent») ou du maître spirituel («le pire qui puisse nous arriver, c’est de donner dans l’élévation spirituelle»), comme il n’en finit pas de fustiger les littérateurs et leurs vanités, sans oublier le diablotin qui gigote en lui («On ne dénonce, en fait, que ce qu’on porte secrètement en soi-même»), les pions qui parasitent ce qu’il y a de vivant dans la littérature et même la «haute foutaise» d’écrire, jamais content de ce qu’il fait lui-même (et l’on sent bien que ce n’est pas de la coquetterie, d’ailleurs la critique peut le faire tempêter aussi bien), mais non du tout par dépit esthétique (il est du genre à écrire mal pour mieux écrire vrai), bien plutôt par conscience de ne rendre qu’une infime partie de ce qu’il ressent ou pressent.
Et pourtant! Pourtant quel inépuisable filtre de vie que L’Etat de Poésie. Ainsi, pour ne citer qu’un jour, ces quelques notes: «Le sentiment parfois d’être un tronc vieillissant et creux mais grondant d’abeilles. Dont quelques-unes seules parviennent à s’échapper» – «Ces passages d’un train dont la rumeur, dans la campagne, le soir, lentement décroît – et c’est chaque fois un peu ma vie, avec l’enfance, qui se déchire» – «Il y a une douceur des choses qui par moments confine à la torture» – «Ce n’est pas d’exister que je me sens coupable, mais d’exister tel que je suis. Fragile, incertain, contradictoire, minable. Bref, un chaos d’inconsistance. Et plus nuisible aux autres encore qu’à moi-même. Et condamné à faire avec ça».
Cependant, mais cela seul le lecteur peut le dire, ce «minable» nous désaltère et nous revigore. Lui qui dit n’avoir «rien écrit qui vaille» note tel matin ceci: «L’émotion devant une cour abandonnée, un vieux vélo contre un mur. Ainsi le bruit d’une fontaine, un ciel de novembre, la voix d’un être cher disant simplement «Quelle heure est-il?» (mais surtout l’intonation de cette voix)». Et toujours et encore ces «minutes heureuses», à l’opposé de l’exaltation convenue, qui nous surprennent aux moments les plus inattendus et diffusent leur douce lumière d’éternité, comme en cette aube où, après un séjour en Grèce, le scribe attend le bus qui l’emmènera à l’aéroport – et la lumière de Céphalonie lui restitue alors «un monde», comme on dit. Ou ces thèmes de plus en plus présents, évidemment liés à ses méditations évangéliques, du corps intime et de l’eau vive. Et cette consumation de tout instant: «Je suis en proie à un feu qui me dévore en même temps qu’il me cause un bonheur sans nom. Il me semble que le monde entier, à travers lui, m’habite et que je suis par là même avec tous et avec chacun. C’est un état que, si exténuant soit-il, je ne voudrais changer pour nul autre».
Georges Haldas, Carnets de L’Etat de Poésie. Le premier volume, Les Minutes heureuses, a paru en 1973 avec une préface fondatrice. Ont suivi treize volumes, notamment Rêver avant l’aube, Le cœur de tous, Le Maintenant de toujours, Paysan du ciel, Ô ma sœur. Tous ont paru aux éditions L’Age d’Homme.
Portrait photographique: Horst Tappe.
***
25. Sainte peste

Flannery O’Connor en son âme et présence…
On a parlé de Flannery O’Connor comme d’une sorte de Bernanos au féminin, et c’est vrai qu’il y a de ça, à cela près que l’écriture de Flannery est d’une densité poétique et d’une violence, d’un humour et d’une acuité sans pareils.
On peut lire ses nouvelles ou ses romans au «premier degré», comme de très remarquables morceaux d’observation des comportements humains, dans cette Amérique de la paysannerie pauvre en butte aux conflits de races et de classes où les prêcheurs de tout acabit foisonnent.
Cependant, bien plus en profondeur, sous les dehors les moins lénifiants qui soient (d’aucuns lui ont même reproché d’être cynique, ce qu’elle n’est pas du tout – mais il est vrai qu’elle ne s’en laisse pas conter…), c’est une véritable arène d’affrontement du Bien et du Mal que l’univers de cette féroce folle en Christ claudiquant (une horrible maladie l’a détruite encore jeune) au milieu de ses poules et de ses paons, plus souvent du côté des supposés coupables que des prétendus vertueux…
Paradoxes du Nègre factice
Quand il se réveille ce matin bien avant l’aube, dans la lumière lunaire qui lui montre son propre reflet, dans le miroir, comme celui d’un jeune homme, alors qu’il se figure incarner la sagesse d’un Virgile prêt à conduire Dante aux enfers, Mister Head pense aussitôt à la mission morale qu’il s’est assignée ce jour, consistant à donner une bonne leçon à son petit-fils Nelson, dix ans et fort insolent, en lui montrant quel enfer est la ville et en lui faisant voir, par la même occasion, ses premiers nègres.
De leur trou de province qui en a été épuré, ils gagneront donc la ville par le train qui, tout à l’heure, ne s’arrêtera que pour eux. Quant à Nelson, il est à vrai dire impatient de retrouver Atlanta où il se flatte d’être né, alors qu’il n’a connu la ville qu’en très bas âge, avant la mort de sa mère. Ce qui est sûr, c’est que son grand-père l’énerve, qui prétend le chaperonner et lui rappelle à tout moment qu’il ne sait rien. Et pourtant : «Grand-père et petit-fils se ressemblaient assez pour être frères, et même frère d’âge assez voisin: à la lumière du jour, Mr Head avait un air de jeunesse, tandis que le visage de l’enfant semblait vieux, comme s’il avait déjà tout appris et ne fût pas fâché de tout oublier». Cette balance incertaine des âges va d’ailleurs se trouver modulée d’une façon saisissante au cours de cette nouvelle de vingt pages marquée par une double révélation, pour l’enfant autant que pour le vieil homme.
Les thèmes de l’égarement et de la perdition, de l’édification morale volontariste conventionnelle et de son retournement, sont au coeur du Nègre factice, qui aborde aussi frontalement la question de l’exclusion raciale.
Dès le voyage en train du sexagénaire et de son protégé, celle-ci s’exprime dans un bref dialogue suivant le passage, dans le couloir, d’un Noir imposant, suivi de deux femmes également bien mises.
«Qu’est-ce que c’était ?», demande alors son grand-père à Nelson. Et celui-ci: «Un homme», avec le regard indigné de qui en a assez d’être pris pour un imbécile. Et le vieux: « Quelle espèce d’homme ? ». Et le gosse: «Un gros homme». Alors le vieux: «Tu ne sais pas de quelle espèce ?» Et Nelson: «Un vieil homme».
Ce qui fait le grand-père lancer à leur voisin : «C’est son premier nègre…»
La relation des deux personnages va cependant se transformer jusqu’à s’inverser complètement, durant la journée qu’ils passent à Atlanta, après que le vieil homme aura perdu ses repères et se sera égaré avec l’enfant dans un quartier nègre. En chemin, alors que le gosse reste fasciné par le spectacle de la grande ville, le vieux tente bien de lui en suggérer la monstruosité infernale en lui faisant humer la puanteur montée d’une bouche d’égout, mais le garçon finit par lui répondre. «Oui, mais on n’est pas forcé de s’approcher des trous» et de conclure: «C’est d’ici que je viens».
Une scène, ensuite, scandalise le vieux, quand le gosse demande leur chemin à une grosse négresse en robe rose, dont le corps l’attire soudain maternellement et qui lui indique le chemin avant de lui donner du «p’tit lapin».
Puis il suffira que le gosse fourbu s’endorme sur le trottoir, que le vieux s’éloigne pour le mettre à l’épreuve à son éveil, que l’enfant affolé parte comme un fou et renverse une vieille femme sur la rue, que tout un attroupement crie au «délinquant juvénile» et que le grand-père, lâchement, se débine en affirmant qu’il ne connaît pas ce garçon, pour faire de cette errance un récit évangélique du reniement, perçu par Nelson dans toute sa gravité jusqu’à lui offrir sa première occasion d’accorder son pardon à quelqu’un. Quant à Mr Head, il découvre, avec la réprobation absolue chargeant le regard de son petit-fils, ce que c’est que «l’homme sans rédemption», jusqu’au moment où, devant un nègre en plâtre penché au-dessus d’une clôture, dans le quartier blanc qu’ils traversent, les fait se retrouver après l’exclamation du vieux: « Ils n’en ont pas assez de vrais ici. Il leur en faut un factice».
La scène a quelque chose de Bernanos ou de Dostoïevski: «Mr Head avait l’air d’un très vieil enfant et Nelson d’un vieillard miniature». Alors le retour à la maison des deux voyageurs leur sera possible. Leur arrivée sous la même lune que le matin est d’une égale magie: «Mr Head s’arrêta, garda le silence et sentit à nouveau l’effet de la Miséricorde, mais il comprit cette fois qu’aucun mot au monde n’était capable de le traduire. Il comprit qu’elle surgissait de l’angoisse qui n’est refusée à aucun homme et qui est donnée, sous d’étranges formes, aux enfants».
Explicitement chrétienne par son inspiration et son langage, surtout dans sa conclusion, cette nouvelle saisissante, l’une des plus belles du recueil intitulé Les braves gens ne courent pas les rues, dépasse infiniment ce qu’on pourrait dire une littérature édifiante.
La filiation catholique est certes essentielle chez Flannery O’Connor, et les allusions à la grâce et à la miséricorde relient la nouvelle à cette tradition théologique, mais l’histoire de Mr Head et de Nelson, comme toutes les histoires de cette grande poétesse du mal et de la douleur, ressortit surtout à la Littérature de toujours et de partout dont aucune secte philosophique ou religieuse n’aura jamais l’exclusif apanage.
***
26. Archipel baroque
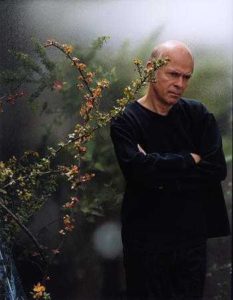
Sur La Barque silencieuse de Pascal Quignard.
Dans la magistrale lecture d’un monde que constitue son essai biographique sur Walter Benjamin, Une vie à travers les livres, Bruno Tackels situe deux auteurs dans la postérité privilégiée de WB, pour lesquels le Temps, la Mort et la Mélancolie font figure d’instances fondatrices, à savoir W.G. Sebald le romantique et Pascal Quignard le baroque.
Bien entendu, taxer Sebald de romantique et Quignard de baroque est par trop restrictif, mais disons que cela rend le ton dominant de leur oeuvre respective : crépusculaire pour le veilleur de toutes les destructions que fut l’auteur trop tôt disparu d’Austerlitz, et comme entée sur la luxure et la mort, la solitude et la merveille pour le poète-essayiste de La barque silencieuse et de plus de quarante autres ouvrages en archipel.
Ceci dit, la traversée du Temps opérée par Pascal Quignard est aujourd’hui tout à fait unique, comme sa façon de trouvère de trouver ses phrase ou de grappiller ses mots dont il sonde les origines et module les développements, du cercueil à l’utérus et retour…
Pour rendre le son et le sens de La barque silencieuse, de loin le meilleur et le plus beau livre paru en France cette fin d’été 2009, il ne serait que de pratiquer la méthode de WB consistant à citer et à citer et à citer encore en liant entre elles citations et citations.
Je cite donc illico le début du chapitre premier où il est question de l’origine du mot corbillard, découlé de l’usage des coches d’eau porteurs de nourrissons menés de leurs nourrices à leurs mères de Corbeil à Paris entre la fin du XVIe et la fin du XVIIe où Furetière fixa le nom dans le marbre du papier : « J’aurai passé me vie à chercher des mots qui me faisaient défaut. Qu’est-ce qu’un littéraire ? Celui pour qui les mots défaillent, bondissent, fuient, perdent sens. Ils tremblent toujours un peu sous la forme étrange qu’ils finissent pourtant par habiter. Ils ne disent ni ne cachent : ils font signes sans repos ».
Or tout fait signe dans la lecture du monde, du Temps, de la Mélancolie et de la Mort que constitue ce sixième tome du Dernier Royaume de Pascal Quignard, dont le premier (Les Ombres errantes, accessoirement gratifié du Prix Goncourt, faisant surtout honneur à l’Académie éponyme) parut il y a sept ans déjà. Sept ans que le crâne décharné et peint en noir de La Valliote, qui fut la femme la plus belle du monde baroque, posé sur le secrétaire du Temps enfui par l’abbé d’Armentières, attendait d’apparaître sur le papier liquide où la barque silencieuse ne dort que d’un œil.
Ces propos décousus marquent le début d’une traversée de l’œuvre intégral du plus grand écrivain français, à mon goût, encore en vie et à l’exercice ce dimanche matin à 12h.13. Chaque livre de PQ fera l’objet de 7 notes, assorties de 7 citations.
De La barque silencieuse – citations à la volée…
« Quel qu’il soit, quel que soit le siècle, quelle que soit la nation, tout enfant est d’abord un inconnu. Tout destin humain est: l’inconnu de la mise au monde confié à l’inconnu de la mort. »
« Une bêche, un sécateur, une hache pour le petit bois, deux bottes en caoutchouc pour la terre spongieuse, un parapluie jaune pour le ciel, un crayon à papier et le dos des enveloppes – la vie solitaire ne coûte pas extrêmement cher quand on la rapporte aux sept bonheurs qui l’accompagnent ».
« Naufragés sont les hommes, venus d’un autre monde, ayant déjà vécu, abordant une rive ».
« On appelle diable de poussière une petite tornade minuscule, haute comme deux ou trois hommes superposés, qui soulève la poussière ou la paille des champs au mois d’août ».
Pascal Quignard, La barque silencieuse. Seuil, 237p.
***
27. Dans la peau d’Amiel
Un savoureux essai romanesque de Roland Jaccard au mentir vrai inspiré…
Opuscule à la fois pénétrant de psychologie surfine et d’une ironie tordante, sur fond de documentation sûre, Les derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel est un portrait fidèle jusque dans ses inventions, et un autoportrait de l’auteur en artiste du mentir vrai…
Ce fut un adorable drôle de type qu’Henri-Frédéric Amiel (1821-1861), auquel on laisse le privilège de se trouver également exécrable en se flagellant tous les soirs au moment de rédiger son «cher journal», mais pas que.
C’était une espèce de vieil orphelin demeuré quand il passa de survie en trépas un matin de mai 1861 après avoir toussé beaucoup, mais pas autant que sa mère, tuberculeuse pour de bon, qui l’abandonna avec ses deux sœurs alors qu’il avait à peine passé l’âge de raison, le père se jetant au Rhône trois ans plus tard pour laisser le petit trio à la charge d’un oncle barbant. L’image d’un type assommant, passant son temps à se scruter le nombril et à s’en épancher, une vie durant, sur les cahiers de son Journal intime, colle au basque du vieux jeune homme à longue barbe, avec son diplôme au mur de champion toutes catégories d’indécision morose, et il y a en effet de ça chez Amiel, mais pas que.
Je le sais d’expérience, pour avoir passé pas mal de temps à dactylographier, avec trois calques violets, des centaines de pages du fameux journal en voie d’édition complète. J’avais vingt ans et des poussières, cela se passait dans une mansarde parisienne où il faisait une chaleur de four, je gagnais cinq francs par page copiée dont chacune me demandait au moins une heure de travail, mais quel boulot passionnant que de se couler dans cette prose certes répétitive mais souvent ponctuée de développements inouïs, d’évocations de la nature aussi belles que chez un Rousseau, de portraits parfois vitriolés de ses soeurs-chaperons ou des bonnets de nuits de son entourage genevois, quels morceau de critique littéraire et quels aperçus pénétrants de la littérature et des philosophies de l’époque, quels récits d’immenses promenades, ponctuées de baignades, conduisant ce présumé casanier autour du Salève ou sur les hauts de Montreux, par Chernex où il rêvait de se faire enterrer, jusque sous nos fenêtres actuelles du vallon de Villard…
Bref, j’ai fait une première cure d’amiélisme intense dans une mansarde des Batignolles, en vue de l’édition complète du Journal intime en douze volumes, aux éditions L’Âge d’Homme, je me suis imprégné de cette écriture d’une sensibilité proustienne océanique, mais sans le fabuleux théâtre vivant du «petit Marcel», j’ai maudit son côté flanelle et cafard, mais ses pires travers se mêlaient si indissolublement à ses qualités et ses charmes que je ne l’ai jamais rejeté, y suis revenu maintes fois sans m’en droguer jamais, ai beaucoup appris sur l’animal humain en le lisant, et c’est donc en pays de connaissance, et avec reconnaissance, que je me suis plongé dans le roman de Roland Jaccard…

Un monument sauvé du feu
Faut-il croire Amiel quand, au bord de la tombe et soupirant à la vue des cahiers représentants quelque 16457 pages de son Journal intime, dont il lui semble qu’il lui ricane au nez, se dit que le mieux serait de les détruire, mais, n’en ayant pas la force (!) s’en remet à son ami Edmond Schérer qu’il taxerait de «trahison» s’il s’avisait de ne pas les brûler voire, horreur, de les publier?
Ce qui est sûr, c’est que ledit Edmond Schérer n’a pas obéi à son ami plus que Max Brod ne s’est résolu à brûler les écrits de Kafka, publiant deux volumes d’extrait du Journal intime un an après la mort du diariste, à partir desquels le plus extraordinaire monument du genre allait susciter autant d’engouement – dont celui de Léon Tolstoï – que de dénigrement, notamment en France.
À cet égard, il vaut la peine de citer le chapitre des Réflexions sur la littérature d’Albert Thibaudet consacré aux Journaux intimes, où il rappelle à quel point la critique parisienne du début du vingtième siècle est restée rétive voire hostile au pauvre Amiel, traité d’«emboché» pour ses accointances avec la culture allemande, et ensuite de «sous-homme» par un Paul Souday (qui fut aussi éclairé à la lecture de Proust… ) quand des extraits du journal divulguant la vie amoureuse d’Amiel, et plus précisément l’épisode connu sous le nom de Philine, furent publiés.
Or, cette détestation que Thibaudet rattache à la forme française de puritanisme que représente le jansénisme, et tenant pour rien la littérature de l’aveu personnel non «sublimée» par le roman, a été relayée autant par le journalisme littéraire que par l’université française, comme on le voit aujourd’hui encore dans la réception du Journal intime, jusque sous la plume d’un Angelo Rinaldi .
L’accusation de nombrilisme, porté contre tout ce qui concerne l’observation de soi-même relevant ou non de l’introspection, relance cette prévention d’une certaine France guindée et coincée. Le même reproche a été fait à Montaigne, et pour Amiel c’est l’opprobre méprisant sans en avoir, généralement, lu une ligne. Mais que cela cache-t-il? Quelle peur de se rencontrer? Quel préjugé? Comme si chacun de nous n’était pas le nombril d’un monde? Comme si le roman était par définition plus ouvert au monde que les écrits intimes ou épistolaires?
Je reste, pour ma part, convaincu qu’un personnage de roman assure plus de liberté et plus d’universalité à l’écrivain que son journal intime ou sa correspondance, mais ce n’est pas une règle et les jugements en la matière ne sont souvent que des idées préconçues.
Autant dire que Roland Jaccard, pratiquant lui-même le genre depuis sa prime jeunesse, (et bien armé pour apprécier l’immense apport d’Amiel à la psychologie littéraire et à la psychanalyse), a fait œuvre unique en matière de défense et d’illustration du présumé parangon d’impuissance, grand «malade de la volonté», d’abord en chroniqueur, puis en éditeur, et maintenant en romancier subtilement ironique.
Perspective cavalière et plus-que-présent
Roland Jaccard ne «romance» pas la vie d’Amiel: il endosse sa peau à l’article de la mort et la retourne comme un gant, si l’on peut dire, en lui empruntant ses maux et ses mots. L’exercice paraît tout simple, servi par l’expression limpide du romancier, mais il a surtout le mérite d’éclairer la complexité du personnage au fil du temps, sans tenir compte d’une chronologie conventionnelle. Le «film» du roman se débobine alors comme une suite de séquences très agencées, qui traite le passé comme une relance vive.
Le bilan établi au début du roman (donc tout à la fin de la vie d’Amiel) est désolant, mais bientôt l’on constatera que l’ombre finale n’est que la somme des désillusions de cet ancien élève (à Berlin) d’un certain Schopenhauer, qui l’aura marqué autant qu’en aura été influencé un certain Roland Jaccard.
Si le Journal intime vous est familier, comme c’est mon cas, peut-être trouverez-vous que l’auteur des Derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel «jaccardise» un peu trop son sujet, en insistant sur la conscience malheureuse et la récurrente tentation suicidaire de celui qui a vu son père, sa jeune cousine Cécile et un ami étudiant «payer d’exemple», mais les faits sont là. Et les maux et les mots lestent le roman de gravité sans jamais exclure le décalage de l’ironie liée aux contradictions du personnage et aux tensions antinomique de sa «nature», ainsi faite qu’«elle s’ingénie à faire le désert autour d’elle et ne peut souffrir le désert», fuit ce qui l’attire, repousse ce qu’elle appelle, outrage ce qu’elle aime».
La passion de l’échec amoureux…
Plus encore, l’Amiel de Roland Jaccard est ici perçu comme un artiste de l’échec amoureux, tantôt en égotiste au cœur sec et tantôt en idéaliste craignant l’enlisement conjugal, dont la première «bonne fortune» qu’il connaît, au tournant de la quarantaine, est ici restituée dans un raccourci saisissant et bonnement comique.
Quand la douce Marie le «drague» pour ainsi dire, au moyen d’une première lettre doucement enflammée, lui avouant que ses conférences au cercle littéraire de Lausanne l’ont convaincue que leurs grandes âmes étaient faites pour convoler, et après qu’ils se sont retrouvés au Lausanne-Palace (Jaccard a l’air de connaître les lieux comme sa poche…) où ils passent une soirée de réciproque éblouissement finissant, au domicile de la jeune veuve, par l’étreinte «biblique» dont il confiera le lendemain à son journal que c’est «peu de chose», Amiel apparaît, dans le roman de Roland Jaccard, comme une synthèse vivante et vibrante de l’impossibilité de vivre une passion et moins encore une relation amoureuse dans le temps. Tétanisé devant le «triangle sacré» de la dame, il garde assez de bon sens pour se dire que cette jeune femme est sa dernière chance, mais il se rappelle bientôt qu’elle est fille de charcutier et, après avoir établi un tableau des avantages et inconvénients du célibat et du mariage, il se trouve des raisons de la repousser comme il l’a fait des «candidates» précédentes, etc.
Pour plus de détails, la lectrice et le lecteur pourront se référer aux extraits du Journal intime d’Amiel relatifs à la liaison de celui-ci avec Marie Favre, dite Philine. Mais la «réalité» du journal n’est pas à opposer à la «fiction» du roman de Roland Jaccard. La loi de l’ironie, chère à celui-ci, à l’imitation d’Amiel, consisterait plutôt à n’accorder aucun crédit à une version plutôt qu’à l’autre, ou de les estimer aussi recevables l’une que l’autre, etc.
Roland Jaccard. Les derniers jours d’Henri-Frédéric Amiel. Serge Safran éditeur, 137p. Paris, 2018.
28. Le chaos et les hirondelles
À propos d’Une rue à Moscou de Michel Ossorguine, fleuron des Classiques slaves de L’Âge d’Homme. Réédité aux Éditions Noir sur Blanc, dans La Bibliothèque de Dimitri.

D’entre tous les écrivains russes de la première moitié du XXe siècle, la figure lumineuse et solitaire de Michel Ossorguine rayonne d’équilibre et de compréhension, contrastant avec les visages souvent tourmentés de ses contemporains. Peu connu jusque-là (seul Une rue à Moscou fut traduit en français il y vingt ans de ça, chez un petit éditeur, mais restait introuvable), Michel Ossorguine n’a pourtant pas été épargné par la tourmente historique, son goût inaliénable de la justice l’ayant poussé, tout au contraire, à militer sur tous les fronts où il estima devoir défendre la liberté.
C’est ainsi que, né en 1878 à Perm, sur le fleuve Kama, il commença par lutter contre le régime tsariste dans les rangs du Parti social-révolutionnaire. Condamné à mort une première fois, puis libéré, exilé en Italie, voyageant de là en France où il se livra au journalisme, il revint en Russie dès 1916, adhéra à la Révolution de Février, mais s’éleva contre celle d’Octobre et, en 1919,passa une nouvelle fois à deux doigts de la mort, séjournant quelque temps dans la sinistre fosse du « vaisseau de la mort » de la Loubianka (prison de la Tchéka) qu’il décrit dans les deux livres auxquels le lecteur de langue française à désormais accès: Saisons, son autobiographie, et Une rue à Moscou.
Expulsé d’Union soviétique en 1922, réfugié à Paris jusqu’en 1940, puis finissant ses jours dans une petite maison située au coeur de la France occupée, Michel Ossorguine semble n’avoir gardé aucun ressentiment à l’égard d’un régime qu’il a certes combattu, acceptant comme une composante de l’âme et de l’histoire de son peuple bien-aimé le dernier état, catastrophique, de la révolution trahie. Aussi peu marxiste que peut l’être un individualiste ennemi des systèmes simplificateurs, ayant éprouvé la vérité de ses opinions au trébuchet de l’expérience et des souffrances humaines, il nous a laissé, avec Une rue à Moscou, le témoignage artistique le plus extraordinaire qui soit sans doute, recouvrant la période de 1914 aux années 20 – exceptionnel en cela qu’il prend le parti des humains contre celui des idées, celui des destins particuliers contre celui des concepts abstraits.
Roman de presque cinq cents pages serrées divisé en tout petits chapitres étoilés, Une rue à Moscou s’ouvre sur une merveilleuse journée, dans la maison d’angle d’une ruelle connue sous le nom de Sivtzev Vrajek, domicile d’un vieil ornithologue savant, célèbre dans le monde entier pour ses travaux.
C’est le temps du retour des hirondelles, et la délicieuse Tanioucha, petite-fille du professeur, apparaît à la fenêtre, qui va éclairer de son sourire jusqu’aux pages les plus tragiques du livre. Le soir, tout un monde d’amis et de connaissances afflue dans la maison de Sivtzev Vrajek – que l’auteur nous présente d’emblée comme le centre de l’univers -, l’on converse et l’on écoute les dernières compositions d’un musicien de grand talent, Edouard
Lvovitch.Il y a là un étudiant ratiocineur, l’une des premières victimes de la guerre toute proche, un savant biologiste, le jeune Vassia préparateur à l’université, un jeune officier plein d’avenir, et l’on verra duquel ! du nom de Stolnikov, la grand-mère Aglaya Dmitrievna, et bien d’autres personnages encore que nous suivrons dans leur destinée.
De fait, tandis qu’Edouard Lvovitch exécute au piano son improvisation sur le thème du « Cosmos », la vie, elle, poursuit son oeuvre féconde et destructrice à la fois. Pour annoncer la guerre, Ossorguine décrit alors une bataille rangée de fourmis: « Comme un invisible ouragan, comme une catastrophe universelle, une force divine, irrésistible et destructrice traversa l’espace, inconnu même à l’esprit de la fourmi la plus avisée ». Et d’enchaîner aussitôt après: « Les armées des fourmis ne furent pas les seules à périr »…
Et l’on entre dans le tourbillon. Mais que le lecteur n’imagine pas que le mouvement du livre va s’accélérer, pour céder au pathétique. Non: patiemment, posément, Ossorguine agence sur la muraille chaque élément de son immense fresque, laquelle comptera des visions d’une horreur insoutenable, pondérées cependant par le contrepoint des zones lumineuses, toujours lumineuses de la vie reprenant ses droits.
La duperie compliquée et grandiose
De quoi est faite l’Histoire ? À en croire Michel Ossorguine, qui en parle assez longuement dans Saisons, ce ne sont pas les historiens brassant leurs papiers poussiéreux qui nous renseigneront les mieux. Le « bruit du temps », dont parle Ossip Mandelstam, n’est pas à écouter dans les bibliothèques ou les archives, mais c’est dans la rue, dans les cours intérieures des maisons, dans les trains et sur les places qu’il faut lui prêter l’oreille. Et c’est ce que fait le romancier. À cette guerre, ainsi, toutes les justifications a posteriori seront données, tandis que les milliers d’Ivan, de Vassili et de Nikolaï lancés contre des milliers de Hans et de Wilhelm n’ont eu à se satisfaire que de mots d’ordre: « Des mots simples, faciles à prononcer, ainsi qu’un certain nombre de belles expressions, les mêmes dans toutes les langues, pour remplacer la pensée… »
« De cette façon, continue le romancier, grâce à une purification méticuleuse, les turpitudes et les mensonges des ronds-de-cuir se trouvaient, en dernier lieu, transformées en bel héroïsme et en larmes pures. Quant aux gens bornés, ils parlaient de simple duperie, ce qui était injuste: la duperie était très compliquée et grandiose. »
Plus compliquée et plus grandiose, encore, car née du peuple, et non plus seulement orchestrée par les puissants de ce monde, sera la duperie de la Révolution, et la vision qu’Ossorguine nous en donnera, multipliant les points de vue, saura nous apprendre, par le détail, à replacer chaque élan légitime et chaque erreur dans le contexte dramatique d’alors: « Des deux côtés, il y avait des héros, des coeurs purs, des sacrifices, des hauts faits, de l’endurcissement, une noble humanité non livresque, de la cruauté bestiale, la crainte, les désillusions, la force, la faiblesse, le morne désespoir. Il eût été beaucoup trop simple, et pour les survivants et pour l’histoire, qu’il existât une vérité unique ne combattant que contre le mensonge. Car il y avait deux vérités et deux honneurs luttant l’un contre l’autre. Et le champ de bataille était jonché des cadavres des meilleurs et des plus braves ».
Le peuple russe en fresque
Concentré sur une vingtaine de personnages, Une rue à Moscou déploie à vrai dire la chronique du peuple russe tout entier durant ces années terribles. Si toutes les classes sociales ne sont pas représentées par Ossorguine (point de « bourgeois » ni d’aristocrates, par exemple), il nous invite néanmoins à suivre les faits et gestes d’une poignée de braves gens, parmi lesquels il s’en trouvera de plus vulnérables que les autres – ou de moins chanceux, tout simplement -, qui succomberont à la première vague d’événements. Il en va ainsi du beau Stolnikov, les jambes sectionnées par un obus, homme-tronc monstrueux qui finira par se jeter du haut d’une fenêtre. Et d’autres qui, lors des années de famine, « s’arrangeront » comme ils pourront avec le nouveau régime, tel le misérable Zavalichine, devenu bourreau de la Tchéka, ensorte de toucher de plus abondantes rations.
Or Michel Ossorguine ne juge pas, et n’accuse jamais. Ce n’est pas « omnitolérance » de sa part, car on sent bien la sourde colère qu’il entretient à l’endroit des « grosses légumes », mais cela participe bien plutôt de son choix de décrire et d’expliquer le sort et les réactions d’une humanité moyenne prise dans un engrenage qui la dépasse.
C’est là que réside l’immense intérêt d’Une rue à Moscou, sans compter la foison de détails observés par l’auteur. Le roman s’achève, après l’audition de l’Opus 37, dernière oeuvre d’Edouard Lvovitch dans laquelle le génial musicien (on pense à Chostakovitch) concentre les aboutissants de la tragédie: « Le sens du chaos est né. Le sens du chaos ! Mais le chaos peut-il avoir un sens ? »), par l’attente du retour des hirondelles…
Michel Ossorguine. Une rue à Moscou. Traduit du russe par Léo Lack. LÂge dHomme, collection Classiques slaves, 483p., 1973.
Michel Ossorguine, Saisons. L’Age d’homme, collection Ecrits contemporains.L’Âge d’Homme, 1973.
29. En manque de sens
Où la chronique devient un genre majeur, à la fois quête de sens et de style. Et comment faire pièce au double matraquage de la Fatwa Valley et de la Silicon Valley…
Dans son introduction au choix de chroniques (un peu moins de 200 sur les 2000 qu’il a rédigées dans l’urgence en vingt ans) de Mes indépendances, Kamel Daoud évoque la pratique de ce genre devenu très populaire en Algérie, dans les sanglantes années 90, en insistant sur l’aspect vital de cette frénétique quête de sens quotidienne (il lui arrivait de composer jusqu’à cinq chroniques par jour sous divers pseudos) et d’échapper à la jactance précipitée par un style personnel.
C’est essentiellement celui-ci, dès les années 60 (j’avais entre 14 et 16 ans), qui m’a attaché aux chroniques de deux maîtres du genre, dans le Canard enchaîné, aux noms de Morvan Lebesque et de Jérôme Gauthier, le premier figurant l’anar humaniste et le second le pacifiste à tout crin.
Mai 68, pour le meilleur et parfois le pire, aura marqué le pic saillant d’une prise de parole libératrice dont les innombrables publications répondaient à une nécessité du moment, peut-être moins vitale qu’en Algérie dans les années de la guerre civile mais non moins réelle. Mais quoi de durable dans ce magma ? Quelle pensée, quelle parole pour tenir l’épreuve du temps et rester vivace aujourd’hui ? Kamel Daoud se pose la question en relisant ses chroniques souvent limitées à l’actualité et à son public algérien, et la réponse d’un style – bien au-delà des belles tournures et de la rhétorique plus ou moins ronflante – se distingue décidément de la profusion des opinions, avec le sceau du sens.
Or qu’est-ce au juste qu’un style ? C’est une pensée et une voix sans pareilles, une façon de parler unique découlant d’une expérience personnelle, mais dans laquelle peuvent se reconnaître d’innombrables “prochains”.
Le style de Kamel Daoud m’en impose peut-être moins que celui de Pascal, Bossuet ou Céline, mais ce nivellement par le haut, si j’ose dire, me dit bien moins que ce que le chroniqueur algérien, ce frère humain qui aurait l’âge d’être mon fils, me dit de sa quête de sens, dans l’ici mondialisé et le maintenant de tous, sous le ciel du Dieu muet de Pascal et dans le non-sens et le néant de tous les simulacres.
Donner du sens à sa vie ne relève pas du politique ou de la religion, pour autant que les religieux et le pouvoir politique ne m’imposent pas leur sens unique. Or ce que nous rappellent les chroniques d’un Kamel Daoud, comme “en creux “, c’est que la dépendance à de multiples visages.
Dans sa chronique intitulée L’Arabie saoudite, un Daesh qui a réussi, parue en novembre 2016 dans le New York Times, Daoud décrit l’industrie de persuasion émanant de ce qu’il appelle la Fatwa Valley : “Il faut vivre dans le monde musulman pour comprendre l’immense pouvoir de transformation des chaînes de TV religieuses sur la société par le biais de ses maillons faibles: les ménages, les femmes, les milieux ruraux. La culture islamiste est aujourd’hui généralisée dans beaucoup de pays – Algérie, Maroc, Tunisie, Lybie, Egypte, Mali, Mauritanie. On y retrouve des milliers de journaux et des chaînes de télévision islamistes (comme Echourouk et Iqra), ainsi que des clergés qui imposent leur vision unique du monde, de la tradition et des vêtements à la fois dans l’espace public, sur les textes de lois et sur les rites d’une société qu’ils considèrent comme contaminée”.
Or qu’avons-nous à opposer au sens unique proposé par la propagande théologico-politique de la Fatwa Valley ? Je me le demandais récemment, en Californie, en assistant au matraquage publicitaires des chaînes de télé américaines. Je me suis demandé aussi comment résister à la persuasion clandestine véhiculée par les big data de la Silicon Valley et consorts, aux vérités falsifiées des médias et de leur contempteur présidentiel plus menteur qu’eux, et je me suis répondu une fois de plus que la base de mes indépendances à moi, depuis que jeune garçon je lisais le Canard enchaîné, et ensuite de livres en rencontres, à l’école de la vie et des erreurs, au contact quotidien d’hommes et de femmes plus ou moins sensés – , la seule perception du manque de sens me poussait à en donner un à ce que je vis au jour le jour et que je partage avec celles et ceux, y compris le bougnoule Daoud (pour le dire à la façon des Trump, Le Pen et autres prophètes souverainistes du Grand Remplacement) qui sont du voyage.
A San Diego, nous sommes allés voir, avec le conjoint légitime de notre fille aînée, le film intitulé Le Cercle, tiré du roman éponyme de Dave Eggers, constituant une fable contre-utopique cinglante opposée aux visées sectaires “transhumanistes” de la Silicon Valley. Dans les grandes largeurs du roman faisant pièce à l’idéologie islamiste opposée de la Fatwa Valley, Boualem Sansal a répondu à sa façon dans son magistral 2084.
Autant dire que, du temps bref de la chronique au roman de plus longue durée, la quête de sens est plus que jamais notre affaire.
Kamel Daoud. Mes indépendances. Chroniques 2000-2016. Préface de Sid Ahmed Semiane. Actes Sud, 463p.
Morvan Lebesque, Chroniques du canard, Pauvert, 1960. Reprises (en partie) dans la collection Libertés.
Boualem Sansal. 2084. Gallimard, 2015.
30. Une lumière dans la nuit
À propos de La petite lumière d’Antonio Moresco
Un effroi d’enfance nous reprend parfois lorsque nous ouvrons les yeux dans le noir de la nuit, ou dans le silence blanc du jour, et c’est l’intense sensation physique, et métaphysique à la fois, qui nous saisit dès les premières pages de La petite lumière d’Antonio Moresco, qui ne nous quittera pas après avoir traversé ce livre ouvert entre deux infinis.
Le narrateur se trouve comme au bord du ciel, dans un hameau désert des monts boisés où il s’est retiré on ne sait pourquoi et d’où tous les soirs, la nuit venue, il aperçoit, au flanc de la montagne d’en face, une petite lumière. Et tout de suite cela nous parle, à l’intime, nous incitant alors à nous approprier.
personnellement le récit.
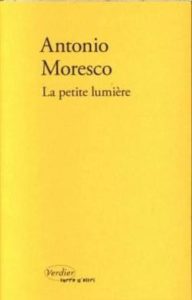
Je me suis donc rappelé, en lisant les premières pages de La petite lumière, cette nuit d’il y a une trentaine d’années où nous nous trouvions dans un tout petit refuge de montagne, avec des amis. Or, tandis qu’ils dormaient je m’étais relevé, bien après Minuit, attiré par je ne sais quoi sous la voûte prodigieusement étoilée formant comme un dôme au-dessus des rochers et des glaciers blêmes, jusqu’à la cime baignée là-haut de clarté lunaire ; et la sensation d’infini que j’éprouvais alors s’était mêlée à celle de n’être rien que chair mortelle; et je pensai aux cendres de notre ami que nous répandrions, le lendemain, du sommet de la montagne dans les couloirs verglacés de la face nord où, un mois plus tôt, notre compagnon de tant d’équipées s’était tué.
L’homme de La petite lumière s’est retrouvé là on ne sait pourquoi. Installé dans une maison de pierre et de bois au toit d’ardoises, il ne fait rien d’autre que songer et cheminer entre son logis et le petit cimetière aux lumignons, en contrebas, observant la nature avec une sorte d’attention exacerbée par ses poussées végétales et ses combats silencieux – on se rappelle, dans la foulée, le récit de Dino Buzzati évoquant les massacres muets qui se perpétuent, chaque nuit, entre insectes féroces et autres rongeurs sans pitié, dans les prairies aux airs tout sereins et bucoliques; et c’est dans l’inquiétante étrangeté de cedésert, au sens où l’entendaient ermites et moines d’antan, que, la nuit venue, le solitaire perçoit la petite lumière comme un signe de Dieu sait quoi.
L’homme étant ce qu’il est, sorti de la nature comme on sait, mais sans savoir pourquoi, voudrait le savoir cependant et s’expliquer, en l’occurrence, ce que signifie par exemple, là-bas, cette petite lumière.
Ainsi va-t-il aux renseignements, comme on dit. Or comme il y a, dans les environs, d’autres hameaux habités, il y va de son enquête, sans obtenir de réponse sur la nature de cette lumière, sinon d’un paysan à l’accent étranger ferré en matière de visiteurs de l’espace, qui a observé de ses yeux divers phénomènes dont l’apparition d’un grand œuf de lumière…
Mais c’est ensuite au lieu enfin repéré de la source de lumière, dans un hameau aussi désert que le sien, que le solitaire enquêteur découvre la vérité sur la source de la petite lumière, en la personne d’un enfant au crâne rasé dont la réserve farouche lui en en impose d’abord.
L’enfance de l’art requiert la plus grande simplicité, et l’on sait l’importance de l’Objet, qui a souvent valeur de symbole, dans les contes, et c’est tout l’art d’Antonio Moresco, de combiner, dans La petite lumière, qu’on pourrait relier à la filiation du réalisme magique, ou métaphysique, de la littérature ou de l’art italiens, un parfaite limpidité apparente, bien tangible et concrète, et comme nimbée de mystère et d’ombre éblouissante, si l’on ose dire, et les éléments tout à fait ordinaires et concrets d’un récit précis.
On pourrait dire aussi, pour creuser plus profond, que l’enfant de La petite lumière figure à la fois notre en deça et notre au-delà, la rencontre du protagoniste avec le petit garçon pouvant se lire, aussi, comme une rencontre avec ce que nous avons été où la projection de ce que nous serons dans quelque au-delà imaginaire.
« La petite lumière sera comme une luciole pour les lecteurs qui croient encore que la littérature est une entreprise dont la portés se mesure dans ses effets sur l’existence », lit-on sur la quatrième de couverture de ce grand petit livre traduit de l’italien de façon probe, sans enjoliver la langue-geste sans fioritures de Moresco, par Laurent Lombard, et l’on devrait en citer in extenso le vingt-quatrième de ses brefs chapitres (pp.106-107) pour mieux faire sentir l’effet possible de cette prose sur notre existence.
La petite lumière paraît, aux éditionsVerdier, dans la collection intitulée Terra d’altri, où l’on relève les noms de Francesco Biamonti et d’Erri De Luca,d’Elsa Morante ou de Mario Rigatoni Stern, entre autres « autres » terriens affiliés à ce que Georges Haldas appelait la « société des êtres ».
Or il faudra revenir sur le parcours singulier d’Antonio Moresco, dont vient de paraître un nouvel ouvrage traduit à la même enseigne, mais dans l’immédiat s’impose la citation du début de ce vingt-quatrième chapitre de La petite lumière, qui en indique assez la tonalité pascalienne et la tonne musicale particulière :
« Comment savoir si au-dessus du ciel il y a un autre ciel ? », je suis en train de me demander, assis devant le précipice. Du moins celui qu’on voit d’ici, de cette gorge, au-dessus de cet agglomérat de maisons et de ruines abandonnées. Comment savoir si la lumière n’est pas elle aussi à l’intérieur d’une autre lumière ? Et quelle lumière ça peut bien être, si c’est une lumière qu’on ne peut pas voir ? Si on ne peut même pas voir la lumière, qu’est-ce qu’on peut voir d’autre ? Comment savoir si la matière dont se compose l’univers, tout du moins le peu qu’on réussit à percevoir dans l’océan de la matière et de l’énergie noire, n’est pas à l’intérieur d’une autre matière infiniment plus grande, et si la matière et l’énergie noire ne sont pas à leur tour à l’intérieur d’une obscurité encore plus grande ? Comment savoir si la courbure de l’espace et du temps, si courbure il y a, si temps il y a, ne sont pas eux aussi à l’intérieur d’une courbure plus grande, un espace plus grand, un temps plus grand, qui vient avant, qui n’est pas encore venu ? Comment savoir pourquoi ça s’est arrangé comme ça, dans ce monde ? Est-ce que c’est comme ça partout, s’il y a un partout, dans ce déchaînement de petites lumières qui percent le noir dans cette nuit froide et dans l’obscurité la plus profonde ? »
Antonio Moresco. La petite lumière. Traduit de l’italien par Laurent Lombard. Verdier, coll. Terra d’altri, 122p.
***
31.Une enfant du siècle
Au singulier du féminin…

Judith Hermann a en elle un puits de larmes. En tout cas j’avais été saisi, dès son premier recueil de nouvelles, Maisons d’été, plus tard, par l’originalité et la maturité, la clarté et la complexité, la puissance expressive et l’hypersensibilité qui caractérisent son art si singulier consistant à mêler, à des situations vécues au présent avec une grande intensité – tout y est concret, sensuellement palpable, rendu avec une plasticité rappelant parfois les expressionnistes – le tremblement profond du temps et son poids de plus en plus perceptible avec l’âge.
S’il y a de la mélancolie dans les nouvelles de Judith Hermann, dont procède le plus lancinant de son blues souvent râpeux, jamais elle ne cède à la délectation morbide. Dans la filiation des nouvelles berlinoises de Nabokov, on est au contraire saisi par la vitalité de ses personnages et par le dynamisme de son écriture. Son exploration des «vies possibles» illustre une imagination romanesque souvent en défaut aujourd’hui. Il ya de la fée chez elle, mais aussi de la sorcière : à la première, elle emprunte la capacité d’enchantement et à la seconde une sorte d’humour grinçant et cette implacable lucidité enfantine (mais jamais infantile) qu’elle promène sur la société en faisant dire à l’un de ses personnages «est-ce qu’il faut vraiment que ce soit comme ça?».
Par-delà l’aura de poésie et, parfois, de magie qui émane de cet univers, c’est aussi bien à la réalité des êtres, et douloureuse, et à tel sentiment d’insuffisance rappelant un Fassbinder, qu’achoppe Judith Hermann.
Avec Rien que des fantômes, son deuxième livre, on retrouve d’ailleurs les même personnages errants et plus ou moins blessés s’ agrippant les uns aux autres comme des naufragés, pour autant de rendez-vous manqués ou décalés, non loin des élégies de Peter Handke et dans le ton aussi d’un certain post-romantisme urbain imprégnant le cinéma allemand d’après-guerre, par exemple dans La balade de Bruno S. de Werner Herzog. La nouvelle éponyme du recueil, qui se déroule dans un sinistre motel d’Austin (Nevada), où se retrouve un couple d’amis allemands traversant les Etats-Unis comme deux âmes en peine, s’inscrit aussi bien dans le droit fil de cette observation panique.
En revanche, l’approche des personnages est marquée, chez Judith Hermann par une perception plus empathique et chaleureuse, sensuelle et presque animale, des rapports humains, auxquels se mêlent un dévorant besoin d’affection et une constante nostalgie d’on ne sait quel monde plus beau et plus pur, quelque chose qui a été perdu, que l’on chercherait à retrouver au fond d’une «caisse remplie d’objets anciens, absurdes, merveilleux», et dont on ne retrouverait finalement que le souvenir du souvenir …
Judith Hermann, Maison d’été, plus tard. Albin Michel, 2001.
Rien que des fantômes. Albin Michel, 2005.
***
32. La Boîte d’échantillons
Pour lire et relire Ramon Gomez de la Serna…

On revient à Gomez de La Serna comme à un inépuisable brocanteur d’images poétiques jamais en mal de nous étonner à tout moment comme à tout moment il s’étonne, et c’est précisément cela qui saisit le lecteur de ses Greguerias: c’est que ces petits fragments colorés d’un immense kaléidoscope semblent refléter toutes les heures du jour et des quatre saisons, et tous les goûts, toutes les humeurs de tous les âges de la vie: de la gaîté primesautière de l’écolier du matin, qui remarque par exemple que “les boeufs ont l’air de sucer et de resucer constamment un caramel”, à la songerie mélancolique de l’homme vieillissant notant que “bien souvent nous nous lèverions pour faire notre testament, malgré que cela soit inutile, malgré que nous n’ayons rien à léguer à personne, mais uniquement pour faire notre testament; faire son testament; l’acte pur et sincère”.
Il y a, chez ce fou de littérature à la production balzacienne et touchant à tous les genres, un noyau doux et tendrement lumineux qui me semble le caractériser pour l’essentiel et le relier occultement au Rozanov des Feuilles tombées ou au Jules Renard du Journal, avec cette aptitude commune à décanter ce que Baudelaire, et Georges Haldas dans sa foulée, appellent les “minutes heureuses”.
Ce sont comme des épiphanies profanes, où nous est soudain révélé comme un surcroît de présence: “Dix heures du matin est une heure argentine, très riche en sonneries argentines et encourageantes… Dix heures du matin est une heure pleine d’un soleil diaphane, fluide et adolescent, même les jours nuageux, une heure pleine de clochette d’argent”.
Ou bien: “Le soir, quand le jour baisse, on voit que la page blanche a sa propre lumière, sa propre lumière véritable”.
Ou encore: “Il y a un moment, à la tombée de la nuit, où quelqu’un ouvre les fenêtres des glaces, les dernières fenêtres de l’après-midi, ces fenêtres qui donnent une lumière plus vive que tout le reste, la suprême lumière”.
Greguerias
(florilège)
Dans l’accordéon, on presse des citrons musicaux.
*
L’âme quitte le corps comme s’il s’agissait d’une chemise intérieure dont le jour de lessive est venu.
*
Lorsqu’une étoile tombe, on dirait que le ciel a filé ses bas.
*
Le S est l’hameçon de l’abécédaire.
*
Lorsque le cygne plonge son cou dans l’eau, on dirait un bras de femme cherchant une bague au fond de la baignoire.
*
L’eau de Cologne est le whisky des vêtements.
*
La musique du piano à queue déploie son aile noire et nocturne d’ange déchu désireux de regagner le ciel.
*
N’ayez crainte : la femme qui s’enferme à double tour après une dispute va non pas se suicider mais tout bonnement essayer un chapeau.
*
Le mot le plus ancien est le mot « vétuste ».
*
La tête de mort est une horloge défunte.
*
L’ennui et un baiser donné à la mort.
*
Venise est un endroit où naviguent les violons.
*
Pour le cheval, la prairie tout entière est un tambour.
*
Le désert se coiffe avec un peigne de vent ; la plage avec un peigne d’eau.
*
Rien ne donne plus froid aux mains que de s’apercevoir que l’on a oublié ses gants.
*
La nuit portait des bas de soie noire.
*
Le baiser n’est parfois que chewing-gum partagé.
*
Les larmes désinfectent la douleur.
*
Il est des femmes qui croient que la seule chose importante chez elles est ce rien d’ombre qui ourle leur décolleté.
*
Ramon Gomez de la Serna. Greguerias. Traduit de l’espagnol par Jean-François Carcelen et Georges tyras. Préface de Valéry Larbaud. Editions Cent Pages, 1992.
***
33. Une banlieue de l’Univers
À propos des Périphéries de Philippe Lafitte…

À l’écart de tout « discours sur l’immigration », le romancier nous confronte, dans une narration très visuelle et physique, aux affrontements de jeune chefs de meute issus de deux communautés – Tsiganes roumains et banlieusards arabo-musulmans – par le truchement de personnages ressaisis entre soumission imposée (pour les femmes surtout) et tentatives d’y échapper, espérances d’une vie meilleure et déceptions amères. Avec le souffle épique d’une fable…
C’est un livre étrangement prenant et même envoûtant par sa beauté crépusculaire et son mélange de violence latente et d’âpre tendresse, que le dernier roman de Philippe Lafitte dont le seul titre de Périphéries, géolocalisable au bout de nulle part ou à côté de chez nous, s’étend aujourd’hui à une nébuleuse de banlieues planétaires rejetées par les centres homologués downtown – ici Paris en pôle magnétique toujours hyper-attirant, et la banlieue parisienne devenue territoire excentré que se disputent certains des individus issus de communautés particulières, plus précisément encore en l’occurrence: Roms en clan d’une quarantaine planqués dans un bidonville naguère démantelé et reconstitué depuis un an, et fratrie arabo-musulmane élargie dont le lien est à la fois traditionnel et déliquescent, le territoire du roman étant à la fois celui des identités tribales et des trafics illicites – leur similitude réduite à la rage de survivre, où le commerce de la drogue reste une base commune et le premier motif de la guerre – le roman de Philippe Lafitte étant aussi bien d’amour et de guerre…

Au présent de l’indicatif incarné
L’incarnation romanesque de Périphéries est immédiate avec l’apparition, torse nu dans la froide nuit industrielle, du jeune Virgile en plein effort de musculation tandis qu’alentour vrombissent les moteurs et se percutent les éclairs de lumière – Virgile à fleur de vingtaine et dont on apprend dans la foulée qu’il nourrit le grand projet de ramener son clan des Monescu au pays après trop de galères partagées en la présumée Terre promise, et comme un souffle biblique à valeur de fable se dégage de ces premières pages au présent de l’indicatif où planent déjà les ombres de diverses menaces.
Autant par sa substance que par sa forme, sa narration très visuelle et le trait percutant de chaque mot, la suite de ses séquences suivant l’évolution des quatre personnages principaux – deux hommes et deux femmes entre vingt et trente ans -, son découpage temporel et ses dialogues à l’arraché, le roman évoque un film à possible extension en série, stéréotypes inclus.
Mais ceux-ci ne figent pas la vie pour autant, et ce que le « discours sur les banlieues » peut avoir de convenu, voire de démagogique, se trouve ici en butte à une réalité tissée de violence et de contraintes qui font que dans chaque communauté chacune et chacun reste plus ou moins sous emprise, questions d’honneur pour la galerie et de raisons moins avouables en réalité.
Puisqu’il y a du cinéma partout désormais, et que Virgile le Rom et Nuri son potentiel ennemi sur le terrain du deal, se balancent des amabilités en verlan dont le sujet est une Yasmine voilée de force par son frère et donc interdite au Manouche, on pense évidemment aux deux clans opposés se défiant dans West side story, donc aux petits amants de Vérone, même si l’on n’en est même pas ici aux préliminaires. N’empêche que la tension monte vite aux extrêmes, et d’abord au sein d’une des deux communautés, entre Yasmine qui se tape tout le job familial (la mère est morte, et le père grabataire) après avoir lâché ses études à regret, et son frère Nuri, chef de bande aux investissements quasi mafieux, et lui imposant soumission au nom de l’honneur, de foulard en hidjab.
Que les exclus s’excluent entre eux et que l’ostracisme périphérique rime avec le racisme franchouille que Virgile et Nuri subiront forcément, chacun de son côté: voilà qui complique la situation, au risque de fâcher les simplificateurs – mais Lafitte montre sans démontrer, ce qui ne veut pas dire qu’il se débine, se dédouane ou renvoie tout le monde dos à dos. C’est plutôt face à face , dans l’emportement des violents et les tentatives d’échappées libres, que le drame se joue et se noue dans la lueur sinistre des brasiers.
La paradoxale beauté du réel
Une étrange aura de pureté, mélange de naïveté et d’aspiration vitale à se sortir du piège de la réalité, se dégage de ces Périphéries et cette « lumière » est ce qui nous attache particulièrement aux trois protagonistes positifs du roman et donne sa beauté à celui-ci.
Beauté du rêve candide de Virgile, loup solitaire qui souffre de l’exclusion des siens et leur offre un avenir de rêve aussi splendide que chimérique – et le personnage s’incarne bel et bien en figure de héros romantique, alors même qu’il a été blessé dès sa tendre enfance.
Beauté de la rage et du désarroi d’Yasmine, dont l’émancipation de femme intelligente est écrasée par la domination d’un frère aussi moralisant dans sa justification pseudo-religieuse que cynique dans ses menées de chef de gang; enfin beauté fragile de Léna la Roumaine à qui la maladie a interdit de suivre Virgile en France et dont le piège est la pauvreté – beauté de cette humanité fragile, sans rien de complaisant par évocation misérabiliste, mais qui garde quelque chose de sacré, comme dans la scène poignante et magnifique des funérailles nocturnes de la vieille Luana, aïeule et mère de substitution de Virgile dont la dépouille en feu est abandonnée au flux de la Seine, accompagnée par les chants et les prières du clan des Monescu…
Tout cela, une fois encore, pourrait nourrir une belle fresque vidéo ou cinématographique, mais avec un « plus » qui tient au roman et à ce que la littérature imprime de mémorable à notre rétine psychique ou affective. À cet égard, tant par sa connaissance et ses intuitions liées à son « expérience » latérale de la banlieue, qu’il a côtoyée pendant des années, que par son travail littéraire d’observateur du réel contemporain, amorcé dans ses livres précédents – une plongée mémorable dans l’univers intime et méconnu d’un Andy Warhol transformiste -, et surtout dans les précédents, Belleville Shanghai Express et sa communauté chinoise de Ménilmontant, suivi de Celle qui s’enfuyait, portrait en courant d’une Black en quête de résilience , Philippe Lafitte reprend et développe, dans une écriture de plus en plus suggestive, le thème qui le passionne de la rupture, chez ses personnages, d’avec les déterminismes sociaux, politiques ou idéologiques, telle que le lui a inspiré L’Eloge de la fuite du biologiste Henri Laborit.
Où le roman renoue donc, avec la touche sensible appropriée, avec les fondamentaux de la condition humaine…
Philippe Lafitte. Périphéries. Mercure de France, 174p. 2023.
Photo JLK: Philippe Lafitte à la rue de Canettes.
***
34. Avec l’élégance du cœur
À propos de Dandys et excentriques de Denis Grozdanovitch.
Champion de la raquette et crack au jeu d’échecs, Denis Grozdanovitch s’est fait, aussi, en vieux sage avant l’âge, le collectionneur des diverses formes de singularités individuelles opposées à l’esprit grégaire croissant aujourd’hui à proportion exponentielle des meutes et des masses.
Substantiel et souvent drolatique en dépit de son indéniable sérieux, Dandys et excentriques est à savourer à l’écart des foules…
La figure idéale du dandy à l’européenne, qui a cristallisé dès la fin du XIXe siècle en symbiose anglo-française, pourrait se représenter sous les traits du poète et activiste Lord Byron, flottant de nuit sur le Grand Canal de Venise dans la position dite de «la planche», un cigare dans une main et dans l’autre une lanterne destinée à signaler poliment sa position aux nautoniers et autres gardiens de l’ordre nocturne vénitien.
De dix ans l’aîné de Byron, le compatriote de celui-ci, surnommé «le beau Brummel», plus précisément George Bryan Brummel (1778-1840) passe pour l’initiateur du dandysme britannique, non moins flamboyant de mise et d’esprit que le poète quoique sans génie, qui lustrait ses bottines au champagne et fut célébré par Balzac autant que par Barbey D’Aurevilly mais finit tout perclus de dettes en exil normand, ne se rasant ni ne se lavant plus tout en lançant la mode de la cravate noire qui ne nécessite point de recours trop onéreux à la blanchisserie…
Arbitres des élégances visibles et parfois invisibles, comme le furent plus tard un Oscar Wilde ou un Kenneth Tynan, avant et après un Robert de Montesquiou (modèle du baron Palamède de Charlus de Proust) ou un Baudelaire, ces dandys emblématiques conservent une aura que beaucoup de leurs émules plus récents, imitateurs de pacotille à la Andy Warhol ou à la Gonzague de Saint-Bris, n’ont plus qu’aux yeux des philistins amateurs d’extravagance au petit pied.
De l’observation concentrique en milieu foldingue…
Denis Grozdanovitch s’identifie, au début de son inventaire kaléidoscopique, à Jack Kerouac assistant, le chapeau discrètement baissé sur ses yeux bien ouverts, à une conversation entre deux de ses amis aussi extravagants l’un que l’autre. Dans son récit-roman Sur la route, sous le pseudo de Sal Paradise, le narrateur fait semblant de dormir pendant le premier échange haut en couleurs de Carlo Marx et Dean Moriarty, lesquels ne sont autres, dans la vie réelle, que le barde beatnik Allen Ginsberg, gourou très barbu de la contre-culture américaine des années 60-70, et Neal Cassady, double fraternel de Kerouac et personnages mythique de la même époque.
Or Grozdanovitch, comme Sal Paradise feignant d’être ailleurs sans perdre un mot de la fameuse conversation, qu’il retranscrira tantôt à l’attention de la postérité, a souvent pratiqué de la même façon, lui l’observateur «concentrique» plutôt réservé et «classique» de nature, avec les multiples extravagants des deux sexes qu’il a fréquentés à travers les années.
Ainsi, se faisant chroniqueur de menées originales dont les unes sont tirées de sa vie et les autres de la littérature, l’auteur de ces «vertiges de la singularité» compose-t-il une espèce de roman tout à fait captivant dont les personnages illustrent, chacun à sa façon, ce que le théologien médiéval Duns Scot qualifiait d’«infiniment singulier», amorçant une interminable dispute entre les tenants de l’unicité fondamentale de la personne et ceux qui parient pour le collectif et la conformité plus ou moins grégaire, disons un peu grossièrement : les individus et les sectes, les solitaires et les attroupés, etc.
Max, Elise, Serge et les autres…
Des personnages singuliers, il y en a beaucoup plus autour de nous que nous ne croyons, sans parler forcément d’extravagance spectaculaire. Je pourrais vous raconter les tribulations de mon neveu Saturnin initié au chamanisme au tréfonds de la forêt péruvienne, dont le mariage avec une Chinoise ne dura que le temps d’une lunaison, ou les hauts faits mémorables de tel prince polonais richissime qui accoutumait, au Grand Hôtel de Chandolin où il se faisait conduire de Saint-Luc par chaise à porteuses (misogyne, il exigeait de solides Valaisannes costumées), de jeter des pluies de monnaie à la sortie de la messe pour jouir du spectacle des chenapans se jetant sur cette manne, mais les extravagants dont parle Denis Grozdanovitch, observés au fil de sa vie, requièrent une attention d’autant plus vive que leur dandysme est moins voyant et parfois plus profond, voire plus poignant.
Une douce folie apparente du moins son compère Max, «pion» comme l’auteur dans un lycée parisien, Edouard le génial stratège d’échecs à la paranoïa galopante, Elise la vieille dame indigne de souche aristocratique retirée dans son manoir avec sa gouvernante Aphonsine et sa ménagerie après avoir envoyé valdinguer sa famille de snobs et rallié la cause internationale du communisme, ou encore Serge le volubile qui met publiquement en boîte le docteur Lacan dont il évente au passage la fumisterie, j’en passe et de quelques autres originaux dont l’écrivain tire la matière d’autant d’esquisses de nouvelles visant à une «théorie générale des exceptions» aussi peu dogmatique que pénétrante et souvent émouvante.
De fait Gozdanovitch est plus sensible à ce qu’on pourrait dire l’aristocratie du cœur, qui imprègne ses observations de tendresse, qu’aux effets extérieurs de telle ou telle mode vestimentaire ou artistique se voulant «décalée» alors qu’elle participe d’un anticonformisme devenu convention. Son approche des provocations avant-gardistes d’un Marcel Duchamp, au début du XXe siècle dadaïsant, devenues conventionnelles au possible à force d’être répétées, va de pair avec sa critique de l’iconoclasme factice et incessamment recyclé d’un Andy Warhol dont le journal intime révèle un snob de bas étage à l’atterrante stupidité.
Au féminin singulier et au nom du style
Si la septuagénaire Elise est tirée des souvenirs personnels vécus de Grozdanovitch, celui-ci se plaît aussi à rendre hommage aux femmes dont la singularité personnelle a si souvent été canalisée ou empêchée – dans le peuple plus encore que dans les classes aisées -, et dont certaines grandes figures littéraires témoignent à travers les siècles, de la poétesse Sapho (dont on sait depuis peu que le «saphisme» est une invention tardive et fallacieuse) à la «comète mélancolique» Annemarie Schwarzenbach, en passant par Madame du Châtelet et Germaine de Staël, Karen Blixen ou – belle découverte au passage – la philosophe bulgaro-américaine Rachel Bespaloff, Virginia Woolf plus forcément que Duras ou encore Louise Brooks dont le « nihilisme érotique » a été célébré par Roland Jaccard, compère de Grozdanovitch aux échecs…
Et l’on pourrait évidemment citer dans la foulée, entre dandysme profond et féminine extravagance, très au-dessus des postures à la coule voire vulgaires d’une Christine Angot ou d’une Virginie Despentes, le génie subversif des contes étincelants de la terrible Madame d’Aulnay, la dévastatrice lucidité d’une Flannery O’Connor en son observation de la misère humaine dans ses nouvelles du «Sud profond », le non moins féroce et drolatique aperçu des relations sociales et familiales chez l’Anglaise Ivy Compton-Burnett, entre autres fées et sorcières des lettres.
La question du style est au cœur de la recherche menée par Denis Grozdanovitch. Qu’un Paul Léautaud, un Arthur Cravan célébré par son ami Cendrars, lui-même peint en personnage de légende par Henry Miller, ou qu’un Charles-Albert Cingria, un Albert Cossery en dandy germanopratin, fassent partie d’une constellation d’originaux plus ou moins hauts en couleurs : c’est une chose. Mais l’essentiel est ailleurs, qui tient au style.
Ramuz ne faisait pas que nouer sa cravate comme personne : son écriture est une modulation du dandysme terrien, de même que la phrase de Léautaud est inimaginable hors de l’Île-de-France, inimaginables les nouvelles de Cossery sans imprégnation arabo-levantine fleurant la rue du Caire.
Grandeur des Bartleby, Oblomov & Co
Le vrai dandysme n’est pas forcément ostentatoire ni moins encore maniéré, même s’il y avait de ça chez un Oscar Wilde dont le style étincelant jetait mille feux brefs. Mais le grand Wilde est ailleurs : dans l’humiliation et la déchéance, dans le cachot où il écrit, après le crachat des justes, le bouleversant De profundis, joyau débourbé de la fange.
La singularité est vertigineuse quand elle va jusqu’au bout d’elle-même, comme on le voit chez Edouard, ami de Grozdanovitch sombrant dans le délire de persécution alors qu’il aspire aux plus hautes sphères combinatoires du Noble Jeu, ou chez Kenneth Tynan le dandy déchu de la critique théâtrale londonienne (c’est lui qui a fait la gloire des culs nus d’O Calcutta…) se vautrant dans le stupre et l’autodestruction.
Mais il faut conclure plus aimablement, entre le divan d’Oblomov le divin paresseux et la douceur implacable du scribe Bartleby refusant de jouer le jeu social, dans l’aura polychrome de Pierre Bonnard retouchant à l’infini ses images du bonheur terrestre, ou dans le souvenir ému d’Anton Pavlovitch Tchekhov, pas plus dandy qu’extravagant au sens commun, dont la vie humble et le style, parfaitement accordé à la simple vérité de toute existence, signaient sa noblesse plus qu’aucune particule…
Denis Grozdanovitch. Dandys et excentriques. Les vertiges de la singularité. Grasset, 383p. 2019.
***
35. Aux confins de la forêt profonde

À propos de Lisière, récit de voyage de Kapka Kassabova.
La Bulgare Kapka Kassabova, établie dans les Highlands écossaises, mais revenue à ses sources balkaniques, en a ramené, sous le titre de Lisière, un récit saisissant à valeur multiple de reportage géo-politique, de document humain aux figures mémorables, de méditation sur les notions de frontière et d’identité ou encore de grand poème existentiel mêlant mythologie antique et tragédies actuelles, alternant ombres et lumières.
Nous venions d’entrer en quarantaine mondiale lorsque, d’un clic, j’ai rejoint en pleine nuit la belle Kapka au fin fond des monts Rhodopes, dits aussi « montagnes de la folie, en quête d’un mythique village-où-l’on-vit-pour-l’éternité, aux confins de trois entités historico-politiqes (Bulgarie-Grèce-Turquie) où les hommes, depuis la nuit des temps «barbares», n’ont cessé de se chasser d’un côté et de l’autre.
Dans la seconde partie du XXe siècle, de nombreux jeunes gens épris de liberté ont perdu la vie dans ces forêts truffées de gardiens en armes en essayant de passer un rideau de fer fantomatique mais terriblement réel, et, plus récemment, dans un mouvement inverse, de non moins nombreux migrants se sont fait piéger alors qu’ils tenaient d’entrer en Europe – symbole à leurs yeux de paix et de prospérité.
Jusque-là, j’ignorais tout des monts Rhodopes, ne me doutant pas que c’était là-bas, à la frontière invisible séparant l’Occident de l’Orient, qu’un certain Orphée, pénétrant dans une grotte percée au flanc de la montagne dite du Jugement, avait accédé au royaume des ombres comme Dante au « milieu du chemin» de sa propre vie ; je ne savais rien des cérémonies purificatrices perpétuées par les habitants de ces lieux se retrouvant pour des ablutions aux sources miraculeuses entrecroupées de danses sur les braises, et d’un clic, en pleine période obsédée par les fameux « gestes-barrières », j’entrai dans ce monde enchanté qui est à la fois notre monde, virus compris.
Un réseau sans barrières
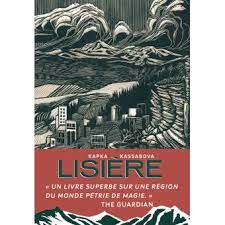
C’est par un autre clic, via Facebook, que mon compère Alain Dugrand – vétéran de la première équipe du journal Libération des années July et juré-secrétaire du prix Nicolas Bouvier à l’enseigne du festival Étonnants Voyageurs – m’a, le premier, recommandé la lecture de Lisière,et, comme le librairies se trouvaient alors interdites d’accès, ce fut via Kindle que je me pointai donc, cette nuit-là, dans cette « histoire humaine de la dernière frontière en Europe », au seuil de laquelle cette belle grande bringue de Kassabova, à propos des nouvelles barrières s’élevant ici et là dans notre drôle de monde, mur de Trump compris, situait sa démarche focalisée sur la « dimension humaine de l’histoire» en ces termes, et plus précisément à propos des barbelés visant à endiguer le flux migratoire en provenance du Moyen-Orient : «Déplacements et barricades à l’échelle mondiale, nouvelles formes d’internationalisme et vieux réflexes nationalistes : telle est la maladie systémique qui gangrène notre monde et se propage de périphérie en périphérie, car à l’heure actuelle il n’existe plus un seul endroit retiré. Enfin, jusqu’au jour où vous vous perdez dans la forêt »…
Or le moins qu’on puisse dire, au fil du parcours de Kapka Kassabova, c’est qu’elle ne se perd pas plus que le cher Dante Alighieri suivant son guide dans sa « forêt obscure », même si elle ne sait pas exactement ce qu’elle cherche, comme elle le confiera en fin de parcours à une guérisseuse de bon conseil.
De la génération qui avait vingt ans quand le mur de Berlin s’est effondré, Kapka n’a jamais cru aux « lendemains qui chantent » de l’idéologie politique ni à quelque au-delà rassurant promis par telle ou telle doctrine religieuse. Contrairement à l’auteur de la Divine comédie, dont la quête parachevait le pèlerinage du Moyen Âge chrétien sur des bases poétiques et théologiques bien établies, avec Virgile pour mentor et Thomas d’Aquin en soutien dogmatique, la brave voyageuse se retrouve en somme, au XXIe siècle, dans une situation rappelant à la fois celle d’Ella Maillart en ses premières explorations, avec un souci quasi ethnographique d’enquêtrice sur le terrain, à la rencontre de personnes plus ou moins déplacées qu’on dirait les survivants d’on ne sait quelle catastrophe passée, au seuil d’une ère non moins inquiétante.
Comme l’Américaine catholique Annie Dillard observant la nature proche ou les Indiens d’Amazonie, pas loin non plus des investigations de la journaliste russe Svetlana Alexievitch, la voici donc arpenter ces hautes terres farouches et magnifiques et se confronter à l’histoire du XXe siècle « à visage humain », et ce sont alors autant de rencontres surprenantes autant de destinées touchantes ou glaçantes, évocatrices d’un temps confus où se mêlent toutes les époques, les croyances et les pratiques. Ainsi l’ancien agent du renseignement bulgare, relooké en jouisseur cynique à compagne raciste en bikini, voisine-t-il avec le délateur-exécuteur en mal de justifications, mais aussi avec les gens simples du village-dans-la vallée ou avec les porteuses d’icônes et les pèlerins nocturnes fouleurs de feu des cérémonies immémoriales.
Une guérisseuse de bon conseil…
Les « purs » littéraires, invoquant le « pur » Mallarmé – en faussant d’ailleurs ce que le poète entendait par là -, évoquent parfois avec dédain l’ « universel reportage » comme un sous-genre négligeable, alors que les récits de voyage, aujourd’hui, se trouvent au contraire exaltés au titre d’une prétendue « littérature-monde » supposée plus « authentique » en tant que telle, effets de mode compris.
Or lisant Lisière de Kapka Kassabova, ces distinctions paraissent à vrai dire académiques, voire dérisoires, tant ce récit « journalistique » recèle de « poésie », parfois aussi envoûtant que telle nouvelle de Buzzati ou que tel roman de Kadaré, tout en restant aussi factuel que les enquêtes d’un Richard Kapuscinski.
La lecture n’est qu’un voyage virtuel, mais lire Lisière m’a paru aussi tonique et roboratif qu’une virée réelle dans nos forêts, ponctuée de rencontres non moins marquantes que leurs homologues en 3D… Jusqu’à la dernière, guérisseuse à tête d’oiseau qui a fait carrière dans la médecine conventionnelle avant d’en arriver à la conclusion que toute douleur a des causes spirituelles et remarquant que « la médecine a horreur d’admettre à quel point elle est impuissante ».
Alors Kapka Kassabova de détailler les pratiques singulières de la guérisseuse, recoupant les croyances et autres « secrets » de multiples traditions spirituelles d’essence populaire restées vivaces en ces lieux où paganisme, islam et christianisme s’entremêlent, qui finit par la soumettre à un rite destiné à la délester du poids de tout ce qu’elle à vécu dans ces «montagnes de la folie» afin de lui rendre, le pied léger, son inaliénable liberté…
Kapka Kassabova. Lisière.Traduit de l’anglais (Ecosse) par Morgane Saysana. Editions Marchialy, 2020, 485p.
***
36. Dits de l’émerveillé
Avec François Cheng, à propos de L’Eternité n’est pas de trop…
(« Sans le vrai deux il n’y a pas de vrai trois »)
Il est certaines rencontres durant lesquelles les heures semblent se dilater ou se parer d’une sorte d’aura, et tel est le sentiment profond que j’aurai éprouvé en passant, l’autre jour, un après-midi de plénitude avec François Cheng, assis sur de mauvaises chaises dans une salle froide entourée de gens bruyants, mais comme hors du temps, ou plutôt au coeur du temps, dans sa palpitation mêlée de violence et de douceur, où l’ombre le dispute à la lumière.
De fait, le poids du monde et la légèreté de l’être marquent immédiatement, sans la moindre pose, la conversation de cet homme qu’on sent à la fois délicat à l’extrême et habité par une grande force intérieure, dont l’enfance fut marquée par les horreurs de la guerre et qui connut l’«enfer parisien», selon l’expression de Rilke, du dénuement et de la solitude, avant de faire un beau chemin de lettré et de poète, puis de romancier capable d’exprimer à la fois les nuances les plus subtiles de l’émotion et les pulsions parfois terrifiantes de la brute humaine.
«Ce qui m’occupe essentiellement dans L’éternité n’est pas de trop, c’est la passion. Et ce que je veux dire, c’est que la vraie passion relève de l’esprit. Elle est certes fondée sur les sens et les sentiments. Mais celui qui reste à ce niveau purement biologique tourne en rond et se dessèche. Quand la passion relève de l’esprit, c’est l’ouverture continuelle. Pourquoi ? Parce que la possibilité d’échange entre le masculin et le féminin est le plus grand don qui nous ait été offert par la Création. Tous les autres types de dialogues relèvent d’ailleurs de cette relation, y compris chez les mystiques qui dialoguent avec Dieu, ou chez les artistes qui dialoguent avec la nature. Un cynique pourrait nous dire que le rapport masculin-féminin n’est qu’une nécessité liée à la procréation, mais je crois que c’est faux. Parce que l’homme est devenu un être de langage, qui est un miracle de la création. Le rapport entre masculin et féminin offre alors un dialogue sans fin, fondé sur un désir toujours renouvelé et encore amplifié par l’inaccessibilité. Comme on ne peut jamais atteindre tout à fait l’autre, le dialogue est d’autant plus infini. L’homme et la femme sont deux êtres finis, mais qui s’engagent sans cesse dans la voie de l’infini.»
Sublimités éthérées que ces propos ? Au contraire: ce qui saisit à la lecture de L’éternité n’est pas de trop, c’est son ancrage physique dans le concret et le sensible, d’où rebondissent ses échappées vers les hauteurs. Disciple de Rilke, sur les traces duquel il est allé se recueillir quelque temps, dans un chalet-hôtel en face de Rarogne – Rilke qu’il affirme un «poète de l’être» comme il se définit lui-même -, François Cheng dit qu’il est devenu un «pèlerin de l’Occident».
Lorsque, boursier de dix-neuf ans et ne sachant pas un mot de français, il débarqua à Paris le premier jour de 1949, le jeune Cheng connaissait déjà parfaitement les littératures européennes. C’est cependant après des années de vraie «galère» que le futur traducteur chinois des plus grands poètes français contemporains, allait se faire connaître, dans les années 70, par deux ouvrages portant, respectivement, sur L’Ecriture poétique chinoise (Seuil, 1977) et sur Vide et plein, le langage pictural chinois (Seuil, 1979), précédant divers livres d’art de haute tenue, notamment consacrés à la peinture de Shitao. Or on relèvera, dans la foulée, que c’est bel et bien en «pèlerin de l’Occident» que François Cheng s’est fait passeur d’Extrême-Orient; et par exemple en remontant aux sources de la Renaissance italienne qu’il a redécouvert celles, bien antérieures, de la peinture chinoise.
«C’est en approchant la meilleure part d’une autre culture que vous découvrez votre propre meilleure part. D’où la nécessité de l’échange. Toute culture qui se replie sur elle-même se meurt. Vous connaissez bien vous-mêmes, en Suisse, ce danger. A ce propos, je me rappelle que Romain Rolland, dans Jean-Christophe, imaginait l’avenir de l’Europe des cultures à partir du modèle helvétique. Plus l’autre est riche, plus je m’enrichis moi-même, et plus je suis à même d’enrichir ensuite les autres.»
«Dans ce mouvement d’échange, poursuit François Cheng, je crois que la Chine peut amener quelque chose à l’Occident avec son intuition ternaire. L’Occident a privilégié la logique duelle, ce qui constitue sa grandeur. Cette séparation du sujet et de l’objet fut sa démarche originale. Cela étant, maintenant qu’on a conquis la matière et le monde entier, il est peut-être temps de valoriser la dimension ternaire. La Chine n’a peut-être pas assez privilégié le deux, qui représente le droit, le respect de l’autre, la démocratie et la liberté. Or sans le vrai deux, il n’y a pas de vrai trois. Ce qui est important à l’instant, dans notre conversation, ce n’est pas chacun de nous: c’est ce qui a pu avoir lieu, qui nous dépasse l’un et l’autre pour donner cette nouvelle expression de l’être – une rencontre et une conversation.»
Evoquant l’avenir de son pays, où il n’est revenu que dans les années 8o, après la tragédie sanglante de la Révolution culturelle, François Cheng refuse d’envisager la rencontre de la Chine et de l’Occident en termes de relation «duelle».
«Il faut que chacun dépasse les idées préconçues qu’il a de l’autre. Non, la Chine n’est pas le monde monolithique et fermé, voire agressif, que se figurent certains Occidentaux. Non, l’Occident n’est pas réductible au culte du profit. Certes, la Chine actuelle est gangrenée par la corruption, mais ce n’est pas toute la Chine. Comme à d’autres époques, le meilleur de la Chine a conscience de sa faiblesse et sait que c’est dans le dialogue avec l’Occident qu’elle peut se régénérer et lui apporter, aussi, quelque chose de sa propre richesse millénaire…»
Une passion qui survit au temps
L’époque est à l’obsessionnelle célébration de la jeune chair, dont les dialogues débiles du Loft illustrent, pour le pire, la pauvreté des échanges. Autant dire que le roman d’un amour empêché, qui devient passion sur le tard, et sans union charnelle consommée (quoique la fin reste ouverte), fait figure d’ouvrage à contre-courant.
Or ce qui saisit, à la lecture de L’éternité n’est pas de trop, c’est l’extraordinaire fraîcheur, et la plénitude sensuelle et spirituelle de cette histoire concentrant à la chinoise, à la fin de la dynastie Ming (XVIIe siècle), les deux passions contrariées de Roméo et Juliette et de Tristan et Yseut.
Trente ans après avoir échangé un regard amoureux avec la belle Lan-Ying, fille de riches bourgeois alors qu’il n’est lui-même qu’un pauvre musicien ambulant, Dao-sheng revient dans le bourg où, mariée contre son gré avec un seigneur local, Dame Ying dépérit. Sa qualité de médecin, acquise auprès des moines, permet à l’amoureux persistant d’approcher celle qui lui a été ravie (il a même été battu et a connu le bagne pour son audace), et de la guérir, au déplaisir ardent du seigneur jaloux, lequel mourra de rage mauvaise après avoir tenté d’étrangler sa femme redevenue trop belle à son goût.
Bien plus qu’un roman d’amour «sublimé», L’éternité n’est pas de trop est l’incarnation vivante – où les instances du mal sont aussi présentes que l’aspiration au dépassement -, d’une passion sublime, admirablement modulée, en un présent de l’indicatif qu’on dirait concentrer tous les temps verbaux, par l’écriture limpide et fruitée, énergique et poétique, d’un maître écrivain.
François Cheng. L’éternité n’est pas de trop. Albin Michel, 282p.
37. La poésie d’une magicienne
À propos de Janice Winter de Rose-Marie Pagnard.
D’un livre à l’autre, et comme entremêlant des fils d’encre soyeuse et d’or, Rose-Marie Pagnard poursuit son œuvre romanesque à la manière d’un grand rêve éveillé, dont l’atmosphère relève à la fois du conte populaire et du romantisme allemand, avec une tension constante entre folie et beauté. Le mélange de psychologie des profondeurs et de poésie de Janice Winter rappelle en outre les romans si troublants et si beaux de Pierre Jean Jouve (de Paulina au Monde désert, en passant par Les aventures de Catherine Crachat), sans qu’il soit question pour autant d’aucune imitation.
De fait, l’univers de Rose-Marie Pagnard est décidément original et unique, et la narration de Janice Winter, dégagée des brumes parfois un peu éthérées du précédent ouvrage de l’auteur, Dans la forêt la mort s’amuse (excellent au demeurant, et gratifié d’un Prix Schiller en 1999), marque une nouvelle avancée.
Janice Winter est une enfant en métamorphose, qui se raconte cette drôle d’histoire tout en la vivant, comme par mimétisme, au côté de sa sœur aînée Léa dont la récente tentative de suicide étreint les siens d’angoisse latente. Le double printemps inquiet des filles Winter s’accorde par ailleurs à l’ambiance étrange de la maison d’Ida Sommer, la grand-tante dont le fils Horst a disparu depuis huit ans et 235 jours. L’histoire se passant rue des Foudres, il est naturel que le disparu tombe du ciel pour réapparaître aux jeunes filles auréolé de feu et en manteau d’Arlequin, qu’elles serviront chacune à sa manière à la cave où, bâtard en quête de père et bandit pour rétablir l’ordre secret des choses, il s’est planqué quelque temps.
Dans un climat d’étrangeté qui nimbe tous les personnages d’une sorte d’aura mythique, Rose-Marie Pagnard marque bien la frontière entre les instances de la trivialité et de la norme, du conformisme social et de la conformité psychiatrique, et celles de la fantaisie et de l’imagination, de la liberté et de la poésie.
Cernés par l’angoisse, les parents de Léa tremblent à l’idée que leur fille puisse toucher à la drogue, sans imaginer ces « phénomènes inexpliqués » de la nature qui ont toujours fasciné Horst, lequel incarne d’ailleurs la poésie en mouvement perpétuel autour de nous, mais qu’on ne saurait percevoir sans attention fervente, à laquelle Janice ajoute une sorte d’amour sorcier, en deçà de la fusion sexuelle vainement espérée par Léa.
Rose-Marie Pagnard, Janice Winter, Editions du Rocher, 179 pp.
***
38. Whispering Safonoff
En lisant Autour de ma mère, cette année-là…

La très belle évocation hivernale de la baie de Montreux vue des hauts, par Varlin, rend bien la tonalité de ce dimanche d’hiver et fait écho, à l’instant, à ces mots que je lis dans le dernier livre de Catherine Safonoff, intitulé Autour de ma mère et me rappelant à tout moment les notes sensibles du livre que je préfère de Peter Handke, Le poids du monde : « Je me rappelle l’hiver dernier, un hiver gris et froid tendu par une sorte de courage mécanique. On écrivait tous les jours, à 16 heures on rangeait les papiers et on partait marcher. J’allais d’un bon pas dans le froid, toujours le même parcours, la nuit tombait, de retour je montais le chauffage, faisais du thé, un peu de ménage, des exercices de grec, écoutais la radio – oui, un bon hiver régulier et les longs soirs étaient assez heureux, tout autour de la maison c’était un beau froid noir et muet ».
Voilà, c’est exactement ça que nous avons ce dimanche matin, ce « beau froid noir et muet », et le murmure de Safonoff me touche et me fait lever les yeux à tout moment, comme hier soir et tous ces soirs le Journal de Kafka, qu’elle dit elle aussi lire en continu, me rappelant également ce seul titre de Handke que ces pages illustrent précisément : L’heure de la sensation vraie…
« Une seule chose a compté dans ma vie, écrit Safonoff, aimer quelqu’un, être aimée de quelqu’un. J’ai vécu ou survécu grâce à cela. J’écris sur l’amour personnel, j’écris sur l’unique entreprise qui vaille au monde, aimer quelqu’un ».
C’est exactement ce que dit aussi Sarah Kane dans le dernier roman d’Arnaud Cathrine, et c’est ce que j’ai écrit dans mes carnets de l’année dernière, et cela aussi du murmure de Safonoff trouve un immédiat écho en moi : « Je n’aime pas ne pas revenir à quelqu’un ». C’est pourquoi j’en ai tant bavé, moi, de ne pas voir certains de mes amis ne jamais revenir. Moi je serais toujours revenu mais le sentiment qu’ils ne reviendraient jamais ni sur ce qu’ils ont dit ni sur ce qu’ils ont fait, parce que leur hubris, leur orgueil, leur paresse, la face à ne pas perdre les en empêchait, cette évidence qu’ils ne reviendraient pas sauf à revenir où ils étaient restés, autant dire une petite mort, m’ont paralysé. Ici, chez Safonoff, on est dans la fragilité pure de qui aime et qui aimerait aimé.
Voici ce qu’elle écrit d’un enfant, elle la vieille petite fille. « Après-midi avec Rémy, quinze mois. Il a un grand attachement pour Doudou, un hippopotame mou recouvert de tissu éponge verdâtre. La peluche est devenue morveuse, croûteuse, malodorante. Parfois l’enfant me la tend mais sans la lâcher. Sucé, cajolé, trituré, Doudou est la chair d’une chair originelle. Je me demande quand Rémy quittera son Doudou et par quoi il le remplacera. Il s’endort, tétant la queue de son hippopotame. Je me demande quels sont mes objets transitionnels et vers quoi ils me transitionnent ».
Mon objet transitionnel de ce dimanche froid noir et muet est ce livre qui filtre la vie avec une justesse de chaque mot et de chaque silence. C’est un livre proustien à l’état de notes apparemment éparses, mais tenues ensemble par-dessous ou dedans, qui pourrait avoir 100 ou 1000 pages. C’est un livre qui ne se discute pas. Je dois aller en parler mercredi prochain à la radio et voilà ce que je dirai : on ne discute pas ce livre, ce livre est ce qu’il est, c’est un objet transitionnel qui a la couleur de la tristesse et d’une joie discrète…
Catherine Safonoff, Autour de ma mère. Zoé, 264p.
***
39. Des ombres lumineuses
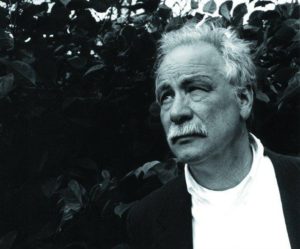
Constellations poétiques de W.G. Sebald.
Il faut écrire entre le cendrier et l’étoile, disait à peu près Friedrich Dürrenmatt, et c’est la même mise en rapport, sur fond d’intimité cosmique, qu’on retrouve aussitôt dans l’atmosphère même, enveloppante et crépusculaire, du dernier recueil posthume de W.G. Sebald consacré à sept écrivains et artistes ayant pour point commun d’associer le tout proche et le grand récit du temps ou de l’espace, comme l’illustre immédiatement cette splendide évocation du passage de la comète de 1881 sous la plume de l’allumé Johann Peter Hebel, walsérien avant la lettre : « Durant toute la nuit, écrit-il, elle fut comme une sainte bénédiction vespérale, comme lorsqu’un prêtre arpente la maison de Dieu et répand l’encens, disons comme une bonne et noble amie de la terre qui se languit d’elle, comme si elle voulait déclarer : un jour, j’ai aussi été une terre, comme toi pleine de bourrasques de neige et de nuées d’orages, d’hospices, de soupes populaires et de tombes autour de petites églises. Mais mon heure dernière est passée et me voici transfigurée en célesta clarté, et j’aimerais bien te rejoindre mais n’en ai point le droit, pour ne pas être de nouveau souillée par tes champs de bataille. Elle ne s’est pas exprimée ainsi, mais j’en eus le sentiment, car elle apparaissait toujours plus belle et plus lumineuse, et plus elle approchait, plus elle était aimable et gaie, et quand elle s’est éloignée, elle est redevenue pâle et maussade, comme si son cœur en était affecté »…
Cette comète qui passe là-haut et nous regarde avec mélancolie me fait penser au saint de Buzzati qui regrette de ne pouvoir tomber de son encorbellement de cristal et rejoindre les jeunes gens en train de vivre de terribles chagrins d’amour dans les bars enfumés, mais une autre surprise m’attendait au chapitre consacré à Robert Walser, mort dans la neige un jour de Noël, comme mon grand-père, et la même année que le grand-père de Sebald, en 1956. Ces coïncidences ne sont rien en elles-mêmes, à cela près qu’elles tissent un climat affectif et poétique à la fois, participant d’une aire culturelle et de trajectoires sociales comparables.
Dans les Promenades avec Robert Walser, Carl Seelig évoque cette Suisse à la fois paysanne et populaire, souvent instruite par les multiples voyages de l’émigration (la Suisse du début du siècle était pauvre, mes quatre grands-parents se sont connus en Egypte où ils travaillaient dans l’hôtellerie), et marquée, comme l’Allemagne du sud, par le mélange des cultures et l’esprit démocrate, l’utopie romantique et le panthéisme, qu’on retrouve dans les univers parcourus par W.G. Sebald. Celui-ci prolonge la tradition des grands promeneurs européens qui va de Thomas Platter, le futur grand érudit descendu pieds nus de sa montagne avec les troupes d’escholiers marchant jusqu’en Pologne, Ulrich Bräker le berger du Toggenburg qui traduira Shakespeare, ou Robert Walser se mettant « pour ainsi dire lui-même sous tutelle », comme l’écrit Sebald, sans cesser de griffonner de son minuscule bout de crayon sous les étoiles…
Une très belle évocation posthume de W.G. Sebald, par son ami l’artiste Jan Peter Tripp, conclut ces Séjours à la campagne en situant le grand art de l’écrivain dans la tradition des graveurs de la manière noire. « Homme enseveli sous les ténèbres, ce maître du temps et de l’espace dont le regard s’animait au royaume des Ombres, n’était-il pas devenu lui-même, au fil des ans, dans son Royaume mélancolique, une sorte de plante de l’ombre ?
D’ailleurs, dans son pays d’adoption, l’Angleterre, la manière noire avait connu au XVIIIe siècle un épanouissement unique, porté par les plus grands artistes. Travailler en partant des ténères pour aller vers la lumière est une question de conscience – ôter de la noirceur au lieu d’apporter la clarté. Aussi l’habitant de l’ombre devait-il ne s’exposer qu’avec précaution à l’éclat de la lumière ».
C’est exactement le processus par lequel Sebald, dans cette suite de plongées dans le temps que constituent ses approches des œuvres de Hebel, Rousseau, Möricke, Keller, Walser ou Tripp lui-même, qui sont à chaque fois des approches de visages engloutis dans la nuit du Temps, révèle progressivement les traits d’une destinée particulière cristallisant les éléments dominants de telle ou telle époque en tel ou tel lieu.
Après la terrifiante traversée de l’Allemagne en flammes, dans Une destruction, Sebald rassemble ici plusieurs avatars de la culture préalpine et du mode de vie propres à l’Allemagne du Sud et à la Suisse, dont un élément commun est cette Weltfrömmigkeit (une sorte de métaphysique naturelle ou de mystique panthéiste assez caractéristique du romantisme allemand) qu’il trouve chez Gottfried Keller, dont le chapitre qu’il lui consacre, autour de Martin Salander et d’Henri le Vert, est une pure merveille.
Je n’en retiendrai que cette mise en évidence d’une scène emblématique d’Henri le Vert, aussi profondément poétique que l’évocation proustienne des livres de Bergotte survivant à celui-ci dans une vitrine à la manière d’ailes déployées, où l’on voit Henri ajuster, sur le cercueil de sa cousine Anna, une petite fenêtre de verre sur laquelle, en transparence, il découvre le reflet d’une gravure de petits anges musiciens. Et Sebald de préciser aussitôt : « La consolation qu’Henri trouve dans ce chapitre de l’histoire de sa vie n’a rien à voir avec l’espérance d’une félicité céleste (…) La réconciliation avec la mort n’a lieu pour Keller que dans l’ici-bas, dans le travail bien fait, dans le reflet blanc et neigeux du bois des sapin, dans la calme traversée en barque avec la plaque de verre et dans la perception, au travers du voile d’affliction qui lentement se lève, de la beauté de l’air, de la lumière et de l’eau pure, qu’aucune transcendance ne vient troubler »…
W.G. Sebald. Séjours à la campagne. Traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau. Actes Sud, 200p.
***
40. Catastrophe annoncée

Witkiewicz le visionnaire avait tout pressenti…
L’actualité mondiale, monstrueuse, annonce-t-elle les pires lendemains, comme aux jours de 1939 où l’un des grands visionnaires de la littérature du XXe siècle, avec Orwell et Huxley, en la personne du génial Polonais Stanislaw Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy, se suicida en constatant que ses prédictions s’avéraient ? Nul ne saurait répondre, mais la lecture des livres majeurs de ce catastrophiste déjanté peut nous aider à voir plus clair dans l’imbroglio désastreux des jours que nous vivons…
Stanislaw Ignacy Witkiewicz (1885-1939) aura sans doute été l’écrivain de la première moitié du xx siècle à la fois le plus attentif à son époque et le plus profondément révolté par les aberrations découlant, entre autres, de la prépondérance croissante des idéologies, politiques ou religieuses, au détriment de la philosophie et de l’art, des libertés sociales et individuelles.
Philosophe métaphysicien, romancier, dramaturge, peintre, théoricien de l’art et pamphlétaire, celui qu’on appelle Witkacy – surnom qu’il se donna lui-même pour le distinguer de Stanislas Witkiewicz, son père, peintre lui aussi et théoricien célèbre en Pologne – incarne la plus pénétrante conscience de son temps, avant Orwell, avec tous les déchirements que cela suppose, vécus jusqu’à leurs dernière extrémités : voyant ainsi se réaliser ses prophéties caractérisées, notamment, par la « bétaillisation » des masses populaires en URSS, et par la montée des fascismes, il se suicida à la lisière d’une forêt juste après avoir appris la nouvelle de l’invasion conjuguée de la Pologne par les troupes soviétiques et hitlériennes.
Personnage hors du commun, de stature physique imposante, très beau de visage et ne dédaignant ni les beuveries ni les longues marches en montagne, Witkacy fut plus connu, de son vivant, pour se frasques et son extravagance que pour son œuvre.
« Toute la Pologne, écrit à ce propos Alain Van Crugten, son premier traducteur en langue française et l’un de ses meilleurs commentateurs, porte aux nues cet ex-enfant terrible qu’on considérait naguère d’un œil furibond ou amusé. On est fier à présent de le compter parmi les phénomènes les plus originaux et les plus représentatifs de l’avant-garde littéraire et artistique européenne des années vingt, on s’enorgueillit de le voir découvert enfin dans le monde entier, de voir ses romans – le magistral Inassouvissement et le non moins étonnant Adieu à l’automne traduits en plusieurs langues et reconnus comme l’une des plus fascinantes expressions du désarroi intellectuel du xxe siècle. »
Ce qu’il convient d’ajouter à cela, c’est que le l’œuvre de Witkacy dépasse le cadre des années vingt, qui ne revêt qu’aujourd’hui sa pleine signification. C’est que ses prédictions qui purent passer, à l’époque, pour les plus échevelées, sont bel et bien en train de se réaliser.
Acteur surprenant au dire de ceux qui l’ont connu, capable d’imiter la voix et les tics de chacun, Witkacy a vécu le drame de toute une civilisation sur le déclin à l’enseigne du même mimétisme. Son immense culture, sa vision panoramique du monde, son historiosophie proche de celle d’un Spengler, le désespoir en sus – il réfute en effet la théorie cyclique du grand historien, où celui-ci place ses dernières espérances –, et ses tragique expériences personnelles sont à la base de son art, apparemment si chaotique mais qui procède cependant de la fondamentale nostalgie d’un ordre supérieur.
Sur le sérieux de Stanislaw Ignacy Witkiewicz, sur la parfaite intégrité de cet individualiste forcené longtemps adulé pour les raisons les plus futiles, alors qu’il était raillé ou méprisé par les mandarins du bien-penser, un témoignage de première main est à prendre en considération : il s’agit des mémoires du sculpteur August Zamoyski, l’un de ses intimes.
L’on y trouve, à côté du récit des facéties auxquelles Witkacy accoutumait de se livrer (pseudo-orgies narcotiques au cours desquelles on faisait renifler de la farine de blé arrosée de vodka aux gogos avides d’hallucinations ; revue littéraire purement canularesque multipliant les traductions imaginaires de Tzara ou Breton et consorts, etc.), le portrait d’un homme délicat, angoissé, dissimulant ses convictions véritables sous les dehors d’un cynisme désespéré : « Witkacy souffrait pour des millions d’êtres de cette dégradation des arts dont lui, au moins, ne cherchait pas à profiter, car il était persuadé que le monde courait ventre à terre à la catastrophe. Les facéties de Witkiewicz et son humour noir étaient les réactions d’un condamné à la pendaison, un rire à travers les larmes. »
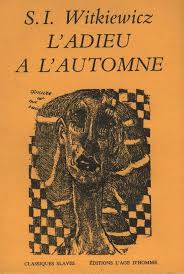
L’Adieu à l’automne (1927) et L’Inassouvissement (1930) sont, respectivement, le deuxième et le troisième roman de Witkiewicz. Le premier en date, Les 622 chutes de Bungo, composé en grande partie en 1910, après une liaison orageuse que le jeune homme entretint avec l’actrice Irena Skolska – modèle de la pléiade des « femmes démoniaques » constellant ses romans et ses pièces de théâtre – a paru pour la première fois en langue française. Quant à La seule issue, le dernier de ses romans, demeuré inachevé, il ne fut publié en polonais qu’en 1968.
Parler de « romans » relève d’ailleurs de la pure convention, tant il est vrai que ces ouvrages de Witkacy apparaissent plutôt comme de gigantesques fourre-tout.
« Le roman, écrit d’ailleurs l’auteur dans sa préface à L’Inassouvissement, est pour moi avant tout la description de la durée d’un certain fragment de réalité, inventée ou véridique, c’est indifférent, mais définie ainsi : la chose principale en est le contenu et non la forme. »
Auteur d’une Théorie de la forme pure qu’il ne parvint – heureusement peut-être – jamais vraiment à incarner, ni au théâtre ni dans ses romans, Witkacy est pourtant le contraire d’un formaliste. Pour lui, ce qui importe avant tout est l’expression immédiate et véridique d’une sensation physique globale et d’un sentiment métaphysique indissolublement liés. Pour l’individu c’est, essentiellement, la stupéfaction d’être, de se sentir être soi-même et pas un autre : de représenter une « monade » distincte, inimitable et inconnaissable parmi la multiplicité des autres unités. Peu importent les éléments auxquels on a recours s’ils contribuent à éclairer les divers aspects de cette expérience primordiale – fondement de la réflexion ontologique, chez Witkacy – qui consiste à isoler ce qu’il appelle, avec son goût drolatique des formules à solennelles majuscules : le Principe d’Identité Particulière Effective !
« Ce qui est d’une étrangeté hors mesure, c’est le fait que moi je sois ainsi et non un autre », remarquent Witkacy et ses doubles romanesques au fil de leurs tribulations érotico-métaphysico-artistico-socialo-politiques. Ou bien, par contraste, pour accuser l’altérité insupportable de la femme démoniaque : « Il y avait dans cette surfemme quelque chose d’effrayant qui dépassait toute description : elle devenait, pour ce métaphysicien raté, l’incarnation, unique pour l’instant, de ce Mystère de l’Être qui était tout à fait mort dans la sphère de l’expérience directe. »
Tout dire et sur-le-champ, avant que le ciel ne nous tombe dessus : telle semble être la règle de Witkacy, qui se moque de tous les canons esthétiques de l’écriture. Pas une phrase bien tournée, ainsi, dans ces romans, ni la moine illusion d’harmonie, en apparence tout au moins.
Cependant, contrairement à ce que laisse entendre la fameuse perfidie de Gombrowicz pointant « un graphomane de génie », nous ne voyons pas un mot de trop dans ce flux monstrueux, pas une phrase qui ne signifie dans cette espèce de concert total évoquant un tourbillon de Szymanowski dans une tempête de Chostakovitch.
En pénétrant dans l’oeuvre de Witkacy, on a l’impression de se plonger dans une sorte de labyrinthe organique polymorphe où chacun reconnaît bientôt, non sans étonnement physique et psychique, les mouvements secrets de son intime personne, retrouvant aussi divers «personnages» de son fonds abyssal.
Ainsi entend-on vociférer le « type du tréfonds », auquel fait écho le chœur des «enchevêtrailles», ces tripes psychiques soudain écorchées par le plus implacable des scalpels.
Witkiewicz, dans ses romans, semble avancer de tous les côtés à la fois. Or ce qui touche au prodige, c’est que, suivant la durée d’un temps purement psychique, tantôt ralenti à l’extrême et tantôt accéléré, la vrai- semblance individualisée des personnages, abordés dans une complète simultanéité, n’est jamais entamée.
Il faut alors noter que, tout comme un Dostoïevksi ou un Shakespeare, Witkacy est à la fois tous ses personnages. Il est Athanase Bazakbal, le héros kafkaïen de L’Adieu à l’automne, dont la présence physique est immédiatement érotisée de manière hyper-plastique, de même qu’il est Héla Bertz, maîtresse démoniaque du précédent dont la superculotte et l’hyperculot émoustillent le formidable abbé Hiéronymus Chicken- Nood, de l’ordre des parallélistes, comme il est aussi le prince androgyne Azalin Tropoudreh, Gaétan Stupitz l’écrivain cynique devenu ponte des Nivellistes, André Lohoyski le décadent bisexuel et cocaïnomane, Zozia la petite fiancée et l’on en passe.
La faculté d’identification de l’écrivain est quasi illimitée, et jamais il ne se trompe de sensation ni de sentiment, par rapport à chaque personnage, mais il sème la plus joyeuse confusion en ce qui concerne les idées et les opinions, mettant un peu de vérité ou de déraison dans chaque bouche.
Ainsi, du détail le plus organique – au point qu’on ressent pour ainsi dire la « pensée » corporelle de chaque personnage – aux grandes synthèses ou aux récapitulations objectives modulées par les inserts en petits caractères de ses INFORMATIONS, pratique-t-il la mise en scène avec une minutie de brodeuse et une furia de génie faustien.
Oui, cet homme que Gombrowicz aimerait faire passer pour un être cruel et froid, névropathe bredouillant qui eût mieux fait de policer sa prose – comme si l’on pouvait dire tout ce que dit Witkacy autrement qu’il ne le dit ! – nous apparaît, au fil de la lecture, comme un hypersensitif capable de tout deviner, de tout déduire et de tout prédire – d’endosser toute souffrance humaine présente ou à venir et d’en désespérer. Le témoignage d’August Zamoyski, au dam de ses détracteurs, ne fait que confirmer ce sentiment.
Roman psychologique d’anticipation, pamphlet, déversoir de toutes les idées de Witkiewicz en matière de philosophie et de religion, mais aussi de politique et d’histoire, de sociologie artistique et de mœurs en mutation, bilan de ses expériences personnelles, éruption de lave verbale dont on est amené à découvrir, sous ses apparences chaotiques, la remar- quable cohérence, L’Inassouvissement, comme l’ultérieur 1984 de George Orwell, ou comme l’antérieur Nous autres d’Evguéni Zamiatine, nous offre la vision spectrale d’une société devenue folle, et, plus encore, nous confronte à une tragédie globale se manifestant aussi bien par le cancer biologique et la crétinisation des foules, que par l’effondrement des édifices conceptuels, en n’omettant ni les transes de l’éthique prostituée à l’utilitaire, non plus que la décadence de l’art et de la littérature.
À ceux qui rêvent d’une littérature par le truchement de laquelle, précisément, l’on pourrait tout dire, Wikiewicz offre un exemple sans pareil.
Utopie pessimiste, L’Inassouvissmeent nous fait assister, à la fin du xxe siècle, aux ultimes soubresauts agitant les élites d’une Pologne incarnant le dernier bastion du libéralisme bourgeois, au milieu d’une Europe entièrement bolchévisée sur laquelle marchent déjà les hordes chinoises. Préparant le terrain des futurs nouveaux maîtres, une secte puissante, au nom de Murti Bing, diffuse partout sa mystique de bazar, laquelle s’ingère pour ainsi dire : une petite pilule, en effet, et vous voici accédant à la pleine harmonie (plus d’un demi-siècle avant la secte Moon et le New Age !), prêt à servir le régime politique au pouvoir.
L’Europe en décadence, dont sont épinglés tous les types de politiciens ou d’affairistes opportunistes, d’intellectuels ou d’artistes, sans parler des masses réduites à des troupes de consommateurs n’aspirant plus qu’à un somnambulique bien-être, constitue donc l’arrière-fond de cette vaste symphonie catastrophistes aux personnages à la fois extravagants et significatifs, bientôt emportés dans le chaos…
***
41. L’empathie lancinante de William Trevor
À propos de Lucy…
Le sentiment mêlé de l’incroyable cruauté, parfois, de la destinée, et de la non moins incroyable capacité de l’être humain à la surmonter, se dégage de la lecture du plus déchirant et du plus beau des romans de l’écrivain irlandais William Trevor, déclaré “le plus grand auteur vivant de nouvelles de langue anglaise” par le New Yorker et qui manqua de peu, avec Lucy, le Booker Prize en novembre 2002.
Encore peu connu des lecteurs de langue française, soutenu par un “petit” éditeur qui s’acharne héroïquement à défendre la qualité plus que la quantité, William Trevor n’en est pas pas moins de ces quelques auteurs contemporains dont on se transmet le nom comme un secret, parce que ses livres échappent au bruit du monde et à la fugacité des modes, tout en nous plongeant au coeur du monde et dans le présent incandescent. Un sentiment profond du tragique et du caractère mystérieux de chaque existence, la perception très aiguë de ce qui lie les destinées individuelles et les drames collectifs, un mélange de lucidité placide et de tendresse imprègnent autant les nouvelles de Trevor, dont le recueil anglais compte plus de mille pages, que ses romans, tel le mémorable En lisant Tourgueniev, évocation poignante et poétique d’une destinée de femme qu’on pourrait dire la parente sensible de la protagoniste de Lucy. Mais ce nouveau roman ne s’en tient pas à la seule destinée de Lucy. De fait, c’est à tous les personnages directement frappés par ce drame apparemment absurde, et si riche de significations, que l’auteur voue son attention compassionnelle, tous étant à la fois coupables et victimes, responsables à certains égards et innocents.
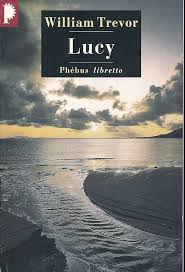
Roman de la fatalité et de la fidélité, de la faute et du pardon, de l’attachement à une terre et de l’exil, de l’amour empêché et de sa sublimation, Lucy entremêle enfin l’histoire d’une femme et celle de l’Irlande contemporaine, du début de l’ère dite “des troubles” à nos jours.
“C’est notre drame, en Irlande, dit l’un des personnages du roman, que pour une raison ou pour une autre nous soyons encore et toujours obligés de fuir ce qui nous est cher”. En l’occurrence, c’est à cause de l’insécurité croissante que le capitaine Everard Gault, rescapé de la Grande Guerre, et sa femme Héloïse, Anglaise d’origine, décident en 1921 de quitter leur propriété côtière proche de Kilauran, dans le comté “rebelle” de Cork. A l’origine de leur angoisse et de leur décision de s’exiler dans le Sussex: l’empoisonnement de leurs chiens et la tentative nocturne de trois jeunes gens d’incendier leur maison, qui a poussé le capitaine Gault à tirer sur l’un d’eux, le blessant et risquant alors de probables représailles. Le souci des conjoints est évidemment de protéger leur enfant unique, la petite Lucy, agée de presque neuf ans. Or ce qu’ils n’ont pas prévu, c’est que celle-ci, vivant en symbiose avec la nature, se refuse absolument de quitter ce coin de terre et de mer. A la veille du départ annoncé, elle disparaît ainsi avec quelques victuailles, sans s’imaginer du tout qu’elle scelle son malheur et celui des siens. De fait, ceux-ci en arrivent à se convaincre, après des semaines de recherches, que la petite s’est noyée, comme le leur suggère un unique vêtement retrouvé dans les rochers. Désespérée, poignée par la culpabilité (elle s’imagine que l’enfant s’est suicidée) et craignant plus que tout d’avoir à identifier un cadavre, la mère de Lucy entraîne alors son mari à une fuite qui les conduit, effaçant toute trace derrière eux, en Suisse puis en Italie. Ce qu’ils ignorent, c’est que Lucy est retrouvée entretemps par le gardien de leur maison, vivante et bientôt gagnée à son tour par un sentiment de culpabilité qui va la poursuivre toute sa vie durant.
Car la vie, désormais, va reprendre dans la séparation. Si invraisemblable que cela paraisse (mais ce ne l’est pas du tout en réalité), Lucy ne reverra jamais sa mère, qui se refuse à tout retour et se réfugie, en Italie, dans le culte de la beauté magnifiée par les peintres. Les années vont ainsi passer, l’approche de la guerre poussera le couple à se replier au Tessin, et la maladie finira par terrasser Héloïse Gault, laissant son compagnon anéanti mais résolu, pour sa part, à revenir au pays. Entretemps, prise en charge par les fermiers Henry et Bridget (lesquels incarnent un autre type de totale fidélité), Lucy a grandi non sans subir l’opprobre de ses camarades et de certains adultes l’estimant “possédée”, puis est devenue la réplique belle et cultivée de sa mère dont elle partage, en outre, le sentiment lancinant d’une faute dont seul le retour de ses parents la délivrera. Ainsi se refuse-t-elle de vivre l’amour que lui offre un jeune homme, et qu’elle partage, s’estimant indigne de tout bonheur avant d’être pardonnée. Un troisième personnage, en outre, est poursuivi par la même hantise de la faute commise, et c’est le dénommé Hoharan, sur lequel le père de Lucy a tiré, que tous considèrent comme une victime alors qu’il s’estime le premier coupable, torturé par des rêves et finissant à l’asile.
Développé à fines et douces touches, tout en délicatesse, ce roman de William Trevor nous semble traversé, en dépit de la profonde mélancolie qui l’imprègne, par une lumière indiquée par le prénom même de la protagoniste, en laquelle on peut voir l’émanation ou l’aura d’une âme pure. Or la beauté intérieure et la noblesse de coeur ne se borne pas à ce personnage, qu’on retrouve aussi bien chez sa mère et son père que chez ses parents adoptifs et l’homme dont elle aurait pour faire le bonheur, et jusque chez le pauvre Hoharan qu’elle ira visiter des années durant à l’asile sous le regard perplexe des gens raisonnables. Si le moment des retrouvailles du père et de la fille est particulièrement bouleversant, c’est cependant au fil du temps et de la vie ordinaire, dans l’acceptation progressive et, pour Lucy, dans la pure jubilation qu’elle éprouve à réaliser de belles broderies et à les offrir, que William Trevor module sa propre vision de romancier à la si pénétrante compréhension et au si profond amour.
Wiliam Trevor. Lucy. Traduit de l’anglais (Irlande) par Katia Holmes. Editions Phébus.
***
42. Paul Bowles le médium
En (re)lisant Le scorpion...
C’est un écrivain souvent mal compris que Paul Bowles, paré d’une légende plus ou moins glamour et qui relève au contraire d’une littérature de la surexactitude implacable, comme l’illustrent les nouvelles réunies dans Le scorpion, dont la lecture procure un voluptueux effroi. On croirait y redécouvrir le monde avec les yeux d’un animal ou de quelque primitif. Tout y est comme déplacé par rapport à nos représentations mentales ou morales ; ou plus précisément, tout y est décentré, et ce changement de point de vue nous permet soudain de concevoir, avec un double frisson physique et psychique, l’extrême minceur de la cloison séparant l’état de nature de la civilisation, et le caractère tout relatif de nos convictions les plus profondes. Le sentiment est familier à tout voyageur un tant soit peu attentif, mais en l’occurrence il s’impose au lecteur avec l’intensité trouble de la fascination communiquée, ressortissant à la position même de l’écrivain, qui m’évoque tantôt un oiseau de proie et tantôt un serpent, avec une capacité de se glisser dans chaque peau comme cet esprit migrateur qu’il décrit dans La vallée circulaire.
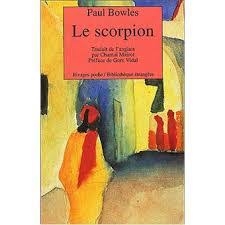
Il y avait de cette objectivité cristalline de vieux lézard altier chez Somerset Maugham, ce même quelque chose de romain et d’impérial (j’entends: de l’empire) qu’on retrouve aussi chez Gore Vidal, et cette même distance qui les sépare tous trois du christianisme. De fait, Bowles paraît complètement étranger à la morale et à la sentimentalité du monde chrétien. C’est un hyper sensitif endurci, avec ce regard implacable de l’enfant qui observe, yeux grand ouverts, les paroissiens en train de prier, ou de l’entomologiste, ou plutôt de la mouche scrutant le monde de son oeil à facettes. Cela étant l’observation de Bowles n’est pas innocente. Ce qui l’arrête (et l’excite et le stimule), ces sont les chocs entre nature et culture, ou bien entre modes de vie hétérogènes, entre civilisations opposées, entre sexes, entre divers ages du même sexe.
Nous nous croyons le centre du monde, mais il suffit de parcourir celui-ci pour que nous soit infligé le plus cinglant démenti. Nous croyons avoir conquis la nature, jusqu’au moment où nous tombons entre les mains du présumé bon sauvage, comme il en va du linguiste candide d’En un pays lointain, qui fait figure de symbole. Ce professeur de linguistique, passionné par les variations de langues du Maghreb, et qui fait collection de jolies petites boîtes en pis de chamelle, bon connaisseur par conséquent de ces régions, néglige cependant, lorsqu’il s’en va, seul et de nuit, négocier auprès des redoutables Reguibat, de tenir compte de tout ce qu’il sait d’eux. Civilisé et pacifique, il imagine qu’il va pouvoir “observer” les pillards de plus près. Bon sujet de thèse, n’est-il pas ? Mais voici qu’il touche terre: qu’on l’assaille dès qu’il a mis le pied dans le ravin des nomades, lui coupe aussitôt la langue et le sangle bientôt dans une armure faite de boîtes de conserves, pour en user désormais comme d’un fou. Et le fait est que, finalement, le prof deviendra bel et bien foldingue. Une scène est prodigieuse, dans la nouvelle: lorsque ce malheureux entièrement assujetti, privé de langage alors que c’était sa raison d’être, rencontre un compatriote au cours d’une escale et l’entend parler anglais sans pouvoir lui faire comprendre qui il est ni ce qu’il est de quelque façon que ce soit. On a rarement mieux suggéré l’horreur de vivre en état d’absolue dépendance…
Une fois encore, au demeurant, la préoccupation de Paul Bowles n’a rien de moral. Simplement il observe. Connaisseur des lieux et des gens, il pratique l’understatement comme personne. Ainsi que le relève Gore Vidal, qui le tient pour l’un des plus grands écrivains américains de l’époque en formes courtes, Bowles “parvient à produire ses effets les plus magistraux quand il concentre entièrement son attention sur la surface des choses”.
Enfin c’est un poète aux pouvoirs d’évocation saisissants, capable de suggérer tout un monde foisonnant et sauvage tout en restant cristallin, net et tranchant, dur et transparent comme le diamant.
Paul Bowles. Le scorpion (nouvelles). Rivages poche.
A lire aussi: L’écho et Un thé sur la montagne. Rivages poche.
***
43. La fuite de Monsieur Mundus
À propos du Train de nuit pour Lisbonne,
de Pascal Mercier.
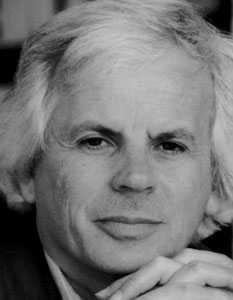
Ce roman démarre en coup de vent comme chez le Simenon des destinées subitement en rupture (dont le premier exemple serait La Fuite de Monsieur Monde), puis on s’immerge à la fois très vite et tout en douceur dans une coulée qui relève d’une autre sorte de poésie existentielle, à la fois enveloppante et cultivée, savante et émouvante, qui évoque le Pereira prétend d’Antonio Tabucchi, et plus encore le Livre de l’intranquillité de Pessoa, d’ailleurs cité dans la foulée…
La fascination pour la langue portugaise, surgie dans la vie du professeur de langues anciennes Raimund Gregorius, surnommé Mundus ou l’Incroyable, à l’occasion d’une péripétie aussi fulgurante que fortuite (une femme qu’il croise sur le pont de Kirchenfeld, à Berne, dont l’intention ambiguë l’a fait se précipiter à son secours), cette fascination née du mot português coulé des lèvres de la femme, et bientôt relancée par la découverte d’un livre dont les phrases l’envoûtent aussitôt, marque la décision soudaine du brave prof, régulier comme une horloge pendant trente ans, de tout plaquer d’un jour à l’autre pour entamer une nouvelle vie.
Il y a de l’extravagance apparente dans ce départ, qui laissera sans doute pantois les collègues du cher homme, mais sa décision est si profondément juste que ses vrais amis (à commencer par l’ophtalmologue philosophe qui apaise sa terreur de perdre la vue) autant que ceux qu’il rencontrera dans le train puis à Lisbonne, que tout va s’enchaîner dans une sorte de logique poétique sans faille, jusqu’au premier rebondissement majeur du roman, devant une tombe du Cimetière des Plaisirs.
C’est là que Gregorius va trouver la première trace tangible de l’auteur du livre qui l’a poussé à apprendre le portugais en une nuit, un certain Amadeu Almeida Prado dont les proses méditatives, largement citées au fil des pages, étincèlent d’une étrange, mélancolique lucidité. Alors s’amorce la vraie entrée en matière de ce roman limpide et prenant…
Pascal Mercier. Train de nuit pour Lisbonne. Traduit de l’allemand par Nicole Casanova. Maren Sell, 490p.
***
44. Un amour dans les décombres
À propos du Semeur de peste de Gesualdo Bufalino
Avec Le semeur de peste, c’est un joyau de la littérature italienne contemporaine qui nous a été révélé en 1985. Et la première occasion de découvrir, en traduction française, le talent, célébré par Leonardo Sciascia, de l’écrivain sicilien Gesualdo Bufalino.
C’est un paradoxe éternel et de partout que la poésie la plus profonde et la plus vraie tire sa substance non du bonheur humain, mais des épreuves et des larmes.
« Oh oui, ce furent des jours malheureux, les plus heureux de ma vie», s’exclame le narrateur du Semeur peste en se remémorant ses 20 ans marqués au double sceau de l’amour et de la mort.
Avoir 20 ans et se retrouver dans le bataillon en pyjama des tuberculeux, tandis que tous fêtent la fin de la guerre, avoir 20 ans et s’enivrer, sous le regard qui en sait trop d’un médecin-sage aux grimaces de vieux singe métaphysicien, des délices empoisonnées de la passion amoureuse: tel fut le sort de de Gesualdo Bufalino qui, quarante après, nous en livre le récit poignant et lyrique, lesté de quelle signification universelle.
Une prison initiatique
L’on pense la fois à Dante et à Puccini, au cinéma italien (du temps où le sang était encore une marque noire sur la chair très blanche) et à Thomas Mann en lisant cet admirable poème romanesque dont chaque chapitre s’imbrique dans une sorte de constellation de fulgurant cristal où l’émotion et le sens, le détail concret et son reflet mystérieux, et chaque signe enfin se doublent de valeur symbolique.
C’est donc l’histoire d’un jeune homme qui découvre soudain, la fin de la guerre, le Minotaure innommable venu hanter sa poitrine, avant qu’il ne se figure qu’il a choisi lui-même ce mal pour nettoyer de son sang les souillures du sang de guerre et guérir, en s’immolant à la place des autres, le désordre du monde.
Plus tard, seulement, lui sera révélé le sens de sa vocation propre, lui qui survivant a « trahi » ses compagnons en leur survivant : non point en martyr, mais d’un témoin par sang d’encre.
Au sanatorium, qui évoque l’antichambre des enfers de la Divine comédie, il apparaît comme un « contrebandier de la vie » dont l’identité se résume à quelques radiographies, dans une forteresse où chacun porte ses chaînes en lui-même et où les actes quotidiens se perpétuent à la lisière du réel, avec accompagnement tragi-comique de rires jaunes.
Au lieu d’un Virgile serein pour guide, il ne trouve que celui qu’on appelle le Grand Maigre, superbe figure de vieux toubib en apparence cynique et blasphémateur, qu’une passion malheureuse et la fréquentation des morts en sursis ont transformé en « archidiable » vitupérant non moins que fraternel.
Avec celui-ci, et auprès de l’aumônier Vittorio, dont la foi est trouée de doutes vertigineux, le narrateur s’interroge sur le mystère du mal dans un monde semblant une immense bévue du Créateur – et l’on se rappelle alors les conversations essentielles de La montagne magique.
Et puis, dans cette même prison-cloître, qui a ses recluses inaccessibles et son théâtre amateur – seul lieu où rencontrer celles-là -, voici que le garçon fait la connaissance de Marta, dont il s’éprend aussitôt.
Sur quoi se noue un lien touchant à la fois au sublime et au dérisoire, entre ces deux orphelins des décombres qui arrachent au crépuscule d’ultimes lambeaux de lumière.
Jusqu’à la mort affreuse de Marta, qui fait songer au dénouement de La Bohême ou de La Traviata, mais sur fond de « sauvage boucherie ».
De mémoire et de temps
Nous l’avons noté, ce n’est qu’au tournant de la soixantaine que Gesualdo Bufalino a publié ce premier livre. Or la réussite exceptionnelle, du point de vue littéraire, du Semeur de peste, doit sans doute beaucoup au filtrage opéré par le temps dans la mémoire de l’auteur, et la capacité de ce dernier, par de multiples références, de transformer un témoignage parmi d’autres en poème riche de mille strates.
Mais ce qui émerveille de surcroît, à la lecture de celui-ci, c’est que l’érudition de l’écrivain se fond tout naturellement dans un creuset bien vivant où la sensualité cohabite avec le tragique, et la connaissance pénétrante avec un lyrisme tantôt somptueux et tantôt déchirant.
Il faut lire et relire Le semeur de peste, qui ne s’épuise certes pas à première lecture. L’on y entre comme dans un labyrinthe, pour affronter les grandes énigmes de la vie humaine sous l’aspect de paraboles vivantes, telle la mort du petit Anselmo, le passé voilé d’obscurité de Marta ou la fable des trois chapeaux citée par le Grand Maigre dans un passage-clé.
Ensuite, lorsqu’on se rappelle ce livre en s’en éloignant, c’est comme d’une vie supplémentaire qu’on aurait vécue dans l’atmosphère physiquement palpable des lendemains de la guerre, cette frontière révélatice où s’interpellent les vivants et les morts.
À relever, enfin, le mérite de Ludmilla Thévenaz, la traductrice, qui est parvenue à restituer la matière verbale, saturée de significations secrètes, et la musique de Bufalino, avec une précision et une justesse rares.
Gesualdo Bufalino. Le semeur de peste. Traduit de l’italien par Ludmilla Thévenaz. Editions L’Age d’Homme, 1985.
***
45.Détresse d’une femme
À propos d’Esprit d’hiver, de Laura Kasischke.
Les romans traitant des aléas quotidiens de la famille Tout-le-monde sont trop souvent plats, voire assommants, qui ressortissent à ce que Céline appelait « la lettre à la petite cousine ». Mais il en va de l’écriture romanesque comme de l’observation des pommes, qui peut s’élever au grand art pour peu qu’un Cézanne y mette du sien.
Or c’est ce qu’on se dit aussi en découvrant les tableaux de la classe moyenne américaine brossés par Laura Kasischke, et plus particulièrement, ces jours, à la lecture de son dernier roman: qu’il y a là du grand art.

Esprit d’hiver est à la fois le portrait en mouvement d’une femme au tournant de la cinquantaine, le récit d’une journée de Noël désastreuse à tous égards, et l’observation clinique, comme sous une terrible loupe, des relations délicates (proches parfois de l’hystérie) entretenues par la protagoniste en question, Holly de son prénom, et sa fille adoptive Tatiana, dite Tatty, âgée de quinze ans et d’origine russe. Le temps du roman se réduit à un seul jour mais avec de constants retours dans le passé proche ou plus lointain, au fil d’une construction d’une parfaite fluidité.
Il y a du thriller psychologique dans ce roman immédiatement captivant, à proportion de la tension angoissée que chaque page relance, autant qu’il y a du poème mêlant hyperréalisme et magies mouvantes, amour exacerbé et sursauts paniques, beauté diaphane et perceptions suraiguës, paranoïa et tendresse.
Holly culpabilise dès le début du roman au motif qu’elle s’est levée trop tard sous l’effet d’un « lendemain d’hier » (elle et son conjoint Eric ont un peu forcé la dose sur l’alcool de la veille au soir) alors qu’elle doit préparer le repas de toute une smala. Pendant qu’Eric est allé chercher ses parents à l’aéroport (cela se passe dans le Michigan familier à la romancière non loin de Detroit), Holly met en route un considérable rôti tout en suivant l’évolution de la météo progressivement plombée par le blizzard. Dès l’apparition de sa fille, en outre, qu’elle exaspère par ses attentions envahissantes de mère aimante, une petite guerre des nerfs s’instaure que l’attente prolongée des hôtes ne cessera d’aiguiser alors même qu’un tout autre drame se prépare, auquel Holly est loin de s’attendre.
Maladivement susceptible en dépit de son volontarisme « libéral », Holly est un personnage insupportable non moins qu’intéressant et attachant. Sensible à la poésie, elle a écrit jadis un recueil mais désespère de trouver jamais un peu de « temps à elle » pour noter ce qu’elle ressent, sans trop se leurrer elle-même à ce propos. Revenant régulièrement sur les circonstances de l’adoption de Tatiana, en Sibérie, elle est aussi marquée, physiquement, par la lourde opération qu’a nécessité une maladie génétique dont plusieurs de ses proches sont morts.
L’étrangeté du roman, autant que sa profondeur aux à-pics vertigineux, tient à la proximité constante de la normalité et de la folie, de l’amour et de la haine, des rôles inversés de l’infantilisme (Holly) et de la lucidité (Tatty), d’un univers rassurant à l’américaine et de tout un monde féerique (la Russie des contes) ou tragique (la Russie des orphelinats), d’un pragmatisme qui se veut optimiste et de la maladie qui rôde.
« Il faut posséder un esprit d’hiver », écrivait le poète Wallace Stevens, que son emploi d’agent d’assurances n’empêchait pas d’écrire, ainsi qu’Eric le rappelle un peu cruellement à Holly pour lui faire valoir que ce ne sont ni ses devoirs de mère ni ses activités de cadre dans une entreprise qui expliquent son « blocage » en matière d’écriture.
Au demeurant, ce « problème » n’est qu’un aspect de la difficulté de vivre ressentie par Holly, que ni sa psy, ni les articles qu’elle a consultés sur Internet, ni les livres qu’elle a commandés par Amazon ne l’ont aidée à résoudre. Par ailleurs, le roman ne se borne pas à l’exposition d’un « cas » frisant certes, parfois, la pathologie. En fait toute femme hypersensible, voire tout homme qui ne soit pas un marteau ou un gnou, devraient pouvoir s’identifier à Holly.
Quant à Tatiana, qui apparaît et disparaît au fur et à mesure que les heures passent, affrontant sa mère pour se défendre quand celle-ci l’infantilise, ou cherchant à la calmer quand elle est proche de délirer (la scène saisissante où Holly cherche à nettoyer son ombre qu’elle croit une tache par terre), elle figure à la fois l’adolescente « comme les autres » et l’incarnation d’une réalité qui résiste aux projections fantasmatiques d’une mère espérant une « fille parfaite » pour mieux gommer une origine très, très, très problématique, renvoyant à la complexité du monde et de la vie.
Les lectrices et les lecteurs (comme on dit poliment les motrices et les moteurs) d’Un oiseau blanc dans le blizzard, de la même Laura Kasischke, retrouveront ici – non sans passer du regard de la fille sur la mère à la configuration inverse -, le mélange de prodigieuse attention au moindre détail concret, et d’intense poésie, qui caractérise le grand art de cette romancière hors pair.
Esprit d’hiver participe, me semble-t-il, de la grande littérature des scrutateurs les plus aigus et les plus tendres du coeur humain. Ce qu’on appelle le quotidien y est transfiguré, et ses personnages y deviennent les messagers de l’humaine ressemblance.
Laura Kasischke. Esprit d’hiver. Traduit de l’anglais par Aurélie Tronchet. Editions Christian Bourgois, 273p. 2013.
***
46. Brisées de Jean Vuilleumier

Dans La rémanence, paru en 1992, Jean Vuilleumier (1934-2012) s’attachait à lire entre les lignes de quelques vies. Une confrontation avec l’érosion de l’existence et son improbable signification.
Les romans de Jean Vuilleumier évoquent admirablement une certaine Suisse engoncée, paisible jusqu’à l’anesthésie et dont les apparences si policées camouflent autant d’abîmes discrets que de désastres estompés.
Avec une sorte d’attention hallucinée au décor dans lequel évoluent ses personnages, le romancier genevois suggère leur météo psychique en se bornant au filtrage extrêmement subtil de leur perception physique. A croire que, dans les romans de Vuilleumier, la difficulté de vivre diffuse à l’état gazeux ou se perçoit sous d’autres formes matérielles, tandis qu’inversement la matière organique, les végétaux, les objets sont porteurs de sensations déterminées, voire de sentiments. Or l’expression de l’écrivain ne cesse de se faire mieux appropriée à son projet.
D’où cette écriture à la fois minutieuse à l’extrême et comme ombrée de mystère, limpide et sourdement astringente, musicale et lancinante, dont la chimie secrète agit finalement à la manière d’un révélateur.
Bilan d’une vie

Après le beau récit de L’effacement paru l’an dernier et qui s’achevait sur une mort «en sourdine», c’est une autre disparition qui marque le bilan de La rémanence.
Bruno vient de mouri du cancer. A son enterrement se retrouvent son ami de jeunesse Romain Fergusson et Nathalie, qui fut successivement l’amante de celui-ci et l’épouse du défunt. Dans les allées du cimetière, pendant l’office funèbre, puis dans la foule des «parents et amis» conviés aux agapes de l’adieu et où il retrouve son ancienne maîtresse, Romain ne cesse d’entremêler ses pensées présentes et les réflexions retrouvées dans le journal qu’il tient depuis une trentaine d’années.
Le récit s’ordonne d’ailleurs, comme rythmé par une respiration pensive, en fonction de cette alternance sans heurts, et néanmoins révélatrice, du récit direct et des pages du journal, qui fait apparaître l’unité intérieure du protagoniste.
Vieil adolescent demeuré, avec ce quelque chose d’orphelin qui lie entre eux tous les personnages de Vuilleumier, Romain est ramené, par la mort de cet ami auquel il s’identifie, à une source dont il perçoit le tressaillement «au plus intime de son ordinaire léthargie». Si le contentement de rester en vie suscite en lui une «pulsion bestiale», c’est avec le sentiment irrémédiable que tout s’amenuise et que tout s’érode qu’il établit ses constats de contemplatif doux-amer. Lui qui pensait, en sa vingtaine d’étudiant boursier séjournant dans un port de la Hanse (où précisément il rencontra Nathalie), que les jeux, alors, étaient déjà faits, paraît avoir toujours vécu un peu à l’écart, jamais aussi à son aise que dans quelque tendre retraite fœtale. Au regard de cet embusqué solitaire, les menées un peu compliquées de l’amour, autant que toute entreprise humaine, paraissent bien dérisoires. Du moins le sentiment de l’inexorable et la souffrance de chacun — l’agonie de Bruno, puis le suicide de Nathalie — ressaisissent- ils sa compassion tandis que revivent doucement, en lui, les images de leur jeunesse commune.
Tissé de résonances qui renvoient le lecteur aux romans précédents de l’auteur (on y entrevoit ainsi tel personnage déjà rencontré), La rémanence illustre à la fois les malentendus qui entachent notre rapport avec le passé, et le caractère aléatoire de toute mise sur l’avenir. Or, pas plus que les autres livres de Jean Vuilleumier, ce dernier roman ne débouche sur le vide ou le nihilisme, aiguisant au contraire notre perception du présent profond, puis stimulant notre aspiration à un temps intérieur plus authentiquement hanté.
Jean Vuilleumier. La rémanence, L’Age d’Homme, 1992.
47. Fulgurances d’un poète
Sur Les Onze de Pierre Michon…
On ne sait trop d’où ça vient ni où ça va, comment ça c’est fait et pourquoi, si c’est plus neuf que Lascaux et en quoi, à quoi ces mots doivent ça et comment on les reçoit étant entendu qu’au commencement c’est à la fin déjà que l’Auteur nous renvoie en citant déjà Les Onze qu’on est censé mondialement connaître, comme on connaît mondialement les événements et les figures fixés par ce grand tableau universellement reconnu et vénéré à la meilleure place du Louvre (au fond à gauche, derrière une vitre blindée genre limousine présidentielle) qui représente THE musée mondial comme Michael Jackson représente THE mondial zombie…
Ce qu’on croit sentir, plus que de le savoir, c’est que la poésie revit ici, dont on sait depuis Cocteau que c’est de la prose qui bouille. Poésie illico surgie et en constant mouvement. À la fois THE film et son making of, THE tableau qu’on a tous en œil et son origine et son développement et les possibles motifs de son projet et de sa réalisation, et ce que nous pouvons dire et faire de cet objet hic et nunc, Monsieur, dit le Cicerone. Et dans un premier tourbillon de phrases on est sorti du bonheur italo-franconien de la France européenne des Lumières, Tiepolo touchant au ciel et y peignant un adorable éphèbe limousin qu’on suppose avoir tapé dans l’œil de Béatrice de Bourgogne, on bondit du jardin ravissant de Rousseau, et trente ans plus tard le même jeune homme ne le sera plus que nous savons retrouver peintre lui-même et pas des moindres puisque l’opinion mondiale le situe quelque part entre Rembrandt et Goya et Van Gogh et Shakespeare (le peintre), mille coudées au-dessus de David et bien sombre comme l’époque, le Tiepolo de la Terreur dira-t-on, mais plutôt caravagesque à ce moment où même Robespierre vacille…
On dit ces jours que la littérature de France, aussi, vacille, et c’est bien triste n’est-ce pas ? Et comme on mélange tout, c’est assez vrai : Il n’y a plus rien. Ou bien on cite quelques copains (HouellebecqDantecRavalec) pour au cas où malgré tout, ou Bergounioux ou Goffette pour faire fin ou Jauffret pour faire dur. Ou bien on se dit que les ProustCélineClaudelColette reviendront sous forme clonée. Ou bien on lit américain ou littérature-monde…
Il y a du vrai dans tout cela mais le triste est que de moins en moins de gens se rappellent les vraies phrases, ni ne voient donc celles, nouvelles, qui surgissent. Je me rappelle par exemple ceci de Cingria : « Ainsi est le cri doux de l’ours dans la brume arctique. Le soleil déchiqueté blasphème. Le chien aboie à théoriques coups de crocs la neige véhémente qui tombe. Les affreuses branches noires s’affaissent. La glace équipolle des fentes en craquements kilométriques. Un vieux couple humain païen se fait du thé sous un petit dôme. Un enfant pleure. C’est le monde ».
Ou bien encore cela : « C’est la forêt. Plus rien qu’un sentier de lune aux cimes des arbres pendant des heures. La demi-forêt. Ces cris, des galops frêles, ces ronflements qui sont probablement des hérissons ou des hermines ou des putois ou des loutres. Mais il y a aussi des êtres humains puisqu’on parle… »
Et des êtres humains continuent de parler dans Les Onze de Pierre Michon : « L’enfant arrêté considère tout cela avec beaucoup d’intérêt, les Limousins noirs, la boue,l’odeur noire ; à peine pense-t-il encore à faire trembler les deux femmes qu’il tient sa disposition. Les voici qui le rejoignent, qui reprennent souffle, qui rient et grondent un peu, le touchent ; la faille crie tout contre lui. S’il les regardait, il verrait que sa mère elle aussi considère tout cela avec beaucoup d’intérêt, l’œil agrandi , les narines ouvertes à l’odeur noire grand, belle, sage et pieuse, mais privée d’homme depuis le départ du père, et les narines passionnément ouvertes à l’odeur noire. François-Elie sans la regarder demande ce que font là ces gens. « Ils refont ce qu’a fait une première fois ton grand-père, dit la mère. Ils font le canal ». Alors l’enfant, avec un grand sérieux et sur un ton d’évidence fâchée :
– Ceux-là ne font rien : ils travaillent ».
C’est qu’en effet il y a faire et faire, et l’artiste casse ici le morceau à titre intuitivement préventif. Sacré petit élitaire de môme pressentant la Qualité qui fera de lui demain un jean-foutre baudelairisant dans les ateliers et les bordels. Et ceux qui se rappellent ce que sont les phrases sont à la fête au fil de ce doux délire comme au soir d’un contrat pour machine de guerre sous forme d’art où le peintre Corentin (de ce beau nom d’un héros vif de notre jeunesse) se retrouve devant cette « scène de théâtre ouverte à deux battants sur l’heure la plus morte de la nuit à loups, la ci-devant nuit des Rois ».
On n’enverra pas, pédanterie désoblige, le message selon lequel les vraies phrases ne sont telles que parce qu’elles sont l’Expression même, messagères d’un sens qui est à la fois rythme de jarrets sur le macadam et forme sculptée dans les diverses dimensions et jazz et fugue et tout le toutim tenu ensemble par une Pensée. Les Onze ont tout cela. Reste à voir comment…
Il faut être un peu suisse, je crois, ou peut-être un peu belge, à la rigueur un peu autrichien (mais sans l’Empire et ses pompes), bref il faut être d’un petit pays ou au contraire d’un immense Empire très mélangé comme celui du Big Will pour apprécier immédiatement l’humour de Pierre Michon dans Les Onze. Mais quand je dis humour c’est au grand sens, que les enfants tristes entendent mieux que quiconque, sur fond de roulement de tambour d’orage dans le galetas du ciel où Dieu fulmine à pas lourd. On a peur avant les mots mais les mots de la peur sont nos premières histoires, bien avant celle qui traîne sa Hache majuscule dans les grands pays. Quant à la Hache majuscule qui a été brandie dans l’histoire de certains petits pays (à commencer par la Suisse déjà sept fois centenaire), son impact est évidemment incomparable avec celui que scellent de grands noms et de grands moments. On a beau rafraîchir certains tableaux anciens à certains moments : ce sera la médiocrité du tableau qu’on verra autant que celle de l’événement, ou alors on se perd dans le symbole (le mythe de Guillaume Tell à toutes les sauces) ou les rixes cantonales ou multinationales (nos mercenaires), mais pour trouver un vrai grand tableau d’Histoire comme celui des Onze il faut se lever aussi tôt qu’Hodler, qui n’avait plus sous la main les acteurs universellement connus (le chauvinisme français lit dans l’avenir) par Corentin fils. Aussi, la Suisse, la Belgique et l’Autriche (surtout actuelle) font peu de cas de leurs poètes. Or disposer en peu de temps de onze littérateurs qui fussent à la fois des tueurs à faire passer pour des héros, permettait une horreur splendide de la carrure des Onze et valait bien aussi les douze pages que consacre Michelet à l’événement. Et puis quoi : la France avait réellement saigné, la France avait réellement noyé son chien divin après l’avoir déclaré pris de rage, la France écrivait une réelle histoire que seules les cousines Bette des petits pays pouvaient trouver outrée et boursouflée de rhétorique. Tout cela que construit et déconstruit le poète avec un lyrisme qui ne sonne, lui, jamais creux puisque le chroniqueur déjanté a les pieds dans le noir de la boue prolétarienne du Limousin et sait d’avance que l’âme collective figurée par les onze littérateurs ratés n’est pas l’émanation du peuple mais un Comité de salut dit public par la langue de bois – non pas onze apôtres mais onze cuistres autoproclamés papes.
J’ai vérifié dans Michelet : hélas les douze pages en question manquent à mon exemplaire, mais peu importe ; peut-être même cela fait-il partie du jeu ? De toute façon les forces, les puissances et les commissaires ne verront jamais le tableau, ni la multitude qui défile au Louvre en courant se pâmer devant le petit jeune homme à sourire androgyne de Léonard, dit Giocondo, autre divin menteur.
« Si un poète demandait à l’Etat le droit d’avoir quelques bourgeois dans son écurie, on serait fort étonné, tandis que si un bourgeois demandait du poète rôti, on le trouverait tout naturel », écrit Baudelaire, que je me suis rappelé en lisant Les Onze, qui raille en somme le rêve de poète rôti du bourgeois.
La peinture d’Histoire est vouée naturellement à l’acclimatation du bourgeois, sauf à se faire peinture-peinture d’avant ou d’après l’Histoire, comme Lascaux ou l’Uccello des batailles immobiles.
Le Tiepolo de la Terreur que figure François-Elie Corentin fait la pige à Girodet et à Delacroix, en peignant Les Onze, comme Balzac fait achever en gloire le chef-d’oeuvre inconnu que Thomas Bernhard appelle sûrement de ses vœux en fulminant de maître en maître ancien pour sauver LA toile absolue, entre Lascaux et le Bacon des papes qui effacent également la référence historique pour devenir l’Histoire. Je sais bien que le poète aligne à peu près sept références à la ligne dans Les Onze, et chiche que le savantasse de service se fera un devoir de relever la pléthore du signifié (je me rappelle un article de Tel Quel qui parlait ainsi de la Comédie de Dante), mais c’est finalement d’un effacement du fait divers qu’il s’agit là, avec ces obscènes pantins lettreux que sont les Comitards travaillés par la même envie de se faire baiser par la Brute que le protagoniste, justement, de L’Envie d’Olécha, figurant par excellence l’intellectuel révolutionnaire (ou le nazi devant l’Athlète) devant le Pouvoir. À celui-ci la seule réponse picturale est celle de Goya ou de Velasquez, pour les grimaces retorses, ou de l’immobilité silencieuse de Rembrandt, d’Uccello et de Corentin fils.
Quant à la question du Douzième, elle est le trou noir éblouissant des Onze que figure celle-là-même du peintre qui a appris de la Terreur que « tout homme est propre à tout ». Vous cherchez le message : il n’y a que le massage de chair et d’ombre et cette lumière qui les traverse et la langue prodigieusement porteuse, patois ou français de l’Île ou babélien de francophonie, etc.
Pierre Michon. Les Onze. Verdier, 136p.
***
48.La troublante beauté du Diable
En marge de l’œuvre poétique majeure de Marina Tsvetaeva, ses proses, tels Le diable est autres récits, nous révèlent un univers poétique d’une fascinante densité.
Aussitôt qu’on pénètre dans le premier des trois récits autobiographiques réunis, ici, c’est pour se trouver replongé dans le climat du tout début du XXe siècle, à Moscou, comme l’ont évoqué déjà un Andrei Biély, dans son génial Kotik Letaev, ou un Ossip Mandelstam dans Le sceau égyptien ou Le bruit du temps.
Comme Biély, Marina Tsvetaeva s’efforce de recomposer la frise de ses souvenirs les plus anciens aux sources mêmes du langage, en ces creusets obscurs où l’esprit enfantin se dissocie du chaos d’avant les mots ; et, à l’instar d’un Mandelstam, elle s’attache à recoller avec son sang, les vertèbres des deux siècles.
Cela étant, la démarche de Tsvetaeva, dans ses proses visant à dire à tout prix l’inexprimable, reste d’une parfaite originalité.
Dès la première phrase du Diable, on a le sentiment d’entrer dans un tableau qui serait à la fois conque musicale, kaléidoscope de vocables ou cinéma du subconscient : «Le Diable vivait en haut, dans la chambre de ma sœur, Valérie, juste en face de l’escalier, une chambre de damas rouge, de satin et de moire, avec un éternel rayon de soleil, oblique et violent, dans lequel tourbillonnait une poussière incessante et presque immobile.
Or, autour de cette figure du Diable à laquelle elle s’est attachée à proportion de la répulsion automatique qu’elle inspire à tout un chacun – et l’écrivain, tout au long d’un destin tragique, prendra toujours fait et cause pour les êtres isolés et faibles, contre la masse – Tsvetaeva élabore tout un réseau d’image et de symboles où l’archétype voisine avec les reliques précieuses de ce que Mandelstam appelait « la secrète Égypte des choses », de sorte que l’on voit simultanément se reconstituer une mythologie personnelle et la chronique d’un temps immolé sur l’autel de la Révolution, avec ses personnages familiers, la patine de ses intérieurs, ses parfums et sa lumière, sa musique jamais oubliée et le contenu disparate de ses tiroirs, bref le « ton » de toute une société disparue.
Non que Tsvetaeva se veuille l’« antiquaire » de quelques Ancien Régime idéalisé. Exilée à Paris en 1932, elle écrira ainsi, contre certain esprit régnant au sein de l’émigration :
« Cessez de célébrer la mémoire
d’un Eden où vous n’avez pas vécu »,
mais bien plutôt parce que là sont les racines de sa vie émotive, de sa culture et de son œuvre poétique.
« Il ne faut rien expliquer à un enfant », écrit Marina Tsvetaeva, « il faut l’ensorceler ». De la même façon l’auteur du Diable parvient à substituer, à la plate logique discursive, une phrase, tout en ellipses et en ruptures, en associations d’images d’une puissance suggestive évoquant les contes de fées, ou en dérives fondées sur l’étymologie, la couleur ou la valeur rythmique des mots, qui associent le lecteur au travail créateur du poète.
Au fil de digressions buissonnantes, nous voyons ainsi son Diable se transformer en avatars successifs, lesquels se rattachent cependant tous à la même sourde inspiration. C’est d’abord un personnage aux yeux « blancs- bleuté » vêtu de sa seule peau grise de dogue, (ou plus exactement de baron balte, de lionne, d’athlète, idéalement, nu), qui offre son inlassable patience et son indifférence à l’enfant. Puis, aux yeux de la lectrice de Pouchkine – à sept ans elle en aura lu les Œuvres complètes –l’image du Diable se confond avec celle de la bibliothèque paternelle, représentant l’Arbre de la connaissance interdit par la mère musicienne. Mais ce sera aussi l’As de pique des jeux de cartes, et, plus encore, le « Schwarze Peter », dont elle se défait avec d’autant plus de délices qu’elle l’aime secrètement. Enfin, c’est l’image, même du poète, isolé et farouche, vivant l’expérience créatrice la plus pure, parce que la plus dense, la plus férocement exacte, la plus profonde aussi – par opposition aux approximations ou aux facilités de la prose, au langage utilitaire et à l’expression impure, entre toutes, du journalisme, que l’écrivain ne se fera pas faute de vitupérer.
Il y a là, cependant, bien plus que l’attitude esthétique. Ou alors, Tsvetaeva l’incarne avec une telle plénitude que toute théorie s’efface à l’instant de la lecture, sous le charme de cette pure poésie, constamment rejaillie comme une source fraîche, scintillante et mystérieuse, tantôt obscure et tantôt cristalline.
Marina Tsvetaeva n’écrit pas comme on parle, relève, Véronique Lossky, la traductrice, dans sa remarquable postface, « elle écrit comme on pense, elle cherche à incarner l’idée au moment de sa naissance, avec toutes les hésitations, parfois aussi toutes les impudeurs qui précèdent sa mise en mots ». Réflexion des mieux venues qui nous fait mieux comprendre la nature de l’espèce d’enchantement dans lequel se poursuit notre lecture.
Comme dans un murmure insistant, et un peu fou, le poète amalgame les visions et les anecdotes, les détails de toute sorte, pour en tirer une synthèse ressortissant à la méditation. Ici, c’est l’enfant, parlant du clavier du piano : « J’aimais qu’à première vue ce fût lisse, et que sous le lisse ce fût profond comme dans l’eau », et nous voici clore les paupières et songer. Ou là, c’est d’un métronome qu’il s’agit : « C’était une maison dans laquelle j’avais moi-même envie d’habiter, jusqu’au jour où le claquement méthodique de ce compteur de temps se trouve associé au tic-tac de la mort et devienne un cercueil habités par la mort »…
Et de même les figures longuement évoquées de sa mère, qui ne parvint à faire de Marina la pianiste qu’elle-même n’avait pu être, et d’un grand-père historien, prennent-t-elles la valeur de mythes.
De l’immobilité énigmatique du Diable au soupir des illusions perdues égrenées au-dessus du gouffre d’un piano ouvert, ou de la lumière paradisiaque des saisons en enfance aux convulsions brisant les vertèbres de l’échine russe (une échelle chromatique elle aussi) Marina Tsvetaeva fait défiler sous nos yeux, les «tableaux vivants» d’une Russie toujours fascinante, dans laquelle s’insère son destin particulier porté par le lyrisme et la révolte.
Marina Tsvetaeva. Le Diable et autres récits. Traduit du russe par Véronique Lossky, Éditions l’Âge d’homme, Classiques slaves, 1979.
49. Pessoa le solitaire innombrable,
ou la complication la plus simple

Présumée innocence. – On dirait qu’on serait un chevrier des hautes terres, là-haut au bord du ciel où tout serait comme au début des temps où l’on chantait dans l’innocence, et ce conditionnel de notre enfance supposée serait le vœu ou plus simplement encore, en deçà de toute intention et appellation: le jeu; et les mots de ce jeu se donneraient comme en dépit voire au défi de la grammaire, l’école dans nos montagnes restant irrégulière quoique vive l’envie d’apprendre les noms des choses et scrupuleux nos instituteurs.
Les mots et les dessins d’enfants sont ce qu’ils sont dans un aléatoire auquel on demande moins qu’à l’esquisse d’un arbre, et ce qu’on appelle innocence relève de la même incertitude et le plus souvent de l’innommable balbutié – et cela bégaie alors comme une strophe d’Alberto Caeiro, ou cela se cherche dans les rues basses de la ville embrumée de mélancolie et l’on est censé se laisser couler au nom de ce qui n’est peut-être que du voulu poétique modulé par le très imprévsible Bernardo Soares…
Actualité de la neige. – Je ne suis ni glaçon ni lézard, pourrait arguer celui qui prétend parler du printenps et de l’automne en sachant de science naturelle ce qui peut en être dit à toute heure du jour et des saisons au jugé de la sensation présente à multiples occurrences temporelles, alors que tel oracle péremptoire affirme que «le plus favorable moment pour parler de l’été qui vient, c’est quand la neige tombe»; mais je dis moi que je suis à l’instant lézard fugace aux murs secs juste vu par le regard éclair du chevrier là-haut entre les pampres, et cela en ce moment précis et nul autre, ou alors en décalage horaire du regard possiblemeent collé au glaçon de la langue si celle-ci se délie à l’évocation d’une banquise passée ou à venir.
Le débat ne s’ouvre pas entre les «ou bien» quand tout fait occurrence à fleur de peau ou par ouï-dire, et comment ne pas conclure qu’à vrai dire qu’importe, ou plus exactement que ce sera le dire qui importe et qui ne se réfléchit pas – qui ne saurait se penser à l’instant du jamais-vu de cette neige et de nulle autre.
Comme un ombre claire. – Parler de désapprobation serait mal préjuger des capacités imaginative du Florentin dont l’ombre lumineuse, loin de s’égarer là par hasard, s’est pointée ce soir dans la Ville Basse, du côté de la Rue de la Douane et jusqu’au port, le long (il l’a lu dans le texte) de « ces longues rues tristes qui longent le port et s’étirent vers l’est », mais on notera que sa fameuse « indifférence royale » se teinte d’ironie quand il relève sans l’écrire – Lunardo jamais n’écrit ce qui touche à l’intime – que cette élection du presque rien, cette façon de donner du galon au néant, cette prétendue modestie du petit employé se flattant en somme de n’être rien, même se conforte en se taxant de rat ou de cancrelat à la Kafka, de manteau de Gogol ou de lambeau sartrien – tels étant les oripeaux, entre tant d’autres, de leur vanité, et l’Athlète se rengorge en douce, mais sans se gausser pour autant, car il y a, fût-il vague et parfois noyé, comme un désir d’artiste chez ce Bernardo Soares à l’imper gris muraille.
Lunardo l’entend encore ressasser : « Aucun désir en nous n’a de raison d’être. Notre attention n’est qu’une absurdité que nous consent notre inertie ailée. Je ne sais de quelles huiles de pénombre est ointe l’idée même de notre corps. La fatigue éprouvée est l’ombre d’une fatigue. Elle nous vient de très loin, tout comme cette idée que notre vie puisse, quelque part, exister », mais ce n’est pas lui qui portera la contradiction à ces litanies que les multiples avatars du terrible Cafard occidental lui opposeront sous tous leurs semblants de masques et de noms, se fiant plus volontiers, en revanche, aux velléités simplistes du gardeur de troupeaux en son refus de penser.
Cependant attention : penser ou ne pas penser ne serait pas, pour autant, l’alternative aux yeux de celui qui tient pour recevable tout ce qui s’offre à ses multiples vues et curiosités, sans impatience ni dédain, dans cette espèce de joie sereine qui va de pair avec le rire parfois, et parfois le sourire.
50. Le temps de la violence
Quand le grand romancier mexicain Carlos Fuentes (1928-2012) achoppait à la violence du monde dans Le Bonheur des familles…

Carlos Fuentes approchait de sa 80e année, fêtée en grande pompe à Mexico, lorsqu’il publia Le Bonheur des familles, qu’on dirait le roman d’un jeune auteur plein de sève et de feu impatient de « casser le morceau ».
En bref, c’est le roman de la famille mexicaine dans tous ses états et ses éclats, en seize récits liés ensemble par les chants heurtés d’un chœur de tous les âges, des filles-mères de la rue aux fils à papa. Débordant l’immense Mexique où cohabite misère et splendeur, créativité et corruption, c’est aussi à toute la famille humaine que s’adresse le grand écrivain.
Le titre original du livre, Toutes les familles heureuses, fleure la dérision en écho ironique à l’exergue de Tolstoï : « Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à sa façon ». En l’occurrence, toutes les « familles heureuses » qu’observe Fuentes sont malheureuses à leur façon, à commencer par celle de Pastor Pagan, qui se demande pourquoi lui seul a jamais été honnête dans l’entreprise dont il vient d’être viré. Même les cinq mille dollars de « bonus » qu’on lui a offerts lui apparaissent comme une incitation à la corruption, « présupposé majeur », au Mexique, « qui règne à tous les niveaux, des membres du gouvernement aux employés, du quincailler au paysan ».
Carlos Fuentes, que son père fouettait pour lui inculquer les bonnes manières, rit jaune en évoquant la femme de Pastor, chanteuse de boléro réfugiée dans son fantasme romantique, Alma leur fille qui vit par procuration en surfant sur internet ou en suivant le dernier épisode d’un reality show, ou enfin le fils Abel, crâne et velléitaire jeune glandeur revenant au bercail en trentenaire vaincu tout semblable à son paternel. Quatre paumés très ordinaires en temps de crise ou, peut-être, de recomposition dans un Mexique restauré, car la vie selon Fuentes est souvent plus forte que l’ordre traditionnel mortifère ou l’anarchie sur fond de drogue: ainsi le père veuf des trois lascars du deuxième récit se réjouit-il finalement de voir son fils aîné, dont il voulait faire un curé par dévotion à sa femme bigote, le « trahir », saluant verre en main son garçon qui a fui le séminaire et pris son destin en main !
Au fils des seize récits de ce Bonheur des familles qui n’a rien d’une série télévisée, Carlos Fuentes traverse toutes les couches de la société mexicaine, du couple gay vieillissant et perdant ses repères à cette mater dolorosa écrivant à l’assassin de sa fille pour lui dire qui était celle-ci, en passant par le Président et son fils ou tel curé péchant les yeux au ciel avec l’Indienne dont il vitupère la souillure… Or alternent, en contrepoint, les voix de ceux qui n’ont pas de mots, au fil d’une suite chorale où le romancier grappille les traits de langage et les rythmes d’aujourd’hui, genre rap parodié…
Un demi-siècle après la parution de La plus limpide région, où il entreprit une première ressaisie romanesque de la nébuleuse humaine-inhumaine de Mexico, Carlos Fuentes ajoute, aux multiples « temps » de son œuvre monumentale (« Mal du Temps » avec Aura, « Temps des Fondations » avec Terra nostra, « Temps politique » avec Le siège de l’aigle, temps autobiographique avec Diane ou la chasseresse solitaire où il exorcise sa passion malheureuse pour Jean Seberg), ce qui pourrait se dire le temps de la violence intime – le roman s’achève aussi bien sur les mots « violence, violence » – et de son exorcisme… Comme si le grand romancier cristallisait, au nom de ses propres enfants disparus – son fils et sa fille sont tous deux morts tragiquement il y a une dizaine d’années -, sa rébellion contre les maux de la destinée.
Carlos Fuentes, Le Bonheur des familles. Traduit de l’espagnol (Mexique) par Céline Zins et Aline Schulman. Gallimard, collection Du Monde entier, 455p.
Simultanément paraît, aux éditions de L’Herne, un passionnant essai sur Don Quichotte, Cervantès ou la critique de la lecture. Un Cahier de l’Herne consacré à Fuentes a paru en 2006.
***
51. Le désir en proie aux vertueux
À propos de Disgrâce, de J.M. Coetzee
Il y a vingt ans de ça, le nom de John Maxwell Coetzee, né en 1940 dans une famille de Boers établie en Afrique du Sud depuis le XVIIIe sièclee, nous fut révélé par un livre magnifique, intitulé Au coeur de ce pays, à l’enseigne éditoriale de ce grand découvreur que fut Maurice Nadeau.
Écrivain d’une totale empathie, chez lequel le «message politique» explicite a toujours été subordonné à un implication humaine et littéraire beaucoup plus profonde et réelle que l’engagement déclaré de maints auteurs, J.M. Coetzee nous revient, après divers romans et récits marquants (tels Michael K, sa vie son temps, couronné par un premier Booker Prize et traduit au Seuil en 1985, En attendant les barbares, en 1987, ou Scènes de la vie d’un jeune garçon, en 1999), avec un roman dévastateur sous son aspect tout ordinaire.
De fait, et par sa forme (narration au présent de l’indicatif, toute claire et nette, en petits chapitres confortables à la lecture) et par son entrée en matière assez décontractée (un prof de littérature plutôt jouisseur qui passe d’une gentille pseudo-Soraya vénale à une de ses étudiantes), le récit des tribulations de David Lurie, connaisseur raffiné de poésie romantique anglaise (Wordsworth et Byron sont ses copilotes) hélas réduit au triste enseignement utilitaire de la «communication» ne semble pas parti pour le bout de la nuit et de l’horreur, qu’il atteindra pourtant, plus proche des chiens martyrisés par des brutes que de ses présumés «frères humains».
Le début de la disgrâce de David, quinquagénaire deux fois divorcé, participe du regain de puritanisme qu’a suscité l’idéologie du «politiquement correct», qui interdit absolument à un enseignant homme de séduire une étudiante femme, même adulte et consentante. Assumant crânement sa responsabilité devant ses collègues (je suis un misérable pêcheur, etc.), le protagoniste refuse cependant de se rouler par terre et d’implorer le pardon de la Femme universelle et des universitaires coincés. David laisse donc tomber son poste et se retrouve chez sa fille, fermière un peu lesbienne et très écolo, en campagne avec ses chiens et ses lapins.
Ce qui s’ensuit, dans un climat rappelant à la fois Faulkner et le terrible Enfant de Dieu de Cormac Mac Carthy, relève à la fois de la réalité sud-africaine dévastée par le ressentiment post-colonial, et de la condition humaine commune aux sociétés disloquées.
Dans le cercle restreint des relations familiales, J.M. Coetzee nous fait ressentir, par le détail, le désastre qu’a été la vie de David Lurie, esthète absolument égoïste qui n’aura vu en sa propre fille qu’une Lolita consommable, avant qu’elle ne devienne une pièce de lard.
Plus largement, dans la sphère des relations sociales entre blancs «moralement concernés» et noirs déclassés plus ou moins contraints à s’émanciper par la bande (le jardinier de la fille de David est éminemment significatif), le roman se charge de sens et déborde, à cet égard, les frontières culturelles, psychologiques ou politiques de l’Afrique du Sud.
Ce qui est en question, dans ce roman, c’est à la fois la disgrâce de l’âge et du savoir, dans une société limitant la jouissance à la jeunesse et à l’ignorance «démocratique». Plus encore, c’est la disgrâce de la «civilisation» contre la loi des «brutes» humiliées, où l’on voit que chacun préfère rester dans son recoin avec ou sans panneaux de discrimination.
Une expression particulièrement déplacée, et même idiote, inadmissible, sur la quatrième de couverture de la traduction française de Disgrâce, parle d’«élégie cynique» à propos de ce roman fondamentalement généreux et fraternel. Bien entendu, on voudrait que la réalité fût moins «cynique». Mais taxer de cynisme un écrivain qui décrit la réalité relève de l’angélisme stupide. J.M. Coetzee nous en sauve pour nous rendre, non plus durs mais plus doux…
J.M.Coetzee. Disgrâce. Traduit de l’anglais par Catherine Lauga du Plessis. Seuil, 251pp.
***
52. Sam ou l’enfance volée
D’une densité émotionnelle et d’une qualité d’écriture hors pair, le premier roman d’Edmond Vullioud, acteur vaudois bien connu, place celui-ci au premier rang de nos écrivains.

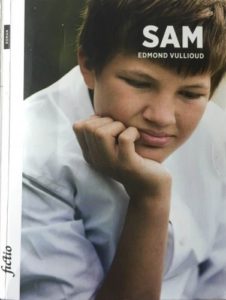
Dans le décor admirablement restitué de nos bourgs calvinistes du début du XXe siècle, l’auteur brosse le portrait infiniment nuancé, tendre et violent, d’un «innocent» humilié de multiples façons et qui se révèle bientôt, par delà ses blessures, un artiste original et un «justicier» impatient de reconquérir son royaume perdu.
Les vraie découvertes littéraires, supposées plus durables que les pléthoriques «coups de cœur» d’un jour, sont aujourd’hui bien rares, et particulièrement en Suisse romande où la foison de livres de second rang disperse l’attention du public autant que de la critique.
En ce qui me concerne en tout cas, je ne saurais citer que deux ou trois titres qui fassent vraiment date, ces dernières années, à commencer par le dernier roman d’Etienne Barilier, Dans Khartoum assiégée (Phébus, 2018), ou, venant de paraître, cet extraordinaire roman d’Edmond Vullioud dont l’originalité du talent s’était déjà déployée dans les nouvelles mémorables du recueil intitulé Les Amours étranges, paru en 2013 à L’Âge d’Homme.
Si je parle d’un roman «extraordinaire», au risque de paraître abuser d’un superlatif, c’est que Sam se distingue à tous égards des romans « ordinaires » à quoi pourraient se rattacher ses thèmes, qu’il s’agisse d’abus sexuel ou de déglingue familiale, d’hypocrisie moralisante ou de préjugés crasses.
Sans doute le jeune Sam, dont l’enfance heureuse de petit prince s’est achevée avec la mort de sa mère, laquelle a provoqué la déchéance alcoolique du père, pourrait-il apparaître comme une victime «ordinaire» depuis que le jeune Thomas, fils du pasteur local, en a fait, dès ses douze ans, l’objet de ses «travaux» sexuels, selon son expression, mais le roman se distingue immédiatement des motifs esthétiques érotico-religieux «à la Chessex» autant que de toute dénonciation explicite de la pédophilie, même si Sam, que son malheur a rendu à peu près muet, souffre de sa sujétion sans oser dire «non» alors que tout crie en lui, faute du moindre amour réel de la part de Thomas. Le môme est «joli» et, n’est-ce pas, c’est un «simple d’esprit» béni par le Seigneur. Le viol récurrent se passe dans un cagibi du temple magnifique dans lequel on entre en traversant le cimetière, après que Thomas a fait courir ses fines mains blanches sur les claviers de l’orgue; et pour accueillir Sam à son retour penaud de l’église, une gifle supplémentaire de son père le marque d’un «coquard» dont les paroissiens charitables s’inquièteront à l’heure du culte. Bientôt l’on s’empressera de soustraire l’adolescent à la garde de l’indigne William en train de laisser son domaine (le plus beau du village) dépérir, pour le confier d’abord au rigide pasteur Nicole et à son épouse Marthe, plus attentionnée mais ignorant tout des liens de son cher fils et de son esclave sexuel, et ensuite à une institution spécialisée où les dons d’artiste de Sam s’épanouiront.
Mais là encore, le roman se distingue de l’ordinaire (et souvent juste) procès fait rétrospectivement aux établissements pour la maltraitance qui y régnait parfois puisque, aussi bien, la bonté et l’intelligence pédagogique offrent un refuge et un terreau fertile aux dons du garçon.
Sam, à vrai dire, n’est ni un roman « historique », ni l’exposé romancé d’un «cas» social ou psychologique, ni moins encore le portrait-charge d’une société donnée, même s’il y a un peu de tout ça dans ce roman où il y aussi de la tendresse poignante à la Dickens, de l’observation méticuleuse et de la grâce verbale d’un Flaubert ou quelque chose des atmosphères oniriques d’une Catherine Colomb dont les titres des romans (Châteaux en enfance ou Le Temps des anges) entrent en consonance évidente avec l’univers d’Edmond Vullioud.
Mais qu’est-ce alors plus précisément que cet étrange roman ?
Le portrait photographique d’un adolescent songeur au doux visage et au regard tout intérieur constitue la couverture du roman d’Edouard Vullioud, qui a choisi de représenter ainsi son personnage sous les traits de son propre fils autiste.
Est-ce à dire alors que Sam traite du «problème de l’autisme» à partir du vécu personnel de l’auteur ? Oui, si l’on pense à la souffrance et aux difficultés de relation imposées par cet état de fait, qui leste l’expérience de l’écrivain d’un savoir «extraordinaire » en matière de sentiments, mais la relation père-fils, dans le roman, dépasse ce «cas» particulier pour englober toutes les difficultés de communication vécues que nous connaissons, de même que la légende familiale «réelle» des Vullioud se trouve complètement transposée par le roman.
La douceur de Sam, son rapport «extraordinaire» avec les animaux, sa parole rare, mais aussi le regard suraigu qu’il porte sur la réalité, et son tenace esprit de vengeance, découlent bel et bien de l’expérience à la fois douloureuse et très riche vécue par Edmond Vullioud et son fils, autant qu’il se rapporte à la saga d’une tribu vaudoise portée, comme souvent les dynasties terriennes, aux embrouilles et à la vindicte.
Dans le roman, il est question de deux vieilles sœurs enfermées par leur famille dont on dit qu’elles ont perdu la boule à la suite d’un chagrin d’amour, et l’auteur, qui a transformé le nom de Vufflens-la-Ville en Bassens, m’apprend (en aparté…) que les sœurs en question, enfermées derrière des barreaux, ont bel et bien vécu à la fin du XIXe siècle dans la grande demeure toujours appelée le Château, à l’entrée du village vaudois, et que cette maison est l’un des modèles du domaine des Auges dont le père de Sam, William Abel, précipite la chute avant de se retrouver valet humilié et pochard de son frère Auguste, autre personnage tonitruant du roman dont les colères folles renvoient à celles que le comédien lausannois a observées chez un de nos metteurs en scène fameux…
Cela noté pour ramener à l’anecdote bavarde ? Tout au contraire : pour souligner l’immense travail, à la fois méticuleux en diable et porté par le souffle de la poésie, accompli par Edmond Vullioud dans ce premier roman à la fois intimiste par sa «voix» narrative, et picaresque dans ses développements romanesques, lesquels nous rappellent, notamment, les aventures collectives de l’émigration des Suisses en Amérique du Sud, et la différence de couleur entre un mauvais lieu de nos régions (le Mironton de la Pernette) et un lupanar chamarré d’Uruguay.
Ce qu’il y a d’unique dans Sam relève d’une sorte de sublimation rêveuse sur fond de lourde réalité, restituée avec une extrême précision; mais il y a plus, car au souci maniaque de minutie, que l’auteur prête aussi à son protagoniste, s’accorde le don de la candeur et de la puissance créatrice qui fera de Sam un artiste non conventonnel suscitant bien des sarcaasmes (l’incrédulité du notaire conseiller de paroisse Bérard, plouc parfait, ou d’un critique méprisant) mais aussi de bienveillantes attentions – à commencer par celle du peintre en lettres Timoléon Magetti devenu son mentor.
Sam est un livre d’une musicalité et d’une pureté émotionnelle sans faille. Chose rare : sa narration elle-même ressortit à la musique par le truchement du murmure intime que l’Auteur adresse à la fois à son protagoniste, puisque tout le récit est modulé en deuxième personne, et à son Lecteur, dans un rapport qui rappelle le murmure du Narrateur de Proust, mais dans une tonalité tout autre, marquée à la fois, et dès la première page, par un mélange détonant de sensualité (l’évocation de la première nuit d’amour de Sam et de la sauvage Philomène) et de sourde douleur, et par une sorte de basse continue qui détaille les multiples nuances de la pensée du présumé «demeuré».
Or ce taiseux peut se révéler terriblement parlant quand il s’exprime, notamment par le dessin et la peinture, autant que l’ «innocent» fait figure de révélateur dans le monde des bavards et des tricheurs. L’art de Sam lui permet de se réapproprier le monde, et parfois même de soumettre les dominants à son pouvoir, non sans cruauté défensive quasi animale.
Quant à l’art du romancier, il tend à l’épopée d’époque dans la partie du roman intitulé Le bout du monde qui nous emmène vers Paris au temps de la Grande Guerre, les espaces infinis de l’Amérique du Sud où les traces du premier amour de Sam se sont perdues alors qu’il hérite d’un fils (imprévu quoique prévisible…) qui lui survivra après un naufrage apocalyptique…
Requiem pour un paradis perdu
À quoi tient enfin le fait que Sam, qu’on pourrait dire un roman anachronique de tournure selon les codes et conventions actuels, sonne si clair et vif, si neuf en somme et si frais en dépit de sa mélancolie lancinante, et nous ménage des surprises à chaque page, nous reste au cœur comme une musique tendre et belle en dépit des laideurs et des violences du monde ?
Sans doute à la substance humaine dense et vibrante, autant qu’à la dimension onirico-poétique et à la tenue littéraire de ce roman qui peut parler de tout sans jamais flatter ni dévier de sa ligne – en dépit de multiple digressions parfois comiques et de variations d’intensité, voire ici et là de quelques longueurs -, à son style élégant mais jamais trop voyant, à sa dimension affective hypersensible mais non sentimentale qui nous attache à Sam jusque dans ses excès de violence compulsive touchant alors au picaresque – et le roman frise alors le conte noir -, enfin à une teneur spirituelle rare aujourd’hui, qui rappelle les «innocents» de Bernanos et de Julien Green, de Faulkner ou de Dostoïevski, à une vision à la fois évangélique d’inspiration et portée par la révolte contre une Création décidément mal fagotée, où l’enfance volée, par delà toute détresse individuelle, revêt le sens universel d’un paradis perdu.
Edmond Vullioud. Sam.Editions BSN Press, 425p. Lausanne, 2019.
***
53.Entre Lucifer et Dionysos
Le Magicien du romancier irlandais Colm Tóibín est d’abord un roman à part entière de cet auteur poreux et puissant, d’une densité limpide sans égale et d’une fabuleuse pénétration psychologique, avant de représenter une ample chronique biographique de Thomas Mann et de sa famille – hautement romanesque elle-même -, de la fin du XIXe siècle à Lübeck (à l’ombre du père sénateur et capitaine d’industrie sans illusions sur sa descendance), aux années 50 où le plus grand écrivain vivant de langue allemande est devenu un symbole de la défense de l’Occident démocratique, antinazi tardif mais implacable, mort en Suisse en 1955 à l’âge de 80 ans, aussi conspué-adulé dans son propre pays qu’honoré-rejeté de par le monde…
Colm Tóibín s’est déjà illustré, dans Le Maître, par une biographie romancée du grand romancier anglo-américain Henry James, dont il a (notamment) mis en lumière un aspect peu connu voire occulté de la personnalité, à savoir son homophilie de célibataire endurci ; et de même s’attache-t-il à celle, plus documentée, d’un Thomas Mann nourrissant diverses passions masculines dès son adolescence et jusque tard dans sa vie, probablement demeurées à peu près platoniques en dépit de l’intensité de leur évocation dans son Journal.
Mais si l’auteur irlandais du Magicien, notoirement gay, se plaît à illustrer cette composante intime rapprochant évidemment l’auteur de La mort à Venise de son protagoniste Gustav von Aschenbach, entre autres projection littéraires de ses fantasmes érotiques – et plus encore de son exaltation d’un fantasmatique « jouvenceau divin » – , cela ne l’empêche pas de rendre justice, dans les grandes largeurs d’une vie où la Littérature reste la maîtresse la plus exigeante de l’écrivain, à un génie littéraire doublé d’un homme fort et fragile à la fois dont l’auteur rend magnifiquement la présence de colosse cravaté à pieds d’argile, autant que celle de l’indomptable et douce Katia, son épouse issue de grande famille juive « assimilée », soutien quotidien et bonne fée-dragon assurant l’équilibre de ses relations avec le monde et avec leurs terribles enfants dont les deux aînés (Erika et Klaus), outrageusement libres dans leur vie personnelle et politiquement engagés, furent eux aussi des figures emblématiques de la littérature allemande en exil et de l’intelligentsia antinazie de premier rang.
La mise en abyme multiforme d’une vie
Le magicien est un immense roman d’une totale simplicité en apparence, synthèse miraculeuse d’une quantité d’histoires personnelles complexes, sur fond de convulsions historiques marquant l’effondrement d’une certaine Allemagne et la transformation d’une incertaine Europe en deux blocs dont on voit aujourd’hui la persistante fragilité.
Le titre du roman de Colm Toibin évoque la figure du pater familias qui aimait fasciner ses cinq enfants par ses tours d’illusion, quand bien même certains d’entre eux lui reprocheraient plus tard le caractère illusoire de sa présence, ou l’artifice écrasant d’une omniprésence de Commandeur littéraire mondialement reconnu mais parfois bien maladroit à reconnaître les siens en dépit de ses constantes aides financières.
Le roman commence par ce qui pourrait être une nouvelle « nordique » de Thomas Mann lui-même qui s’intitulerait La mort du père, située en 1891 à Lübeck et racontant le double effondrement d’un homme et d’une firme commerciale auréolée de prestige. Peut-on croire Colm Tóibín quand il prête, à Thomas Mann, l’intuition selon laquelle l’entrée dans la famille Mann de Julia la Brésilienne, sa mère enchanteresse, belle et raconteuse d’histoires, qui oppose son rire latino à la sévérité guindées des Luthériens « nordiques », aura marqué le déclin de la dynastie ?
Ce qui est sûr, après le désaveu d’un testament imposant une tutelle à l’épouse et à ses fils aînés, c’est que le rejet paternel, humiliant, va provoquer l’émancipation de l’aîné, Heinrich, qui fera ses premières armes d’écrivain en Italie, bientôt suivi de Thomas dont ses tuteurs tâcheront vainement de faire un sage employé d’assurance. En outre, la mort du père déplacera la famille vers le sud à l’initiative de Julia, à Munich où la bohème artistique fleurit plus généreusement que sur les rivages puritains de la Baltique – et Les frères ennemis pourrait être, alors, une nouvelle de Klaus Mann, futur aîné de Thomas, considérant, en lecteur marxisant, les destins parallèles et souvent opposés de Heinrich, compagnon de route des communistes, et de Thomas l’humaniste incessamment hésitant, d’abord nationaliste et ensuite se ralliant à l’Occident démocratique par dégoût viscéral du nazisme.
Dès sa vingtaine, Thomas Mann va tisser, entre sa vie et ses
écrits, des liens constants et profonds, qui laissent à penser que tout lui fait miel littéraire, et les effets spéculaires se multiplieront avec les livres de son frère et de ses enfants, autant que par les commentaires quotidiens de son Journal sur ce qu’il vit et le roman en chantier.
Ainsi, le premier chef-d’œuvre, qui lui vaudra explicitement le Nobel de littérature en 1929, à savoir la saga familiale des Buddenbrook, constitue-t-il la projection balzacienne, quasiment « d’après nature », de la chute de la maison Mann à Lübeck, avec un jeune Hanno, trop délicat pour vivre longtemps, qui ressemble à la part la plus sensible de l’auteur lui-même. Ensuite, à Munich, dans l’extraordinaire nouvelle intitulé Sang réservé, le futur époux de Katia Pringsheim se servira, non sans énorme culot, de la relation gémellaire liant sa nouvelle amie à son frère Klaus, pour évoquer une relation incestueuse « wagnérienne » d’une sensualité et d’un raffinement proustien, à quoi s’ajoute une dimension symbolique où l’Allemagne et la judéité de sa famille sont clairement impliquées.
À propos du seul prénom de Klaus, l’on relèvera dans la foulée qu’il est à la fois celui du beau-frère de Thomas, de son fils aîné et d’un jeune homme angélique qui comptera beaucoup dans sa vie secrète, dont le personnages de « divin jouvenceau » ressemble évidemment au Tadzio de La Mort à Venise, alors que l’ombre de Gustav Mahler plane également sur la lagune…
De la même façon, comme le montre Colm Tóibín, plus attentif à la vie de Thomas Mann qu’au détail de ses œuvres, celles-ci ne cesseront de se nourrrir de la substance existentielle de l’écrivain et de son entourage, de La Montagne magique (après l’hospitalisation de Katia en Engadine) au Docteur Faustus où les relations de Mann et d’Arnold Schönberg joueront un rôle à la fois épineux et central.
Boutons de culottes et autres détails intimes…
À propos de Schönberg, précisément, Colm Tóibín fait dire à Thomas Mann que ce qui distingue les musiciens des romanciers tient à cela que les premiers en décousent avec Dieu et l’éternité, tandis que les seconds doivent achopper d’abord aux boutons de culottes de leurs divers personnages, autrement dit : au détail, jusqu’à l’intime, de la vie qui va et non seulement aux grands sentiments et autres sublimes idées.
À la hauteur, quant au rayonnement intellectuel et moral, d’un Tolstoï et d’un Romain Rolland, ou d’un André Gide, ses contemporains, Thomas Mann est sans doute le seul grand auteur-intellectuel, des années 30 aux années 50 du XXe siècle, avant et après les crimes du nazisme et la débâcle de l’Allemagne et sa partition, à incarner, en son exil de Californie puis à son retour en Europe, la voix de la liberté et de la démocratie, notamment dans ses innombrables interventions en conférences ou émissions radiophoniques. Proche de Roosevelt, pressenti par certains comme un président de l’Allemagne à venir, il fut adulé par les Américains jusqu’au temps du maccarthysme où on lui supposa des accointances avec le communisme. On n’imagine guère, aujourd’hui, malgré l’influence d’un Sartre ou d’un Soljenitsyne, les attentes qu’a suscité le plus grand écrivain allemand du XXe siècle, et la violence des réactions que ses positions non partisanes ont suscitée, des injures de Brecht aux mesquineries du FBI, notamment. Son retour en Allemagne en 1950, pour célébrer la mémoire de Goethe à Weimar (à l’Est) autant qu’à Francfort, illustre l’indépendance et le courage exceptionnel du vieil homme.
Cela étant, le roman de Colm Tóibín n’a rien d’un « reportage » historico-politique. Son Herr Doktor Mann mondialement connu, romancier fêté dont les ventes considérables lui permettent de bien vivre et d’aider nombre de ses confrères, sans parler de sa famille dont il assure la protection avec l’aide de son épouse – ce patriarche à cigares est aussi un Mister Hyde de désir entretenant, sous le regard ironique de Katia et de ses filles, une espèce de passion obsessionnelle , et qu’il juge lui-même « infantile », pour ce qu’il appelle lui-même le «divin jouvenceau» – tel Jupiter enlevant le mignon Ganymède – dont le dernier avatar sera un gentil serveur du palace Dolder, à Zurich, sur la main duquel le Magicien pose sa patte en croyant atteindre le paradis.
Et puis rien, ou tellement plus que ce rien fantasmagorique: le noyau-vortex du chapitre final de ce roman qui évoque, plus qu’il ne décrit, avec le souvenir revenu de la mère latino dévoilant, à ses enfants, un secret merveilleux dont la lectrice et le lecteur découvriront la nature renvoyant à la beauté d’une œuvre et du monde qui l’a inspirée…
Colm Tóibín. Le Magicien. Grasset. Traduit (admirablement) de l’anglais (Irlande) par Anna Gibson. Grasset, 603p.
***
54. Jean Genet l’irrécupérable
Avec Proust et Céline, Il fut l’un des plus somptueux prosateurs français du XXe siècle. Son centenaire suscita une pléthore d’hommages. Relire ses premiers romans-poèmes, à commencer par Miracle de la rose, est peut-être plus important que toute célébration convenue…

Il faut penser à la pauvre tombe de Jean Genet au moment de rappeler sa pauvre naissance, le 19 décembre 1910. Une humble pierre blanche sous le ciel marocain et face à la mer : telle est la sépulture d’un des plus grands écrivains français du XXe siècle, mort en 1986 comme un vieil errant anonyme dans un couloir de ces hôtels sans étoiles où il ne faisait que passer.
Or ce vagabond fut aussi un génial romancier-poète traduit dans le monde entier, un auteur de théâtre non moins célébré, une véritable « icône » de la contre-culture des années 60-80 qui défendit des causes aussi « indéfendables » que celles des Palestiniens, des Black Panthers, ou des terroristes de la bande à Baader. Paria de naissance, il appliqua cependant, à sa conduite publique, une « logique » incompréhensible en termes strictement idéologique ou politiques. Le vrai Genet est ailleurs que dans la défense de telle ou telle cause : son fil rouge, son « âme » relève du sacré plus que du social, ce qui l’anime ressortit à une soif de pureté et d’absolu qui dépasse les engagements contingents.
Moins « martyr » que ne l’a suggéré Sartre, mais certainement « comédien » plus souvent qu’à son tour, Jean Genet mérite une approche sérieuse, mais lucide aussi, dont la meilleure à ce jour reste la biographie monumentale du romancier américain Edmund White, avant les compléments et démentis révélateurs apportés par Ivan Jablonka dans Les vérités inavouables de Jean Genet.
Quant à l’œuvre, assurément fascinante et paradoxale, elle a fait l’objet d’innombrables études, à commencer par le Saint Genet comédien et martyr de Sartre récemment réédité, entre autres essais, colloques et dossiers, et la célébration du centenaire confine à la pléthore. Puisse-t-on se défendre, cependant, de sanctifier un homme qui ne le demandait sûrement pas, ni de porter aux nues une œuvre, aussi éclatante et variée qu’elle fût, sans en lire vraiment les livres qui la composent.
Pour qui n’aurait rien lu de Jean Genet, rappelons que cinq romans-récits ( Journal du voleur, Miracle de la rose, Notre Dames-des-Fleurs, Pompes funèbres et Querelle de Brest), tous écrits en prison entre 1942 et 1946 par cet autodidacte-voyou, constituent la première œuvre majeure de Genet. Celui-ci, au fil de récits très poétiques jouant sur un mixte d’autobiographie sublimée et de légende dorée canaille peuplée de mauvais garçons, se livre à une sorte de vaste remémoration érotique dans une langue mêlant sordide et sublime. Le culte de l’abjection, un peu comme chez Sade, s’oppose au culte des vertus chrétiennes, avec l’exaltation du vol, de la trahison et de l’homosexualité. Les premières éditions seront d’ailleurs expurgées des passages les plus « hard », dûment rétablis aujourd’hui.
Cette mystique invertie et solipsiste – à l’usage du seul Genet – signale à la fois la vengeance d’un être humilié avec la bénédiction des belles âmes, et la recherche d’un absolu esthétique. Abandonné par sa mère à sept mois, bouclé pendant des années dans un bagne d’enfants, exclu de la norme par sa double nature d’homosexuel et de poète, Genet exorcisa une première fois sa souffrance et son ressentiment dans ce prodigieux jaillissement créateur initial, auquel succéda une période de désespoir et de stérilité. « J’avais écrit en prison. Une fois libre, j’étais perdu ». Et comme pour y ajouter, la monumentale étude de Sartre, où le philosophe accommodait Genet à la sauce de l’existentialisme, du freudisme et du marxisme, faisait l’impasse sur la complexité dostoïevskienne du monde de Genet, trop intelligemment décortiqué et démystifié.
Or un Genet plus profond et confus, et surtout approché dans ses métamorphoses successives, restait à raconter, comme s’y est employé Edmond White dans la reconstitution de cette vie marginale et souvent fuyante, de la Grande Guerre à l’Occupation, puis de la guerre d’Algérie à Mai 68, à quoi l’écrivain participa non sans scepticisme.
Evitant la psychologie à bon marché, Edmund White s’étend en revanche sur l’environnement social dans lequel Genet a passé ses jeunes années. On y découvre que sa mère nourricière, dans le Morvan, le choya passablement, mais que le statut des « culs de Paris » et autres « metteux de feux », enfants abandonnés mal vus a priori, relevait quasiment de la damnation. Les pages consacrées à la colonie agricole de Mettray, combinant le dressage des adolescents et leur exploitation lucrative en dépit du déclin de cette institution « phare », sont d’autant plus frappantes que Genet, dans Miracle de la rose, tend à magnifier cette « maison de supplices » fermée en 1939. « Paradoxalement, dans l’enfer j’ai été heureux », écrira-t-il ainsi.
À propos de la première enfance de Jean Genet, et complétant ou contredisant même les versions de Sartre et Edmund White, mais aussi de Genet lui-même, Ivan Jablonka apporte un nouvel éclairage, dans Les vérités inavouables de Jean Genet (2014), qui rend justice aux premiers parents d’accueil de l’enfant, réellement choyé, et corrige bien d’autres aspects de la légende du présumé maudit, dont les tenants de l’antisémitisme et de la fascination pour Hitler sont également exposés.
De nombreuses autres zones obscures de la vie de Genet ont été éclairées, en outre, notamment liées à une période de six ans à l’armée où le caporal Genet fit probablement tirer sur des civils, aux voyages innombrables en Europe, à la dèche et aux expédients, et l’on en sait plus désormais sur l’immense travail personnel accompli par le semi-analphabète de 20 ans (ses lettres de l’époque sont poignantes de maladresse mais aussi de géniale fraîcheur) pour acquérir un grand savoir littéraire et philosophique et la maîtrise d’une langue sans pareille.
Un personnage à facettes
Selon les témoignages, Jean Genet pouvait se montrer aussi charmant qu’odieux. Dans ses Lettres à Ibis, une jeune amie idéaliste à qui il se confie entre 1933 et 1934, il donne l’image d’un garçon très sensible et assoiffé de tendresse qui a les « larmes aux yeux de n’être pas Valéry » et s’excuse pour ses « anomalies sentimentales ».

Délinquant plutôt minable (même s’il fut menacé de la relégation à vie, ce ne fut que pour des vols de bricoles et de livres…), il ne s’affranchi jamais pour autant de son état de voyou. Ainsi déroba-t-il un dessin de Matisse à Giacometti, dont il disait pourtant que c’était le seul homme qu’il avait jamais admiré – et le sculpteur laisse d’ailleurs de lui un portrait mythique. Mais le brigand était capable, autant que de vilenies, des attentions les plus délicates, et la plupart de ses amis, qu’il trompa ou « jeta » les uns après les autres, lui vouent une tendresse aussi paradoxale que tout son personnage. C’est que, finalement, l’intransigeance furieuse, la folle susceptibilité, les coups de gueule légendaires de cet homme blessé, à la fois conscient de son génie et doutant de tout, trahissaient la fragilité fondamentale d’un enfant blessé à vie et resté vulnérable, sensible enfin à la détresse des plus mal lotis que lui.
Cohabitant avec l’homme de théâtre extraordinairement doué et avec le moraliste contestataire de haut vol, proche à ce double égard de l’artiste-polémiste Pasolini, il y avait enfin en Jean Genet une espèce d’exilé « à perpète ». De là sa défense des humiliés et des offensés, et plus précisément des Palestiniens qui, disait-il, cesseraient de l’intéresser au jour où ils disposeraient d’une terre à eux. Cela étant, même devenu mondialement connu et souvent « récupéré » à son corps défendant, Jean Genet a fui jusqu’au bout toute forme d’acclimatation et continua de mener sa vie de vagabond errant d’un hôtel sans étoiles à l’autre, distribuant ses biens à ses amants et amis, pauvre parmi les pauvres et reposant désormais sous la plus humble pierre blanche du bout du monde, face au ciel et à la mer.
Pour lire Jean Genet
Jean Genet. Journal du voleur, Querelle de Brest, Pompes funèbres. Préface de Philippe Sollers. Gallimard, coll. Biblos 788p.
Jean Genet, Miracle de la rose. Version non expurgée. L’Arbalète, 347p.
Jean Genet. Lettres à Ibis. Gallimard, L’Arbalète 2010, 109p.
Jean Genet. Le condamné à mort. Nouvel enregistrement, combinant chant et récitation, d’Etienne Daho et Jeanne Moreau.
Edmund White. Jean Genet. Avec une chronologie biographique référentielle d’Albert Dichy. Biographies-Gallimard, 1993. 685p.
Jean-Paul Sartre. Saint Genet, comédien et martyr. Gallimard 2010, coll tel, 695p.
Ivan Jablonka. Les vérités inavouables de Jean Genet, Editions du Seuil, Points 2014, 453p.
Image: Jean Genet en 1939. Photo inédite, de la collection Jacques Plainemaison. La tombe de Jean Genet. Portrait de Genet par Giacometti. Genet et Giacometti.
***
55. Un envoûtant théâtre d’ombres
Sur Les écorchés vifs de Nicola Barker.

Wide open. Grand ouvert. Comme l’horizon. Ou comme le vide. Comme un large regard. Comme une plage déserte ou un ciel nocturne sillonné d’autoroutes vrombissantes ou de silencieux satellites. Comme l’entonnoir d’un cœur ou d’une âme. Wide open : tel est le titre anglais de ce livre béant, énigmatique et fascinant.
On traverse Les écorchés vifs comme un grand rêve éveillé que baigne une lumière crépusculaire. Cela commence sur un pont d’autoroute où deux hommes, tous deux prénommés Ronny, se rencontrent sans savoir qu’un lien secret les attache ; puis l’essentiel du roman se déroule sur le bord d’un chenal, en l’île de Sheppey où voisinent une plage de nudistes et une zone de bungalows préfabriqués, des dunes où se terrent des lapins noirs et un élevage biologique de sangliers.
C’est ce « coin désert », ce « paysage lunaire » évoquant les landes désolées de Beckett que hante une étrange humanité de vieux enfants perdus. Il y a là le premier Ronny, fils du malfaisant « grand Ron », du genre ogre pédophile – Ronny qui va devenir Jim lorsque l’autre Ronny (Jim de son vrai nom, squatter errant) s’installera chez lui. Il y a Sara, qui s’occupe de l’élevage de sangliers en l’absence du père, et sa fille Lily, la mal-aimée qu’attire la monstruosité animale, persuadée que «la nature est un véritable tyran ». Il y a Luke le porno-photographe, qui se livre à des jeux étranges à partir d’images de corps morcelés, et plus tard apparaîtra Nathan frère du premier Ronny-Jim, en affaires avec Jim-Ronny, qui s’intéresse à l’obscène message présumé d’un Christ d’Antonello de Messine…
Compliqué tout cela ? Bien plutôt : immergé en de mystérieuses ténèbres, et se dévoilant progressivement comme une trame de roman noir ou comme un drame à la Faulkner, à la fois très physique et diffusant comme des ondes d’inquiétude métaphysique. De fait, et à l’exclusion de toute explication factuelle rassurante, le dénouement de ce roman renvoie le lecteur dans le « monde malade » dont il constitue la projection poétique, tout en offrant une forme de paix à chacun des protagonistes. Au regard de surface, l’univers de Nicola Barker paraît absurde et désaxé. Or cette méditation incarnée sur le Mal aboutit à une forme non lénifiante de pardon.
Qui sont ces personnages ? Que leur est-il arrivé au juste ? D’où viennent-ils et à quoi rime au juste leur existence ? Tous, en l’occurrence, sont marqués par une forme de malédiction, à commencer par les deux Ronny, dont on pourrait penser parfois qu’ils ne forment qu’une personne à deux faces. La figure inquiétante du père de Ronny, violeur d’enfants, dépasse de loin les dimensions de l’anecdote pour étendre son ombre maléfique, qui rejoint celle des pères (absents) des deux jeunes personnages féminins.
Si la filiation est entachée, la représentation de soi n’est pas moins problématique ou faussée, à commencer par l’image de son propre corps (que Sara photographie sous toutes les coutures pour mieux se « révéler », croit-elle) ou celle de l’autre et du groupe, complètement éclatée en ce lieu fantomatique. Plus encore : ces animaux dénaturés, dont la vie sexuelle a sombré dans une confusion totale, ont pour ainsi dire déteint sur leur environnement: voici naître des hybrides étranges qu’on dirait le résultat de manipulations génétiques ; et l’apparition des lapins noirs ou du sanglier géant frappé à mort face à la mer accentue encore le sentiment de déréliction qui émane de ces pages.
Très curieusement cependant, de cet univers apparemment insensé et glacial se dégage une singulière énergie et comme une sombre beauté, avant qu’une réelle compassion ne nous gagne.
S’il y a chez Nicola Barker de la moraliste mystique, avec des à-pics spirituels qui rappellent une Flannery O’Connor, son univers est à la fois plus radical et plus glauque, sa « théologie » moins orthodoxe, sa façon de parler du corps, du sexe, de la douleur et de la solitude, plus violente mais non moins pénétrante.
Nicola Barker. Les écorchés vifs. Traduit de l’anglais par Mimi et Isabelle Perrin. Gallimard, coll. Du monde entier, 429p.
56. Thanks Mister Vidal !
Entretien avec Gore Vidal, à propos de Duluth, à Paris, en 1984.

“Je suis Romain, je suis humain”, pourrait dire le plus cultivé et le moins aligné des auteurs américains du moment, cet affreux Gore Vidal dont je me suis régalé de la charge sulfureuse de Duluth, son dernier roman, et que je redoutais tant de rencontrer que j’en venais à me réjouir de manquer à l’instant notre rendez-vous par sa faute, lorsque, prêt à lever le camp après une heure d’attente, j’ai vu le concierge du Prince de Galles me faire ce grand geste m’annonçant enfin l’arrivée de Mister Morgue…
Je suis humain dit cependant le sourire du grand seigneur à longs tifs argentés, shake hand chaleureux et sourire cajoleur, cent et mille excuses; et je suis Romain pour la prestance d’imperator à l’américaine, tape dans le dos et faites comme chez vous dans mon humble suite.
Présentations, whisky, souples approches et premiers tilts de reconnaissance: notre goût commun pour l’Italie en général et Fellini en particulier qui l’a fait apparaître dans une séquence nocturne de Roma, les romans de James et les nouvelles de Paul Bowles, enfin mes questions roulant sur Duluth dont il m’évoque alors le céleste déclencheur.
“Je me trouvais dans une rue de Rome, un jour, lorsque j’entendis une voix qui me disait: “Duluth, on l’aime ou on la déteste, mais même si on la quitte on ne l’oublie jamais !” Vous conviendrez qu’on ne résiste pas, plus que sainte Jeanne, à une telle suggestion du Ciel”.
A propos de ce roman satirique dont le titre désigne la ville américaine typique où il se passe, par référence évidente au feuilleton Dallas, l’auteur affirme que sa composition l’a beaucoup amusé, notamment par le gorillage des stéréotypes de la culture de masse auquel il se livre.
“Le roman n’a pas manqué d’être conspué par mes détracteurs, qui font leur devoir comme je fais le mien. Ils ont donc aboyé: Calamity Gore ! Il salit la Nation… Mais le public, lui, a plutôt bien marché. Et puis figurez-vous que j’ai eu droit à l’enthousiasme des femmes de la prison de Lima, au Pérou. N’est-ce pas une reconnaissance enviable ?”
Ensuite, évoquant dans la foulée les scènes carabinées des milieux hispaniques de Duluth: “Voyez-vous, cher ami, les Etats-Unis pratiquent une nouvelle forme d’esclavage avec les immigrés. Mexicains, Portoricains, Boat People, tous leur sont bons, qu’il est désormais possible de se procurer à plus bas prix que dans la Rome antique…”.
Comme je lui propose d’en revenir au personnage de Julien l’apostat, auquel il a consacré un livre magistral, Gore Vidal se fait plus sérieux: “Je me suis toujours intéressé aux origines des grands mouvements historiques. Mais saisir le fondement de cette catastrophe qu’a été le christianisme n’impliquait pas le retour au Christ lui-même, qui ne marque pas le vrai début de l’affaire, mais à l’époque de Constantin et à ce personnage fascinant de Julien qui s’oppose à l’hégémonie de la nouvelle religion d’Etat.”
C’est de la même façon, me raconte-t-il, qu’il s’est intéressé à l’origine de son pays avec Burr. “Oui, j’aimerais retracer ainsi toute l’histoire des Etats-Unis comme dans un grand rêve panoramique, mais en restant très près des faits. Mon tout dernier livre est d’ailleurs consacré à Lincoln, ce Bismarck américain qui fut également un écrivain de premier ordre”.
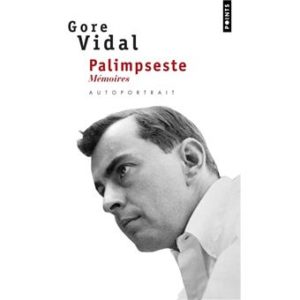
Lorsque je lui demande comment il écrit lui-même, Gore Vidal me répond aimablement: “Mais le plus simplement du monde, un phrase après l’autre, avec grand soin, et j’aimerais qu’on me lise de la même façon. Ou peut-être est-ce trop demander ?”
Ce qui est sûr, c’est qu’il n’apprécie guère plus les pédants que les faiseurs médiatiques: “La critique en est hélas trop souvent là, soit réduite à l’enquête sur la vie sexuelle de l’auteur ou ses préférences animales, soit vouée à la mise en coupe des pions. Se rappelant alors une soirée académique durant laquelle, en présence du grand romancier Frederick Prokosch, un cuistre avait affirmé, pour se rendre intéressant, que la poésie n’avait plus aucun intérêt de nos jours, Gore me décrit Prokosch déclamant alors des stances entières de Virgile, avant que lui-même ne se mette à réciter par coeur le premier Canto de la Comédie de Dante…

“Il y a aux Etats-Unis, reprend-il, une nouvelle espèce littéraire redoutable, et c’est le professeur-qui-écrit, dont le roman n’intéressera jamais que d’autres professeurs rêvant d’écrire. Avec tout le respect dû à l’enseignement vivant ou à l’érudition, cela m’incline à déclarer solennellement que le professorat, avec l’alcoolisme, est le plus grand fléau de la littérature américaine”.
Mais voici que, chancelant la moindre sous l’effet des larges rasades de scotch qu’il m’a resservies aussi généreusement qu’à lui-même, je me trouve contraint, l’heure de départ de mon TGV ne laissant d’approcher, de prendre congé du cher homme. Alors lui de pêcher un bel ananas dans une coupe qu’il y a là et de me l’offrir avec son sourire de vieux charmeur et la plus romaine accolade.
Gore Vidal. Duluth. Julliard/ L’Age d’Homme, 1984.
***
57. Prodiges de Fabrice Pataut
Dans le sillage de Nabokov, le nouvelliste et romancier fait merveille…

Dans son recueil de nouvelles intitulé Un jeudi parfait, Fabrice Pataut déploie la même étincelante originalité qu’on trouve dans les autres très insolites récits et romans de ce magicien de l’imaginaire et du verbe, primé vivant par les Immortels et loué par Alberto Manguel le grand lecteur-découvreur, qui écrit que « le monde de Fabrice Pataut est un monde de prodiges »…
Mea maxima culpa : je n’avais pas lu une ligne de Fabrice Pataut avant le 20 avril 2018 à la première heure du matin lorsque, revenu à l’hôtel parisien La Perle d’une soirée arrosée quoique sans excès anesthésiant, les bras chargés de douze livres que m’avait offerts l’éditeur Pierre-Guillaume de Roux, je commençai de lire Un dimanche parfait dont la première nouvelle, curieusement intitulée Coups de feu et pommes de terre,me saisit illico au collet dès sa première page pour ne pas me lâcher avant de s’achever; et rien d’étonnant à ce tilt-surprise initial pour autant que soit précisé que le début de ce dialogue entre un double meurtrier et une psychothérapeute nous apprend que le premier homicide (plus exactement gynocide) commis, de façon quelque peu involontaire, par le protagoniste, fut d’avoir révolvérisé sa mère à l’âge de trois ans dans un supermarché américain, avant que la sœur aînée du criminel, décidée à en établir l’innocence, dix ans plus tard, ne subisse le même sort au motif qu’un acte ne saurait s’édulcorer par une tierce volonté même bonne…
L’immédiate ironie de cet échange positif et même constructif, comme on dit, entre un meurtrier assumant ses actes et une professionnelle de l’écoute cherchant à en comprendre les motivations, n’a donc pas manqué de piquer ma curiosité au vif, au point que je profitai du confort moelleux des oreillers de La Perle (hôtel de la rue des Canettes dont chacune et chacun se rappelle qu’il fut acquis par la bienveillante Céleste Albaret, gouvernante de Marcel Proust, au lendemain de la mort de son adorable et despotique patron), pour lire les seize autres nouvelles du recueil avant le lever du jour sur les toits avoisinants entre lesquels s’aperçoit le double clocher de l’église de saint Sulpice.
Trois fenêtres ouvertes sur un dédale
La deuxième nouvelle du recueil Un jeudi parfait évoque la punition, de mort, d’un brave homme qui a eu le toupet de toucher, d’un doigt sacrilège, le veau d’or biblique fameux, et Fabrice Pataut rend bien l’ambiance fumigène du paganisme et les rigueurs incessamment révoltantes de l’observance des rites que les intégristes actuels perpétuent un peu partout, mais c’est surtout la troisième nouvelle – qui n’en est pas tout à fait une à l’aveu même de l’auteur -, intitulée Trois fenêtres, à laquelle il faut revenir pour commencer d’entrevoir les diverses lignes de fuite du grand Labyrinthe que constitue l’univers narratif de l’auteur.
Trois fenêtres pour distinguer «la différence entre les vies audacieuses et les vies manquées». La première donne sur un jardin en enfance, à Neuilly, avec la vision héraldique d’un dalmatien et le souvenir d’une protection féminine – cette fenêtre, ouverte sur l’inconnu, qu’on franchissait en douce plus volontiers qu’une porte. La troisième fait face à la forêt de buildings de New York, d’où le narrateur envoie des lettres à une amoureuse, donc avant le trop immédiat SMS.
Et la deuxième ? la plus décisive sans doute en termes de mue existentielle : une fenêtre en la parisienne île Saint-Louis où le studieux étudiant en philosophie reçoit une invite , avec contrat à signer, dans une faculté californienne aux maîtres prestigieux; bascule d’une vie aventureuse pour l’esprit et le jogging, mais vision aussi de la vie manquée, d’un ami tiraillé entre deux genres, ce Michel sensible, compère lycéen qui rendit l’âme (et le corps avec ) dans un train de nuit entre Salamanque et Paris, à l’âge de cueillir les roses…
Or, des fenêtres de cette nouvelle qui-n’en-est-pas-une , comme d’un cristal réfractant, mille rayons se projetteront en autant de lignes thématiques : sur le jeune héros aux multiples avatars et doubles mimétiques, les oscillations affectives et sensuelles, les filiations propres ou figurées, les trous noirs de la grande Histoire dans l’espace-temps de nos vies fugitives ou inversement, l’enfance intransigeante et les transits du cœur – autant de nouvelles à l’obscure clarté et de romans non moins énigmatiques évoquant souvent les détours au terrier d’Alice. Et Nabokov là-dedans ?
Tout un univers à reconquérir
Le lyrisme de Puccini, souvent snobé par les spécialistes, ne vaut-il pas en sensibilité complexe les projections complications admirables d’un Schönberg ? Je ne réponds, pour ma part, qu’en chantant par cœur des airs entiers de La Bohème ou de Tosca, tandis que « réciter » du Schönberg est au-dessus de mes forces, autant que résoudre les problèmes d’échec de Vladimir Nabokov.
Dans Un jeudi parfait, Fabrice Pataut évoque la prétendue opposition/rupture entre Puccini et Schönberg, comme on pourrait l’imaginer entre le roman classique (Balzac. etc,) , le Nouveau Roman et les narrations postmodernes auxquelles d’aucuns rattachent Nabokov.
Or un grand écrivain, comme un grand peintre (Cézanne contre les bôzarts), échappe à ces classifications en sortant par la «porte» de la fenêtre enfantine, et c’est là, dans la clairière de ce qu’on peut appeler la poésie, qu’un Fabrice Pataut rejoint le grand maître facétieux du Montreux-Palace sans chercher jamais à l’imiter, le citant pourrant «en creux» dans le grand roman Reconquêtes.
Parlons alors de Reconquêtes, non sans deux allusions à Aloysius et au chat qui parle, cousin du Tobernory de l’impayable Saki, puis au charmant William du roman Tennis, socquettes et abandon mangeant ses trop beaux habits dans une vertigineuse quête de soi
Il faudrait passer par la ligne « pensée » de Degas, et donc par l’intelligence de Valéry, pour évoquer, plus que raconter, les romans de Fabrice Pataut dont partent ou souvent aboutissent les nouvelles de Pataut Fabrice.
Aloysius(2001) est un diabolique roman minorquin, donc hispano-anglais, qui se situe temporellement à la fin de la guerre d’Espagne. Aloysius est un garçon charmant, surtout charmeur narcissique, mais c’est un faux révélateur, comme Lolita charmante et charmeuse est révélatrice en son charme toc. La lectrice et le lecteur brûlent d’y aller voir. Allez !
Ensuite il y a donc Tennis, socquettes et abandon (2003), deuxième roman : rien à voir avec le précédent, quoique. Comme du génial Feu pâle de Nabokov je dirais de ce roman que c’est une espèce de poème, ici à la jeunesse éperdue, du côté des enfances qui se rêvaient épiques et sont tombées sur l’os des micmacs adultes.
Sur quoi l’on passe (en 2011) à cette grande chose que représente Reconquêtes, extravagante évocation de l’Amérique dont l’hyperréalisme le dispute au rêve éveillé. Il y est question d’une digne dame américaine, dont le contour de la propriété correspond exactement à celui des Etas-Unis, et qui décide d’acheter l’Alaska (donc au nord du « jardin ») à un Russe exilé au prénom de Vladimir (suivez mon regard…) avec la collaboration de deux agents immobiliers amis de jeunesse, à la fois gémeaux et rivaux comme les deux jeunes prostitués de Valet de trèfle et les deux Aloysius (le vrai et le faux) du premier roman éponyme – vous suivez le discours du tour operator ?
On cherchera en vain la moindre allusion directe, dans les nouvelles et les romans de Fabrice Pataut, aux roman et aux nouvelles de Nabokov, même si la malice sardonique de Lolita ou l’innocence incestueuse des jeunes amants d’Ada ou l’ardeur trouvent des échos poétiques dans le roman En haut des marches (Seuil, 2007), évoquant le transit quasi transparent d’un transgenre, et dans maintes dérives sensuelles ou sexuelles.
À ce propos, je ne connais aucun auteur contemporain qui parle, comme Fabrice Pataut, de ce qu’on appelle le sexe ou de ce qu’on dit la politique, et là encore il me semble s’apparenter avec Vladimir Nabokov par sa profondeur mélancolique et sa pénétration de sentiments, sous couvert de constante invention littéraire.
Chacune et chacun, en mal de curiosité documentaire, peut apprendre plus précisément qui est Fabrice Pataut «à la ville» en consultant la notice que Wikipedia lui consacre en toute transparence. Les lecteurs de nouvelles aussi folles que Kipling, sur laquelle s’ouvre le grand recueil intitulé Le cas Perenfeld, ou de romans aussi dingues que Tennis socquettes et abandon, ne manqueront pas de s’étonner du fait que cet écrivain si versé dans l’irrationnel fantaisiste et les fantômes, fantasmes et autre fantasmagories puisant au tréfonds du subconscient, à l’imagination frottée d’affectivité maladive et de poussées oniriques, soit à la fois un très digne chercheur cravaté, spécialiste reconnu dans les sphères académiques pour ses travaux sur la philosophie du langage et des mathématiques.
Or quoi de vraiment étonnant à cela si l’on y réfléchit à deux fois (réfléchissez toujours à deux fois avant de vous tirer une balle ou d’épouser votre directeur de thèse ou votre concierge kosovare ) en se rappelant qu’un Vladimir Nabokov fut à la fois l’interprète éclairé des errances de Nicolas Gogol, l’époux prévenant d’une Russe juive et le plus rigoureux lépidoptériste ?
De même Fabrice Pataut passe-t-il, après chasses et cueillettes un peu foldingues, comme en enfance, au travail minutieux du polissage des petits cailloux de Poucet et à l’établissement de minutieuses nomenclatures.
On ouvre Le Cas Perenfeld pour lire, à la page 329, une Table périodique des thèmes des quarante-cinq nouvelles réunies dans ce grand recueil, dont les titres (Amour, Cannibalisme, Echec, Exil, Frères, Mère et fils, Mode, Perte de temps, Paris, Prostitution, Rituels, Yiddishkeit, etc. ) renvoient à autant de titres de récits, dont l’origine de chacun est décrite en fin de volume…
Or cette espèce de folie littéraire, qui rappelle les inventaires de Perec ou de Cortazar, n’exclut pas ici une sorte de sagesse infuse, qui procède d’une tendresse diffuse, irradiant bonnement une lecture vécue comme une exploration…
Lecture difficile ? Pas plus que celle de Nabokov, mais sûrement exigeante. Rien de froidement cérébral, mais rien non plus de tout cuit ou de pré-mâché. Chaque mot compte, se savoure, interroge et parfois révèle. Ouvrez la fenêtre et c’est là : ce que vous voyez vous regarde !
Fabrice Pataut. Un Jeudi parfait. Nouvelles. Pierre-Guillaume de Roux, 2018.
Autres nouvelles de Fabrice Pataut : Trouvé dans une poche. Buchet-Chastel, 2005, prix de la Nouvelle de l’Académie française ; Le Cas Perenfeld, Pierre-Guillaume de Roux, 2014.
Romans : Aloysius, Buchet Chastel, 2001, réédité au Rocher en 2009 avec une préface d’Alberto Manguel ; Tennis, socquettes et abandon, Buchet-Chastel, 2003 ; En haut des marches, Seuil, 2007 ; Reconquêtes, Pierre-Guillaume de Roux, 2011 ; Valet de trèfle, Pierre-Guillaume de Roux, 2015.
***
58.Frères humains dans la tempête
Retour à Notre-Dame-de-la-Merci, deuxième roman de Quentin Mouron.

Après Au point d’effusion des égouts, premier récit déjà très remarquable, ce nouveau livre creuse plus profond et ressaisit, dans le temps d’une tempête, quelques destinées cabossées avec l’empathie d’un Raymond Carver.

Quentin Mouron m’a étonné, puis il m’a intéressé, dès les pages initiales de son premier roman, Au point d’effusion des égouts. Tout de suite j’ai constaté quelque chose de rare, et particulièrement chez les très jeunes écrivains de notre époque, dans ce texte apparemment imparfait selon les codes académiques, qui tenait à la dramaturgie du récit, à son atmosphère et à son écriture à la fois nerveuse et très précise, curieusement hâchée et frénétique en apparence, mais comme tenue par-dessous, fautive mais voulue telle comme on parle aujourd’hui dans la rue ou par SMS, affirmant en tout cas une voix et une trempe, une tripe particulière et un ton tendrement teigneux. Tout de suite il m’a semblé qu’il y avait là un écrivain pur jus et peut-être d’avenir, non pas à cause des traits immédiatement apparents de son talent hirsute, mais à cause de l’émotion filtrant entre les lignes et les scènes se bousculant de page en page – cette émotion vive découlant d’un certain regard sur le monde et d’un certain sentiment du monde.
Un thème lancinant y apparaît en outre, qui court de page en page et se déploie dans le deuxième livre de Quentin, Notre-Dame-de-la-Merci, pour en devenir le motif central et sombrement rayonnant, qu’on pourrait dire celui de l’amour sans retour.
Or ce qui me frappe aussi, dans la modulation de ce thème, tient au fait qu’il soit quasi pur de toute sentimentalité alors même que sa lancinante évidence « fait mal ». La même fragilité, sous la même apparente crânerie, se retrouve chez le narrateur du premier livre de Quentin et chez les personnages de Notre-Dame-de-la-Merci, qui appellent ici deux ou trois remarques préalables sur le jeune auteur.
Lui aussi semble faire son crâneur, dans sa dégaine de rocker à la coule, blouson de cuir et santiags, illico décontracté, voire un brin canaille, dans ses premières apparitions médiatiques. Tout pour plaire ou déplaire au premier regard, même style flashy que le Philippe Djian des débuts. Mais le vrai Quentin est tout autre derrière ce masque de faux frimeur : un type discret, délicat, éduqué. Un garçon hypersensible mais pudique. Un youngster de son âge avec des intuitions de vieux barde. Le fils d’Isabelle l’instite et de Didier l’artiste, fait au feu et au froid en plein air dans la forêt québecoise, respirant la nature et voyant des tas de gens plus ou moins louches entre le ranch familial d’Appaloosa et plus tard aux quatre coins de la Californie. Question lecture, passé de la lecture de l’intégrale d’Harry Potter à celle de Voyage au bout de la nuit de Céline, de Madame Bovary ou de Kant, des Deux étendards de Rebatet ou des romans de Simenon. À la fois un capteur hypervibrant et un cracheur de mots à fulgurances, rythmant et dopant ses premiers écrits au rock industriel ou aux éclats de John Coltrane. Cela pour la vibration de tam-tam de son écriture, qui dit pourtant autre chose. Par exemple, en confidence publique, qu’ Au point d’effusion des égouts a été écrit pour une fille aimée, qui n’en avait rien à foutre. L’assistance adulte et responsable se gausse : voilà bien du roman-photo sentimental de basse époque. Mais de quoi parle Bovary ? Et si Bovary avait fait des petits dans la forêt québecoise, une nuit de tempête ?
Et si les trois paumés de Notre-Dame-de-la-Merci, comme Bovary est sorti de Flaubert, sortaient des tripes d’un certain Quentin Mouron passant ces jours ses examens de linguistique à la fac de lettres de Lausanne ?
De part en part de Voyage au bout de la nuit, on a mal au monde et aux gens. De la même façon, toutes proportions gardées évidemment, j’ai eu mal en lisant les deux premiers livres de Quentin, avec lequel nous rions le plus souvent. Je ris aussi beaucoup, ces jours, en relisant le Gargantua de Rabelais, qui avait si mal au pauvre monde et aux tristes hommes. Or la tristesse du jeune narrateur d’Au point d’effusion des égouts n’a pas de quoi faire rire en apparence, moins encore la tristesse qui se dégage de Notre-Dame-de-la-Merci aux destinées cabossées, et pourtant la réelle profondeur de Quentin Mouron tient à son terrible humour. Pas tant dans sa satire carabinée d’une certaine Amérique friquée et névrosée, puritaine par obsession et violente par compulsion : bien plus dans la perception panique de la douleur que l’homme s’inflige à lui-même, finalement aussi drôle, au double sens du teme indiquant le comique et l’étrangeté, que les grimaces de la famille Deschiens. Les personnages du premier roman de Quentin sont peu développés, mais la touche est à chaque fois très précise et fait tilt. On voit illico l’oncle flic pédophile sur les bords. On voit la cousine Clara obsédée par le sexe, à proportion de son esseulement, et se réfugiant dans les thérapies à la gomme. On voit la voisine Laura que la non-résolution de sa blessure secrète empêche de se lâcher. On voit l’énergumène bavarois se défoulant à Vegas. On voit les vieux hippies et les vieux tacots du mythe perdu qui n’en impose guère au jeune voyageur. On voit l’affreuse église de Trona ceinturée de barbelés, comme on verra l’église vide de Notre-Dame-de-la-Vertu. On voit partout les débris d’un monde déserté par la grâce, sans un enfant. On voit le champion des buveurs de bière reconnu dans le monde entier par Youtube. On le voit gerber jusqu’en Chine et en Colombie où les gens ont des webcams et pas de travail. Tout explose à Vegas et tout part en couille. À la toute fin, dans le remarquable dernier chepitre intitulé Le banquet, on voit le chœur des adultes responsables autour de la table aux agapes conviviales, genre retour de l’enfant prodigue – retour à la case nains de jardin où l’on est prié de ne pas user de la tondeuse à gazon aux heures de repas – et que feras-tu plus tard, jeune écervelé ?
Cela ne crève pas les yeux au premier regard, mais les deux premiers livres de Quentin Mouron concentrent une somme d’observations sur le monde actuel et l’homme actuel, la solitude et la déréliction des femmes et des hommes d’aujourd’hui, qui saisissent par leur acuité et font mal sans moraliser pour autant ni verser non plus dans l’indifférence blasée ou le cynisme. Ces observations découlent d’une attention au monde et aux gens qui me rappelle l’attention de Tchékhov ou de Simenon, ou encore de Raymond Carver pour l’attention particulière portée par le nouvelliste américain aux « vaincus » de ce Brave New World tout déglingué, ou enfin l’attention exacerbée de Flannery O’Connor àl’égard des humiliés et des offensés – le substrat théologique en moins.
Notre-Dame-de-la-Merci s’ouvre sur l’apparition, dans le froid et la nuit d’une tempête québecoise qu’on va sentir physiquement tout au long du récit, d’un corps de vieil homme pendu. C’est le vieux Pottier dont le suicide est comme un dernier cri lancé aux hommes. Et tout de suite le narrateur, et l’auteur en transparence, accueille et répercute ce cri bientôt mêlé à la clameur des véhéments silencieux. Quentin, qui se tient au coin de l’écran genre Hitchcock, attentif à ces « crieurs muets », remarque que « le cri qu’on étouffe n’est qu’un silence de plus », et ce silence curieusement sera celui, aussi, de la tempête et de la nature enneigée, juste cisaillé de dialogues laconiques. Tout de suite aussi le lecteur est averti : ce qui se passe là pourrait arriver à côté de chez vous. Et de fait, tout aussitôt je me suis rappelé les sept suicides du quartier de petits-bourgeois de notre enfance, sur les hauts de Lausanne où l’on croit que rien ne se passe, et m’est revenue la vision de la maison voisine de la nôtre, vidée un jour de ses étranges habitants noctambules et de son contenu, dont on découvrit dans la cave des milliers de seringues et d’ampoules.
Cela se passe en Amérique mais cet encanaillement du peuple tirant vers la classe moyenne, que figurent les protagonistes de Notre-Dame-de-laMerci, est désormais une constante sociale de partout dans la ville-monde que MacLuhan appelait, avec une sorte de candeur optimiste, le « village planétaire ». Odette, qui aspire au top du pouvoir politique local, est snob comme on peut l’être dans un bled tenant du condominium informel de retraités, mais comment assurer quand on a si mauvais genre ? À un siècle de distance, Odette Swann avait de meilleures chances.
Les trois personnages principaux de Notre-Dame-de-la-Merci n’ont aucune chance, ni en amont ni en aval, sauf d’aller crever d’ennui sur une plage mexicaine. Odette, dont le jules affilié aux Hell’s Angels s’est crashé contre un orignal – même pas une belle mort à la Bonnie & Clyde -, a cru que Jean voulait d’elle après qu’il l’eut sautée, ivre, à la fin d’une soirée. Or Jean n’en avait qu’à son héritage, après quoi il s’est rabattu sur une belle plante dont le vide pouvait juste faire écho au sien. Et dans le vortex de la tempête : voici Daniel, plus fort physiquement que Jean mais plus fragile et plus digne de compassion.
Les cloches de Notre-Dame-de-la-Compassion doivent être noyées dans cette tempête symbolique et hyper-réelle à la fois, comme celles de Kitèje. La seule voix qu’on entend dans la nuit est celle deu narrateur qui rejoint, sur la route où Daniel s’est planté après avoir laissé tomber son dessein de vengeance, cette incarnation pantelante de l’homme rejeté à lui-même. Dès le début du roman le jeune auteur a filé, comme entre les lignes, le thème philosophique du déterminisme et du libre-arbitre. C’était culotté, mais fait avec tant de naturel qu’on l’a admis – comme on admet l’apparition d’Alfred Hitchcok dans ses films pour nous rappeler, précisément, que nous sommes dans un film et qu’on en discutera le contenu à la sortie.
Après la Road-story d’Au point d’effusion des égouts, le deuxième livre de Quentin Mouron, noir et grave mais irradiant une tendresse inquiète, est un roman d’immersion et d’empathie dont l’écriture restitue physiquement l’épaisseur des personnages et l’atmosphère. Dans la triple unité de lieu, de temps et d’action de la tragédie, l’on reste évidemment en deça de celle-ci, faute de dieux et faute de héros –on se rappelle la réflexion de Friedrich Dürrenmatt sur l’impossibilité d’une traédie contemporaine. Daniel aurait pu flinguer Jean : ça n’aurait rien changé. Il faut que tout ça reste un peu médiocre pour être vrai. Il faut que la mère de Daniel, maltraitée par son conjoint alcoolique, soit à la fois attachante et insupportable. On voit les enfants de Daniel traîner dans la saleté pendant qu’il se réfugie dans une pauvre extase : il faut que tout ça fasse « mal » sinin ce n’est pas la peine. Il faut que la fin de la tempête soit à la fois une dévastation et une paix – comme une espèce de pardon.
(Ce texte constitue la postface de Notre-Dame-de-la-Merci, deuxième roman de Quentin Mouron, paru en 2012 aux éditions Olivier Morattel. )
59. Le ferrailleur débonnaire
G,K. Chesterton, relu et magnifié par Gérard Joulié

Chesterton, dont l’énorme derrière cédait la place à trois dames quand il se levait dans l’omnibus, avait le sens du beau et du bien, de la merveille partout présente dans la trompeuse grisaille du monde et du mystère entier de notre existence hors d’une vérité révélée qu’il reconnaissait en paladin chrétien converti au catholicisme; il affirmait «qu’il vaudrait la peine de jeûner quarante jours pour entendre chanter un merle» et, sans exagérer, qu’il vaudra la peine, ce prochain printemps, de « passer par le feu pour voir une primevère ».
Cela n’en faisait pas un chantre de la nature «positivant» béatement pour ne pas voir le Mal courant dans le monde : au contraire c’était un chevalier batailleur tout dévoué à la cause du Bien et du Vrai, sans sacrifier pour autant aux bons sentiments qui n’engagent à rien, ni moins encore discréditer les bonnes choses de la vie.
«Quand presque tous les intellectuels de son temps (et du nôtre, la chanson est la même seulement amplifiée) se mobilisent pour défendre les causes humanitaire, écrit Gérard Joulié, Chesterton dit et redit l’héroïsme des existences ordinaires, le charme de la vie domestique, le tragique des odes, les vertus de l’humilité (car tout comme l’orgueil, elle a aussi les siennes) et du patriotisme, et la puissance de la littérature populaire».
À ce propos, l’inventeur du roman policier «théologique», avec son impayable Père Brown résolvant toutes ses énigmes au moyen de son seul bon sens, était porté autant au fantastique des contes qu’à la stylisation héraldique des légendes.
«Chesterton est tout spontané, son tempérament l’emporte et le domine. Imagination aussi opulente qu’ingénieuse, sensibilité brûlante, puissance du tempérament, verve magnifique de l’esprit, et tout cela nullement livré à soi-même, mais gouverné, dompté, poussé d’un mouvement rectiligne jusqu’aux fins sévères de la discussion et de la démonstration par l’intellect le plus tranquille et le plus fort, tels sont les outils de ce fougueux polémiste ».
Polémiste ? Oui, notamment contre ces grands esprits libéraux de son temps que furent le chantre de l’Empire Rudyard Kipling, le scientiste H.G. Wells et le socialiste George Bernard Shaw.
Gérard Joulié montre très bien aussi ce qui le rapproche et le distingue d’Oscar Wilde le dandy, et pourquoi Charles-Albert Cingria le mystique byzantin en appréciait à la fois l’humour et la folle poésie, ou encore l’énigmatique paradoxe du «cauchemar» romanesque d’Un nommé Jeudi où l’on découvre que le policier et le criminel sont le même homme…
« Il y a des époques où être sage c’est être fou, et Chesterton était ce fou-là », écrit Joulié moult preuves à l’appui (détaillant brièvement diverses œuvres du « fou » en question) et précisant justement que « le combat de Chesterton n’est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances de méchanceté qui bataillent dans les cieux» et que sa rébellion est «l’insurrection de la campagne et de la terre contre la ville et le béton, celle du sang contre l’argent et de la main contre la machine».
L’antimodernisme fringant de Chesterton «lui vaudrait peut-être aujourd’hui une inculpation auprès du Tribunal international de La Haye», persifle encore Gérard Joulié, en concluant qu’«un réactionnaire est toujours un rebelle, un progressiste est toujours un conservateur : il conserve la direction du progrès et va dans le sens du courant»…
Mais encore ? Ceci : «Chesterton, au début du XXe siècle, se définit comme un démocrate anticapitaliste, antilibéral, antiparlementaire, antisocialiste et antimoderniste, dans la mesure où il prévoyait que le progrès technique, scientifique quantifiable, chiffrable, capitalisable et commercialisable allait dévaster la terre et la rendre inhabitable». Surtout, G.K. Chesterton fut un bonhomme poète et prophète qui avait l’élégance humoristique de l’espérance…
Gérard Joulié, Chesterton ou la quête excentrique du centre. Ed. Pierre-Guillaume de Roux, 2017
***
62. À fleur de mémoire
À propos de Tristano meurt d’Antonio Tabucchi…

Le philosophe russe Léon Chestov évoquait, dans Les révélations de la mort, ce moment décisif, dans la vie du jeune Dostoïevski condamné à mort pour menées subversives, où il fut confronté au “mur” ultime avant d’être gracié in extremis.
Or c’est dans une situation comparable, à certains égards, que se trouve le vieux Tristano en ce mois d’août de la dernière année du XXe siècle, dans une maison de campagne de Toscane écrasée de chaleur, au milieu du crissement des cigales, sachant la mort certaine et proche, et non moins convaincu de la nécessité de parler tout en se méfiamt des mots, “l’écriture fausse tout”, dit-il même, et à l’écrivain qu’il a convoqué à son chevet pour se confier à lui, de lancer acerbe “vous les écrivains vous êtes des faussaires”.
Lui-même, considéré comme un héros pour d’anciens faits de résistance qu’il rappellera plus tard, n’est pas moins lucide à son propre égard, et pourtant Tristano va parler.
Sa parole semble d’abord surgir du silence crissant de l’été comme de l’ébluissante nuit d’un autre temps, sous la forme de bribes d’une chansonpopulaire surgie des années 40 et se prolongeqant ensuite par bribes désordonnées, délirantes parfois même à proportion des doses de morphine que lui administre la Frau revêche qui veille sur lui, puis un récit, discontinu mais non moins cohérent, accidenté mais traversé de visions et incessamment pimenté d’humour, va se développer, de plus en plus ample, en suivant les méandres de la mémoire, ressaississant à la fois une vie et toute une époque aussi.
Emprunté à une personnage de Leopardi, le prénom de Tristano rayonne ici de la même sombre lumière filtrant dans la poésie et la pensée du grand poète italien, tout en associant le lecteur à une vertigineuse traversée de ce qu’il est convenu d’appeler “la réalité”. Réalité d’une enfance, d’une adolescence, d’une histoire nationale précipitant les troupes de Mussolini sur la Grèce, réalité de l’acte soudain déviant (mais à un millimètre près) du jeune soldat Tristano tirant sur un “camarade” allemand avant de rallier la Résistance et d’endosser la figure du héros, réalité revisitée après que son interlocuteur muet (qui fut naguère son biographe) l’eut fixée une première fois, et redite cette fois “pour de vrai” (mais qui écrit, sinon celui qui a écouté…), réalité “à la vie à la mort” qui voudrait dire pour l’essentiel une histoire en train d’être prostituée à toutes les sauces par le nouveau monde du dieu “dingodingue” de la société médiatique et berlusconienne.
Tristano se meurt et , pour reprendre le titre d’un autre admirable roman de Tabucchi, “il se fait tard, de plus en plus tard”. Et pourtant la musique des mots, la poésie des images, la chanson alternée de nos amours et de nos idéaux de jeunesse résiste à la corruption – la vive voix de Tristano est là pour en témoigner, et si l’écriture ne rend pas toute la voix de Tristano, du moins l’écriture ressuscite-t-elle en nous la réalité d’une vie transmutée par le verbe…
Antonio Tabucchi. Tristano meurt. Traduit de l’italien par Bernard Comment. Gallimard, coll. “Du monde entier”, 203p.
63.Heureux soit le lecteur heureux
En mémoire de Georges Piroué (1920-2005)

C’est une sorte de forêt enchantée que nous font parcourir les Mémoires d’un lecteur heureux de Georges Piroué, dans laquelle s’appellent et se répondent les innombrables voix d’une conversation à la fois intime et universelle. Peu de livres illustrent, avec autant de minutieuse attention, de marque personnelle et de qualité d’accueil, la merveille que c’est de lire et le malheur que ce serait d’en être privé. On verra dans ces pages quel grand lecteur a été Georges Piroué au fil de sa vie, mais ce n’est pas d’exploits que nous aimerions parler à propos de cet homme discret peu porté à la forfanterie, ainsi qu’il l’explique d’ailleurs tranquillement: “Je confesse volontiers mon respect pour l’exercice réussi de la précision. Penchant que je tiens des enseignements de l’école, de mes origines jurassiennes, de la méticulosité horlogère au sein de laquelle j’ai vécu et peut-être aussi du prosaïsme de ma mère qui m’a inculqué le principe de ne jamais dépasser ni ma pensée, ni ma perception des choses. Toute exaltation de quelque nature qu’elle soit a toujours été pour moi signe de mauvais goût ou de ridicule, menace de danger”.

Cela étant, la passion de lire est d’autant plus vive chez Piroué qu’elle se concentre dans l’attention scrupuleuse et l’écoute réitérée à travers les années.
C’est d’abord comme à tâtons que le lecteur-écrivain (soulignons l’importance immédiate du second terme) nous entraîne dans la selva oscura de sa mémoire confondue à une manière de soupe originelle d’où émergent, de loin en loin, tel visage ou telle silhouette, l’esquisse de tel geste annonçant toute une scène ou l’écho de telle voix préfigurant le développement de trois fois trente-trois chants.
Les premiers paysages et les premières figures entrevus par le rêveur-lecteur (le premier terme ne sera pas moins important que le second) dans sa remémoration d’une réalité fondamentale dégagée des ténèbres par ses premières absorptions, évoquent une lande désolée où des bergers se retrouvent autour d’un feu (et bientôt l’un d’entre eux va peut-être parler, et peut-être un Tourgueniev sera-t-il là aussi pour écouter dans le clair-obscur), et se regroupent alors diverses réminiscences, comme aimantées par l’image initiale.
Une lecture orale, par sa mère, lors d’une de ses maladies d’enfant, a-t-elle ancré au coeur de l’écrivain le souvenir de La Prairie de Biega, des Récits d’un chasseur, auquel est liée la vision nocturne (et quasi préhistorique) d’une tête de cheval, ou bien sa première lecture de la nouvelle, vers l’âge de seize ans, a-t-elle marqué la scène du sceau de sa vision d’adolescent ? Ce qui est sûr, et qui fonde le développement de toute la méditation qui suit, rassemblant d’autres souvenirs de lecture (Stevenson et son âne dans les Cévennes, les bergers de Tchekhov dans La Fortune, puis le chasseur Maupassant, la guerre, la chasse au loup), c’est que la lecture et la mémoire ont travaillé de concert à révéler la véracité (un mot que Piroué semble bien préférer au terme de vérité) de ces motifs à valeur d’archétypes en les éclairant les uns par rapport aux autres pour mieux les faire signifier.
Ce qui émerveille et qui surprend à chaque pas dans ce parcours, c’est la remarquable liberté que Georges Piroué manifeste dans ses rapprochements, dont la pertinence découle de sa propre autobiographie de lecteur. Le voici par exemple, et avec quelle justesse affectueuse, parler de Thoreau, dont on sent que l’hyperréalisme mystique, et la langue parfaitement transparente, conviennent à sa propre nature contemplative et à son esthétique littéraire peu portée au gongorisme. Or la compréhension en profondeur de Thoreau amène Piroué à une mise en rapport lumineuse (“A travers lui Rousseau et Proust se donnent la main”) qui détermine aussitôt une double mise au point: “Avec cette différence que Rousseau n’est parvenu à son état d’ataraxie qu’après s’être obstiné à échapper à la société de son temps par l’utopie politique. Il voulait d’un réel réformé. Avec aussi, concernant Proust, la différence que celui-ci, en aiguisant ses sens, lorgnait du côté de leur utilisation à des fins artistiques. Il voulait d’un réel esthétique. Et tous deux, de manière différente, conservaient, en bons Français, des attaches avec la société, tandis que Thoreau les avait dénouées.”
Quant à notre lecteur, c’est bien plutôt “en bon Suisse” qu’il progresse avec l’absence de préjugés ou de snobisme des ressortissants des petites nations, l’ouverture à toutes les cultures que favorise naturellement notre éducation, la modestie des terriens et la défiance envers toute rhétorique creuse. Mais son vice impuni n’est pas moins d’un lettré européen, qui le fait tutoyer Leopardi (« Giacomo, amico mio ») dans une admirable lettre de reconnaissance, au double sens du terme; éclairer Tolstoï d’une lumière révélatrice, cheminer aussi à l’aise avec Henry James qu’avec Jacques Réda, Peter Handke ou Conrad, en rendant à chacun son dû et sa place.
Nul élan à caractère métaphysique chez ce lecteur-poète qui se confesse “douteur fervent” et dit s’être fait “une religion de l’irréalité narrative”, et pourtant les pages qu’il consacre à Dostoïevski ou à Dante sont d’une pénétration spirituelle rare, de même que tout son livre est traversé par une sorte de douceur évangélique jamais sucrée, qui le porte naturellement vers les humbles et les enfants malheureux chers à son cher Dickens.
L’homme sous le ciel, l’homme à la guerre, l’homme en amour, l’homme et la mer, ou les mères du sud selon Morante, et les Anna, les Emma, les Félicité, Julien Sorel et Lucien Rubempré, notre adolescence Roméo, notre jeunesse Hamlet, notre ultime veillée Lear, tous nos âges, nos travaux, nos grandes espérances, nos lendemains qui déchantent, words words words et salive de Joyce en marée océane, tout cela l’écrivain-lecteur le brasse et le rebrasse sans jamais perdre son fil très personnel.
Or c’est à proportion, justement, de ce que ce livre a de très personnellement impliqué qu’à son tour le lecteur de l’heureux mémorialiste s’immerge dans les eaux profondes de sa mémoire, s’interroge et se met à “écrire les yeux fermés.” Femmes de Keller, orages de Faulkner, paysans déchirés de Ladislas Reymont et notre cher Buzatti à l’étage des cancéreux, Oblomov lu et relu sous toutes les lumières, une Vie de Rancé de plus pour se nettoyer de trop de “carton” contemporain, ou l’autre jour Par les chemins de Marcel Proust d’un certain bon Monsieur Piroué…
Georges Piroué. Mémoires d’un lecteur heureux. L’Age d’Homme, 1998, 380pp.
64. Métèque de Sa Majesté
Hanif Kureishi, ou l’empathie réaliste, des faits à la fiction…

Les drames humains qui affectent la société contemporaine sous l’effet des flux migratoires, des chocs de cultures, des ruptures entre générations, des bouleversements de l’économie ou de l’évolution brutale des moeurs, marquent assez faiblement la littérature française contemporaine, qui ronronne avec la conviction d’être toujours le centre du monde.
Par contraste, les écrivains du «domaine étranger», et notamment sur l’aire des empires déchus ou renaissants, nous paraissent beaucoup plus sérieusement à l’écoute du monde contemporain, et sans doute n’est-ce pas un hasard si ceux-là même qui ont vécu dans leur chair le déracinement et les difficultés de l’assimilation, le racisme ou la xénophobie, nourrissent leurs oeuvres de cette réalité bouillonnante.
Dans le sillage des plus célèbres rejetons de l’ancien Commonwealth en train de revivifier l’anglais à leur façon – tels l’ex-Trinidadien V.S. Naipaul ou l’ex-Bengali Salman Rushdie -, l’ex-«Paki» Hanif Kureishi, né dans le Kent (en 1948) et sorti de King’s College, incarne bien cette capacité à ressaisir, par la fiction, des situations significatives de cette fin de siècle, sans jamais donner dans le simplisme démagogique ou le socio-journalisme.
Les personnages de Kureishi ressemblent assez à ceux de Tchekhov ou de Simenon, tous plus ou moins pris au piège, doucement paumés ou carrément en perdition, mais combien attachants sous le regard fraternel et gouailleur de l’écrivain.
Ainsi du protagoniste d’Intimité, long récit au fil duquel un écrivain de scénarios (tiens tiens) nous détaille, une nuit durant, les mille et une bonnes raisons qui le feront plaquer, promis-juré, et pas plus tard que le matin prochain, son emmerderesse de bonne femme supportée douze ans durant, qui lui a donné deux mômes encombrants comme tout, qu’il a déjà trompée plus souvent qu’à son tour et qui se révèle néanmoins plus attachante au fur et à mesure qu’il la débine. Par aileurs s’accroît la conviction du lecteur que la séparation ne se fera pas, ou, tout au moins, que l’éventuelle échappée du protagoniste n’aboutira qu’à un plus grand empêtrement. Dans la foulée, l’on donnera volontiers son absolution à chaque personnage d’Intimité, tant Kureishi les rend aimables.
Avec une palette plus ample et plus variée, Hanif Kureishi brosse, dans les dix nouvelles rassemblées sous le titre Des Bleus à l’amour, un tableau de la société multiculturelle contemporaine qui serait assez désespérant s’il n’était traversé par le souffle d’une grande tendresse et d’une formidable vitalité, un peu comme il en allait du Snapper de Stephen Frears.
Perdus dans la grande ville, voici les petits immigrés «pakis», la mère et l’enfant souffre-douleur, que persécutent Gros Billy l’ex-teddy boy et son méchant fiston. Alors la mère du gosse de gémir à bout d’argument: «Nous ne sommes pas des juifs !»…
Ou voilà, dans Ta langue au fond de ma gorge, la jeune junkie rejetée par son père – un coq parvenu régnant à Lahore sur sa basse-cour -, et qui accueille, à Londres, sa demi-soeur fascinée par l’Angleterre: deux univers sont alors confrontés en miroir, aussi déglingués l’un que l’autre.
Dans la plus longue des nouvelles du recueil, intitulée Dernièrement et composée sur le modèle du Duel de Tchekhov, Kureishi décrit le monde, à la fois velléitaire, convivial, bavard et pathétique d’un groupe qui évoque les vauriens adorables des Vitelloni de Fellini, rêvant de s’arracher à leur trou et n’en trouvant jamais l’énergie.
Plus obscure et folle, la nouvelle Veilleuse exprime la quête éperdue de vie palpable qu’un homme poursuit dans un rapport strictement charnel avec une inconnue. Plus obscène encore, Le Conte de l’étron figre l’absurdité cocasse de certaines situations où des bribes de convenances lient encore des gens vivant en réalité comme des sauvages.
Telle est d’ailleurs la vertu des écrivains du melting pot: qu’à la manière des enfants mal élevés mais pétris de bon naturel, ou devenus hyperlucides par humiliation (Salman Rushdie en est un autre), ils disent tout haut une vérité peut-être blessante pour Sa Majesté mais intéressante à entendre dans sa modulation vibrante d’humanité.
Devenu célèbre par le truchement du cinéma (il fut le scénariste fêté de Stephen Frears dans My beautiful laundrette et Sammy et Rosie s’envoient en l’air, et deux autres des histoires de son cru ont été adaptées à l’écran: Le Bouddha de banlieue et Mon fils le fanatique), Hanif Kureishi est d’abord et avant tout un écrivain à part entière, conteur et moraliste doux-acide. A travers le prisme de son observation, nous découvrons une réalité qui est celle-là même qui nous entoure, également, ici et maintenant. Un Kureishi saurait ressaisir, à n’en pas douter, la vie triste et joyeuse de vos voisins bosniaques ou celle de votre cousin Paul maniaque de philatélie qui succomba lors du dernier transit astral de certaine secte solaire…
Hanif Kureishi. Des bleus à l’amour. Traduit de l’angais par Géraldine Koff-d’Amico. Christian Bourgois, 326pp.
Intimité. Traduit de l’anglais par Brice Matthieussent. Christian Bourgois, 164pp.
65. La passion de témoigner
À propos de Danse du léopard, de Lieve Joris.

Certains livres nous rendent confiance en l’humanité, et tel est Danse du léopard de Lieve Joris, où il est pourtant question d’un monde en pleine gabegie: le Congo d’après Mobutu. La voyageuse-écrivain y débarque au lendemain de l’arrivée de Kabila et ses rebelles à Kinshasa, onze ans après un séjour très important pour elle qui était, alors, en quête de ses racines congolaises.
« Depuis Mon oncle du Congo, je savais que je retournerais au Zaïre. En 1993, je suis partie au Sénégal voir François, mon premier guide à Kinshasa, pour lui parler de ce retour. Nous avions peur: le Zaïre nous semblait trop dangereux. « Creuse ici », me disait François, « tu verras que c’est aussi l’Afrique ». Ca m’a pris trois ans et le résultat fut Mali blues. Après ça, je n’avais plus de prétexte de ne pas retourner. Je suis partie pour ne plus me sentir lâche. La guerre avait éclaté entre temps à l’Est. Tout était préférable que de voir les Zaïrois comme des étrangers lointains sur mon écran de télé, à Amsterdam ».
Dès les premiers jours qu’elle passe à Kinshasa, Lieve Joris constate trois phénomènes qu’elle aura l’occasion d’observer plus d’une année durant dans toutes les régions qu’elle va parcourir: pillage, règlements de comptes et tribalisme. Après la déroute du régime totalement pourri de Mobutu, l’installation des « libérateurs » donne lieu, dans le chaos propre à ce genre de transition, à des scènes de racket ou de rapine qui impliquent autant les enfants-soldats, dans les rues, que les dignitaires de l’AFDL (l’armée de Kabila) prenant possession des villas de barons mobutistes, tandis que ceux-ci revendent tout ce qu’ils peuvent aux pays voisins.
D’emblée, en outre, Lieve Joris accumule, sans trace de préjugés mais pas toujours sans humeur personnelle, une quantité de témoignages dont l’ensemble va constituer une formidable fresque vivante. Y apparaissent aussitôt Annette la Katangaise, qui tient « à fond » pour Kabila; Izi le haut responsable de la radio-télévision, ascète écoeuré par le régime précédent mais déjà sceptique à l’égard des nouveaux venus; Bondo l’affairiste profiteur en train de négocier son virage, Mukendi le nouveau ministre et sa smalah, ou l’ami Kis passé du journalisme au sectarisme religieux en attendant un poste, fait pour lui à l’en croire, de… premier ministre. Entre beaucoup d’autres !
Avec un mélange très singulier d’intuition sensible et de flair sociologique, toujours attentive au caractère représentatif de ses interlocuteurs, Lieve Joris mêne une enquête en immersion qui passionnera même le lecteur ne sachant à peu près rien (comme c’est le cas du soussigné) du Congo et de ses habitants. Contrairement au journaliste pressé ou au voyageur de surface, elle « fonce » en prenant son temps, s’attache sans s’engluer jamais, et nous donne envie à notre tour de comprendre le drame qui se joue sous ses yeux.
« J’ai voyagé assez instinctivement, suivant les problèmes qui me semblaient pertinents: de la zone d’où venait Mobutu à la zone d’où vient Kabila, en passant par celles où se trouvaient les réfugiés hutu, l’Est où la guerre a commencé, le Katanga où j’ai pu observer l’acharnement et le cynisme de l’équipe Kabila à travers le procès militaire. Le livre couvre une période de 16 mois, mais en réalité j’ai passé beaucoup plus de temps dans la région. Après la guerre de 1998, j’ai voyagé dans plusieurs pays voisins, puis j’ai revisité certains endroits au Congo même – tout ça dans le but de mieux comprendre ce que j’avais observé. »
Tout au long de son voyage, Lieve Joris paraît longer un gouffre. La spirale de la haine qui aboutit au génocide anti-Tutsi de 1994, puis aux massacres de hutu perpétrés jusque dans les camps de réfugiés, continue de sécréter son poison. La défiance envers le Tutsi infecte ainsi la pensée du pur Izi, à Kinshasa, autant que celle du bon père Francesco, qui a vu les massacres de tout près. De la même façon, la morgue du Tutsi, persuadé d’appartenir à une race élue, choque la voyageuse à l’approche de José, de Clément ou de ce pauvre Jean-Jacques avec lequel elle a sympathisé et qui se fait abattre dans la chasse aux Rwandais attisée par Kabila.
Or la valeur exceptionnelle de ce livre, à côté de grandes qualités d’expression (puissance d’évocation, dialogues admirablement filés, art consommé du portrait, lien organique entre le détail révélateur et le tableau d’ensemble) qui l’apparentent à un V.S. Naipaul, en plus chaleureux, tient d’abord à cela: que Lieve Joris n’admette jamais, chez les Congolais pas plus que chez les Blancs, la ségrégation raciste ou la malhonnêteté, la cruauté ou la veulerie.
Sans cesse confrontée à des malins qui se « débrouillent », elle fait certes la part de la misère qui induit, souvent, la ruse ou la mythomanie. Pour la haine tribale fauteuse de guerre, elle se montre en revanche intraitable. Avec un courage imposant, elle ose braver une foule parfois hostile, au procès (ubuesque et bouleversant à la fois) de Lubumbashi, comme elle se risque dans les zones hypersensibles de Kisangani ou de Goma, sur une péniche chargée de réfugiés promis à Dieu sait quel sort (!) ou dans les rues de Kinshasa où la foule brûle vifs les Rwandais – cela enfin sans jamais désespérer!
« J’espère de tout coeur n’avoir pas écrit un livre pessimiste. J’ai du mal à parler de l’Afrique en général. je crois qu’un pays comme le Mali a plus de chance de se développer parce qu’il a des structures pré-coloniales fortes, et parce qu’il n’est pas riche – qu’on le laisse donc tranquille. Le Congo est une invention coloniale, et j’ai parfois l’impression que les Congolais continuent à y vivre comme s’il ne leur appartenait pas. Il appartenait aux belges, puis les Français et les Américains s’en sont emparés, suivis par les Rwandais, les Ougandais, les Zimbabwéens, les Angolais et j’en passe. J’attends le jour où les Congolais se réveilleront, regarderont autour d’eux et diront: tout ceci nous appartient, nous en sommes responsables. Je crois en ce jour, je le vois approcher »…
Lieve Joris. Danse du léopard. Traduit du néerlandais par Danielle Losman. Actes Sud, 489p.
***
66. La Noël du Poète
En pensée vive avec Robert Walser,mort le 25 décembre 1956,
et avec Fleur Jaeggy la vieille enfant de coeur…

Robert Walser et Fleur Jaeggy sont des enfants de cœur dont les écrits candides et cernés d’abîmes nous empêchent de vieillir, gages d’immunité contre la violence du monde et les Noëls de pacotille. Le recueil de brefs récits de la prosatrice italo-suisse, Je suis le frère de XX, est un livre magique d’atmosphère et de style étincelant, qui nous ramène dans la Suisse farouche et pure de Walser tout en ouvrant de plus larges perspectives sur le monde, du Bronx aux camps de la mort…
Des enfants furent les premiers à découvrir ce vieux Monsieur gisant dans la neige face au ciel, et son chapeau tout à côté, en ce jour de Noël de l’an 1956. Quelqu’un prit ensuite une photo, mais probablement le photographe ignorait-il que le type qui gisait là, après une longue virée depuis l’asile psychiatrique d’Herisau, était un poète du nom de Robert Walser qui avait connu la notoriété quelques décennies plus tôt entre Zurich et Berlin, Vienne ou Prague, admiré par ces grandes figures de la littérature européenne qu’étaient Hermann Hesse et Robert Musil, Walter Benjamin ou Franz Kafka – mais quelle importance à ce moment-là ?

L’important, sur fond d’hiver glacial durant lequel nous arriveraient les premiers réfugiés hongrois sauvés de l’enfer communiste (langage de l’époque), reste cette image du poète oublié reposant dans la neige de nos enfances et de l’adolescence d’une blonde jeune fille un peu fée et un peu sorcière dont l’internat où elle avait passé ses plus belles années de rêveuse incarcérée se trouvait dans le même canton que l’asile de Walser, entre Herisau et Teufen, en Appenzell de mélancolique idylle.
Tout en restant attentif à l’espèce de cauchemar éveillé que constitue l’actualité, avec ses pantins semant le chaos sous couvert de grimaces policées, je lisais ces jours le dernier livre de Fleur Jaeggy après avoir relu Les Années bienheureuses du châtiment et L’institut Benjamenta de Robert Walser, découvert il y a bien quarante ans de ça, quand le nom du gisant de l’hiver 56 ressuscitait avant de devenir culte selon l’expression de notre époque d’idolâtrie à la petite semaine.

Or, à chaque page de Fleur Jaeggy je retrouvai quelque chose du génie de Walser, qui m’évoque à la fois une certaine Suisse sauvage, chrétienne et païenne, terrienne et cosmopolite.
La première page des Années bienheureuses du châtiment , premier joyau scintillant de la constellation poétique de Fleur Jaeggy, fait d’ailleurs référence explicite à la mort de Walser dans la neige, et la jeune Fleur, aussi teigneuse que tendrement amoureuse, aura sans doute retrouvé un frère occulte dans le Jakob von Gunten de L’institut Benjamenta,confronté à la même splendide autorité directoriale qu’elle a connue à l’institut Bausler pour jeunes filles riches tenu par le couple classique de la femme capitaine et de son conjoint falot.
Ce qui est important à l’école de la vie
L’enfance selon Robert Walser et Fleur Jaeggy n’a rien de sucré ni de rassurant, pas plus que les contes de Grimm où l’ogre et la fée font partie de l’enchantement. Bernanos opposait justement l’infantilisme et l’esprit d’enfance. Or celui-ci, de tous les âges, tire sa force de sa fragilité. La douleur enfantine est source de bonheur, nous suggère Fleur Jaeggy, et ce n’est pas un paradoxe morbide. De son côté, comme l’a bien vu Kafka, qui l’admirait et le continuait à sa façon, Walser poursuivait l’exploration de la forêt magique, mélange d’émerveillement et de terreur, des contes de Grimm transposés dans la réalité quotidienne où l’enfant est supposé faire l’apprentissage de la vie en distinguant – première leçon -, ce qui est important de ce qui ne l’est pas.
Ce qui est important dans la vie, grosso modo, c’est de réussir. Voilà ce qui est recommandé au petit garçon de huit ans par sa sœur aînée, dans Je suis le frère de XX, alors qu’il a décidé de mourir quand il serait grand. Et c’est le même projet, on dirait aujourd’hui le même plan de carrière, qui est proposé aux pensionnaires de l’institut Benjamenta , imaginé par Robert Walser, et aux jeunes filles de la pension Bausler décrite par Fleur Jaeggy.
Mais la réponse de Jakob von Gunten, double poétique de Walser dans L’institut Benjamenta, est clairement formulée : «À l’idée que je pourrais avoir du succès dans la vie, je suis épouvanté», à quoi il ajoute: «Je me fous du monde d’en haut, car là, en bas, j’ai tout ce dont on a besoin, les beaux vices et les belles vertus, le sel et le pain». Et la narratrice des Années bienheureuses du châtiment, plus portée aux rêveries solitaires sur les alpages cristallins d’Appenzell qu’à la réalisation des ambitions de sa mère, laquelle lui dicte sa conduite dans ses lettres envoyées du Brésil, manifeste la même résistance douce et têtue au drill et au formatage.
Tout cela par molle paresse ou je m’en foutisme anarchisant ? Nullement. Alors pourquoi ? La réponse est la même que donnait Blaise Cendrars quand on lui demandait pourquoi il écrivait: parce que. Parce que j’aime chanter. Parce que j’aime dessiner. Parce que j’aime écrire. Parce que j’aime aimer et que ça m’importe plus que de réussir selon vos codes.
Ainsi Jakob von Gunten envisage-t-il la fortune: « Si j’étais riche, je ne voudrais nullement faire le tour de la terre. Sans doute, ce ne serait déjà pas si mal. Mais je ne vois rien de bien exaltant à connaître l’étranger au vol. Je me refuserais à enrichir mes connaissances, comme on dit. Plutôt que l’espace et la distance, c’est la profondeur, l’âme qui m’attirerait. Examiner ce qui tombe sous le sens, je trouverais cela stimulant. D’ailleurs je ne m’achèterais rien du tout. Je n’acquerrais pas de propriétés. Des vêtements élégants, du linge fin, un haut-de-forme, de modestes boutons de manchettes en or, des souliers vernis pointus, ce serait à peu près tout, et avec cela je me mettrais en route. Pas de maison, pas de jardin, pas de valet. Et je pourrais partir. J’irais me promener dans le brouillard fumant de la rue. L’hiver et son froid mélancolique s’accorderaient merveilleusement avec mes pièces d’or».
Robert Walser considérait le fait d’écrire comme un acte sacré, et de même y a-t-il, dans l’écriture de Fleur Jaeggy, comme une aura de pureté. Mais est-ce à dire, là encore, qu’on flotte dans le vague ou le flou ? Au contraire: la poésie de Walser et de Fleur Jaeggy capte la réalité avec une simplicité et une précision extrêmes. Aussi allergiques l’un que l’autre aux idéologies politiques ou religieuses, ils n’en sont pas moins attentifs au monde, chacun à sa façon..
Des anges dans nos campagnes
Celles et ceux qui ne connaissent pas Robert Walser feraient bien, avant que de lire la première ligne des vingt volumes de son œuvre parue chez le grand éditeur allemand Suhrkamp (dont seule une partie est traduite en français), de consacrer quelques heures à la lecture des Promenades avec Robert Walser publié par son ami et tuteur Carl Seelig, journaliste et éditeur zurichois qui, de l’été 1936 à la Noël 1955, a parcouru avec lui les monts et vaux d’Appenzell, avec moult étapes revigorantes dans les auberges et les cafés de campagne, avant de noter chaque soir les propos tenus par son compagnon aussi vaillant marcheur que passionnant causeur, dont la formidable mémoire et la pertinence des vues sur un peu tout – la guerre, le peuple, le socialisme, les élites prétentieuses, sa propre nullité revendiquée, la vie simple, les best-sellers (déjà !), la famille, sa vénération sans faille pour Gottfried Keller – stupéfie chez un supposé malade mental. Carl Seelig n’avait rien de l’ange ailé, mais c’était le plus zêlé des admirateurs, à qui l’on doit précisément la «résurrection» de l’œuvre de Walser, dans les années 60, et le plus fraternel témoignage humain.
La promenade, soit dit en passant, est pour ainsi dire un genre littéraire de notre littérature vagabonde, de Rousseau aux deux adorables compères Baur et Binschedler de Gerhard Meier, ou de Gustave Roud à Philippe Jaccottet, sans parler des écrivains nomades à la Cendrars, Ella Maillart ou Nicolas Bouvier. Ramuz prétendait que la littérature suisse n’existe pas, et il avait en partie raison, quoique la Suisse multiculturelle, buveuse de kirsch et d’Ovomaltine (ou de grappa) ait bel et bien nourri des tas de livres relevant d’un habitus commun dont ceux de Fleur Jaeggy, polyglotte et chez elle partout, sont un autre exemple, montrant combien le jugement de Ramuz est en somme borné.
Avec Fleur Jaeggy, nous retrouvons aussi bien les anges de Catherine Colomb, romancière vaudoise familière des gouffres affectifs en milieu bourgeois, mais aussi les enfants humiliés de Bernanos ou de Flannery O’Connor, avec des coups d’ailes tous azimuts qui ponctuent les vingt récits à la fois très personnels et non moins universels de Je suis le frère de XX.
L’on y croise ainsi, de nuit, le grand poète russe Iossif Brodsky en sa «ville mentale» appelée Negde, qui signifie nulle part en russe, sur cette promenade new yorkaise d’où un certain jour on vit s’effondrer les tours; ou c’est chez le psychiatre Oliver Sacks qu’on se retrouve en plein Bronx, ou voici la jeune Polonaise Basia qui a conduit son amie Anja à la porte d’Auschwitz mais qui n’entrera pas, tandis que les touristes miment «l’ostentation de la douleur», prostrée au seuil du camp de la mort surmontée de l’atroce inscription ARBEIT MACHT FREI et ne voulant plus voir de visages humains. «Si tu veux en savoir davantage, alors va et deviens toi-même – disent ses yeux fermés – deviens toi-même la victime»…
La Noël des enfants perdus
«Il neigeait. On aurait dit depuis des années. Dans un village désolé du Brandebourg, un enfant crie avec un mégaphone un sermon de Noël ».
Ainsi commence le récit de Fleur Jaeggy intitulé L’Ange suspendu, dont la féerie noire est à la fois ancrée dans un temps et un lieu (les souvenirs et lendemains de la DDR), et qui m’a semblé rejoindre, par delà les années, le récit, par Carl Seelig, de la mort de Robert Walser dans la neige du Rosenberg, sur les hauts de Herisau, quand le coeur du poète le lâcha dans la lumière étincelante de ce début d’après-midi de Noël.
Robert Walser, cet original souvent mal luné, était il un ange ? Les services administratifs du Ciel, dont il ne parle guère, se tâtent à ce propos, mais ce fragment de L’Ange suspendu de Fleur Jaeggy me parle de lui : «L’enfant est accompagné par un vieillard. Le patron, son maître. D’aspect, il ressemble à un moine et à un joueur de poker, comme ceux que l’on voit dans les films. Il a instruit l’enfant. Il l’a habillé et nourri. Il lui a donné un endroit où dormir. Le vieillard a échappé aux prisons, aux bûchers et aux écoles. En échange, l’enfant doit prêcher et demander l’aumône. L’obole. Une haine fraternelle les unissait. L’enfant sent autour de son cou la corde qui le lie à cet homme. Il sentait dans tous ses os et son sang un besoin primordial de haine. Et c’est ainsi que l’enfant parvenait à émouvoir, quand il lisait ses sermons. « Et maintenant, chante », lui disait le vieillard. L’enfant hurle en suivant le Livre des Hymnes. Les femmes l’entouraient. Chacune d’elles lui donne l’obole. Elles caressent sa tête, le capuchon pointu en laine noire. Elles veulent le toucher. L’enfant les regarde avec amour, comme le vieillard le lui a suggéré. C’est Noël. Le butin est consistant »…
Fleur Jaeggy. Je suis le frère de XX. Traduit de l’italien par Jean-Paul Manganaro. Gallimard, 2017.
Carl Seelig. Promenades avec Robert Walser. Traduit de l’allemand par Bernard Kreiss. Rivages, 1989.
Dessin original: Matthias Rihs.
***
67. Keller et Walser
ont de la Suisse dans les idées…

«La Suisse n’existe pas», proclamait le slogan culturel de Ben Vautier visant à prouver le contraire à l’expo de Séville, en 1992, dans un bel élan d’avant-garde béni par l’officialité et l’élite la plus chic…
L’on sourit au rappel de ce qui semble aujourd’hui une bravade «choc» passée de mode en lisant deux livres d’une totale fraîcheur qui sentent la Suisse à plein nez: la terre et l’herbe qui faisait rêver Nicolas Bouvier quand il se trouvait au Japon, la campagne et la ville qui se sont chamaillées pendant des siècles, les petites largeurs cantonales et l’appel du large qui a fait faire le tour du monde à l’institutrice Lina Bögli avant Cendrars et Ella Maillart, les cafés du Niederdorf zurichois et leur Keller Stube voisinant avec l’Odéon de Dada et de Joyce, ou l’arrière-pays des sublimes collines d’Appenzell où Robert Walser n’en finissait pas de promener son parapluie, etc.
Gottfried Keller et Robert Walser, tout différents qu’ils fussent, étaient en somme du même bois «suisse» qu’un Ramuz, et tous trois, en poètes «réalistes», auraient sans doute trouvé loufoque une formule telle que «la Suisse n’existe pas», malgré le «quelque chose» de vrai qu’il y a là-dedans, comme il y a du vrai dans l’affirmation de Ramuz selon laquelle la «littérature suisse n’existe pas» ou, balancée l’an dernier par un Michel Thévoz, celle que «l’art suisse n’existe pas»…
Arguties que tout ça ? Paradoxes mondains ou contradictions bavardes ? Plutôt: composantes d’une réalité riche et souvent contradictoire, bonnement présente dans la «conversation» de Walser.
Quant la marche est une démarche…
Rousseau dit quelque part qu’il n’a jamais si bien pensé qu’en marchant, je ne sais plus qui affirmait que le meilleur de la littérature romande était sorti de la cinquième rêverie du solitaire en question, et c’est vrai que la promenade, de Jean-Jacques à Philippe Jaccottet, en passant par Gustave Roud célébrant la marche en plaine ou Charles-Albert Cingria le perpétuel itinérant, fait chez nous autres figure de véritable démarche poétique, avec quelque chose de spécifiquement suisse qu’on retrouve chez Walser autant que, cinquante ans plus tard dans les balades des deux compères Baur et Bindschedler de Gerhard Meier, ou plus récemment dans les longues trottes d’un Daniel de Roulet ou d’un Jean Prodhon.
Mais quoi de «spécifiquement suisse» en cela ? Disons que la constante proximité de la nature y va de pair avec un brassage de culture au sens le plus large, où le dialogue joue parfois un rôle majeur.
À cet égard, les Promenades avec Robert Walser, consignées dans un récit au charme savoureux, constituent un modèle du genre, autant par leur contenu littéraire et humain que par le «montage» très particulier élaboré par Carl Seelig.
Lucidité et mémoire d’un « zéro » social
Lorsque Carl Selig, chroniqueur littéraire et poète zurichois dans la quarantaine, dont la fortune personnelle lui a déjà permis d’aider financièrement plusieurs auteurs, se pointe pour la première fois à la maison de santé cantonale d’Appenzell Rhodes-Extérieures, à Herisau, Robert Walser, âgé de 58 ans, au « visage enfantin tout rond, fendu comme par la foudre, les joues un peu rouges, les yeux bleus et une courte moustache dorée », lui apparaît avec sa cravate de travers et ses dents en mauvais état, et tout de suite un détail noté en dit long : alors que le médecin-chef Otto Hinrischen , qui a autorisé cette première promenade, fait mine, en bon paternaliste, de fermer le dernier bouton de la veste de son pensionnaire, celui-ci se rebiffe en dialecte bernois « mélodieux »: « Non, celui-ci doit rester ouvert !»
On voit le tableau. En outre Seelig a été averti par la sœur aînée de Walser : Robert est «extrêmement méfiant». Alors de préciser dans son premier récit que «le silence fut la passerelle étroite sur laquelle nous nous sommes rejoints». Mais dans une autre lettre la version sera un peu différente, selon laquelle Walser et lui se sont tout de suite parlés naturellement et beaucoup.
On voit ainsi illico que le récit de Carl Seelig est construit, fidèlement sans doute pour l’essentiel mais correspondant au regard – très intelligent, sensible et cultivé d’ailleurs – du compagnon de route qui s’implique lui-même et souvent pour le meilleur.
Le «montage» de Seelig brasse la matière de ces balades en détaillant à la fois les charmes du paysage, la beauté de telle vieille façade ou de telle servante bien fessue, le menu des repas toujours bien arrosés, engloutis après des dizaines de bornes à pied à ne cesser de parler, et le résumé très vivant voire dialogué de ces conversations où l’on parle de tout : des nuages («ils ont un air d’amitié, comme de bons camarades silencieux, tout de suite grâce à eux le ciel s’anime, s’humanise » de la tyrannie à l’époque de la montée du nazisme, de Staline juste après sa mort (« J’ai toujours été dégoûté par l’encens qu’il exigeait qu’on répande autour d e lui »…), de la beauté (« la beauté vraie, la beauté du quotidien, se révèle plus subtilement dans la pauvreté et la simplicité », du tourisme croissant (« On voyage beaucoup trop aujourd’hui. Les gens partent en troupeaux dans les pays étrangers et se comportent avec un sans-gêne absolu, comme s’ils étaient chez eux »), de l’intervention américaine en Corée («orgueil imbécile, arrogant, cupide, en quoi le combat pour la liberté d’un grand peuple d’ancienne culture concerne-t-il les Américains ? »), de la souffrance parfois fertile pour l’écrivain («sans l’expérience de l’échafaud et de la Sibérie, Dostoïevski n’aurait pas pu écrire »), des écrivains et des livres qu’il a aimés (Keller et Goethe viennent en tête, Eichendorff ou Gotthelf quand il ne sermonne pas), etc.
La mémoire de Walser, que Seelig dit justement « prodigieuse», lui permet de raconter de nombreuses anecdotes significatives remontant à sa jeunesse et à ses innombrables rencontres et lectures, et le «ton» si particulier de l’écrivain se retrouve dans les observations du promeneur. Mais Carl Seelig n’est pas en reste, qui s’intègre parfaitement dans ce « tableau » avec des portraits de femmes d’exception, notamment.
Dès leur première promenade, Walser évoque ses débuts d’écrivain couronné d’insuccès, si l’on ose dire, qui doit beaucoup à sa méfiance instinctive envers les chapelles littéraires et la « lèche » qui lui donne la nausée. Du même coup, parlant de ses années les plus productives (sept ans à Berlin après sept ans à Zurich, et ensuite sept ans à Bienne, il critique les «années honteuses» vécues par « la plupart des écrivains» pétris de haine après la Première Guerre mondiale, alors que selon lui la littérature doit rayonner de bienveillance : « On décernait les prix littéraires à de faux sauveurs ou au premier maître d’école venu ». Or son propre «déclin» est lié selon lui à son refus de s’aplatir ou de donner des leçons. Mais c’est sans aigreur qu’il reviendra, durant ces vingt ans de promenades, sur le fait qu’il se considère comme un raté social, et chaque fois que Carl Seelig proteste en lui rappelant la considération qu’il s’est acquise auprès des meilleurs auteurs (d’un Kafka ou d’un Hesse, notamment), Walser s’énerve comme l’impatientent les éloges et autres commémorations, nouvelles publications de ses œuvres et prix littéraires que Seelig cherche à lui obtenir .
Rejet de toute littérature qui rappellerait l’exil de Rimbaud ? Non, le cas est tout différent. Humilié de toujours, mais à la fois résigné dans sa mélancolie; taxé de schizophrénie et se laissant en somme faire, Walser ne se plaint pas. Il est vrai qu’il n’écrit plus, alors qu’on lui a proposé un arrangement qui le lui permettrait, mais lui-même refuse tout privilège par rapport aux autres pensionnaires de l’institution : comme eux il s’astreint aux plus humbles travaux consistant à plier des bouts de carton et à trier des ficelles…
Cela étant, sa parole est bel et bien la prolongation de ses écrits, et ce qu’il dit recoupe souvent et prolonge ce qu’on a lu dans ses romans.
Le 28 janvier 1934, au cours d’une longue marche qui conduit les promeneurs de Saint-Gall à Rorschach, Walser raconte comment il a composé ses Rédactions de Fritz Kocher, à Zurich, dans la rue où Lénine a vécu, et pourquoi il n’a pas « réussi » à s’imposer comme écrivain : « D’emblée, mes débuts littéraires ont dû donner l’impression que je me moquais du bourgeois, comme si je ne le prenais pas tout à fait au sérieux. On ne me l’a jamais pardonné. Voilà pourquoi je suis toujours resté un zéro tout rond, un gibier de potence ». Et dans le L’Institut Benjamanta, le plus magique de ses romans – qu’il dit préférer d’ailleurs aux autres pour sa « fantaisie poétique » -, son double romanesque dira exactement la même chose. Mais Walser ne se flatte pas pour autant d’avoir été «une sorte de vagabond», n’écrivant jamais pour séduire le public et se «fichant du beau monde», buvant énormément durant ses années berlinoises et se rendant «assez impossible» au lieu d’imiter un auteur adulé à la Hermann Hesse.
Or le paradoxe est que c’est ce personnage d’inadapté qui lui a valu de devenir un «auteur culte» après sa mort – une figure clinquante qu’il aurait détestée -, du genre « perdant magnifique » complaisamment célébré par la jeunesse occidentale des années 60-80, alors qu’il estime que « rien de grand ni de durable n’est jamais sorti d’une existence vagabonde » et défend les petits-bourgeois en lesquels il voit les gardiens de la civilisation.
Les anarchistes de salon, ou les « fans » d’un Walser «rebelle» bondiront à la découverte de réflexions qui n’ont rien de «réactionnaire» pour autant : « Même si sa stupidité peut parfois énerver, le petit-bourgeois n’est pas pour autant, tant s’en faut, aussi insupportable que l’homme de lettres qui croit qu’il est de son devoir de donner des leçons de morale au monde entier»…
À préciser, enfin, que les Promenades avec Robert Walser ne sont pas forcément la meilleure introduction à l’œuvre de celui-ci, mais en constituent un complément inappréciable, auquel la postface d’un triumvir (Lukas Gloor, Reto Sorg et Peter Utz) ajoute des informations inédites révélatrices, notamment sur l’ambivalence de la prise en charge littéraire de Walser par Seelig, à la fois louable et abusive après la mort de l’écrivain, tant il est vrai qu’à l’inverse de Max Brod «sauvant» l’œuvre de Kafka contre la volonté de celui-ci, Carl Seelig a failli détruire les inédits de Walser qu’il s’était pour ainsi dire appropriés…
Walser renard, et Keller hérisson
La coïncidence de la parution des Promenades avec Robert Walser et des dix nouvelles réunies dans Les Gens de Seldwyla de Gottfried Keller offre une sorte de «multipack» suisse aux résonances multiples qu’il m’a paru intéressant de signaler ensemble à la lectrice et au lecteur.
L’essayiste anglais Isaiah Berlin faisait une distinction, valable pour les écrivains et le artistes autant que pour les savants (ainsi que le souligne le physicien Freeman Dyson) entre hérissons et renards. Les premiers, tout concentrés, « creusent » leur œuvre sur place, tels un Ramuz ou un Gottfried Keller, précisément ; et les seconds, tels un Cingria, un Bouvier ou un Walser, grappillent avant de revenir au terrier avec leur prise.
Cela étant, le hérisson Keller a pas mal de points communs avec le renard Walser, à commencer par une « suissitude » à la fois centrale et périphérique, ou plus précisément un solide ancrage dans le « village » populaire, la nature et les usages d’une humanité vue d’un œil à la fois très réaliste et très sensible à la féerie.
Je ne parlerai ici que de la première des nouvelles de cette nouvelle édition complète des Gens de Seldwyla – intitulée Pancrace le boudeur et très walsérienne de tournure mais avec une verve «flamande» propre à Keller: l’histoire d’un garçon terriblement bougon foutant le camp de son trou de province pour courir les monde, comme tant de Suisses migrants, et revenant au pays avec la peau du lion qu’il a héroïquement affronté et occis…
En 1952, le grand passeur que fut Walter Weideli présentait un choix de nouvelles tirées des Gens de Seldwyla, traduit en bon français un peu lisse par Charly Clerc sous le titre de Trois justes, dans une préface qui situait bien l’œuvre de Gottfried Keller dans l’histoire politique et sociale de notre pays, en ces termes immédiatement sympathiques : «Nous sommes entre amis et il fait bon se trouver plusieurs à aimer les mêmes choses », avant de préciser que « si un poète nous parle plus précisément de notre pays et de nous-mêmes, gens de ce pays, de nos mœurs, de nos désirs et de nos limites, nous l’écoutons avec une attention toute particulière , je dirais presque avec reconnaissance ».
Et de conclure comme on n’ose plus le faire aujourd’hui. «Je vous souhaite d’aimer Gottfried Keller». Ce qui vaut évidemment pour Robert Walser dont le même Weideli avait admirablement ressaisi le ton et la touche de l’écriture dans sa traduction de L’Homme à tout faire, peut-être la meilleure introduction à l’univers walsérien où se découvre bel et bien cette fameuse Suisse qui-n’existe-pas…
Carl Seelig, Promenades avec Robert Walser. Traduit par Marion Graf. Editions Zoé, 221p. 2021.
Robert Walser. L’Homme à tout faire. Traduit par Walter Weideli. L’Âge d’Homme, Poche Suisse, 2000.
Gottfried Keller, Les gens de Seldwyla. Traduit par Lional Felchlin. Zoé, 645p. 2021.
Réédition dernière: Henri le vert, aux éditions Zoé. 2025.
***
68. Todo Bolaño
Une lecture traversante de 2666, fascinant dernier roman-gigogne de Roberto Bolano (1953-2003), paru un an après sa mort et constitué de cinq livres en un. Les Oeuvres complètes de l’auteur chilien trop tôt disparu paraissent à l’Olivier.

1. Sur La partie des critiques, première section.
Ce n’est pas sans réserve qu’on entre dans ce roman de 1352 pages, mais une fois qu’on y est on y est bien. Une première hésitation tient à la dimension de l’ouvrage, constitué de cinq romans collés ensemble pour n’en former qu’un, cela donnant un énorme volume tout à fait mal pratique dans son édition de poche.
Et puis, et surtout, certaine adulation plus ou moins convenue, typique aujourd’hui des engouements suscités par les livres qu’on dit « cultes », voire « cultissimes », ne peut qu’engendrer certaine méfiance – du moins est-ce mon cas.
Or, sans entrer vraiment « à reculons » dans la lecture de 2666, j’attendais tout de même d’être séduit ou séduit sans aucune contrainte extérieure, et ce fut le cas dès les dix ou vingt premières pages, me régalant aussitôt et sans discontinuer jusqu’au terme de la première section intitulée La partie des critiques et lisible comme un tout cohérent, non sans appeler aussitôt la suite.

Ce qu’il faut dire en premier lieu, c’est que 2666 sent bon la littérature. J’y ai retrouvé, pour ma part, ce mélange de bien-être profond et de griserie, de confort mystérieux et de vive curiosité qui a marqué mes lectures d’enfant et d’adolescent, de Vincenzo à Michel Strogoff ou de Moravagine à Alexis Zorba, entre cent autres livres découverts de dix à dix-huit ans, avant d’accéder à une littérature, disons : plus littéraire, dont les premiers grands moments furent la lecture d’Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry ou, beaucoup moins connus, de Je ne joue plus ou du Retour de Philippe Latinovicz de Miroslav Karleja.
La première partie de 2666 nous replonge, ainsi, dans le climat de ferveur inconditionnelle lié aux découvertes plus ou moins exclusives d’une espèce de club occulte se transmettant, par dessus les frontières, des noms et des titres – et voici redéfiler L’institut Benjamenta de Robert Walser ou Le métier de vivre de Cesar Pavese, Miss Lonelyhearts de Nathanaël West ou Hordubal de Karel Capek, Le pavillon d’or de Yukio Mishima ou Le Bonheur des tristes de Luc Dietrich, entre tant et tant d’autres.
Le mystère du romancier invisible, voire inaccessible, moins photographié qu’un Blanchot ou qu’un Michaux, et pourtant considéré comme le plus grand auteur allemand de la seconde moitié du XXe siècle, forme ce qu’on pourrait dire le trou noir de la première partie de 2666, dans lequel s’engagent crânement quatre jeunes critiques européens réunis par leur commune passion.
Celle-ci s’incarne en la personne de Benno von Archimboldi, dont les nombreux livres suscitent un peu partout un croissant intérêt, à commencer par celui de nos quatre critiques, à savoir Pelletier le Français, Espinoza l’Espagnol, Morini l’Italien et Liz Norton l’Anglaise de Londres qui partagera son cœur et son corps avec les trois autres.
On le sait évidemment : les critiques littéraires, et notamment ceux de de la caste universitaire, ne représentent pas, du point de vue romanesque, les plus captivantes incarnations du cheptel humain. Les quatre protagonistes de 2666 ne font pas vraiment exception à la base, mais l’auteur va les « travailler » au corps en sorte de donner, au fil de leurs expériences, consistance humaine et « poétique » à leur inconsistance.
À travers les années, devenant bonnement les spécialistes mondiaux de l’œuvre d’Archimboldi, en concurrence directe avec leurs rivaux allemands, l’on suit l’évolution, de colloques internationaux en réunions de toute espèce aux quatre coins de la planète, de tout un petit monde de touristes universitaires de plus ou moins haute volée accroché aux « basques » de l’écrivain « culte », candidat au Nobel et fuyant comme le furet du bois joli. Pendant ce temps, l’on assassine des centaines de jeunes femmes au nord du Mexique, où nos critiques finissent par débarquer en s’imaginant que l’écrivain y rôde…
Malgré les apparences, le vrai sujet de La Partie des critiques ne se borne pas à un tableau balzacien des facultards se la jouant « spécialistes de » et se royaumant de par le monde en multipliant les intrigues.
À part ses innombrables digressions enchâssant moult histoires étonnantes dans le corps du récit, le roman progresse, quasi souterrainement, vers on ne sait quel « cœur des ténèbres » ponctué, de loin en loin, par des épisodes d’une soudaine violence sur fond de menées « purement littéraires ».
Ainsi voit-on Espinoza et Pelletier, qu’on pourrait taxer de « puceaux de la vie », se révéler soudain de possibles tueurs en s’acharnant sur un malheureux chauffeur de taxi pakistanais…
De même voit-on se développer, sous la narration fluide et plaisante en apparence, un sous-récit plus inquiétant, ponctué de séquences parfois délirantes, lyrique ou oniriques, auquel s’ajoute la voix d’un nouveau protagoniste, critique chilien celui-ci, au nom également italianisant d’Amalfitano et qui commandera la partie suivante…
2. Sur La Partie d’Amalfitano
Une douce folie littéraire imprègne La partie des critiques, première section de 2666, qui va s’accentuer crescendo dans La partie d’Amalfitano, dont le protagoniste, professeur et critique chilien, apparaît à Santa Teresa, au nord du Mexique, où ont débarqué les spécialistes d’Archimboldi sûrs de trouver celui-ci en ces lieux perdus.
Or, avant de poursuivre, on remarquera que, sur les 248 premières pages de La Partie des critiques, pas une seule n’aura jamais évoqué le contenu des œuvres d’Archimboldi, comme si cela constituait le dernier des soucis des commentateurs du grand écrivain, en revanche impatients de le rencontrer et de se faire photographier avec lui.
Ceci rappelé, l’observation de Roberto Bolano va porter, dans La partie d’Amalfitano, sur des réalités » littéraires » encore plus extérieures, voire décalées, dans le sillage de personnages échappant en outre aux normes académiques, à commencer par Lola, l’extravagante épouse d’Amalfitano, mère de la jeune Rosa et fuyant à n’en plus finir à la recherche d’on ne sait quoi, folle d’un poète qui l’a baisée avant de se retrouver dans un asile psychiatrique où il l’ignore quand elle vient l’y relancer.
Lola est en somme le type de la « groupie » littéraire, qui n’en finit pas de se féliciter d’avoir été baisée par un poète et rêve ensuite de le sauver de lui-même. Plus précisément,le poète en question, au demeurant sans intérêt particulier, est supposé coucher avec un ami philosophe, du moins à en croire les ragots. Ainsi Lola se sent-elle la mission sacrée de le « délivrer ». On connaît ce genre de délire…
L’épisode s’inscrit dans une longue suite de péripéties racontées par Lola à Amalfitano au fil de lettres constituant autant de digressions romanesques. Ensuite,le récit va basculer du côté d’Amalfitano et de sa fille Rosa qui, d’Espagne où ils vivaient jusque-là, vont migrer au Mexique où le prof est appelé à enseigner à Santa Teresa. Du coup, le thème des filles assassinées resurgit, dont on sent qu’il préoccupe sourdement le père de Rosa.
Rien cependant du roman noir dans La partie d’Amalfitano, qui voit le protagoniste évoluer vers des états alternés de déséquilibre psychique et de lucidité aux manifestations des plus singulières. C’est ainsi que, dans l’esprit de Marcel Duchamp, il va suspendre un traité de géométrie à l’étendage, en plein air, afin de le mettre à l’épreuve de la pluie et du vent, non sans amener sa fille à se poser, comme lui d’ailleurs, des questions sur son état mental.
Le rapport entre « la littérature » et « la vie » est d’ailleurs un thème récurrent dans 2666, dont la progression narrative, dans ce deuxième volume, accentue d’ailleurs le glissement du récit vers « la vie », notamment avec l’apparition d’un jeune homme assez inquiétant, fils du recteur de l’université professant le nihilisme le plus cynique et se flattant de participer à des jeux violents.
À la littérature, la vie se mêle aussi par le truchement de la politique, dans La partie d’Amalfitano, mais là encore « par la tangente », s’agissant des rapports des écrivains mexicains avec le pouvoir ou d’un livre creusant la question des origines de l’homme américain, plus précisément chilien, en rapport avec la vieille culture des Araucans, ou Mapuches, dont Amalfitano finit par se demander si l’auteur n’est pas un certain Pinochet…
Formellement moins accomplie, et surtout plus déroutante, que la première section de 2666, La Partie d’Amalfitano nous captive cependant, avec ses errements entre folie et phénomènes paranormaux (où le rêve continue de jouer un rôle majeur), dans la mesure où nous lui savons une suite, qu’elle appelle de toute évidence. Ce deuxième roman tiendrait-il « la route » en tant que tel ? On peut se le demander. Chose certaine en revanche : son magma narratif bouillonne comme dans un chaudron, duquel on s’attend à voir surgir… ce qu’on va voir.
3. Sur La partie de Fate.
Il est toujours intéressant de voir, ou de sentir plutôt, de l’intérieur, à la lecture d’une roman d’envergure, à quel moment ce qu’on pourrait dire le « grand dessein » de l’auteur cristallise embarquant véritablement le lecteur.
Dans la suite du roman-gigogne que représente 2666, la chose se précise et s’amplifie puissamment dans la troisième section intitulée La partie de Fate, dont le protagoniste va retrouver, au Mexique, ceux de La Partie d’Amalfitano sur fond de sombre drame marqué par les disparitions et les assassinats de femmes déjà cités à plusieurs reprises jusque-là.
Ce troisième roman-dans-le-roman commence à New York, dans le quartier noir de Harlem, lorsque Quincy William, connu sous le nom d’Oscar Fate dans la revue où il travaille, perd sa mère et s’apprête à partir en reportage à Detroit pour y rencontrer un certain Barry Seaman, auteur d’un livre de cuisine intitulé Mangez des côtelettes avec Barry Seaman.
Comme on l’aura déjà deviné, puisque la revue Aube noire traite surtout de politique et des « frères » Blacks, ce n’est pas la gastronomie qui intéresse Fate mais le passé de Seaman, lié à la fondation des Black Panthers.
Or le personnage va se déployer de la manière la plus inattendue, puisque, emmenant Fate dans une église, c’est du haut de la chaire de celle-ci qu’il prononce une suite de discours portant sur les thèmes du danger, de l’argent, des repas, des étoiles et de l’utilité… digressions constituant autant d’éclairages sur Barry Seaman tout en rappelant à Fate son premier papier consacré au dernier vieux communiste authentique de Brooklyn, qui l’a fait classer dans les chroniqueurs du « pittoresque
sociologique ».
Par la suite, Fate va se trouver envoyé, par la rédaction d’Aube noire, au nord du Mexique où, en remplacement d’un chroniqueur sportif récemment décédé, il est supposé rendre compte d’un match de boxe entre deux illustres inconnus.
Aussi « improbable » que l’installation d’Amalfitano, prof de philo espagnol et critique, dans la ville mexicaine de Santa Teresa, proche du désert de Sonora où ont été retrouvés de nombreux cadavres de femmes, le voyage de Fate en ces mêmes lieux s’inscrit pourtant dans la logique un peu somnambulique, et tout à fait cohérente au demeurant, de ce roman-labyrinthe se peuplant peu à peu de nombreux personnages de premier ou de second plan dont chacun trimballe une autre histoire. À Santa Teresa, Fate va d’abord découvrir l’univers de la boxe, en compagnie de divers autres chroniqueurs sportifs avérés, et tout un petit monde plus ou moins interlope dont se détache le nommé Chucho Flores, en lequel il va découvrir l’amant d’une jeune femme d’une grande beauté, prénommée Rosa et fille du professeur Amalfitano, dont lui-même s’éprendra.
Si le match de boxe auquel Fate est supposé assister pour en rendre compte dans sa revue est expédié en un rien de temps et n’aura intéressé le journaliste que par ses à-côtés, c’est dans l’ univers des bars et de boîtes de Santa Teresa, qu’il fréquente la nuit, que l’idée lui vient d’enquêter sur la disparition des femmes. Dans le même temps, s’étant rapproché de Rosa Amalfitano, il accepte d’accompagner une consoeur au pénitencier de Santa Teresa où elle compte interviewer un suspect des assassinats.
Passons cependant sur les multiples péripéties du récit, pour insister sur la trame narrative à la fois limpide et complexe, fluide et buissonnante, et sur l’atmosphère de plus en plus étrange, inquiétante, folle parfois, de cette troisième section où le Mal court et s’incarne, soudain, comme dans telle ou telle pages des Démons de Dostoïevski, à l’apparition du tueur présumé…
On se trouve alors au seuil de La partie des crimes, dont traiteront les 400 pages suivantes…
4. Sur La partie des crimes
À la fin du troisième roman-dans-le-roman que constitue La partie de Fate, il est écrit que les multiples assassinats de femmes commis dans la région de Santa Teresa, auxquels on ne semble guère accorder d’attention en haut lieu, cachent le « secret du monde ».
Or La partie des crimes, quatrième section de 2666, va consacrer quelque 430 pages à ces morts atroces. Dans le roman, le premier crime répertorié date de janvier 1993, et le dernier de 1997, et le nombre des mortes est estimé à 200 ou 300. Mais en réalité, les faits se sont étalés sur une plus longue période, et le nombre des victimes est parfois estimé à plus de 2000. Car les faits sont là : le roman de Roberto Bolaño ne procède pas d’une imagination morbide, tout nourri d’une tragédie contemporaine innommable, dont Ciudad Juarez (le Santa Teresa du roman) fut (et reste) l’infernal décor.
Selon les chiffres d’Amnesty International, plus de 2000 femmes ont disparu à Ciudad Juarez depuis une vingtaine d’années. Selon d’autres sources, plus de 2500 femmes auraient disparu. Les chiffres concernant l’intervalle de 1993 à 2003 font état de 300 femmes assasinées. La plupart avaient entre 12 et 25 ans, étaient d’extraction sociale modeste et furent enlevées, torturées, violées, parfois mutilées, toujours étranglées, selon un rituel répétitif en de très nombreux cas. Ainsi a-t-on pu parler de deux serial killers, dont aucun ne fut pourtant identifié formellement.
De cette terrifiante histoire criminelle, le journaliste et écrivain Sergio Gonzalez Rodriguez, spécialisé jusque-là dans le domaine culturel ( !) a tiré une longue enquête sur le terrain, maints articles et un livre, Des os dans le désert, publié au Mexique en 2002 et traduit en français en 2007 aux éditions Passage du nord/ouest.
Quant à Roberto Bolaño, dont le livre parut en 2004, donc un an après sa mort, c’est en romancier-moraliste, et parfois en romancier-poète, qu’il ressaisit cette inhumaine matière humaine d’une rare cruauté et d’une non moins insondable tristesse.
S’il cite précisément un journaliste-écrivain du nom de Sergio Gonzalez, comme il relate la venue, à Santa Teresa, d’un certain Albert Kessler, expert américain dans le domaine des tueurs en série (Robert K. Ressler en réalité, auteur de Chasseurs de tueurs et consultant pour Le silence des agneaux ), Roberto Bolaño transpose les faits en fiction plus-que-réelle avec une saissante puissance d’évocation, combinant une topologie hyper-précise (quoique fictive) et toutes les composantes sociales et psychologiques d’un grand roman à multiples personnages.
Il y a, d’abord, la cohorte des victimes, dont nous saurons chaque nom et chaque détail des sévices subis, et dont la litanie évoque une sorte de Livre des Mortes. Mais la plupart n’étant « que » des ouvrières des maquiladoras de la zone industrielle, ou « que » des prostituées, seront vite jetées à la fosse commune, et leur affaire classée. Comme le relèvera le« vrai » Sergio Gonzalez, les autorités minimiseront la portée de ces morts, quand ils ne les nieront pas, sur fond de corruption ou de terreur exercée par les narcotrafiquants. De même les journalistes trop curieux seront-ils surveillés de près, et parfois liquidés.
Du côté des criminels, présumés ou avérés, seul le personnage de Klaus Haas, dans le roman, se trouve développé. Ingénieur en informatique, commerçant un peu louche, ce « gringo » est emprisonné comme le fut, en 1995, un chimiste égyptien soupçonné de multiples meutres et qui ne fut probablement qu’un bouc émissaire pour la police et le gouvernement. Dans le roman, Haas pose en victime innocente tout en manipulant la presse et la police en témoin des ténèbres carcérales.
Si le vrai Sergio Rodriguez a pointé l’incurie des autorités mexicaines avec virulence – et au péril de sa vie -, Roberto Bolaño, en romancier de grand souffle, vise plutôt l’immersion et la perception progressive du mal profond de toute une société, impliquant à la fois la corruption étatique et sociale, la culture et les mentalités découlant d’une tradition machiste du viol et de la domination masculine en général.
Il n’est point vraiment de « héros positif » tout pur dans La partie des crimes, dont le plus attachant, jeune policier de vocation du nom de Lalo Cura, représente le dernier né d’une famille dont les mères ont toutes été violées, une génération après l’autre. Non moins capable d’attention compatissante, l’inspecteur Juan de Dios Martinez, amant de la directrice d’un asile psychiatrique d’une remarquable solidité, connaîtra des vertiges de tristesse proportionnels aux abominations qu’il découvre.
Autres figures activement opposées à tout consentement : la voyante Florita qui « sait les choses » et défend courageusement les femmes assassinées à la télévision, ou cette ancienne journaliste devenue députée qui, à la suite de la disparition d’une amie proche- elle-même mêlée à l’organisation de parties fines dans le milieu hyper-contrôlé des narcos -, entreprend de mener l’enquête puis enjoint son confrère Sergio Gonzalez d’écrire la vérité réclamée depuis des années par des associations de femmes solidaires refusant d’admette le pire.
Or à quoi tient «le pire » ? Où est donc ce fameux « secret du monde » ? Dans l’archaïque cruauté de l’homme ? Dans la domination masculine qui se résume, à un moment donné, par la sidérante anthologie de blagues misogynes débitée lors d’une beuverie de flics épuisés ? Dans l’acculturation désastreuse d’une ville-monde faisant office de dépotoir social au seuil des States et de plaque tournante du trafic de drogue ? Dans le pouvoir sans partage d’une classe dirigeante pourrie ? Dans le mal ancré au cœur de l’homme ?
Roberto Bolaño ne prêche pas plus qu’il ne démontre quoi que ce soit : il montre, et La Part des crimes, comme les derniers romans-fables de Cormac McCarthy (Non ce pays n’est pas pour le viel homme ou La Route), nous fait traverser les plus sombres ténèbres, non pour ajouter au désespoir ambiant (ou à quel complaisant nihilisme) mais pour aiguiser au contraire, au plus profond de l’âme du lecteur, son rejet de l’abjection et sa nostalgie de la lumière.
5. Sur La Partie d’Archimboldi
On se rappelle la noire tirade du cinquième acte de Macbeth en arrivant au terme de la lecture des 1353 pages de 2666 de Roberto Bolaño, dernier roman en cinq livres de l’écrivain chilien mort en 2003, en Espagne, à l’âge de 50 ans :« La vie n’est qu’une ombre errante ; un pauvre acteur /Qui se pavane une heure sur la scène / Et qu’ensuite on n’entend plus ; c’est une histoire / Racontée par un idiot, pleine de bruit et de furerur. / Et qui ne signifie rien ».
Ce qui donne, dans la langue de Shakespeare : « Life’s but a walking shadow ;a poor player , / That struts and frets his hour upon the stage,/ And then is heard no more : it is a tale / Told by an idiot, full of sound and fury, / Signifying nothing ».
« Rien » vraiment ? Ce n’est pas, cela va sans dire, à quoi se réduit la signification de la tragédie, dont la conclusion nihiliste de Macbeth n’est qu’un aspect, recoupant la désespérance, à la fin de 2666, de la vieille sœur chérie du protagoniste, Lotte de son prénom, confrontée à un nouvel avatar du Mal, quelque part au Mexique et cinquante ans après la chute du Reich…
À vrai dire, le dernier roman de Roberto Bolaño, paru à titre posthume en 2004, est l’un des livres contemporains les plus riches de sens et de (sombre) poésie qui se puissent trouver, dont la quatrième et la cinquième partie ne cessent de se densifier et de s’intensifier.
Après la terrible Partie des crimes, déployée comme un hypnotisant Livres des mortes, en lugubre rappel romanesque des centaines de meurtres de femmes perpétrés aux abords de Ciudad Juarez (Santa Teresa dans le roman), La partie d’Archimboldi nous ramène au début du XXe siècle en Allemagne où, en 1920, une borgne et un boiteux revenu de la Grande Guerre mettent au monde un enfant pas comme les autres, géant ressemblant à une algue à sa naissance et qui développera, bientôt, une étrange propension à l’apnée, un intérêt marqué pour les fonds marins et une vie onirique intense.
Tel est en effet le jeune Hans Reiter, dont l’évocation des premières années rappelle les bons vieux romans d’apprentissage de l’Allemagne romantique, du côté de Jean Paul Richter. Après lecture, c’est d’ailleurs comme une grande courbe qu’on distingue dans l’évolution du livre, du romantisme allemand très imprégné de nature aux convulsions extrêmes de l’expressionnisme. Pour le dire autrement, on pourrait préciser que le roman allemand du Chilien transite de Novalis au Tambour de Günter Grass ou même aux Bienveillantes de Jonathan Littell, ou encore de Döblin (explicitement cité par le protagnoiste) à W.G. Sebald.
Plus précisément encore, s’agissant de celui-ci,l’évocation hallucinante des bombardements en tapis, dans 2666, rappelle les pages insoutenables que Sebald consacre, dans Une destruction, à l’anéantissement vengeur des villes allemandes par les Alliés, à la toute fin de la guerre.
Roberto Bolaño est un fou de littérature (fou de lecture et fou d’écriture), et pourtant rarement un écrivain contemporain, dans le sillage (style non compris) du Voyage au bout de la nuit, n’aura brassé tant de matière vivante avec autant de puissance évocatrice, à croire qu’il est allé partout en personne, sur le front de l’Est et dans les souterrains de tel château des Carpates, dans le fouillis d’un éditeur berlinois de l’immédiat après-guerre ou dans le dédale des jardins intérieurs vénitiens, entre autres innombrables lieux hantés par de non moins innombrables personnages merveilleusement présents, à tous les étages de la société.
À la fin de La partie des critiques, premier des romans-dans-le-roman de 2666, le fameux romancier allemand Benno von Archimboldi, pressenti pour le Nobel, se trouvait plus ou moins localisé à Santa Teresa, sans apparaître vraiment, aussi insaisissable qu’un Salinger ou qu’un Pynchon des décennies durant.
Sur les 250 premières pages de la quintuple fresque, le protagoniste, tout « écrivain culte » qu’il fût, n’était qu’un objet faire-valoir pour Madame et Messieurs les critiques spécialistes mondiaux de son œuvre, dont le contenu n’apparaissait guère plus – suprême ironie de l’auteur.
Or c’est du côté de la vie que nous ramène La Partie d’Archimboldi, au fil d’un roman qu’on pourrait dire picaresque mais qui n’est pas plus un « roman de guerre » que La Partie des crimes n’était un thriller à serial killers. En fait, Roberto Bolaño se joue des genres autant qu’il joue avec ceux-ci, sans donner jamais dans ce qu’on pourrait dire l’exercice de style ou l’ acrobatie littéraire. Il y a chez lui la candeur des vrais passionnés, communiquée au merveilleux Hans Reiter – le futur Benno von Archimboldo, dont le pseudo renvoie (vendons la mèche !) au réformateur mexicain Benito Juarez et à l’archiconnu peintre de fruits et légumes italien, et qui écrira livre sur livre après avoir vécu plusieurs vies en une.
Si c’est devenu un lieu commun que de parler du « cauchemar » du XXe siècle, avec ses guerres et ses génocides, le plus étonnant est qu’on parcourt ce « tunnel du temps », au côté du jeune Hans Reiter, avec la sensation de rêver éveillé sans cesser de se rappeler la « vérité »historique. Ainsi de l’épisode tout à fait saisissant du fonctionnaire d’Etat, dans un bled de Poméranie, qui voit soudain débarquer un train de Juifs grecs supposés finir à Auschwitz, et qu’il lui faut « gérer » par ses propres moyens, en « opérant » comme il le peut avec peu de personnel, la nuit en douce. Dans la même veine, oscillant entre réalisme et fantastique, la destinée tragi-grotesque du général roumain Entrescu, au membre viril mythique, et finissant crucifié par ses hommes, rend puissamment le mélange détonant d’érotisme et de fureur démente de l’insensé carnage.
Or le plus étonnant peut-être, et le plus manifeste dans cette dernière partie aux dehors parfois apocalyptiques et fuligineux, tient à la remarquable limpidité de la narration et à sa profonde poésie.
Hemingway dit quelque part que le plus difficile, pour un écrivain, consiste à fondre la poésie et la prose (comme on le voit chez un Faulkner ou un Céline), et sans doute est-ce à ce mélange de réalisme fantastique et de lyrisme, de lucidité tranchante et de tendresse, de force expressive quasi brute et de délicatesse (notamment filtrée par les trois personnage féminins magnifiquement dessinés de l’éditrice érotophile, de l’amante tuberculeuse et de la sorella dolorosa), de tragique et d’humour, que tient la grandeur et l’originalité incomparable de 2666.
S’il n’est pas styliste à ciselures comme un Céline, Roberto Bolaño n’en atteint pas moins, dans la masse mouvante de 2666,et jusque dans ses imperfections formelles et autres longueurs occasionnelles, une forme ressortissant à la transfiguration poétique.
Sous les dehors d’un raconteur inépuisable en matière de digressions et d’histoires enchâssées, Roberto Bolaño ne cesse d’affronter, enfin, la question du Mal.
Question sans autre réponse, en l’occurrence, que celle du roman lui-même. Dont le titre fait lui-même question…
Roberto Bolaño. 2666. Gallimard, Folio, 1358p.
***
69. La force qui va !
ll fit poésie de tout, voulut tout dire. Il vint au monde le 26 février 1802. Certains de ses livres semblent avoir été écrits ce matin, tel L’homme qui rit…

Tout a été dit, et son contraire, de Victor Hugo. Sa dépouille fut saluée par un million de Parisiens, dans le «corbillard des pauvres» qui le conduisit au Panthéon, mais Hugo suscita de son vivant plus d’injures qu’aucun autre des titans littéraires du XIXe siècle.
L’évolution de ses positions politiques, de la droite à la gauche «humanitaire», lui valut d’être conspué tant par les socialistes révolutionnaires (un Paul Laforgue, le qualifiant de bourgeois enrichi et réduisant sa religion à «l’adoration du Dieu- Propriété») que par les extrémistes de l’autre bord, tel le mystique catholique Léon Bloy se réjouissant de sa mort en ces termes: «Ce vieux faisan de Victor Hugo (…). Que sera-ce donc des funérailles imminentes de Victor Hugo? (…) Que ne fera-t-on pas en ce prochain jour? On ameutera sans doute Paris sur ce dernier camionnage d’une pourriture si célèbre.»
En matière littéraire, les attaques de ceux qu’écrasaient ses dons et ses succès, ou que bousculaient l’enflure de sa rhétorique ou la pleine pâte de sa prose, ne furent pas moins assassines. Ainsi Jules Barbey d’Aurevilly, autre grand seigneur des lettres, écrivait à propos des Misérables : «Vous pouvez renoncer à la langue française, qui ne s’en plaindra pas, car depuis longtemps vous l’avez assez éreintée. Ecrivez votre prochain livre en allemand.»
De la même façon, Baudelaire se tortilla entre adhésion et rejet, Verlaine le sacrifia à son projet de «tordre le cou à l’éloquence», et Valéry se posa en anti-Hugo alors qu’il y a, comme le relève Louis Perche dans sa monographie récente Victor Hugo chez Seghers, dans la collection Poètes d’aujourd’hui) des échos musicaux ténus mais évidents entre l’un et l’autre.
Du côté des laudateurs, nous nous bornerons à citer la reconnaissance en filiation, consciente et généreuse (à quelques bémols près, destinés calmer les camarades de son parti) proclamée avec une emphase tout hugolienne par Louis Aragon, en 1952, dans la préface de son anthologie au titre combien significatif: «Avez-vous lu Victor Hugo?»
Retour au texte

Les commémorations, et surtout depuis que la culture selon Jack Lang en a fait des sortes de messes sociales où l’on est censé s’agenouiller en toute pieuse laïcité (Rimbaud superstar, etc.), ont au moins cela de bon qu’elles stimulent les éditions et les rééditions, et par conséquent réaménagent de nouveaux accès à une œuvre.
Malgré la question d’Aragon, celle de Victor Hugo n’a jamais été oubliée par le grand public, dont la connaissance se limite cependant, souvent, à quelques poèmes appris de force à l’école et bientôt oubliés, et plus sûrement deux romans: Les Misérables et Notre-Dame de Paris.
Dans la perspective d’une vraie redécouverte, à part celle des inépuisables Choses vues (dans la collection Quarto, de Gallimard) nous aimerions alors signaler l’édition, en livre de poche, d’un extraordinaire roman, probablement le plus envoûtant et le plus riche par sa substance poétique, politique, morale et spirituelle, qui fut mal reçu à sa parution et reste méconnu.
Son titre est L’homme qui rit, sa présente édition est établie et annotée par Roger Borderie, avec une (très) longue et (très) intéressante introduction de Pierre Albouy. Sans faire insulte à celui-ci, nous conseillons pourtant au lecteur de se plonger illico dans le texte, qui le happera comme le courant d’un fleuve, quitte à revenir ensuite à d’indispensables explications sur les thèmes et le sens de ce que Paul Claudel considérait, non sans perfidie éventuelle, pour «le» chef-d’œuvre de Victor Hugo, comme si celui-ci n’avait atteint qu’une fois ces hauteurs.
La première coulée narrative de L’homme qui rit, qui se passe dans l’Angleterre du XVIIe siècle, fait apparaître deux personnages merveilleux, au sens propre: le poète philosophe misanthrope et ventriloque Ursus, flanqué de son loup Homo. Mais c’est avec l’entrée en scène de deux enfants errants dans la tempête, qui trouvent refuge dans la petite charrette à théâtre d’Ursus, que l’on entre vraiment dans le vif du sujet.
Le petit garçon, qui se fera connaître sur les places de foire comme l’homme qui rit, mais dont le nom est Gwynplaine, a été victime, en bas âge, d’ une horrible mutilation qui marque son visage d’un rire permanent. L’association criminelle des comprachicos (achète-bébés et fabricants de monstres de tout acabit) est à l’origine de cette «opération», dont on découvrira qu’elle été commanditée par le roi en personne.
Gwynplaine est en effet le fils d’un noble tombé en disgrâce, mais c’est «tout en bas» qu’il grandira et se développera, avant qu’il ne soit rétabli dans ses droits et accède à la Chambre des lords, où il soulèvera l’hilarité générale (un rire combien plus laid que le sien) en révélant à ces messieurs la misère des humiliés et des offensés, dans un discours proprement révolutionnaire.
Tout cela paraît bien mélodramatique à l’énoncé… Ainsi que le souligne Pierre Albouy dans son introduction, L’homme qui rit écrit entre 1866 et 1868, avait pour visée «l’affirmation de l’âme humaine». Pour Hugo, «le combat pour l’âme ne se sépare pas de la lutte pour la démocratie». Vaste méditation «incarnée» sur les puissances antagonistes du mal et du bien, du chaos et de l’effort humain d’en sortir par la parole et l’action, le rôle de l’art et la fonction du poète, L’homme qui rit est un livre vivant et émouvant, dont chaque phrase nous tire en avant.
Devant l’insuccès du roman, Victor Hugo notait: «J’ai voulu forcer le lecteur penser à chaque ligne. De là, une sorte de colère du public contre moi.»
On n’en déduira pas qu’il s’agit là d’un roman cérébral. La pensée de Hugo est essentiellement d’un poète, et nous citerons ces vers d’Hernani, constituant l’exergue de la biographie récente de Max Gallo, pour distinguer le génie du poète de l’intelligence la plus pointue: «Oh! par pitié pour toi, fuis! Tu me crois peut-être / un homme comme sont tous les autres, un être/Intelligent, qui court droit au but qu’il rêva./Détrompe-toi. Je suis une force qui va!/Agent aveugle et sourd des mystères funèbres!/ Une âme de malheur faite avec des ténèbres!/Où vais-je? je ne sais. Mais je me sens poussé/D’un souffle impétueux, d’un destin insensé»… deux amours déchirant Gwynplaine, pour la pure Dea, l’enfant aveugle du début, et de la femme araignée Josiane, qui symbolise par excellence les délices de la chair.
Oui, tout cela pourrait sombrer dans le ridicule, si le roman n’était pas traversé par un souffle shakespearien (on se souvient du texte prodigieux que le poète a consacré à William Shakespeare), une incroyable énergie, une peinture de la société anglaise à tous ses étages, et une langue brassant toutes les formes de langage avec une exubérance rabelaisienne et des visions préfigurant Lautréamont et les surréalistes.
Un exemple entre mille: «La mer, dans les écartements de l’écume, était d’apparence visqueuse; les vagues, vues dans la clarté crépusculaire à profil perdu, avaient des aspects de flaques de fiel. Ça et là une lame, flottant plat, offrait des fêlures et des étoiles, comme une vitre où l’on a jeté des pierres. Au centre de ces étoiles, dans un trou tournoyant, tremblait une phosphorescence, assez semblable à cette réverbération féline de la lumière disparue, qui est dans la prunelle des chouettes.»
Voilà, cher Connétable des lettres, ce qui s’appelle de l’allemand!
Victor Hugo, L’homme qui rit, Editions Roger Borderie, avec une introduction de Pierre Albouy. Folio Classique, 838 pp.
***
70. Volkoff le mousquetaire
À la rencontre d’une oeuvre et d’un personnage…

C’est avec Le retournement, inaugurant une série de thrillers mêlant l’espionnage à la métaphysique, que Vladimir Volkoff (1932-2005) connut son premier grand succès en 1979, après une première série d’ouvrages dont Le trêtre, évoquant les dilemmes d’un prêtre orthodoxe sous le communisme.
Marqué par l’exil de ses parents autant que par la guerre d’Algérie, à laquelle il avait participé de 1957 à 1962 au titre d’officier, Volkoff tenait la position d’une sorte de mousquetaire franco-russe, hussard de l’anticommunisme très versé dans les intrigues de la guerre froide et de la désinformation, dont un long séjour aux Etats-Unis, où il enseigna, l’engagea à brocarder le « politiquement correct » dès ses premières manifestations, dans Le complexe de Procuste.
Conteur flamboyant, Vladimir Volkoff a construit, avec Les humeurs de la mer, un vaste roman polyphonique cristallisant de grands thèmes éternels, où l’opposition de Caïn le meurtrier fondateur de cités, et d’Abel l’idéaliste, se trouve notamment modulée dans le contexte tragique du XXe siècle.
Ma découverte des Humeurs de la mer sur tapuscrit, en 1979.
L’oeuvre d’art, selon Vladmir Volkoff, doit être bombée, contrairement à la vie qui est plate. Et de fait il me semble avoir pénétré dans la courbure d’un univers parallèle en commençant de lire le monumental tapuscrit, dactylographié très serré, du premier volume des Humeurs de la mer que Dimitri m’a soumis en lecture, et qui fait valdinguer une fois de plus la pauvre idée de clercs exsangues selon laquelle le roman serait mort.
Première rencontre de Vladimir Volkoff, en 1979
Je me figurais un immense type à la Robertson Davies, style grand maître dominant à lippe de séducteur et de buveur de scotch, à l’image du protagoniste des Humeurs de la mer, mais c’est un fin personnage à bouc de blé sec, court sur pattes et tiré à quatre épingles, du genre médecin ou notable de province à la Tchékhov, cordial mais un peu ampoulé, avec un rire bruyant de soldat, que j’ai rencontré en la personne de Vladimir Volkoff, flanqué d’une femme qu’il voussoye et me paraît le modèle de l’épouse légitime intelligente et fidèle, plutôt mère qu’amante et sûrement promise à s’effacer de temps à autre devant telle ou telle autre créature de chair.

Je ne sais à quoi cela tient, mais je sens chez lui quelque chose d’obscur et de compliqué, sous ses airs de fringant réactionnaire, qui m’en dit beaucoup plus sur son monde que ses explications voulues claires et nettes. Il y a chez lui du mousquetaire mais je le sens également sans père et sans fils, sans terre et sans âge, ou alors à la fois plus jeune et plus vieux qu’il ne semble (il approche de la cinquantaine), plus apatride américanisé que Russe ou Français même s’il se réclame de sa parenté avec Tchaïkovski et tire probablement l’essentiel de sa connaissance des hommes et de la vie de ce qu’il a vu et vécu durant la guerre d’Algérie. Tout de même, et une fois de plus, je suis saisi par le contraste opposant le personnage, si corseté d’apparence, et le maëlstrom des Humeurs de la mer que j’imaginais brassées par je ne sais quel démiurge échevelé…
Lecture des Humeurs de la mer
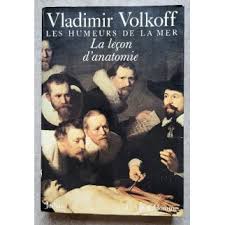
Le premier souvenir que j’ai de la tétralogie des Humeurs de la mer, qui n’avait pas encore de titre à ce moment-là, est un énorme paquet de feuilles de papier défraîchi à dactylographie serrée qui m’a transporté en quelques heures, après l’épique plongée initiale du jeune Arnim à travers la nuit américaine, dans une sorte de labyrinthe mental qui se construisait au fur et à mesure de ma lecture, comme par génération spontanée et plus précisément à la façon dont la lecture des pièces de théâtre – et je pense immédiatement à Shakespeare, si difficile d’abord et si prodigieusement précis dans toutes ses suggestions ensuite – dresse en nous un décor où des bribes de voix vont faire apparaître des personnages et les situations d’une histoire; et je me trouvais là sans beaucoup mieux comprendre ce qui m’arrivait que le pauvre Arnim au milieu de ces facultards européens répétant eux-mêmes une drôle de pièce où il était question du mythe de Caïn et Abel; et d’emblée j’avais l’impression que ce premier chaos baigné de magie avait un sens que maîtrisait probablement l’Auteur, que je voyais debout à sa table sans savoir qu’en effet Divomlikoff, alias Vladimir Volkoff, avait travaillé dans cette posture au pupitre de son pavillon de la région d’Atlanta.
Je ne sais pourquoi j’ai pensé à Dumas dès le début de cette lecture, peut-être du fait de l’allant viril et des pouvoirs suggestifs d’un récit peu porté sur l’adjectif ou la calorie sentimentale, ce côté mousquetaire du Roy-Tsar de Volkoff et d’emblée aussi l’importance de la quête et du secret. Il en va d’un message crypté.
Arnim est en quête de son père, et d’entrée de jeu la question de sa nature propre, d’agneau doux ou de prédateur, se pose dans le débat central du livre: savoir la mesure dans laquelle le Mal peut contribuer au Bien. Question fondamentale de l’éthique: Dieu a-t-il voulu le Mal ? Mais tout aussitôt le sentiment que, pour Volkoff la réponse est déjà faite, me rappelant alors le malin plaisir de notre prof d’italien à troubler nos coeurs candides en nous présentant Machiavel dans son optique de catholique de droite – du cynisme de bourgeois rassis à mes yeux de jeune protestant attiré par l’objection de conscience et lisant Camus. Pourtant ici je cède à l’élan du roman, à la magie des situations (comme en rêve) et à la griserie presque physique de la découverte – le côté Jules Verne de cette psycho-théologie tordue, où tous les hommes sont restés un peu jeunes gens, que hantent et qu’inquiètent les femmes.
Le titre d’Olduvaï fait allusion au premier crâne défoncé de notre histoire, en lequel Volkoff identifie Abel, moins intéressant à ses yeux que Caïn le premier tueur, bâtisseur de la première ville et patron des arts martiaux et poétiques. Le maître du jeu, d’abord apparu sous le nom de Bloch, qui devient Blok ensuite puis Beaujeux, est lui-même un démiurge qui dégage un fumet de viande fauve, jubilant en son narcissisme de Don Juan frotté de théologie et de littérature d’espionnage, comme l’Auteur.
Les femmes là-dedans n’ont guère d’autres rôles à jouer que ceux de maman (ou plus exactement de grande frangine maternelle) ou de “Botticelli vénal” juste bonne au repos du guerrier, et c’est ce qui fait à mes yeux la faiblesse de ce roman de mecs. Volkoff m’a dit lui-même que le sujet de Bovary lui semblait indigne du romancier, et l’option chevaleresque lui donne aussi bien son bel élan et son panache, mais tout le côté végétatif de James ou de Tchékhov me manque. Pas de place ici pour le canapé défoncé d’Oblomov…
Cependant il y a tout le reste et qui m’a captivé, surtout dans La leçon d’anatomie, où Volkoff raconte sa guerre d’Algérie de loyaliste déchiré, puis dans Intersection où l’histoire de Beaujeux et de sa compagne, racontée par leurs anges gardiens respectifs, recoupe celle de la France et de la Russie, vues du ciel comme l’Auteur voit en somme ses personnages, non sans divine tendresse au demeurant.
Volkoff se défie de Freud avec la même véhémence qu’un Nabokov, à cela près que celui-ci ne réagit en somme qu’en artiste alors que, dans la diatribe lancée par Beaujeux à la fin des Maîtres du temps, c’est dans la perspective de la religion du Père et du Fils, avec toute une civilisation patriarcale à ses basques que Volkoff réagit à ce qu’il estime à la fois la ruine des pères et la mort de Dieu.
Pour ma part je ressens les choses tout autrement: c’est bien Nietzsche et non Freud qui nous confronte à la mort de Dieu, parce que c’est Nietzsche qui a l’intuition la plus profonde du nihilisme chrétien. On peut en découdre avec Freud sans cesser de s’intéresser à ses analyses, tandis qu’avec Nietzsche il faut choisir et trancher. Le docteur de Vienne ne m’en impose pas plus que la figure du Commandeur, et la mystique du chef m’est aussi étrangère que le tremblement de Kafka devant son père, mais du moins le discours de Volkoff est-il clair, qu’on pourrait dire celui d’un preux à l’ancienne, et c’est dans l’affirmation réactionnaire et manichéenne qu’il est d’ailleurs le plus éclairant.
Le libéral Arnim, que Beaujeux aime de son haut comme un vague fils oedipien et qui finira chef d’entreprise ou fonctionnaire aux Nations Unies, n’est pas un personnage bien consistant, et d’ailleurs aucun personnage – sauf celui de la compagne du protagoniste, en faire-valoir – ne se hausse au niveau de Beaujeux. Tout le roman tourne aussi bien autour de ce pivot du Maître, qui est à la fois le représentant faillible de Dieu le Père et de l’Auteur, du Christ au poste de chef des services secrets ou de Don Juan se poissant au whisky entre deux saillies…
Reste un formidable roman de cape et d’épée idéologique à la gloire de la civilisation chrétienne et des âmes bien nées, qu’il est tout à fait logique en somme qu’un esthète proustien de l’espèce d’Angelo Rinaldi déteste au point de le descendre en flammes, sans l’avoir à l’évidence vraiment lu, dans sa chronique outrageusement intitulée Les égouts de la mer…
Chez Vladimir Volkoff, à Atlanta puis à Macon (Georgia), en 1981.
Nul individu de ma connaissance n’est aussi poseur et naturel à la fois que Vladimir Volkoff, qui me semble simultanément tout proche et d’une autre époque ou d’un autre empire, autrement dit un bon camarade qui serait au même moment corseté dans son rôle de Monsieur l’écrivain ou de Monsieur le prof, de Monsieur l’aristocrate russe en exil ou de Monsieur l’officier de l’armée visible ou invisible au garde-à-vous en son âme et conscience comme enfant il devait l’être au milieu de ses soldats de plomb.
Il m’avait invité à le venir trouver en Amérique mais sans penser que je débarquerais tout à trac non moins que fauché, et c’est ainsi qu’au téléphone on m’explique que la maison est sens dessus dessous et qu’on ne peut m’y recevoir ces jours, avant de me faire comprendre que, la femme actuelle et la mère ne frayant pas, on ne pourra se voir qu’à l’insu de l’une ou de l’autre – bref c’est dans un chapitre de roman de Volkoff que je débarque ou plus exactement dans le pavillon où Les humeurs de la mer ont été écrites à ce pupitre qu’on me propose de photographier, et l’écrivain debout comme Tolstoï ou un cheval, et la femme et la fille ensuite au repas de la Noël orthodoxe, stigmatisant de concert Rinaldi le sodomite…
Nous sommes montés au sommet tournant du plus haut building du monde, non loin de l’aéroport d’Atlanta et, sirotant un Bloody Mary, Vladimir le preux m’a fait l’éloge de Flannery O’Connor la catholique marquée par Dieu du signe du lupus et n’en chantant que plus crânement, avant que Volkoff le prédateur ne me cuisine en douce sur mes amours et me propose ensuite de revenir bientôt en Georgie où nous traquerions ensemble le gibier dans la vaste forêt.
Et telle est l’impression que me laisse cette rencontre, à laquelle je resonge en lisant le tapuscrit du Complexe de Procuste dans le Greyhound: je n’avais pas de cravate mais je me sentais en société sans être dupe, ni lui non plus, de notre mutuelle anarchie et de divers Ordres dont nous respectons tous deux les hiérarchies…
A la chasse avec Volkoff, en 1981.
L’apparition de Vladmir Volkoff en tenue de chasse, ce matin aux aurores, m’a confirmé dans l’impression que cet homme est une espèce de séminariste encanaillé pour qui toute forme, et plus précisément tout uniforme, confère à celui qui le porte une légitimité supérieure et garantit en quelque sorte l’efficace de son action, consistant en l’occurrence à traquer la bécassine dans les bois sauvages. Le pimpant de ce costume de style broussard, mais sans un faux pli, dont la tournure d’opérette est accentuée par un joli chapeau à larges bords, m’a rappelé le monde du général Dourakine plus que celui des safaris à la Hemingway, et c’est sans cesser de sourire sous cape que j’ai accompagné notre grand petit homme, nanti d’un beau fusil flambant neuf et d’une gibecière, dans les immenses forêts proches où je lui ai proposé, pour ne pas le déranger dans sa partie, de l’attendre au soleil avec mon livre du moment – et c’est ainsi qu’après nous être quittés je suis monté dans un arbre du genre sycomore où j’ai poursuivi la lecture de La conjuration des imbéciles.
C’est là-haut que m’est apparue la proximité singulière des aspirations de l’énorme Ignatius, Don Quichotte thomiste du dépotoir amerloque à dégaine de Pança pansu, et de Vladimir l’orthodoxe en guerre contre le nivellement à la Procuste de nos sociétés égalitaires, et je me suis senti comme un lien entre eux. L’informe patafiolu en mal de hiérarchies théologiques m’a rappelé ma propre attirance pour le catholicisme, de même que j’ai retrouvé chez Volkoff la chaleur spirituelle et le mélange d’intuition et de rigueur d’un Berdiaev ou d’un Florenski.
J’en étais là de mes cogitations lorsque des coups de feu m’ont annoncé la position de Volkoff dans les fourrés, dont il a bientôt surgi mais les mains vides, n’ayant fait qu’effaroucher une paire de je ne sais quels oiseaux, et me cherchant là-bas sur le chemin avant de pousser de hauts cris amusés quand il m’a localisé sur la fourche de mon sycomore. “Mais vous rendez-vous compte, jeune écervelé que vous êtes, que j’aurais pu vous confondre avec le paresseux qui hante ces bois et vous tirer tout vif ?!”
Sur quoi notre goût commun de la réalisation concrète s’est manifesté par une séance de tir au pistolet, sur une cible de papier, où je l’ai battu à plate couture mais sans le vouloir en somme, gagnant du moins l’estime de Dourakine Bis au titre de Nouveau Guillaume Tell…
A en croire Vladimir Volkoff, le mauvais romancier se reconnaîtrait essentiellement à son incapacité foncière de créer de bons personnages féminins. Or il est lui-même l’exception qui prouve le contraire: qu’on peut être un romancier très estimable sans avoir jamais réussi un seul personnage féminin…
Vladimir Volkoff. Les Humeurs de la mer. L’Âge d’Homme, Julliard, 4 vol. 1980.
***
71. Douces horreurs de l’amour
Le deuxième roman de Noëlle Revaz, Efina, démêle les fils barbelés d’un impossible amour. Entre guerre des sexes et théâtre à tout dire et son contraire. Un grinçant régal.

Dire que le deuxième roman de Noëlle Revaz, sept ans après Rapport aux bêtes, est captivant, pourrait sembler une formule convenue, mais c’est un fait : Efina vous captive, Efina vous fascine même d’entrée de jeu, ce roman-sparadrap (par allusion au Capitaine Haddock qui n’arrive pas à se débarrasser du foutu sparadrap qui lui colle au doigt et et aux semelles) est immédiatement passionnant par sa façon de vous attirer et de vous repousser, comme les deux protagonistes sont irrépressiblement attirés l’un vers l’autre et repoussés par un désir qui se nie et se multiplie à l’instant de se jurer que cette fois c’est bien fini, et ni.
Efina est l’histoire d’une obsession mimétique qui se transforme en amour plus profond que l’amour qu’il y a trop souvent dans les livres ou sur les scènes de théâtre, exaltation factice. Le roman commence par les retrouvailles de deux personnages : Efina, qui n’est rien qu’Efina, trentenaire passionnée de théâtre à ses heures, et T., comédien fameux et grand tombeur, dont la première apparition le voit, sur scène, jouer alternativement deux personnages que tout oppose : un escroc ventru et un notable raffiné. Efina voit en lui un « merveilleux comédien » auquel elle écrit le soir même en prenant soin de préciser que « l’amour n’est pas entre eux ». Et la lettre ne partira jamais. Or T. a lui aussi écrit une lettre le même soir, comme il en a écrit une au lendemain de leur première rencontre, à laquelle Efina n’a jamais répondu si tant est qu’elle l’ait reçu – ni l’un ni l’autre ne se le rappellent sûrement.

Les lettres jouent un rôle important dans Efina, autant pour « tout dire » que le contraire, pour séduire en disant le contraire de ce qu’on pense et de ce qu’on sent en inquiétant ou en humiliant (T. est un champion de ce jeu-là, pour attirer en se dérobant ou en vexant l’autre, pour séduire en jouant la parfaite indifférence, comme les deux personnages s’y emploient – théâtre de la correspondance source de tous les malentendus, aujourd’hui par courriels et textos : masques de l’aveu à distance et défi au temps…
Après s’être revus une seconde fois au théâtre, Efina et T. s’écrivent donc des lettres qui ne partiront jamais. Tout au long du roman, ils ne cesseront d’ailleurs de s’écrire des lettres, qui arriveront parfois, parfois seront anonymes, souvent diront le vrai, souvent le faux qui parfois est moins faux que le vrai. Or, au dit du roman s’ajoute ainsi le non-dit de lettres non envoyées qui, sous la signature de T., surtout, pourraient constituer un autre roman…
Efina est un formidable roman de la passion mimétique, telle que l’a décrite René Girard dans Mensonge romantique et vérité romanesque. Mais Efina n’est pas l’illustration d’une théorie : c’est la vie même et la fiction même en craintes et tremblements d’écriture. Efina croit qu’elle aime T. mais c’est peut-être une illusion, en tout cas au début. Elle lui écrit pour lui dire qu’au fond il ne compte pas pour elle, et c’est là, déjà, bien entendu, que la passion repique. Même topo pour T. Efina et T. se cherchent méchamment mais ne coucheront pas avant 40 pages, et ça n’arrangera pas vraiment les choses de découvrir une langue à consistance d’escargot ou des nibards plus fermes qu’on ne l’eut cru, car leur amour est ailleurs, n’est-ils pas ?
L’amour d’Efina et de T. est tissé par des siècles d’attente d’amour. C’est Paolo et Francesca qui lisent ensemble Love Story avec le même air blasé. T. est marié et saute des tas de femmes, Efina rencontre des hommes plus gentils que T. et s’essaie à la maternité, mais l’enfant l’embête et les hommes se succèdent comme les chiens. Et c’est comme au théâtre, entre cœur et jardins publics : ce qui s’y passe surtout, c’est surtout que le temps passe et vous fait des rides au coeur.
Or ce qui ne vieillit pas, dans Efina, c’est l’écriture de Noëlle Revaz. Curieusement maniérée au tout début, ou plus précisément « ralentie » par des expression inattendues, elle s’affûte de magistrale façon au fil des pages, sans se policer pour autant, et devient une joyeuse cavalcade de mots qui font la pige au mensonge romantique pour accéder à la vérité romanesque. Et c’est très drôle, très affreusement juste et drôle, humoristique comme la vie quand elle tombe le masque.
Il y a, dans Efina, une énergie endiablée et un humour qui passe, là encore, par les mots. On pourrait dire que c’est le roman de la dérision du romantisme, et c’est pourtant un roman très émouvant qu’Efina, avec deux admirables portraits d’âme sensibles écorchées vives. Plus on avance « dans » les personnages, plus mufle (apparemment) se montre T., plus insaisissable se montre Efina, plus mal faits l’un et l’autre pour vivre jamais l’un avec l’autre, et plus leur double solitude les rapproche en réalité, pour communiquer parfois. Sans pathos, même si la fin de T. a quelque chose de déchirant, Noëlle Revaz travaille ses personnages à la fine pointe des sentiments et, surtout, sait inscrire leur souffle et leurs pas dans l’inexorable passage du temps. Le temps du roman est un présent apparent, mais qui semble brasser le passé de plusieurs vies et nous ouvrir un autre présent à venir. Roman de la passion invivable, de la guerre des sexes et de la cruauté du grand art (car il y a de l’enfant blessé chez le grand comédien écrabouilleur), entre autres thèmes, Efina fera date (Goncourt al dente ?) et confirme le talent original, avec quelque chose de commun aux héritiers de Robert Walser (pour la candeur jouée) et de Thomas Bernhard (pour la bonne rage), d’une romancière pur jus qui a encore, sans doute, beaucoup à dire…
Bonheur enfin de lire un vrai roman qui dit le faux pour mieux exprimer la vérité, jusqu’à cette dernière phrase ailée : « Le cimetière est la maison des oiseaux »…
Noëlle Revaz, Efina. Gallimard, 182p.
72. Hugo Claus, maître flamand
Hugo Claus (1929-2008) était très légitimement considéré comme le plus grand auteur belge néerlandophone, cité depuis des années parmi les nobélisables possibles de la littérature européenne. Déployant de multiples dons d’expression, l’écrivain était aussi à l’aise dans le roman que dans le poème en pleine pâte, le théâtre ou le cinéma, et son œuvre de peintre, amorcée dans la mouvance du groupe Cobra, fit l’objet d’une monographie conséquente.

Artiste baroque et frondeur, Hugo Claus s’est toujours opposé au conformisme de classe, de parti ou de secte, à l’écoute des individus singuliers ou déviants, qui vivent une passion hors norme ou se trouvent isolés, voire rejetés par le groupe social du fait de tel ou tel trait d’ « anormalité ». Parent à cet égard d’un Faulkner ou d’une Flannery O’Connor, Claus se distingue aussi, comme ces deux grands auteurs américains, par une écriture poétique étincelante et très concentrée, qui le fait exceller particulièrement dans la nouvelle ou le roman bref. Les meilleures preuves en sont, dans la vingtaine de ses livres traduits, et avant même le fameux Chagrin des Belges, les inoubliables récits de L’espadon (De Fallois, 1989) et du recueil intitulé L’empereur noir (De Fallois, 1993), ou encore cette sombre merveille que représente La rumeur (De Fallois, 1997), et enfin les trois récits réunis dans Le dernier lit, dont les personnages ont pour point commun de vivre au bord d’un abîme.

La protagoniste de la nouvelle éponyme s’adresse, dans une sorte de lettre-récit, à sa vieille mère haïe qui l’a chassée de chez elle après l’avoir couvée et adulée pour mieux exploiter son talent d’enfant-pianiste prodige, n’admettant jamais ensuite qu’elle devienne indépendante et s’entiche, horreur, d’autres femmes que sa génitrice. A fines pointes elliptiques, mêlant les temps et les plans d’une histoire se construisant un peu comme un film mental, l’auteur nous fait percevoir les tenants du drame presque en même temps qu’adviennent ses terribles aboutissants.
Moins noire, mais non moins grinçante, et se rapportant à une situation tout aussi extrême, La tentation réinvestit l’univers, qui a souvent fasciné Claus, de la passion mystique. En l’occurrence, on sourit de connivence à l’observation des menées de Sœur Mechtilde, entrée dans les ordres après avoir perdu son premier enfant et qui se mortifie et se flagelle pour mériter l’amour fou qu’elle voue à son divin fiancé, refusant de se laver (« Qu’il se détourne de moi, qu’il se pince les narines, qu’il reconnaisse: elle est excrément !») et se fichant pas mal des réformes du Vatican (les sœurs folâtrent désormais en jupe courte, et « les hosties sont cuites à l’étranger »), non sans incarner, grâce à ses visions et à ses stigmates, la véritable attraction du tourisme religieux en Flandre-Occidentale …
Comme nous l’avons relevé à propos du premier de ces trois récits, la forme de ceux-ci est marquée, plus que précédemment, par le souci de dire plus avec moins de mots, au fil de raccourcis qui requièrent l’attention vive du lecteur. Cette économie radicale de l’expression s’accentue encore, dans Une somnambulation, du fait de l’altération du langage vécue par le protagoniste, qu’on sent dans la situation souvent décrite des victimes de la maladie d’Alzheimer. Sans indication clinique d’aucune sorte, et avec un mélange singulier de tendresse et d’humour, Hugo Claus nous fait vivre, à fleur de mots pourrait-on dire, la dégradation de la communication verbale, qui n’exclut pas la persistance, voire le développement chaotique, d’autres formes d’échange. Ainsi, des phénomènes assez proches de ceux qu’a décrits un Martin Suter dans Small World, spécifiquement liés à l’Alzheimer, trouvent ici une résonance plus générale et plus troublante à la fois, liés à une sorte de cancer verbal où « les mots endommagés se multiplieront ».
Hugo Claus. Le dernier lit. Récits. Traduit du néerlandais par Alain van Crugten. Editions Bernard de Fallois, 210 pp
***
73. Shmuel T. Meyer, contre la haine,
célèbre la ressemblance humaine
Pour lire et relire Tribus...

Avec les douze nouvelles de Tribus, souvent déchirantes, mais combien éclairantes et gages d’espoir « malgré tout », l’écrivain franco-israélien en dit plus que maints experts et autres analystes, sondant les sources de la haine qui divise aujourd’hui la société israélienne, où l’idéal sioniste s’est transformé en « messionisme » vengeur avec une violence inouïe…
Un double sentiment, d’accablement désespéré et de joie paradoxale, de tristesse partagée et de confiance confuse refusant le pire, ne cesse de s’imposer à la lecture des récits à la fois très incarnés et fortement symboliques de Tribus, nouvelle illustration de l’immense talent de Shmuel T. Meyer, vivant lui-même la déchirure vécue par les Israéliens entre eux.
« La vie était propre et simple même après l’assassinat de Rabin, parce que la colère était nourrie d’espoirs. Yoav et son épouse croyaient en la rédemption des hommes », lisons-nous dans la sixième nouvelle de Tribus, intitulée Yoav et Maya et décrivant la vie d’un couple de sexas de bonne foi (lui est le rabbin d’une communauté réformée enseignant l’histoire des religions, et elle est infirmière en oncologie), mais ladite « foi en la rédemption des hommes » a du plomb dans l’aile depuis le 11 septembre (la famille de Yoav l’accompagnait alors aux Etats-Unis pour une série de conférences ), le « judaïsme bonhomme » pratiqué par le couple a subi des coups avec la radicalisation religieuse en marche, et plus particulièrement quand un juge intègre de leur connaissance, ancien président de la Cour suprême, a soudain été placé en résidence surveillée par un sbire du Premier ministre, enfin leur communauté libérale est devenue l’objet d’injures et d’attaques physiques de la part des ultraorthodoxes conspuant les « faux juifs prosélytes d’Amérique », et la conclusion est à fendre le cœur quand ces amoureux de Jérusalem, ces pratiquants d’un « judaïsme de la joie », se font dire, par un fonctionnaire de police des frontières à dégaine de seul véritable défenseur de la tribu, que leur nouveau passeport leur ouvrira désormais toutes les portes, sauf celles de leur pays…
La vie décrite, plutôt que les bombes, les destinées personnelles et leurs « petites histoires », ressaisies dans la dérive collective de l’Histoire avec une grande hache, mieux que les analyses expertes et autres explications géo-politiques ou théologico-sociologiques: telle est la matière de ces douze modulations individualisées de la vie des gens à visages de femmes et d’hommes de conditions et de convictions diverses, témoins d’une tragédie aboutissant aujourd’hui, après un odieuse agression de masse islamiste, à un non moins abominable massacre des innocents.
Mais que peut faire un écrivain face à la Shoah, face aux pogroms, face aux fatwahs et aux razzias ? L’on se rappelle l’injonction de Theodor Adorno, selon lequel « après Auschwitz, écrire de la poésie est barbare », mais de même qu’Adorno s’est rétracté, la Littérature a prouvé depuis lors qu’elle participait bel et bien à la lutte « contre Auschwitz », et c’est « la poésie », justement, qui constitue l’un des forces de Shmuel T. Meyer, à savoir la concentration, à chaque page de chacune de ses nouvelles de la beauté et de la bonté dans le contexte humain parfois le plus haineux ou le plus laid, cette nouvelle société israélienne aux prises avec le fanatisme et ce que le penseur allemand Peter Sloterdijk appelle justement « la folie de Dieu ».
Or nous voici arrivés en ces temps où des citoyens qui ont cru à l’idéal sioniste, déçus voire désespérés par le « messionisme » qui fait danser les Messie avec Satan s’exilent en Allemagne…
« Je fous le camp », déclare le jeune Avroumchik. «Définitivement. Vancouver, Melbourne, Auckland, Copenhaugue, Berlin. Un endroit qui n’est pas ici, un endroit où tu ne serais pas juge. Un endroit où Dieu me semblera heureux »…
Dans la nouvelle intitulée Le jour du colonel, ce jeune caporal-chef chargé de conduire une juge militaire au procès d’un colonel dégradé représentant « le patron de ce qui restait de l’opposition parlementaire », taxé d’antisémitisme et de trahison par le Premier ministre et qui se suicidera le soir même, cet Avroumchik a perçu la nouvelle violence plombant la capitale de l’Etat hébreu, « une violence qui échappait au sens commun de la violence tribale, économique ou sociale », ici la violence était divine, il n’en doutait pas un instant, une justice sans miséricorde, une violence de la radicalité ».
Et le vieux Ravi, le cœur à gauche et l’âme en lambeaux, de formuler son propre désespoir dès la première nouvelle de Tribus et dans son épilogue : « Lui qui était, aux yeux de la communauté séfarade, lorsqu’il portait encore l’uniforme, un symbole de fierté, était devenu à sa retraite et depuis son remariage avec Nava, la cible préférée des prêcheurs des synagogues orientales. Il avait toujours fait le choix d’Israël contre celui des tribus. Il s’était trompé. Le tribalisme ontologique du peuple juif s’était imposé face à l’utopie du rassemblement des exils ».
Des prénoms, des visages et des voix…
Si vous ne savez rien des traditions et des rites du judaïsme, ne connaissez rien de la cuisine judéo-arabe ou des découpages territoriaux de Jérusalem et environs cousus de checkpoints, sursautez plus ou moins devant les noms et prénoms, ou autres noms de lieux, tels que Shaul et Rafi (deux vieux amis aux positions contrastées) et Nava et Ronit (leurs épouses), ou le septième enfant de dix prénommé Yakov et surnommé Koby, ou le kibboutz Kfar Avraham où sont nés divers personnages, Josh le vieux hippie transformé en mystique , Scanner le rabbin et IRM son épouse, la ville arabe bétonnée à la diable de Umm el Fahm ou la tribu hiérosolymitaine de Reb Pinhas Altschuler ; si les premières manifs de Shalom Akshav (la Paix maintenant) ne vous en disent pas plus que les éditos contestés d’Amira Hass dans le supplément de Haaretz, pas de soucis les amis : vous serez illico dans le bain malgré vous grâce à la grâce grave du conteur dont les histoires rassemblent aux vôtres, histoires de familles semblables aux familles de partout avec leur grognes à propos de tout, sauf qu’Israël ne ressemble à rien avec son Histoire taillée à la hache, son passé terrifiant et « tout » qui recommence comme aux temps bibliques des tribus en bisbilles…
Par delà l’horreur, la vie…
La composition des onze nouvelles de Tribus a été achevée par Shmuel T. Meyer le 27 juin 2023, au kibboutz Nativ Halamed Hé. L’épilogue, plus que poignant : bouleversant, est daté du 7 octobre 2023. Nous y retrouvons Rafi, en phase terminale de cancer, Nava son épouse et le jeune infirmier Idan du « camp des vainqueurs », petit-neveu de Koby de la Mousrara, mais le contraire de ce perdant : un futur médecin à large kippa qui lance au grand malade : « On les crèvera tous…ces nazis, ne vous en faites pas, Monsieur Rafaël, ces sauvages on les crèvera tous ».
Alors Nava, plus que jamais éprise de justice et de vérité, de reprendre Idan : « Ce ne sont pas des nazis. Ils ne mécanisent ni n’industrialisent la mort des juifs, ce sont des pogromistes, comme le furent les Roumains, les Ukrainiens, les Polonais, les Baltes, les Russes, les Croates ». Et la très belle femme aux cheveux blancs de poursuivre : « J’ai l’âge de ce pays dans lequel j’ai eu la chance de naître, je suis sûre que Rafi dirait « ou la malchance, imagine-toi la Californie en 1948 ». Je suis née à Jérusalem, imagine-toi Idan. Je suis née dans cette ville que tous les juifs durant toutes les générations espérèrent comme la fin de l’exil, la fin de la haine, la fin des pogroms et du gaz, et des crachats et de la peur »…
Et la vieille épouse de Rafi de poursuivre au nom de celui-ci : « Le sionisme nous avait promis plein de choses et notre expérimentation collective de deux mille ans d’exil était tentée d’y apporter foi. Les juifs qui ont toujours espéré quelque chose ont été trahis chaque fois par de faux messies venus de leurs rangs, le sionisme semblait pour certains une espérance crédible qui avait répondu à sa première promesse – le retour du peuple juif sur sa terre ancestrale. Mais il y avait d’autres promesses, Idan. Celle d’être une démocratie généreuse, mais aussi celle d’être le seul endroit au monde où les juifs seraient en sécurité. Er ces deux promesses-là, le sionisme ne les a pas tenues. Notre démocratie ? La lumière s’éteint comme une bougie qui grésille depuis 1967 déjà. Des Cosaques venus de Gaza arrachent en Israël les têtes des enfants, éventrent les femmes, les violent, les brûlent, assassinent des vieillards. Voici les deux promesses que le sionisme n’a pas voulu ou pas pu respecter, Idan ».
Et Nava d’enjoindre finalement le jeune infirmier qui va recevoir son ordre de mobilisation : « Alors, va te battre contre les Cosaque de l’Islam, mais fais respecter cette promesse avec justice et humanité et, lorsque tu reviendras de cette guerre, rallume la flamme de la démocratie qu’on y voie enfin clair dans ce pays et qu’il redevienne une espérance humaine, ici et maintenant, et pas dans un monde où le Messie danse avec Satan »…
Shmuel T. Meyer. Tribus. Gallimard, 2024. 164p.
***
74. Jean Prod’hom élargit les seuils
de l’univers qui nous contient
En un peu plus de cent pages limpides, voire parfois candides, et non moins denses et d’une belle musicalité, le rêveur à la Rousseau, promeneur des marges, que représente l’auteur vaudois, poursuit ses déambulations dans la nature accueillante autant que par le dédale de son existence passée, entre moments de déprime et minutes heureuses, tout à la célébration de « cela simplement qui est », cadeau du présent…
C’est un petit livre étroit de format et d’à peine plus de cent pages, mais assez large d’esprit et de cœur et qu’il faut tout de suite dire amical et de bonne compagnie, de bon conseil sans être sentencieux ; un livre d’une immédiate proximité ou celui qui parle de lui vous parle de vous, ou d’une sorte de nous partagé, en évoquant l’étrangeté de notre naissance et la singularité de nos enfances ou de l’adolescence telle que les uns, bien sages et alignés, ou plus rebelles , ou tout à fait solitaires, les auront vécues à travers les années, des années parfois marquées par de soudaines déprimes qu’aucun thérapeute prêtre ou coach de vie (homme ou femme si ça se trouve) n’aura soulagé sur le moment alors même que la dépression en question aura peut-être préludé à une reconstruction de soi ou peut-être à une véritable rédemption – le livre de Jean Prod’hom évoquant plus ou moins tout ça ; et j’en étais d’ailleurs à penser à nos vies, l’autre soir, tout en poursuivant ma lecture, bientôt interrompue cependant, du fond de la nuit de la forêt d’à côté , par les abois de mon fox Snoopy devenant bientôt d’inquiétants gémissements, sur quoi j’aurais pu finir assommé dans l’obscurité des bois où, à la recherche de mon chien, j’ai fait une chute aussi soudaine que brutale, tête la première et rebondissant sur une quinzaine de mètres le long de la très roide pente du ravin tapissé d’ail de ours…
Or je n’évoque pas cette péripétie par complaisance narcissique, mais parce qu’elle s’inscrit en somme dans cette fin de soirée de lecture d’un livre impliquant précisément le moment vécu de celui qui lit et ses propres sentiments ou sensations du moment…
« J’étais là, telle chose m’advint », le vers fameux de La Fontaine, pourrait être, de fait, l’exergue de ce livre intitulé Élargir les seuils et dont l’auteur, Jean Prod‘ hom, a plutôt choisi cette citation du pédagogue Fernand Deligny : « Le langage mène à tout. D’aucuns n’en reviennent jamais »… Ce qui n’exclut ni les mots qui aident, ni les paroles qui sauvent, pourrait ajouter Jean Prod’hom, à la fois pour lui-même et pour ses lecteurs.
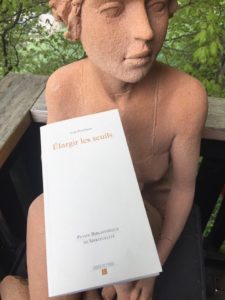
Des choses, des mots et des « je » que sont les autres…
Or le mot Désarroi figure le premier vecteur de la narration, donnant son titre au premier des cinq chapitres, plus précisément : Naissance et découverte du monde, Dimanches, Au milieu : la nuit, et enfin La Vie plutôt, tout un programme comme on le voit, accordé aux âges revisités par le narrateur, lui-même décentré, et à ce qui en nous relève de la permanence, à commencer par ce moment de fragilité existentielle suggéré par le premier intitulé qui renvoie à un état largement partagé par nos contemporains dans le drôle de monde qui est le nôtre : « Qui ne s’est réveillé un beau matin les mains vides, allégé mais sans perspective, un peu perdu ? »
Le grand mélancolique que fut Leopardi l’écrivait dans son inépuisable Zibaldone : « Pour jouir de la vie, un état de désespoir est nécessaire », et c’est le long de cet abîme « pascalien » que chemine aussi bien Jean Prod’hom, mais il chemine d’un bon pas, et c’est un premier mouvement salutaire, car il y a le chemin et les choses le long du chemin, et « les choses débordent de partout, affranchies de leurs noms, libres des fables et des représentations qui les réduisent si souvent à n’être que les auxiliaires de notre récit personnel. Elles ont non seulement retrouvé leur pouvoir d’être et d’agir mais aussi cette voix singulière que les poètes tentent de restituer dans leurs poèmes. Le vent les effleure parfois, alors qleles remuent heureuses et inquiètes ; et le frémissement qui les parcourt se répercute de proche en proche jusqu’à l’horizon. Cette mystérieuse concertation des choses ne m’est pourtant pas inconnue ; plus d’une fois j’ai surpris les arbres debout dans la nuit, les yeux grands ouvert »…
Je ne sais plus qui disait que la littérature romande découlait en partie de la cinquième promenade des Rêveries d’un promeneur solitaire de Jean-Jacques Rousseau, où il est question de relation quasi fusionnelle avec la nature et de contemplation, et cela vaut pour ce nouveau livre de Jean Prod’hom, plus encore que pour les précédents, qui s’inscrit également dans le sillage des longues virées pédestres d’un Henri-Frédéric Amiel ou des marches en plaine de Gustave Roud et des promenades de Philippe Jaccottet, explicitement cité d’ailleurs dans le premier récit. Mais un autre aspect, plus urbain et plus contemporain, marque aussi la relation de l’écrivain avec les choses et les gens, qui m’évoque plutôt la quête des « minutes heureuses » d’un Georges Haldas ou l’approche des gens par celui-ci, quand il est question ici des clients d’un café en terrasse ou, comme un leitmotiv majeur, de tel vieux berger rencontré par l’auteur dans les monts de la Drôme, dont le conseil lui est resté comme un message essentiel de sagesse : « Le vieux berger me répète depuis plus de trente ans, lèvres closes, par un mystérieux mouvement des yeux, du dedans vers le dehors et du dehors vers le dedans, mais aussi de tout son corps, que l’impossible est à portée de main, que la césure qui nous fait si souvent douter et aller de travers n’est pas tant un empêchement ou une gêne que l’appui à partir duquel il est possible de nous réconcilier avec nous-mêmes, les autres et la terre ». Et de citer, dans la foulée, un fragment des Éléments d’un songe de Jaccottet où il est question, là encore, du dépassement du désespoir par ce que Georges Haldas appelait l’état de poésie.
Les détours du spirituel et le dehors grand ouvert
Jean Prod’hom n’écrit point de vers, qu’on sache, pas plus que Gustave Roud d’ailleurs, ni ne prêche pour aucune paroisse religieuse ou politique, même si « le ménage de la poésie et du religieux », auquel il fait allusion à propos de Jaccottet, le préoccupe de toute évidence et que la présence de son livre dans la « Petite bibliothèque de spiritualité » des éditions Labor et Fides se justifie pleinement.
Or la meilleure illustration de sa « position » en la matière me semble se trouver dans le chapitre intitulé Dimanches, où il évoque sa participation aux cultes dominicaux de la communauté darbyste, en son enfance, dont ce qu’il a retenu, bien plus que le « message » des offices, est la présence d’un vieil homme chétif et solitaire chargé, en tant que concierge apparemment extérieur à la communauté, d’ouvrir les fenêtres du local entre le moment de la lecture et celui de la communion.
Contraste formidable, alors, entre l’atmosphère confinée du rituel auquel l’enfant se sent aussi étranger que le chenapan fils de quakers, dans La Loi du seigneur, qui reluque les fidèles en train de prier, et le « miracle » du grand jour révélé par le vieux concierge. Alors l’auteur de commenter : « Pourquoi ne pas le reconnaître, je dois beaucoup à ces dimanches darbystes et à cet inconnu qui, sans le vouloir ni le savoir, m’aura détourné des collectifs et de la folie qui les guette lorsqu’ils tournent le dos à ce qu’ils ont sous les yeux ».
Et de conclure en ces termes qui ne sont pas d’un « mômier » mais rejoignent en somme les « métaphysiques naturelles » communes à beaucoup de nos auteurs : « Les années ont passé mais la foi qui m’habitait est restée intacte ; je voue aujourd’hui comme hier une espèce d’adoration et de culte à l’égard de la terre et du ciel lorsqu’une fenêtre s’ouvre et qu’ils déboulent. Je concède même que, sous ce rapport, je suis devenu toujours plus religieux. Nous sommes nombreux – n’est-ce pas ? à répondre chaque matin à l’appel du dehors»…
Ce « dehors », c’est La vie plutôt, comme le suggère le titre du dernier chapitre de l’ouvrage, suivant une très belle évocation de la solitude adolescente (dans le chapitre précédent intitulé Au milieu : la nuit), la vie et ses états dépressionnaires (« Il n’y a qu’un pas entre le néant et le ciel, les gouffres et les illuminations, l’effroi et l’émerveillement »), la vie et ses cadeaux de chaque jour, la vie et ses détours dont la poésie intrinsèque scelle la valeur à l’épreuve du temps: « S’il nous faut beaucoup d’années pour ne plus consacrer nos heures à l’exercice exclusif de la raison et de la preuve, il nous en faut plus encore pour accepter l’insensé, le ciel et les rivières, l’éphémère, le jeu de l’éveil et du déclin, de la tension et du relâchement, de la vie et de la mort. Et de nous en satisfaire »…
Jean Prod’hom. Élargir les seuils. Editions Labor et Fides, « Petite bibliothèque de spiritualité », 107p. 2023.
75. Une maison pour Monsieur Naipaul
L’oeuvre de V.S. Naipaul, consacrée par le Prix Nobel de littérature 2001, est sans doute l’une des plus intéressantes de ce tournant de siècle et de millénaire, constituant une ample et pénétrante lecture du monde actuel soumis au changement et au métissage des cultures, et nous donnant à la fois des outils pour continuer à notre tour ce déchiffrement.
Naipaul est le grand écrivain contemporain du déracinement et de la recherche d’une maison. De son premier chef-d’oeuvre, Une maison pour M. Biswas (1961), à L’Enigme de l’arrivée (1987), cette autre merveille qu’on pourrait dire proustienne par le type d’immersion que nous vaut sa lecture et par la somptuosité liquide de son écriture, Naipaul n’a cessé de traiter ce thème, qui ne se réduit aucunement à la quête d’un établissement “bourgeois”, mais correspond à l’aspiration de tout individu à la dignité personnelle et à son insertion dans la société de ses semblables.
“Chacun d’entre nous possède une chose, en dehors de lui-même”, affirme Naipaul, “qui lui donne une idée de son propre statut. On ne peut pas supposer que ceux qui vivent dans la misère ne possèdent aucune espèce de dignité intrinsèque et se laisseront donc berner par n’importe quelle propagande révolutionnaire”.
Un thème corollaire de Naipaul est sa lutte contre ce qu’il appelle le “retour à la brousse”. La critique du colonialisme va de pair, chez lui, avec la remise en cause de toute forme de régression. Elevé dans une région de grand brassage de races et de cultures (rappelons qu’il est né en 1932 à Trinidad, dans les Antilles anglaises), jeune immigré solitaire et complexé, Naipaul a partagé longtemps, tout en étudiant à Oxford puis en se lançant dans une carrière de journaliste et d’écrivain, la condition des “personnes déplacées”.
Contre un certain romantisme tiers-mondiste, Naipaul a développé sa propre vision sans se contenter de rester dans sa tour d’ivoire. C’est ainsi qu’il s’est fait, après ses premiers romans, collecteur de témoignages dans une suite de récits-enquêtes où il relate (L’Inde sans espoir, 1968) sa rencontre avec l’Inde de ses origines et, rappelle, en passant, les séquelles des six siècles d’impérialisme musulman qui ont anéanti les civilisations plus anciennes, bien avant l’arrivée des Anglais. De la même façon, le romancier a exploré (dans cet autre “noeud” significatif de son oeuvre que représente A la courbe du fleuve, 1979), le Congo de Mobutu et, plus largement, la tragédie de l’Afrique d’après les indépendances.
Comme un Tchékhov faisant le voyage de Sakkhaline pour enquêter sur la situation des bagnards russes, Naipaul a accompli en outre un immense travail d’investigation sur le terrain afin d’observer les conséquences du fondamentalisme musulman dans les pays d’Orient non arabes, et ce par deux fois, à plus de quinze ans d’intervalle, dans Crépuscule sur l’Islam (1981) et Jusqu’au bout de la foi (1998).
Si l’oeuvre de Naipaul est souvent considérée comme dérangeante, c’est d’abord parce que son auteur a toujours montré la réalité telle qu’il la voyait, sans jamais chercher à dorer la pilule. “Il y a dix ans à Trinidad”, remarque-t-il, si l’on disait à une personne d’origine africaine qu’elle était noire, elle était mortellement offensée”. Or l’écrivain ne s’embarrasse pas de précautions oratoires “politiquement correctes”. Il y verrait non seulement un mensonge mais également une forme de mépris.
Evoquant la façon dont certains Occidentaux exaltent “l’Inde resplendissante”, il assimile cette attitude à l’“ultime soubresaut de la hideuse vanité impérialiste”. De la même façon, à ceux qui continuent de magnifier une Afrique où il ne font que passer en touristes ou en esthètes, il reproche d’alimenter “une des fonctions fondamentales de l’Afrique: rester une colonie perpétuelle, une petit île au trésor, un espace de jeu pour des gens qui veulent une culture-jouet, une industrie-jouet, un développement-jouet”. Quand on lui reproche de désigner la régression de certaines communautés, il répond en outre: “La condescendance se trouve chez ceux qui ne remarquent rien. Il faut être atrocement libéral pour ne pas être bouleversé par la détresse humaine. Quand on a vu la déchéance à un tel degré, on ne peut plus être le même”. Et revenant sur son Crépuscule sur l’Islam; voyage au pays des croyants, il constate enfin: “J’ai mieux compris la capacité humaine à se mentir et à se leurrer. J’ai perçu la tragédie de ces gens qui sont si mal équipés pour le XXe siècle, qui demeurent à des années-lumière du moment où ils pourront fabriquer les outils qu’ils ont fini par apprécier”.
Est-ce à dire que sa vision se réduise à celle d’un “renégat” occidentalisé à outrance, et l’image d’un Naipaul méprisant les “barbares” est-elle fondée ? La vérité est évidemment beaucoup plus nuancée. L’image négative de l’écrivain procède d’ailleurs plus des attitudes de l’homme public, qui refuse que les médias le traitent “comme un joueur de cricket” et ne ménage ses critiques ni au monde littéraire ni aux clercs confinés, qu’à ses livres. Le vrai Naipaul n’a certes rien d’avenant au sens conventionnel, qui s’est blindé pour survivre. On le dit caractériel et même impossible, mais qu’en pensent ceux qui l’ont réellement approché ? C’est ce que nous découvrons à la lecture du récent recueil d’entretiens de Sir Vidia avec une trentaine de journalistes et d’écrivains, de 1965 à 2001, rassemblés par Feroza Jussawalla dans un volume intitulé Pour en finir avec vos mensonges, et qui inclut son émouvante et très éclairante profession de foi de à Stockholm.
Pour compléter le portrait qui s’en dégage, avec ses aspects désobligeants ou plus attachants, il faut lire enfin le tout dernier livre de V.S. Naipaul, revenu au roman et à son “moi indien”. De fait, La moitié d’un vie (Plon, 2002), module par la fiction l’une des dernières boucles du grand roman d’apprentissage que figure toute l’oeuvre. Le protagoniste, double romanesque de l’auteur, a fui le sous-continent indien pour se forger une nouvelle identité dans la bohème londonienne des années 50, où il mène une vie tumultueuse avant de trouve la rédemption affective auprès d’une femme, un peu comme Naipaul lui-même a scellé les retrouvailles d’avec ses origines en épousant une Indienne et en réinvestissant la “maison” de ses ancêtres.
V.S.Naipaul est considéré, par les Britanniques, comme leur meilleur auteur vivant. Lui-même se défend pourtant d’être un maître à penser. Lorsqu’il affirme que “le style est essentiellement une affaire de réflexion”, il se distingue radicalement de l’idéologue qui plaquerait sa grille d’interprétation sur une réalité donnée. Au contraire, c’est par absorption, comme par osmose et transmutation, du fait noté à sa décantation pensée, et de la pensée à la musique de la langue, que le “style” de Naipaul “réfléchit”, dans un effort constant de décentrage. L’écrivain dit avoir toujours essayé de “voir comment les autres nous voient”. Or, la lecture de Naipaul nous aide non seulement à mieux voir le monde qui nous entoure, avec le regard nettoyé de l’étranger, mais également à mieux nous voir nous-mêmes.
V.S. Naipaul. Une maison pour Monsieur Biswas. Gallimard. L’Imaginaire, 579p.Le premier chef-d’oeuvrede jeunesse.
V.S. Naipaul. L’énigme de l’arrivée. Bourgois, 444p. Le chef-d’oeuvre de la maturité.
V.S. Naipaul. Dis-moi qui tuer. Albin Michel, 280p. Un fabuleux recueil de nouvelles.
V.S. Naipaul. Pour en finir avec vos mensonges. Sir Vidia en conversation. Anatolia/ Editions du Rocher, 2002, 326p.
V.S. Naipaul. La moitié d’une vie. Traduit de l’anglais par Suzanne
V. Mayoux. Plon, “Feux croisés”, 2002, 232p.
V.S. Naipaul. Comment je suis devenu écrivain. Traduit de l’anglais par Philippe Delamare. 10/18, 2002, 96p.
À lire aussi: V.S. Naipaul, Entre père et fils. Grasset, 485p. Une correspondance très éclairante…
Hanif Kuresihi, Le Dernier mot. Christian Bourgois, 2014.
76. Les folles fugues de Corinne
Il arrive que des «expériences négatives» soient des «bénédictions déguisées», et Corinne Desarzens en sait quelque chose. En quelques années, en effet, celle que je tiens pour l’un des meilleurs écrivains romands a perdu mère et père, ce qui arrive à tout le monde, mais également ses deux frères jumeaux, suicidés le même jour à six ans d’intervalle, chose plus rare évidemment.
Or, bien plus exceptionnels encore: la force intérieure, l’énergie et l’extraordinaire déploiement d’amour et de poésie qui lui a permis de surmonter sa peine par le truchement de son dernier livre – le meilleur sans doute à ce jour-, qui emprunte la voie du «roman» alors même que tout y est personnellement vécu. Question de pudeur, sans doute, puisqu’il y est aussi question de proches encore vivants, mais aussi de légère distance, qui lui fait observer sa propre vie de l’extérieur.
«La vie est tellement riche», m’expliquait-t-elle à ce propos, «que la raconter suppose des choix. Vous pouvez être dix personnes à avoir vécu la même chose, sans retenir du tout les mêmes détails. C’est peut-être ce qui distingue le roman du récit autobiographique. Et puis ma vie elle-même est très romanesque…»
Au-delà du «reportage»
Ce passage du témoignage vécu, limité à un «cas», à une expression plus universelle, amplifiée par la musique et la magie des mots, se vérifie d’ailleurs dans la comparaison entre Un roi et un livre précédent, intitulé Le gris du Gabon (L’Aire, 2009), où Corinne Desarzens abordait, de manière plus prosaïque, l’expérience humaine importante qu’elle a vécue à Nyon auprès des requérants d’asile depuis 2009.
En quelques traits, précisons alors qu’Un roi détaille le parcours d’une femme mariée, la cinquantaine déclinante, qui a trois enfants d’un Léo avec laquelle elle vit «la paix des braves», et qu’un mélange de curiosité et de sollicitude rapproche d’un nouveau centre de requérants d’asile sis dans un abri souterrain à Nyon, en cette même bourgade de la Côte vaudoise où se tient chaque année le festival Visions du réel.
Or ledit «réel», le plus souvent lointain, semble intéresser les journaux plus que celui de l’abri baptisé Five Stars (comme un hôtel *****) par ses hôtes de passage auxquels, il faut le préciser illico, les professionnels ou les bénévoles qui s’en occupent sont priés « de ne pas s’attacher ». Hélas la narratrice «a tout faux».
Non seulement elle s’attache, s’intéresse à l’histoire de ces damnés de la terre auxquels elle donne des cours de français, et en aide quelques-uns à trouver un job: mais elle se lie à l’un d’eux, jusqu’à faire intervenir le mari, avant que la police ne vienne le cueillir (par erreur) et l’emmener en fourgon, entravé comme un malfaiteur ou un cheval… petit détail «technique», entre beaucoup d’autres, qui fait mal au coeur.
Cependant la relation avec Nega, ce bel Erythréen fier et lucide («trouve quelque chose qui te sauve», lui conseille-t-il) mais jaloux qu’elle s’occupe aussi d’autres que lui, tournera court sur une sorte de malentendu, tout en rappelant à la narratrice la réponse du renard de Saint-Ex au Petit Prince: «On ne connaît que les choses qu’on apprivoise». De là sa décision, alors qu’un «manteau de honte» lui pèse aux épaules, de se rendre en Ethiopie, «seule issue pour comprendre»…
Corinne Desarzens a tant aimé l’Ethiopie, ses terres diverses et ses gens, qu’elle y est retournée plusieurs fois après un premier voyage organisé qui nous vaut un récit gratiné, où son observation de ses compagons de route européens n’est pas moins incisive que lorsqu’elle décrit un député nyonnais soignant son image ou la ministre rigide en laquelle on reconnaît la conseillère fédérale Widmer-Schlumpf en train de « gérer » l’affaire mémorable du jeune Irakien Fahrad.. «Je ne fais pas d’angélisme», précise-t-elle cependant et je n’ai pas de message à faire passer: je m’occupe essentiellement de sentiments, mais qui ne vont pas évidemment sans indignation tant il y a d’écart entre les paroles officielle lénifiantes et la froide réalité des faits. Par ailleurs, je n’ai pas non plus de leçon à donner, ne parvenant pas à m’impliquer plus longtemps dans des situations sans issue…»
En contraste marqué avec la froide réalité helvétique, nullement caricaturée pour autant, la partie d’ Un roi consacrée à l’Ethiopie, où s’opère une véritable résilience existentielle dans la vie de la narratrice, notamment auprès du jeune Alex, au fil d’un vrai voyage aux multiple échos humains ou livresques (Michel Leiris, Joseph Kessel et Evelyn Waugh y sont évoqués avec une rare pertinence), saisit le lecteur par la beauté d’une écriture qui n’a rien d’esthétisant pour autant, jouant du contrepoint avec une originalité renouvelée. Sans se cacher la difficulté de vivre de ses hôtes, et les conditions sociales et politiques lamentables de l’Ethiopie, et plus encore de l’Erythrée, Corinne Desarzens n’en compose pas moins une façon de psaume d’amour non sentimental, disons : poétique, dont la lumière et la musique irradient.
Cristal d’Engadine
On lit vingt-cinq lettres sur le mur blanc d’une maison d’Ardez, en Basse- Engadine, « IL .MAINT.ES.RAI.DE.L’ETERNITA », relevées par Corinne Desarzens qui les traduit dans la foulée (« le moment est roi de l’éternité »), et se les rappellera plus tard en accentuant « cette note mineure, inconsolable, qu’on entend aussi en Irlande et qui décline le sang, la faim, l’herbe, l’émigration au loin, cette face sombre si bien brassée à la volupté solaire du champ que j’en retiens moins le regret que la légèreté », et voilà, tout est dit.
Ou plutôt disons que la mèche est allumée, après quoi l’on n’a plus qu’à suivre le fil Bickford fulgurant à travers prés « vert fluo » et par les traboules des villages aux maisons « harnachées de ferronnerie, bombées, griffées de dragons », jusqu’aux petits paquets de poudre planqué de loin en loin et destinés à la fois à faire péter les clichés et à illuminer la face cachée des choses.
Corinne Desarzens écrit en général à plat ventre, par terre ou dans l’herbe, mais elle dessine aussi (cinq ou six beaux croquis émaillent d’ailleurs sa prose) et ce qu’elle dit du dessin vaut pour son écriture: « Dessiner met des yeux ai bout des doigts, la vie se concentre, palpite, le reste disparaît, et c’est un peu comme l’amour, qui fait sortir de soi… »
De fait, tout ce qu’elle écrit est plein d’amour, non pas au sens sentimental mais au sens de l’élan curieux hors de soi et d’une curiosité qui sonde le secret et l’âme des choses. Elle note ainsi que les maisons grisonnes ont une petite fenêtre pour laisser l’âme s’envoler, et que le mot secret désigne, en langue romanche, les lieux d’aisance…
Curieuse au point d’apprendre l’un des cinq idiomes du romanche et de nous en servir au passage une louche de chuintantes (« Tschinch chatschaders van a chatscha da tschinch chamuoschs e tchinchtchient tschiervis », ce qui signifie bien sûr « cinq chasseurs vont chasser cinq chamois et cinq cents cerfs »), Corinne Desarzens ne cesse de lier saveurs et savoirs, sensations et sonorités verbales.
Du même coup elle nous apprend des Grisons une foultitude de détails, et par exemple qu’on y appelle les migrants hirondelles (randulinas) et les chemins de traverse palingorenas, que les sauterelles d’Engadine sont « vert pois », ou que « le ciel est noir, la neige bleue, l’instant jaune citron » et qu’une certaine église « pourtant minuscule a une antichambre avec une potence, pour suspendre le gibier à bénir ».
Afin de lui rendre la pareille, gibier de cette chasseresse au pied léger et au gai savoir, le lecteur bénit à son tour Corinne Desarzens qui lui a rappelé que « les sirènes ne se montrent qu’à ceux qui sont prêts à partir avec elles »…
De l’herbe et des araignées avec ou sans fil
Dès qu’on se met à lire ce premier livre au beau titre , Je voudrais être l’herbe de cette prairie, inscrit en lettres vertes sur la couverture agréablement orangée, après en avoir d’abord coupé les pages à l’ancienne manière civilisée (hélas inconnue des cadres des grands magasins Manor, qui ont renvoyé le stock à l’éditeur en le déclarant «impropre à la consommation ! »), on se trouve saisi par une espèce d’allégresse un peu folle: «Avec les escrocs internationaux et les chevaux, l’herbe partage une caractéristique: elle ne dort jamais, ou très peu. L’hiver l’oublie, le printemps la redresse, l’automne lui retire ses sucs. Elle est là et plus là. Toujours là sous les pieds, dans les rêves. De l’herbe froide affrontée en pyjama trop léger à l’élastique distendu à la taille. Il ne fait ni nuit ni jour. Rien ne s’interpose entre le ciel et ces pieds nus, qui se mettent à courir, pour une balle perdue dans l’herbe, pour la brûlure, pour le plaisir».
Et l’on serait bien tenté de coudre cent autres citations de la prose fuguée qui constitue les pages de ce livre et celles de son jumeau paru simultanément sous une couverture analogue et avec un titre de tonalité proche (Je suis tout ce que je rencontre) pour faire goûter au lecteur cette écriture à peu près incomparable, n’était à celle du génial Charles-Albert Cingria, certes plus continûment inspiré et profond que sa folâtre disciple, mais partageant avec celle-ci la propension à «la déclaration d’amour, dans une oeuvre où pas une ligne ne parle d’amour».
Et cette seconde citation se rapportant justement à Cingria s’impose encore à l’évidence: «Son herbe c’est de l’eau, comme le corps, fragile comme lui, citadine, ce que le rat est au ruisseau invisible, le sanglot à l’amour, la peinture au mur, le café au croissant, la sève au probable, une odeur avant-coureuse, lui qui trouve la paille douce, le fumier violent, le sol tendrement noir. Un raccourci de l’instant présent. Une courbe de santé…»
De même que Corinne Desarzens distingue «ceux qui dorment avec leur montre et les autres sans», le vénérable essayiste anglais Isaiah Berlin discernait, chez les écrivains, le type du renard et celui du hérisson.
Le premier (un Cingria) grappille et produit une oeuvre plutôt baroque à labyrinthes, le second (un Ramuz) stocke une oeuvre solidement «tenue ensemble».
Or, les deux ouvrages dont il est ici question réalisent la combinaison de ces deux tendances du lyrisme digressif et de l’accumulation concentrée. La suite fuguée de Je voudrais être l’herbe de cette prairie correspond en effet, tout naturellement, au voyage ferroviaire à travers l’Europe, du Portugal en Russie, que restituent ces récits, tandis que Je suis tout ce que je rencontre se tisse et se déploie par rayonnements concentrique à l’imitation de l’araignée, inspiratrice à la fois très familière et trop méconnue de ce subtil traité.
Lectrice aux curiosités insatiables, aussi attentive à la déambulation d’une Argiope frelon au plafond de sa cuisine qu’à une partition de Bach (une page qu’il est mortifiant de ne pouvoir citer toute!) ou à l’interprétation d’une scène de théâtre nô, entre mille autres intesections du vivant et de ses transmutations,
Corinne Desarzens donne autant qu’elle absorbe, et c’est un bonheur rare que de la suivre en ses impros de musique verbale…
Corinne Desarzens. Un Roi. Grasset, 298p.
Corinne Desarzens. Sirènes d’Engadine. Editions du Laquet, coll. Terre d’encre, 123p.
Corinne Desarzens. Je voudrais être l’herbe de cette prairie. Récits. L’Aire, 144p.
Corinne Desarzens. Je suis tout ce que je rencontre. Récits. L’Aire, 240p.
***
77: Mater furiosa
À propos de Campagnes, de Louis Calaferte.

Une sombre beauté se dégage de cet affreux tableau de la vie paysanne, qui me fait penser aux souliers et aux gueules du premier Van Gogh de la glèbe hollandaise.
La Marie de Calaferte, dans Campagnes, est un personnage de mater furiosa qui réunit à peu près tous les vices, exacerbés par l’alcool, et pourtant il y a une sorte de grandeur dans sa mesquinerie teigneuse, et comme une dimension dostoïevskienne dans la violence de sa passion destructrice, qui nous la rend presque aussi proche, malgré sa rouerie et sa méchanceté, que son Joanny tout droit et consciencieux, qui s’acharne à planquer l’argent qu’elle lui vole en douce et à réparer tout ce qu’elle dégrade ou démolit à mesure, battant ses enfants dès l’aube, vidant le poivrier dans la soupe et menaçant à tout moment les siens de s’égorger ou de se jeter à l’eau.
On n’aime pas cette sale carne, mais le personnage reste terriblement humain, comme Alceste ou Tartuffe, avec ce mélange d’épique et de comique, mais aussi de faiblesse et de détresse, qui fascine autant sinon plus que les figures de victimes ou de justes.
Plus que la Marie, c’est la condition même de ces paysans pauvres de l’époque de la Grande Guerre qui nous semble cruelle et dégradante, et le constat me rappelle ce qu’on m’a raconté des paysans de notre famille fuyant la terre à la même époque : «Des sept enfants, pas un ne restera sur cette terre à laquelle leur père a consacré sa vie. »
Lorsque, après avoir failli tuer Marie, Joanny se retrouve mourant à ses côtés, elle en arrive à boire encore l’eau de Cologne nécessaire à sa toilette, mais sa propre fin à elle ne manquera pas pour autant de gueule, stupéfiant ceux qui la soignent par le courage qu’elle montre face à la Douleur…
Louis Calaferte. Campagnes. Récit. Denoël.
***
78. Une impossible quête de vérité

Par l’un des plus grands écrivains italiens actuels, Impossible nous confronte au passé des «années de plomb» italiennes, abordant les thèmes de la violence révolutionnaire, de l’amitié trahie et du clivage entre générations, notamment…
Que s’est il vraiment passé ce jour-là, sur cette vire vertigineuse des Dolomites de laquelle tel homme a soudain dévissé pour se fracasser dans les rochers, avant que tel autre, qui le suivait de plus ou moins loin, ne donne l’alerte conformément à la loi non écrite des montagnards ? Qui d’autre que ce dernier pourrait témoigner de ce drame ? Et pourquoi son appel à l’aide s’est-il transformé en geste suspect au regard d’un juge d’instruction, au point qu’il se retrouve incarcéré pour soupçon d’homicide après qu’un lien personnel «historique» a été établi entre les deux hommes, tous deux anciens révolutionnaires dont l’un, trahissant ses camarades, à valu à l’autre des années de prison.
Et si c’était une vengeance ? Si la présence des deux hommes sur la «vire fatale» n’était pas une coïncidence, comme le prétend obstinément le narrateur ? Si celui-ci avait ourdi et camouflé une sorte de guet-apens ? C’est ce dont le magistrat est persuadé, mais comment établir la vérité ? Et qu’en est-il «au final» de celle-ci ? L’affirmer est-il possible ? C’est ce que se demanderont la lectrice et le lecteur d’Impossible, dernier roman paru d’un des auteurs italiens les plus vifs, en dépit de son âge, et les plus intéressants de l’heure, dont ce nouvel ouvrage, concis et d’une profonde résonance poétique, rappelle les fables de cet autre écrivain-grimpeur que fut Dino Buzzati et, pour ses connotations policières et politiques, les investigations romanesques d’un Leonardo Sciascia, lequel est d’ailleurs cité à plusieurs reprises par le protagoniste.
Un récit à multiples facettes
Le narrateur en question, comme Erri De Luca, est un ancien militant d’extrême-gauche et un frère de ces «conquérants de l’inutile» dont parlait l’alpiniste français Lionel Terray. Peu importe, au demeurant, dans quelle mesure les parcours des deux personnages coïncident, mais ce que dit le narrateur, de sa vie et du monde passé et présent, recoupe en tout cas ce que nous savons de l’écrivain: à savoir qu’il vient du Sud, est issu d’une famille modeste, n’a pas fait d’études universitaires mais a été ouvrier et néanmoins grand lecteur, a milité dans une organisation révolutionnaire sans participer pour autant à la lutte armée, etc.
Ce qui est sûr, aussi, c’est qu’Erri De Luca est en mesure de comprendre son narrateur, alors que celui-ci pense que le jeune magistrat qui l’interroge ne le peut pas vraiment. Or cette question de la difficile compréhension entre générations – celle de l’écrivain et de son narrateur ayant été «la plus poursuivie par la justice de toute l’histoire d’Italie » n’exclut pas une possibilité de communication plus ou moins fraternelle, comme on le verra dans l’évolution des relations entre le prévenu et le magistrat -, ni bien sûr la compréhension affective éclairée par la relation amoureuse, comme on le voit au fil des très belles et très tendres lettres que le détenu envoie à sa compagne beaucoup plus jeune que lui…
De la vérité et de ses interprétations
Affirmer qu’il n’y a qu’une Vérité, évidemment assortie d’un V majuscule, relève de l’autorité d’une doctrine de justice ou d’une dogme religieux qui se veulent indivisibles, au contraire des vérités à visages humains aux multiples approches et possibles interprétations ; et ce qu’on peut rappeler, dans la foulée, est qu’Erri De Luca est, depuis longtemps, un lecteur et un traducteur assidu de la Bible, même s’il se dit non croyant sans être athée…
Dans son dernier roman, sans doute marqué par les démêlés judiciaires récents de l’écrivain, ex-communiste passé par l’anarchisme et rallié à la cause altermondialiste, la version du narrateur s’affronte aux convictions «intimes» du magistrat, au fil d’une enquête où interviennent des témoignages extérieurs, à vrai dire fragiles, des indices qui ne le sont pas moins, des investigations portant sur le passé commun de la «victime» supposée et du présumé suspect, à quoi s’ajoutent, au fil du temps, les réactions des anciens camarades du narrateur et des médias, etc.
Un thème central d’Impossible, qui s’ajoute à celui de la quête de vérité, est celui de la trahison du «collaborateur de justice», qui a balancé ses camarades pour des raisons non précisées ici mais qui pourraient se discuter. De fait, certains révolutionnaires repentis avaient des raisons, devant les excès de la lutte armée, de se rallier à la répression du terrorisme. Et qui pourrait exclure que le jeune magistrat lui-même généreux et intelligent, cherchant à comprendre son prévenu, n’aurait pas été, cinquante ans plus tôt, du côté des contestataires ?
Par sa forme même, alternant les interrogatoires (auxquels participe, contre la volonté du prévenu, un avocat d’office au rôle ambigu), les lettres du narrateur à sa compagne et une missive finale du magistrat lui-même, le roman de De Luca module en quelque sorte le débat auquel le lecteur se sent forcément convié, dont la conclusion splendide, évoquant quelque mythique combat ancestral, n’explique rien de façon «rationnelle», ressortit à la poésie et rappelle le titre d’une des pièces du grand analyste des ambigüités humaines que fut Luigi Pirandello, À chacun sa vérité…
Erri De Luca. Impossible. Traduit de l’italien par Danièle Valin. Gallimard, coll. Du monde entier, 2020, 171p.
***
78. Un exil entre amours et colère

Dans Les Allées sombres d’Ivan Bounine, le grand écrivain russe passe les sentiments au filtre du temps et d’une poésie claire-obscure.
On entre dans ce livre par une sombre allée battue de pluie d’automne, le long de laquelle roule une lourde voiture couverte de boue – et c’est aussitôt comme l’image de notre propre course dans l’enfilade des années qui nous apparaît, avec le souvenir confus des saisons radieuses et des joues qu’on aimerait oublier à jamais ; et de même le vieux militaire qui débarque dans l’auberge accueillante qu’il y a là découvrant, en la personne de l’aubergiste, la femme qu’il a aimée et abandonnée trente ans plus tôt (car ce n’était alors, n’est-ce pas, qu’une servante), nous semble-t-il l’incarnation symbolique de l’homme confronté, par delà les années, à ce que la vie lui a donné de meilleur.
À peine plus de cinq pages, et ce sont deux destinées ressaisies pour l’essentiel, toutes deux marquées par le même sceau de l’amour: cette intimité partagée, ces instants qu’on imaginait éternels, ces nuits d’été propices aux confidences et aux baignades secrètes, ces irrépressibles élans, folies de jeunesse ou plus tardives rencontres, comme autant de fugaces image du bonheur en ce monde.
Ce bonheur, Ivan Bounine l’a évidemment connu pour en parler si bien. Ainsi l’écrivain en exil évoque-t-il souvent la Russie de ses propres souvenirs avec un mélange de verve et de nostalgie, de lyrisme et de mélancolie qui localise en quelque sorte son paradis perdu. Mais pas plus qu’il ne se borne à l’anecdote passionnelle, Bounine ne se limite à la déploration de son exil. Aussi bien les histoires qu’il raconte sont-elles tissées de sentiments et de vérités universels, et sinon comment expliquer que, tous tant que nous sommes, nous nous reconnaissions dans ces pages qui sollicitent à la fois les sens et l’émotion, l’expérience de chacun et sa vision du monde ?
Au demeurant, nulle spéculation désincarnée dans ces nouvelles, ni la moindre morale plaquée, mais une sorte de mosaïque qu’on pourrait lire en trois dimensions, où l’art de l’écrivain emprunte tour à tour à la rapidité du cinéma, à la magie suggestive de la musique et aux pouvoirs expressifs de la peinture, avec de constantes inventions du point de vue du récit.
Amours incarnées
Mais venons-en, plus précisément, à la substance de ces trente-huit nouvelles composées en France entre octobre 1938 et juillet 1944, dont certaines tiennent en une page et qui forment un tout organique en dépit de leur grande variété de ton et d’atmosphère. Nous l’avons dit : l’amour en est l’élément fondamental. Or ce qu’il faut souligner, c’est, à tout coup, l’enracinement charnel de ces rencontres d’un érotisme souvent intense, voire à la limite du scabreux, que Bounine évite de franchir par compensation d’émotion. Certaines de ces étreintes sont aussi frustes et violentes que celles de l’ours « Pélage de fer », violeur redoutable de la légende russe. Mais ce n’est certes pas un paradoxe que des situations combien triviales puissent inspirer des sentiments plus délicats… À égale distance des clichés édulcorés et de la fausse hardiesse contemporaine qui ne révèlent plus rien force de vouloir tout montrer, Bounine se fait en somme le chantre sans préjugés de ces amours qui ne sont pas forcément les premières ni les seules, mais dont le souvenir nous reste avec une intensité sans pareille. Cela peut ne tenir qu’à des riens : au grain velouté d’une peau, à la beauté d’un corps, à l’aura d’un visage ou au reflet troublant d’un regard.
Il n’en faut pas plus, assurément, pour faire perdre la tête aux petits étudiants que nous trouvons dans Antigone, dans Zoé et Valérie ou dans l’admirable Nathalie. Mais ajoutons, à propos justement de ces trois nouvelles restituant l’atmosphère quasi mythique des vacances russes à l’ancienne, que le charme de celles-ci compte aussi pour beaucoup dans l’éclosion de ces passions juvéniles, donnant lieu à des évocations qui rappellent à la fois la plénitude sensuelle de Tolstoï et la grâce mélancolique de Tchékhov. Soit dit en passant, rappelons que tels étaient les deux maîtres dont se réclamait Bounine, qui les égale parfois à bien des égards.
Ombres et lumières
Ainsi que le note pertinemment Jacques Catteau dans son excellente préface, « Ivan Bounine pressentait l’oubli, l’ombre froide et mystérieuse du caveau, et pourtant, dans le même temps, il œuvrait à la chaude journée d’été de la vie ». Sans la trempe du Tolstoï « métaphysicien », et beaucoup moins sombre que ne le devint Tchékhov, le premier Nobel de littérature d’origine russe (en 1933, au dam du pouvoir stalinien) réalise une manière d’équilibre dont les relations qu’il entretient avec ses personnages sont peut-être la meilleure illustration.

De fait, Bounine est capable de parler d’une grisette moscovite avec la même attention amicale que celle qu’il voue à tous les autres, fussent-ils artistes ratés ou généraux en retraite, demeurés obscurs (la terrible nouvelle intitulée L’idiote, où l’on voit un jeune séminariste engrosser la cuisinière de la maison avant de l’en faire chasser avec l’avorton qu’il lui « donné »), ou brillants exilés.
De même, cette équanimité préside aux rapports que l’écrivain entretient avec les lumières et les ombres de l’existence humaine. Mélange de chaleur et de lucidité, son regard fait part égale aux surprises de l’amour et à ses revers. Les femmes (dont il faudrait détailler la frise magnifique des portraits) ne sont pas toujours victimes, loin s’en faut, pas plus qu’elles ne sont toutes fatales.
Certaines de ces histoires semblent finir bien, comme Une vengeance où, contre toute attente, deux êtres éprouvés par la vie s’aperçoivent qu’ils sont faits l’un pour l’autre. D’autres s’achèvent tragiquement comme Galia Ganskaïa, ou tristement, comme ces deux joyaux que représentent Paris et Premier lundi de carême. D’autres encore ne finissent pas : un jour sur un bateau, le grand écrivain X. rencontre la charmante Y., dont le rêve d’enfance était de se faire faire des cartes de visite… et la prochaine escale de les séparer après une seule nuit de volupté, les laissant tous deux « avec cet amour que l’on garde à jamais blotti au fond du cœur ». Entremêlés avec un art suprême, les thèmes de l’amour, de l’exil, de l’errance et de la mort constituent ainsi la trame vivante et vibrante des Allées sombres, dont les résonances nous touchent infiniment.
Journal des Jours mauditsAu lendemain de la révolution bolchévique, du 1er janvier 1918 au 20 juin 1919, Ivan Bounine tint un journal. À l’approche de la cinquantaine, le futur premier Nobel russe de littérature (en 1933) était déjà reconnu comme un classique de sa génération, auteur d’une fresque dans laquelle il avait décrit les rudes aspects de la vie des moujiks (Le Village, 1909) et qu’on aurait pu dire le triple héritier de Tolstoï pour le style, de Tchékhov pour son attention aux humiliés, ou encore de Tourgueniev pour sa pénétration des sentiments les plus délicats.
De ce dernier aspect, la meilleure illustration a été donnée par Les années sombres, datant de l’exil et constituant son livre préféré et son chef-d’oeuvre.
Dans ces Jours maudits, nous découvrons un honnête homme confronté, au jour le jour, à un ouragan social et moral qui ravage tout ce qu’il a aimé au nom d’un « Avenir radieux » dont il voit immédiatement quels abus et quels simulacres il camoufle.
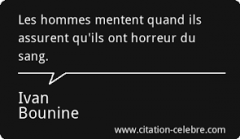
Aux premières loges, il note que les Bolchéviks sont les premiers stupéfaits du succès de leur putsch. Et puis il observe le simple comportement des gens, le changement du langage et des visages. Car tout à coup se manifestent cet élan, cette arrogance, cette hargne, cette vindicte qui lui font noter : « Un langage est apparu, tout à fait nouveau, spécifique, composé exclusivement d’exclamations grandiloquentes mêlées à des injures grossières ». Et de repérer les nouveaux arrivistes, les délateurs, les profiteurs opportunistes, les salopards qui vont s’auto-proclamer commissaires politiques et proclamer leurs épouses femmes de commissaire politiques…
Le premier il dénonce l’imposture de cette rhétorique qui dit que « le peuple a dit ! ». Contre les poètes flirtant avec la Révolution, les Blok et les Maïakovski, il se déchaîne : « Ô fornicateurs du verbe ! Des fleuves de sang, des mers de larmes, mais rien là qui les touche ! ». Ainsi se fait-il le témoin de cette tragédie, inébranlable et atterré, par fidélité à un monde conspué. En attendant de survivre ailleurs, une pierre au cœur…

Ivan Bounine. Les Allées sombres. L’Âge d’Homme, 1988.

Ivan Bounine. Jours maudits. L’Âge d’Homme, 1988.
***
79. Imre Kertesz, témoin capital
Une rencontre et quelques lectures pour l’accompagner…

Que ressentait Imre Kertesz, ce matin-là, quand il est entré dans la Salle du Belvédère bondée, au dix-huitième étage de la Tour des Lois dominant un Paris baigné de grisaille et d’aigre crachin ? Qu’a-t-il pensé à la vue des rangées de bouteilles de Veuve-Clicquot (sponsor) qui flamboyaient à l’entrée ? Cette vision lui a-t-il rappelé le «bonheur sans fard» des poux qui dévoraient ses plaies à Buchenwald, ou bien a-t-il revu soudain son visage de déporté de quinze ans, sur lequel il remarqua «les plis et rides caractéristiques des hommes que l’abus du luxe et des plaisirs a fait vieillir avant l’âge» ?
Ensuite, qu’a-t-il bien pu se dire en découvrant tout ce monde, Hongrois de Paris ou gens des médias venus rien que pour lui en ce haut-lieu de la nouvelle Bibliothèque nationale de France ? S’ennuyait-il déjà ou se sentait-il bien ? A-t-il été blessé d’apprendre qu’un tract d’inspiration révisionniste avait circulé dans la salle avant son arrivée, ou cela lui semblait-il aussi «naturel» que de recevoir des coups de son tortionnaire attitré, il y a de ça presque soixante ans, autant dire tout à l’heure ? Et lorsqu’un «effet de Larsen» fit hurler l’un des micros installés pour lui et ses vaillants éditeurs, n’a-t-il pas sursauté intérieurement en se rappelant certaine épouvantable voisine du dessus, du genre «cyclope féminin se nourrissant de bruits», à Budapest, quand il essayait d’écrire un nouveau livre dans son logis d’obscur plumitif, à l’époque du «socialisme goulasch» ?
Je me posais ces questions en voyant s’avancer, à pas lents, cet homme qui se dit lui-même un Jedermann, donc un Monsieur Tout-le-monde, le visage rayonnant de la même espèce d’irradiante détresse dont la cendreuse aura baigne tous ses livres, et l’air un peu de se demander ce qu’il faisait là comme il se l’est demandé, un certain jour au beau lever de soleil rougeoyant, quand il s’est retrouvé, après un voyage ennuyeux et assoiffant, en un lieu appelé Auschwitz-Birkenau, au milieu de bâtiments et d’«espèces d’usines» dont les cheminées bavaient une fumée à l’odeur «douceâtre» et «en quelque sorte gluante» ?
Ces rapprochements étaient évidemment incongrus, et pourtant ils me venaient «naturellement» à l’esprit, comme dictés par l’esprit même de Kertesz, qui fait communiquer à tout moment, dans ses livres, tous les temps et toutes les situations. Toute «professionnelle» ou «mondaine» qu’elle fût, cette «conférence de presse» signifiait beaucoup plus, pour les vrais lecteurs de Kertesz réunis, qu’un «must» médiatique (ce que confirmait joyeusement l’absence totale des «stars» du monde littéraire parisien), comme solidarisés par un sentiment commun.
Simplement, les lecteurs marqués par Imre Kertesz, comme celui-ci a été marqué par un destin non désiré, se réjouissaient d’être là sans penser du tout que l’écrivain en dirait plus que dans ses livres. Mais quelle pure ferveur dans cette présence commune ! Comme le jeune Imre s’extasiait sur la beauté des gens qu’il croisait dans les ruines de Budapest, à son retour de Buchenwald, il nous semblait ce matin-là que la vie valait la peine d’être vécue; et nous revint la remarque incroyable du jeune protagoniste d’Etre sans destin, quand, à moitié mort, après qu’un infirmier lui a arraché son lambeau de couverture parce qu’il l’estime «fini», le voici qui entend «la voix d’une espèce de désir sourd, qui s’était faufilée en moi comme honteuse d’être si insensées, et pourtant de plus en plus obstinée: je voudrais vivre encore un peu dans ce beau camp de concentration».
Or la Salle du Belvédère n’était pas mal non plus, ce matin-là, avec ces gens qu’on sentait (sauf le réviso dans son coin) pleins de reconnaissance pour le «héros du jour»; et Martina Wachendorff, qui a dirigé l’édition française de Kertesz, lançait maintenant la discussion, amorcée par un chaleureux éloge de François Fejtö, figure majeure de l’émigration magyare qui remercia l’écrivain d’avoir «si merveilleusement» revivifié leur langue commune.
Un Prix Nobel de littérature, on s’en doute, est censé se prononcer sur tout. En l’occurrence, cependant , les questions générales ont été épargnées à Kertesz, sauf sur l’avenir européen de la Hongrie. «Pour ma part, je m’estime déjà dans l’Europe, a-t-il déclaré en souriant. Quant à la Hongrie, elle a encore du chemin à faire en ce qui concerne l’intégration de sa propre histoire, depuis le traumatisme de 1919.» Comme c’est désormais la coutume, confort intellectuel oblige, le nobélisé a été prié d’expliquer en outre pourquoi il n’avait pas refusé, lui qui est «un résistant», cette consécration ? A quoi l’écrivain a répondu que le Nobel était une «merveilleuse récompense», même si elle ne changeait rien pour lui d’un point de vue existentiel. «J’ai eu la chance de travailler dans l’ombre pendant des années», a-t-il ajouté. «Ainsi ai-je échappé aux tribulations d’un Pasternak ou d’un Brodski».
Imre Kertesz a dû s’expliquer cent fois, déjà, sur les raisons qui l’ont poussé à écrire un roman plutôt qu’un témoignage autobiographique. Mais une fois de plus, il a déclaré que le roman était à ses yeux «plus objectif» et qu’il lui permettait d’aller «sous la peau du lecteur», en quelque sorte. «J’ai été chargé d’un fardeau», a-t-il précisé, «que je dois transmettre au lecteur». Une fois de plus, il s’est expliqué sur la saisissante «naïveté» du protagoniste de son chef-d’oeuvre, qui aboutit soudain à quelle effrayante mue physique et à quel mûrissement intérieur, pour agir sur le lecteur d’une manière si profonde. Enfin, comme nous l’interrogions personnellement sur ce qu’on pourrait dire, selon l’expression de Léon Chestov, les «révélations de la mort», dans sa vie et son oeuvre, Imre Kertesz nous a confié que la perception de la mort, des autres d’abord, puis de la sienne propre, l’avait bel et bien transformé à Buchenwald. «C’est cette expérience, d’une certaine manière, qui m’a libéré»…
Être sans destin n’est pas un livre anti-fasciste ni un réquisitoire documenté sur les camps de concentration: c’est un roman de formation, ou plutôt de «déformation», le récit candide d’un garçon qui, a quinze ans, a été (gentiment) prié de descendre d’un autobus, pour se retrouver bientôt avec une petite foule d’autres jeunes gens, puis dans une grande foule de juifs de tous âges. Après trois jours à Auschwitz, où il voit ses compagnons de voyage partir en fumée, il se retrouve à Buchenwald où il va devenir, en quelques mois, un cadavre vivant. Sur un ton préfigurant celui du film de Roberto Begnini, ce livre (1975), infiniment troublant par son humour, déjoue toute tentative de réduire le déporté à son rôle de pure victime innocente qui doit absolument renaître et donc oublier. Sali par le destin, Kertesz dépose sur notre front la même tache humaine.
Imre Kertesz. Être sans destin. Traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. Actes Sud, 366p.
LE ROMAN DE LA NÉGATION
Des années après la composition de son premier livre, un écrivain survivant à l’écart en alternant traductions et comédies médiocres, se rappelle les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires de l’édition, à Budapest, lui ont refusé son ouvrage jugé «un peu amer» ou «de mauvais goût», incapable de «donner une expression artistique» à un sujet pourtant «terrible et bouleversant». D’une écriture singeant violemment le réalisme socialiste, ce livre aussi singulier que le premier, mais plus hirsute, constitue l’exorcisme du second choc traumatique vécu par nombre de déportés, et une méditation bouleversante sur la Shoah vue avec le recul des années. Dans sa seconde partie, revenu du fond de son désarroi, l’écrivain brosse un tableau ravageur du socialisme réel à la manière hongroise. Telle étant la pièce centrale (1988) de la trilogie de l’«absence de destin».
Imre Kertesz. Le Refus. Traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. Actes Sud, 348p.
LITANIE DU REFUS

Troisième élément du même triptyque, Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas résonne comme un long cri de révolte et de désespoir, immédiatement lancé au ciel sous la forme d’un «non» radical et sans appel, ensuite modulé comme une plainte relevant tour à tour de la douleur la plus vive et d’une colère cosmique rappelant celle de Job. Empruntant son titre à la fameuse oraison funèbre de la tradition juive, ce livre extraordinairement tendu, de structure très savante, est simultanément un roman et un poème d’une puissante amplitude émotionnelle. Jouant sur d’incessantes reprises thématiques et musicales, cet ouvrage d’imprécateur (1990) est lui aussi un exorcisme littéraire de la «vie invivable» que la déporté à choisi de vivre sans retrancher rien de ce qui a été ni de ce qui continue d’être, mais en refusant de donner une vie de plus à la vie.
Imre Kertesz. Kaddish pour l’enfant qui ne naîtra pas. Traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. Actes Sud, 158p.
Au lendemain de l’effondrement du communisme, en 1991, Kertesz vit une nouvelle période de désarroi personnel tandis que ceux qui, pendant des décennies, ont pratiqué la langue de bois, se justifient pour mieux rebondir dans la nouvelle société «libérée». Avec une lucidité qu’aiguise chaque jour la lecture de Wittgenstein, dont il est en train de traduire les Remarques mêlées, Kertesz note que «la leçon qu’on peut en tirer est que ces hommes ont consacré leur vie à un mauvais usage du langage. Mais aussi, et c’est déjà plus grave, ils ont promu ce mauvais usage au rang de consensus.». Tout au long de ces pages tissées de réflexions et de lectures, de rencontres et d’observations, qui le voient voyager de Vienne à Leipzig ou de Munich à Berlin, Kertesz ressaisit le présent avec une merveilleuse qualité de présence, à jamais dédoublé cependant en face sombre.
Imre Kertesz, Un autre. Chronique d’une métamorphose. Traduit du hongrois par Natalia et Charles Zaremba. Actes Sud, 150p.
Portrait d’Imre Kertsez: Horst Tappe.
80.Platonov et le saint anonyme
À propos de La Fouille, Djann et autres romans d’une Russie élémentaire aux prises avec la fausse parole idéologique…

« Le jour du trentième anniversaire de sa vie privée, Vochtchev fut congédié de la petite entreprise de mécanique qui assurait ses moyens d’existence. Son bulletin de licenciement précisait qu’il était renvoyé pour baisse croissante de productivité et propension à la rêverie ralentissant le rythme du travail ».
Ceux qui ont lu les oeuvres déjà parues en traduction française du grand écrivain russe Andrei Platonov auront sans doute reconnu le style qui le caractérise, qu’on pourrait situer entre la transparence et l’efficacité narrative de la Légende dorée ou d’un rapport administratif.
Et ce n’est pas un paradoxe: Platonov me semble en effet rédiger, dans ses livres, une sorte d’hagiographie du Saint Anonyme -, d’un obscur vagabond, clochard céleste qu’on aurait privé de son Dieu. Il le fait dans un langage dont l’âme a été peu à peu étouffée par les directives de l’idéologie présidant à l’établissement d’un bonheur exclusivement terrestre. La nécessité a envahi le monde et tout se passe, dans cet univers, comme si la matière elle-même, à force d’être sollicitée, se trouvait soudain mécaniquement animée: le vent souffle pour que les gens puissent respirer, l’herbe pousse avec une bonne volonté d’essence prolétarienne, et les pierres elles-mêmes semblent se remuer lourdement afin de participer, à leur humble manière, à l’édification du socialisme. Le lecteur aura déjà perçu, en ces mots, l’ironie sous-jacente propre à Platonov.
Pourtant ne nous y trompons pas : Platonov n’est pas un « dissident » comme les autres. Son ironie est plus profonde que celle des contestataires politiques, se rapprochant d’une forme très singulière, et spécifiquement russe, d’humour philosophique, voire métaphysique.
Cela dit, La Fouille n’est pas un livre drôle du tout. Si j’ai parlé d’humour, c’est pour qualifier une attitude devant l’existence faite à la fois d’incrédulité fataliste et de pitié, d’accablement et de solidarité, de lucidité et de sourde révolte.
« Comment avons-nous pu en arriver là ? », semblent demander à tout instant certains de ses personnages, à quoi d’autre font écho en s’exclamant crânement: « Creusons, camarades, creusons pour que nos fils le connaissent, ce p’tit bonheur ! »
Fable symbolique, La Fouille évoque une sorte de mise en scène rêvée de quelque épisode mythique de l’histoire humaine se déroulant dans un terrain vague rappelant étrangement les déserts bibliques du peuple élu. Oui, mais. Mais cette épopée, rassemblant une poignée de gueux, se situe dans le cadre de l’Union soviétique des débuts, quelques lustres après ce qu’on appelle la « révolution industrielle », à une époque où la machine se trouve officiellement promue au rang de prothèse du corps humain, voire à celui de cerveau d’acier.

L’humanité de Platonov, à cet égard, est à la fois à peine sortie de sa caverne préhistorique et bombardée « masse responsable ». Ses préoccupations quotidiennes sont à peu près celles de l’homme de Néanderthal, et son langage d’un intellectuel petit-bourgeois qui aurait fait ses classes entres les camarades Marx et Lénine.
Sans cesse, en lisant Platonov, nous passons du plus concret à l’abstrait: l’idéologie n’est plus un discours coupé de la réalité, mais la matière même de la réalité, le référentiel absolu, le nouveau dieu, la suprême drogue – en un mot la nouvelle aliénation. Poussez le mode d’emploi du réalisme socialiste jusqu’à l’absurde et vous aurez l’art insidieux de Platonov, fondé sur le degré zéro du sens réalisant la plus pure tautologie.
La grandeur de Platonov tient, entre autres, à cela que cette leçon « philosophique » ne nous est pas servie de façon didactique mais qu’elle émane pour ainsi dire des situations figurées au cours du récit. Ses « idées », ce sont avant tout des hommes vivants dont l’écrivain partage la souffrance élémentaire.
« À présent, leurs corps déambulent comme des automates – se dit Vochtchev en les observant – ils ne perçoivent pas l’essentiel ».
Les question posées par l’auteur et ses personnages naissent tout naturellement de la narration et de ses saillies: « Voici que vient de naître en moi un doute scientifique », dit Safronov en fronçant son visage poliment conscient ». Ou, entre autres observation innombrables: »J’étais le curé, mais maintenant je me suis désolidarisé de mon âme et me suis tondu à la mode fox-trot… »
Aujourd’hui, l’on creuse la fouille qui servira à l’édification de la Maison du Prolétariat. Demain, l’on organisera un kolkhoze où tous travailleront dans le même esprit, correspondant à « La Ligne », après liquidation des koulaks qu’on aura tous réunis sur un radeau, et va comme je te pousse jusqu’à l’océan.
Mais aujourd’hui et demain, chez Platonov, c’est tout un. Car le temps semble s’être arrêté: les travailleurs dorment dans des cercueils, les petites filles s’expriment par aphorisme comme de vieilles femmes aux formules recuites, et le moujik, ce héros de l’Histoire, a pris les traits de l’ours légendaire de la tradition, effrayant plantigrade pétri de ressentiment social, dont on sait bien qu’il ne mourra jamais et dont les rugissements se perdent néanmoins dans le néant.
Telles sont, trop hâtivement évoquées, quelques-unes des composantes de ce livre saisissant, dont une vertu supplémentaire est de nous renvoyer à notre propre vide.
L’Occident n’a pas encore accouché de son Platonov (même s’il y a Beckett, en nettement plus émacié…), mais nos gueux existent cependant, et la pauvreté morale et spirituelle des riches, pas plus les slogans du Grand Magasin, n’ont rien à envier aux saints anonymes du romancier-poète de Voronej.
Andrei Platonov. La Fouille. Traduit du russe par Jacqueline de Proyart. L’Âge d’Homme, collection Classiques slaves.
Chez le même éditeur: Djann.
Chez Gallimard: La ville de Villegrad.
Chez Stock: Les Herbes folles de Tchévengour.
***
80. Au miroir du roman
À propos de Jette ton pain d’Alice Rivaz.

Très lente remémoration du vécu par l’écrit, qui fait songer à Tchekhov pour l’émotion et à Proust pour la façon d’adhérer au flux du temps au gré de longues phrases tout en méandres et en retours amont, le dernier roman d’Alice Rivaz, Jette ton pain, réserve au lecteur un véritable envoûtement, tenant à la fois à la musique du texte, parfaite sublimation d’une lancinante souffrance, et à la densité existentielle de son contenu.
« On écrit parce qu’on s’enfonce et qu’on ne peut plus aller nulle part », écrivait Tchekhov à Maxime Gorki vers la fin de sa vie. À ces mots font écho ceux que cite Alice Rivaz en exergue de la deuxième partie de Jette ton pain, tiré du journal d’Eugène Dabit : « Au fur et a mesure qu’on avance dans la vie, le chemin se rétrécit, il n’en est plus qu’un : le sien, sans qu’il soit possible d’aller à droite ou à gauche ».
Or ces deux thèmes de l’implacable resserrement d’une destinée et du recours à l’écriture pressenti comme vital, constituent précisément les deux courants de fond de l’ouvrage.
Tout le livre se donne comme un prélude aux écrits à venir de Christine Grave, qui n’accède qu’à la dernière page à la liberté de réaliser enfin son rêve lancinant, à l’accomplissement d’une sourde nécessité («car, après moisson finie, blé vanné et engrangé, vient le moment de moudre le grain, puis de pétrir et cuire son pain, quitte a jeter « ce pain sur la surface des eaux », selon la parole de la Bible si belle et si énigmatique»).
Cela étant, le présent récit se développe lui-même bien au-delà de l’expérience morcelée de la protagoniste, dans le temps « pur » de la création littéraire, à égale distance entre la trop froide objectivité et la complaisance intimiste – d’où ce mélange de netteté dans l’analyse et de flou poétique, de lucidité et de tendresse, qui est d’ailleurs le propre d’Alice Rivaz.
De la même façon, l’auteure de La paix des ruches, de Comptez vos jours ou de L’alphabet du matin, ne fait que reprendre des thèmes maintes fois traités –mais n’est-ce pas le lot de tout écrivain cherchant dans l’écriture une réponse aux quelques questions insoluble que lui pose l’existence ?
Le poids des bons sentiments
Comme la lecture de Mars de Fritz Zorn à pu nous le rappeler tout récemment, il est des apparences, dans la société propre-en-ordre que nous connaissons, dont le moins qu’on puisse dire et qu’elles sont trompeuses. À cet égard, l’une des observations les plus perspicaces de Zorn nous montre comment, à l’enseigne des bons sentiments, s’exerce parfois une insidieuse tyrannie dont certains individus feront les frais. Ainsi, dans son cas, le conformisme étroitement borné de ses parents – de riche bourgeois zurichois, notons-le pour mémoire – se présente-t-il sous les dehors de l’harmonie la plus souriante. Si l’on dit bonjour à tout le monde dans le quartier, ce n’est pas par cordialité, mais parce que de l’omettre serait mal jugé. De même se montre-t-on de temps à autre à l’église, dont on n’aurait pas l’idée de critiquer l’institution, alors qu’on ne croit pas le moins du monde en Dieu, ou encore se contente-t-on de taxer de « compliquées » toutes les choses qui risqueraient de faire réfléchir ou plus précisément de rompre la belle ordonnance de telle enclave angélique.
Pour ce qui concerne Christine Grave, il en va certes tout autrement. Contrairement à Froitz Zorn, elle a toujours senti, toujours aimé à sa façon. Même si son père, le Dr Grave, ne voit en le piano qu’un « art d’agrément », autant dire un caprice, elle a conscience de ce que représente vraiment, pour elle, la musique. Parallèlement, en dépit des recommandations de sa mère, qui la pousse à devenir l’épouse de tel jeune homme bien-sous-tous-rapports dont elle est aimée, s’obstine-t-elle, parce qu’elle ne le lui rend pas, à n’en faire qu’à sa tête et selon son cœur, quitte à en souffrir la première.
Néanmoins, c’est également par les bons sentiments – et sans doute fondés sur une véritable générosité, en tout cas sur une conception plus sincère de la charité que ce n’est le cas dans le milieu de Zorn – qu’elle se fait « piéger ». Il est vrai qu’elle y contribue notablement, à la fois par manque de caractère et parce qu’elle craint de faire de la peine à des êtres qu’elle aime. Toujours est-il que les années passent, qui ne connaissent, elles, aucune pitié. Or, que reste-t-il de ce qu’elle a vécu ? Cela ne se résume-t-il qu’aux angoisses qui l’arrachent prématurément à la paix du sommeil, une nuit après l’autre ? Et les petits carnets qu’elle tient jalousement serrés dans un coffre ne sont-ils pas que vaines est « paperasses » à liquider, comme sa mère le lui conseilla plus d’une fois ?
Lorsque commence son récit, telle nuit de décembre d’où elle peut déjà évoquer « l’autre bout de la vie », bien qu’elle n’ait guère que 56 ans, Christine Grave se trouve encore dans la situation qui aura marqué son destin, semblable à cet égard au sort d’innombrables autres femmes: la dépendance. Après s’être toujours comportée en « bonne petite » à l’égard de ses parents, même si elle a grandement déçu les espérances professionnelles que son père a placées en elle, la voici chargée de veiller jour et nuit sur sa mère, de plus en plus mal portante depuis son veuvage, et maintenant menacée de paralysie.
Quoi de plus normal, de la part de quelqu’un qui a bénéficié, en d’autres temps, maints « sacrifice », comme sa mère ne se fait pas faute de le lui rappeler ? Plus même, n’est-ce pas une sorte de privilèges, pour elle qui n’a jamais dû endosser les responsabilités d’une mère ou d’une épouse, de pouvoir ainsi se rendre utile ? Aussi bien l’éthique maternelle se réduit-elle à prôner que tout est vain qui ne vise pas à « rendre service à son prochain, à aider les plus déshérités que nous ».
Là-dessus, les méditations et les songeries de Christine ne la ramènent pas moins, irrépressiblement, à la « spirale quel parcourt inlassablement depuis qu’elle a pris conscience d’elle-même ». Dans ses carnets secrets, elle retrouve un autre aspect de sa constante dépendance, avec les motifs sans cesse repris de la présence ou de l’absence de l’homme aimé – il y en a trois qui ont compté dans son existence. En outre, tous les objets qui l’entourent sont reliés entre eux par les fils invisible de sa mémoire à elle. Aussi, en dépit de l’apparent disparate de ses sentiments, pressent-on la cohérence d’une vie intérieure dont l’écriture devrait rétablir l’unité.
« Je ne suis qu’une vieille orpheline à la recherche de trésors perdus », écrivait Alice Rivaz dans Comptez vos jouzrs. Et l’on voit ici, derechef, que cette quête s’est poursuivie sous une autre forme, le roman prenant le relais de la confession dont il module plus librement les thèmes.
Ce que sont ses « trésors perdus » ? Chacun en décidera à sa guise en assistant à la recomposition des images de cette vie, dont l’essentiel a décané dans les « vases profonds ».
Madame Grave eût-elle jamais pu comprendre que sa fille se rêve, immatérielle, comme une sorte de pure sensation voguant à la surface d’une mer paradisiaque ? Et le lointain Dr Grave, ou tel amant si peu attentif, ne se moqueraient-ils pas d’elle à l’instant de la voir se pencher sur la feuille blanche ? Comment savoir ? Chaque histoire n’a-t-elle pas diverses versions possibles; et chaque personnage ses aspects encore inaperçus ?
L’important n’est d’ailleurs pas là. De fait, comme il arrive que la seule question contienne la solution, le mouvement même du livre, sa respiration mentale et son bruissement nocturne, la souffrance qui se trouve comme exorcisée et les musiques y entremêlant leurs thèmes nous incitent à notre tour à quelque plongée au fond de nous-même. Tout cela que l’auteure suggère au reste en évoquant ce que représente les livres aux yeux de Christine, pour l’essentiel : « Ce qu’il lui reste après une lecture, c’est une saveur, une odeur, des couleurs, des images, des êtres, une sorte d’aura, ou encore un sentiment d’horreur ou de beauté, ou de pitié, ou tout cela à la fois, un grand désir de créer à son tour un univers. Un amour renouvelé des autres, le ravissement et l’angoisse d’être envie, la révélation de ce qu’elle est, mais aussi de ce qu’elle pourrait être»…
Alice Rivaz. Jette ton pain, Gallimard, collection blanche, 1979.
(JLK, La Liberté, 18 janvier 1980)